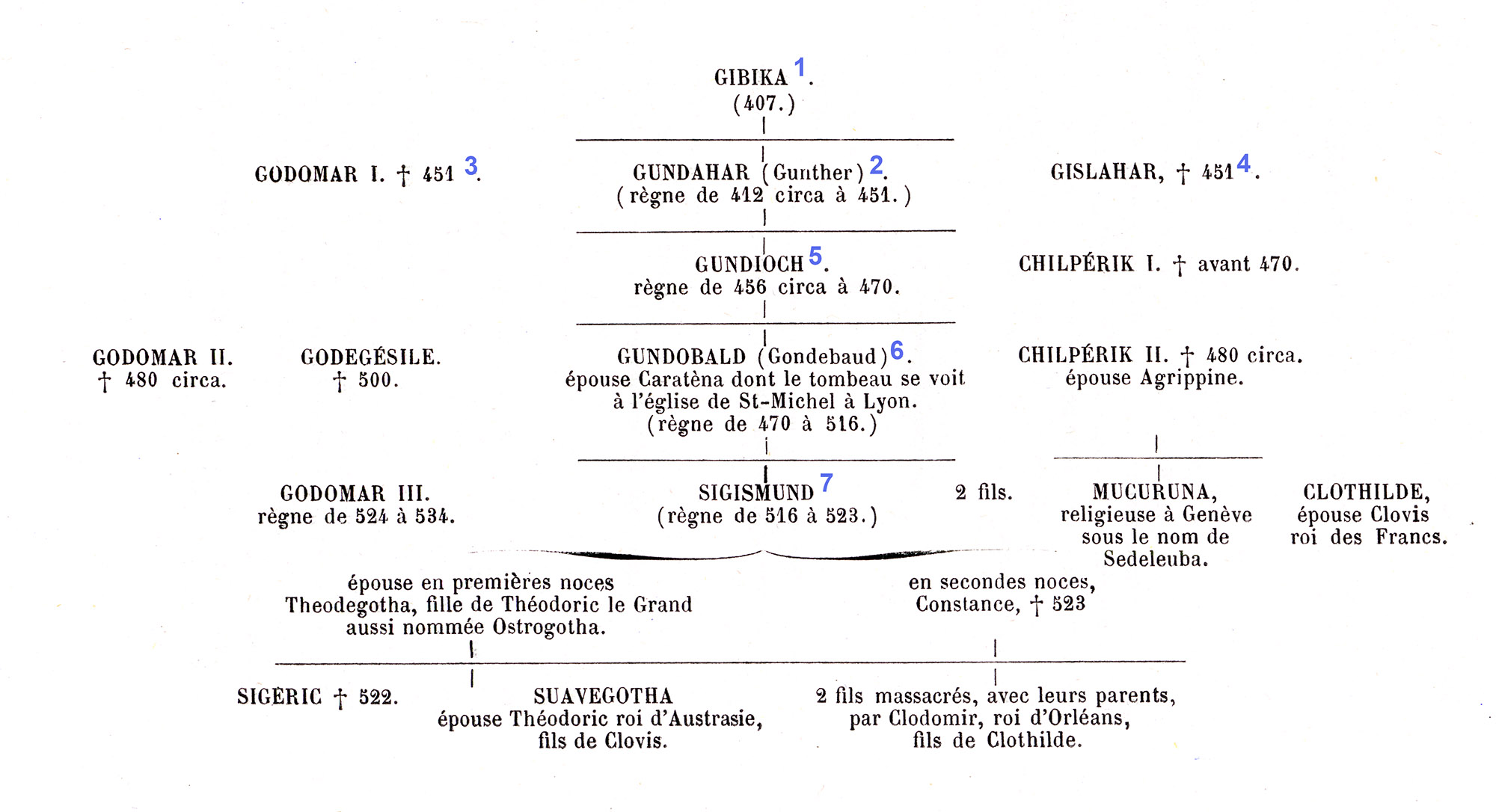MÉLANGES
LAUSANNE
GEORGES BRIDEL ÉDITEUR 1868
/2/
FRAGMENTS D’HISTOIRE NATIONALE
LE PREMIER ROYAUME DE BOURGOGNE
par
ÉDOUARD SÉCRETAN
Professeur de droit.
/3/
AVANT-PROPOS
Ce morceau fait suite à une précédente publication sur la tradition des Niebelungen, son origine et sa valeur historique 1 ; il forme, en même temps, le début d’un essai d’histoire des institutions politiques et juridiques de l’Helvétie romane, auquel l’auteur travaille. L’histoire du droit ne peut se passer d’une partie extérieure et proprement historique, à laquelle ce fragment appartient. Je ne le recommanderai point aux lecteurs, comme devant apporter sur les problèmes de l’époque assez obscure qu’il embrasse, des lumières particulièrement nouvelles. Entre les diverses hypothèses que les historiens précédents présentent, j’ai cherché à choisir ce qui me semblait vraisemblable. En fait de travaux spéciaux sur le sujet traité, j’ai pu utiliser /4/ un manuscrit de notre regrettable et savant compatriote M. de Gingins, qui formait le commencement d’une histoire du peuple Burgonde 1 ; il aurait été l’antécédent de son mémoire sur l’établissement des Burgondes dans notre patrie 2 . J’ai souvent utilisé l’Histoire de Burgondes, publiée récemment par M. Hermann Derichsweiler 3 ; car, sur les règnes de Gondebaud et de Sigismond, entr’autres, cet écrivain a su recueillir quelques sources ecclésiastiques peu connues de ses devanciers. — J’ai cherché aussi à tirer parti de la tradition poétique plus qu’on ne l’a fait jusqu’ici.
/5/
LE PREMIER ROYAUME DE BOURGOGNE
§ 1.
Les Burgondes avant leur établissement définitif.
Le peuple qui donna son nom au premier royaume de Bourgogne me paraît avoir appartenu, comme les Vandales, les Gépides, les Rugiens, les Hérules, et quelques autres tribus, à la branche gothique 1 . Le tronc de l’arbre germanique se divisant en quatre principales branches: les Teutons, les Suèves, les Goths et les Scandinaves. Lorsque l’histoire mentionne les Burgondes pour la première fois, ce peuple habitait les plaines situées /6/ entre l’Oder et la Vistule. Les Vandales, leurs voisins, occupaient le sud de cette région et touchaient aux Marcomans de Bohême et de Moravie. Les Gothones occupaient, selon Pline, les bords de la Baltique où ils recueillaient l’ambre jaune. Les Burgondes, placés entre deux, se trouvaient donc dans le duché de Posen et sur les bords de la Wartha.
Zozime parle d’une guerre que l’empereur Probus fit en 277 contre les Vandales et les Burgondes. Le nom de l’île de Bornholm, autrefois Borgunda-holm, et celui de l’île de Rügen, Borgunda-land, ont fait croire que les Burgondes venaient de la presqu’île Scandinave, mais la position de ces îles ferait plutôt penser que leurs habitants sont venus de la côte méridionale.
De fond essentiellement germanique, ces peuples du nord-est de la Germanie s’étaient mélangés plus ou moins avec les tribus wendes ou slaves dont ils se trouvaient entourés.
Le nom des Burgondes a beaucoup occupé. Bien qu’appuyée du témoignage d’Orose, l’étymologie tirée de Burg, château, est évidemment fausse, car les Burgondes portaient le nom sous lequel ils nous sont connus longtemps avant d’arriver dans le voisinage du Rhin, et d’y occuper les forts dont on voudrait tirer ce nom. Le gothique Burja, incola, civis, dont l’allemand a fait Bauer et Bürger, joint à Chunda, Gunda, bellicosus, nous fournit une étymologie plus naturelle, et surtout beaucoup plus germanique 1 . /7/
Du IIIe au IVe siècle de notre ère, les Burgondes viennent, par successives étapes, des plaines de la Pologne jusqu’aux rives du Rhin. Dans la première moitié du IVe siècle, ils se trouvaient déjà voisins des Alamans; en 359, Julien ayant poursuivi ces derniers au delà du Necker, parvint à une ancienne redoute romaine qui servait de limite entre les deux nations. En 373, Valentinien Ier chercha à nouer une alliance avec les Burgondes contre les Alamans. Ceux-ci descendirent alors vers le Rhin au nombre de 80 000. L’empereur, effrayé peut-être d’une force si considérable, les laissa seuls aux prises avec leurs ennemis; profondément irrités, les Burgondes se retirèrent, mais en se promettant de tirer vengeance de ce manque de foi.
Au commencement du Ve siècle, le monde barbare s’ébranle de toutes parts. La pression des Huns, déjà arrivés aux confins de l’Europe, se faisait-elle sentir de proche en proche? On l’a dit; je croirais plutôt que la tendance, longtemps comprimée des nations germaines à franchir le Rhin pour se jeter sur la Gaule, fait explosion en ce moment parce que la résistance de l’Empire faiblit, parce que ce colosse, miné depuis longtemps par ses vices intérieurs, commence à se désorganiser tout de bon. Quoi qu’il en soit, l’heure fatale a sonné pour les maîtres du monde, et la barbarie déborde.
En 406, Radagaise, à la tête d’une coalition de Germains méridionaux et de tribus gothiques et slaves, se jette sur l’Italie, où ses hordes farouches sont taillées en pièces, près de Florence, par le patrice Stilicon.
En 407, les Burgondes, unis aux Vandales et aux Alains, venus des frontières d’Asie, passent le Rhin près /8/ de Mayence et pillent les Gaules de concert. Poursuivant leur route droit devant eux, les Vandales allèrent en Espagne; une partie des Alains demeura dans la Gaule centrale; quant aux Burgondes, ils s’établirent dans le pays où ils étaient entrés en premier lieu, dans la province gauloise que les Romains nommaient première Germanie 1 , et qui forme aujourd’hui la Bavière rhénane.
Le chef qui les commandait dans ce temps-là était Gibika; les historiens ne le nomment pas, mais il nous est connu par la tradition poétique et par la loi Gombette 2 .
Gundahar, le Gunther du chant des Niebelungen, succéda bientôt à son père Gibika, car c’est lui qui proclamait à Mayence, en 412, l’usurpateur Jovinus, de concert avec un chef alain appelé Goaric 3 . Un peu auparavant un autre usurpateur gaulois, du nom de Constantin, avait traité avec les Burgondes et leur avait concédé les terres qu’ils désiraient et dont ils s’étaient emparés préliminairement.
En 410, le roi des Wisigoths, Alaric, débarrassé par la mort de Stilicon du seul capitaine romain capable de lutter contre lui, s’était rendu maître de Rome. Son successeur Ataulphe passa déjà l’année suivante (411) dans /9/ la Gaule méridionale. Le comte Constance, gouverneur des Gaules pour Honorius, dut le laisser s’établir à son gré dans ces belles provinces; mais il profita de l’arrivée d’Ataulphe pour débarrasser son maître de la rivalité de Constantin; puis quand Jovinus eut été proclamé, il parvint aussi à déterminer Ataulphe à se décider contre lui. Le Wisigoth, qui avait promis son concours à Jovinus, changea de politique tout à coup (412), fit Jovinus prisonnier et le livra au lieutenant d’Honorius. Constance, obéissant aux mêmes nécessités politiques qui lui avaient fait abandonner l’Aquitaine aux Wisigoths, confirma les concessions de Constantin et de Jovinus en faveur des Burgondes (413).
Les cantonnements de ceux-ci sur la rive gauche du Rhin, allaient, semble-t-il, de Mayence à Strasbourg, ils avaient pour capitale Worms 1 . La rive, de Strasbourg à Bâle, était dans le même temps occupée par les Alamans.
La conversion des Burgondes au christianisme eut lieu dans les premiers temps de leur séjour sur le territoire romain. « Alors, dit Orose, on vit ces hommes, jusqu’alors farouches et cruels, devenir doux et humains, traitant les indigènes non plus en ennemis vaincus, mais en frères. » Comme les Goths, les Burgondes étaient ariens.
Le passage d’Orose nous renseigne aussi touchant la position nouvelle des Burgondes. Par leur traité avec le gouvernement d’Honorius, ils reconnurent, sans doute, la supériorité nominale de l’Empire, mais, dans le fait, ils devinrent les maîtres du pays occupé par eux. Domini rerum, comme dirent plus tard les Romains. Ainsi, /10/ quoiqu’ils fussent établis dans les colonies militaires de l’empire en qualité d’auxiliaires, la condition des Burgondes rhénans ne fut point la même que celle d’autres tribus, moins nombreuses, arrivées à d’autres époques et comprises sous la même dénomination. Les Burgondes se gouvernaient d’une manière indépendante et continuèrent à communiquer librement avec les tribus de leur nation qui étaient demeurées sur la rive droite du Rhin, dans les vallées du Mein et du Necker.
Au commencement du Ve siècle, tandis qu’Ataulphe fondait le royaume Wisigoth dans la Gaule méridionale et que les Francs saliens s’avançaient en Belgique jusqu’aux limites de la Gaule septentrionale, les Burgondes rhénans se bornèrent quelque temps à défendre leurs nouveaux territoires contre les remuants voisins de même race qu’ils avaient au nord et au sud 1 . Aussi les annalistes de ce temps ne nous parlent-ils guère d’eux 2 .
Cependant, tout à l’orient de l’Europe et aux frontières de l’Asie, il se passait des événements qui allaient bientôt toucher de près les sujets du Kindin Gundahar. Sur la fin du IVe siècle, les Huns, peuples mélangés de Finnois et de Caucasiens 3 , apparaissaient en Europe pour la /11/ première fois, sous la conduite de leur roi Balamir. Hermanaric réunissait alors sous sa domination les principaux rameaux de la branche gothique, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Gépides et les Roxolans; il régnait de la mer Noire à la Bohême, sur la rive gauche du Danube. Ce prince déjà très âgé mourut au début de la guerre. Ses successeurs ne purent résister au redoutable choc. Les Ostrogoths et les Gépides se soumirent aux Huns, les Wisigoths se réfugièrent sur les terres de l’empire d’Orient, défirent et tuèrent Valens dans la bataille d’Andrinople et entreprirent dès lors à travers la Thrace, la Grèce et l’Italie, ce long et sanglant pèlerinage qui les avait amenés en Aquitaine en 411, d’où ils passèrent enfin en Espagne, et y fondèrent un état.
Vers l’année 430, les escadrons rapides des Huns pénétraient déjà jusqu’au cœur de la Germanie et l’empire goth était entièrement soumis. Les Huns reconnaissaient pour chefs quatre frères: Rugilas, Uptar, Œbarse et Mundzuk; c’est à ce moment que leurs rapports avec les Burgondes commencent.
Socrate le scolastique raconte 1 que ceux-ci, attaqués par les Huns et n’espérant plus dans les secours humains, demandèrent le baptême à un évêque gaulois leur voisin. Alors, forts de la confiance que leur inspirait leur nouvelle foi, ils allèrent au-devant des Huns, les surprirent au moment où leur roi Uptar venait d’expirer ensuite d’un excès de table, et les défirent entièrement. Cette victoire est incontestablement postérieure à la conversion des Burgondes rhénans, car Uptar mourut en 433, et Orose, /12/ qui mentionne cette conversion dans ses écrits, était mort en 416. Ces deux récits peuvent toutefois se concilier. Les Burgondes de Worms n’étaient que la tête de colonne d’un peuple nombreux qui occupait tout le bassin du Mein et s’avançait à l’est jusqu’aux montagnes de Bohême. Or, c’est nécessairement sur leur frontière orientale que les Huns les auront attaqués. Vaincus d’abord, et effrayés par l’aspect étrange, la tactique militaire nouvelle de leurs adversaires, les Burgondes d’Allemagne, encore païens, invoquèrent le secours des Rhénans, convertis depuis peu. Puis, à l’exemple de leurs frères, ils embrassèrent la religion du Christ avant de livrer le combat dans lequel on les voit victorieux.
Bientôt après, les Burgondes, encouragés par l’exemple des Francs, cherchèrent à étendre les limites assez circonscrites de leurs établissements sur la rive gauche du Rhin. Pour cela ils entrèrent en Lorraine.
Le gouvernement de la Gaule était alors dans les mains d’un grand capitaine, d’un homme que l’histoire, à juste titre, a nommé le dernier des généraux romains. Sa disgrâce momentanée avait seule permis les récents progrès des barbares. Mais il faut reprendre ces faits d’un peu plus haut.
Depuis quelque temps tout était en fermentation dans cette partie de l’empire. Clodion, chef des Saliens, s’était emparé de Tournay: les Ripuaires, après avoir pillé et détruit Trêves, s’étaient établis sur les bords de la Meuse.
En 425, Théodoric, roi des Wisigoths, venait de pousser sa domination jusqu’à l’Océan, et avait mis le siége devant Arles, alors capitale des Gaules. Une formidable /13/ insurrection des Bagaudes se répandait sur les provinces centrales, en particulier sur l’Auvergne, la Viennoise et la Lyonnaise; les Bretons d’Armorique aussi se déclaraient indépendants. (427.)
Aëtius arriva d’Italie juste au moment où Arles allait tomber au pouvoir des Wisigoths; il les contraignit à en lever le siége; quelques années après, une grande bataille fut de nouveau gagnée par lui dans les environs d’Arles; Anulphe, général des Wisigoths, y fut fait prisonnier. (430.) Les Bagaudes, les Armoricains et les Francs, attaqués successivement. (428), furent également malheureux dans leurs efforts pour lutter contre l’habileté supérieure du gouverneur romain.
Aëtius avait pour rival en gloire et en mérite le comte Boniface, gouverneur d’Afrique. On l’accusa d’avoir cherché à perdre ce rival dans l’esprit de l’impératrice Placidie, qui régissait l’empire comme mère et tutrice de Valentinien III; Boniface fut rappelé. Genseric, roi des Vandales, qui régnait en Andalousie, profita d’une occurrence si favorable pour s’emparer de toute la province d’Afrique. (429.) Boniface, revenu en Italie, rentra cependant en faveur et Aëtius fut privé de son gouvernement; il ne put supporter cet affront et recourut aux armes; à la tête des légions des Gaules, il entre en Italie; les plaines de la Ligurie deviennent le théâtre d’une sanglante bataille entre les deux derniers généraux et les deux dernières armées de Rome. Aëtius vaincu chercha un refuge en Franconie, auprès du roi des Huns Rugilas. (432.) Boniface mourut peu de temps après des blessures qu’il avait reçues. Placidie, qui ne pouvait se passer à la fois de /14/ Boniface et d’Aëtius, rappela ce dernier, lui pardonna sa révolte et lui rendit son commandement dans les Gaules. (434.) Lorsqu’il put y retourner, les Burgondes, avaient envahi la contrée de Toul et de Metz. (435.) Aëtius les battit, mais pas assez complètement pour terminer la guerre. L’année suivante ses succès furent plus décisifs. Les Burgondes, vaincus, durent demander la paix et rentrer dans leurs cantonnements.
Dom Bouquet, d’après un passage de Sidoine Appolinaire, indique une première expédition d’Aëtius contre les Burgondes en 428; mais Sidoine ne donne aucune date, il n’est pas impossible qu’en 428 les Burgondes se fussent unis aux Francs leurs voisins, mais il est plus probable encore que le passage de Sidoine se rapporte aux campagnes de 435 et de 436.
Les données des divers chroniqueurs touchant ces derniers événements sont si vagues qu’elles ont prêté de la part des historiens postérieurs à des interprétations eronées, parmi lesquelles il n’est point facile de se débrouiller.
Cassidiore, qui mentionne les deux campagnes comme une seule, ajoute que Gundahar, roi des Burgondes, ne jouit pas longtemps de la paix que lui accorda Aëtius et qu’il succomba quelque temps après sous les armes des Huns: « Theodorius XV et Valentinianus IV (cette indication des consulats se rapporte à 435) Gondicharium Burgundionum regem Aetius bello subegit; quem non multo post Huni peremerunt. » Prosper d’Aquitaine reproduit ce texte à peu près textuellement 1 . Idace place la guerre /15/ des Burgondes en 436. « Bnrgundiones qui rebelleverant a Romanis duce Aetio debellantur. » Idace qualifie ici l’irruption burgonde comme une révolte, attendu qu’aux yeux des Romains, ils étaient des lètes qui avaient reconnu la suprématie impériale. Par une méprise singulière, on a inféré de l’observation de Cassiodore sur le sort postérieur du roi des Burgondes, que dans la guerre même de 436, Gundahar est tombé sous les coups des Huns. Rien de plus opposé au texte; Cassiodore explique que la paix fut conclue entre Aëtius et Gundahar, mais que Gundahar n’en jouit pas longtemps. C’est Prosper Tyro, chroniqueur moins sûr et plus récent, qui a donné lieu à cette erreur grossière en écrivant, à la date de 436: « Bellum contra Burgundionum gentem memorabile exarsit, quo, universa pene gens cum rege Peretio deleta. » Littéralement: « Une guerre mémorable s’alluma en 436 contre la nation burgonde; elle fut détruite presqu’en totalité avec son roi Peretius. » Comme on ne connait pas ce roi Peretius, Sigebert de Gembloux, chroniqueur plus éloigné encore de l’époque des événements, reproduisit le passage de Prosper Tyro, en le portant, on ne sait pourquoi, à la date de 441, et en substituant aux mots cum rege Peretio, ceux-ci: cum rege per Aëtio.
C’était plus compréhensible, mais cette correction produisit la croyance à un fait manifestement faux, savoir que le roi Gundahar succomba dans la bataille perdue contre Aëtius dans l’année 436.
Cette première erreur a engendré les autres. Ce qu’il y avait d’un peu indéterminé dans les expressions de Cassiodore touchant la mort de Gundahar (non multo post), conduisit à imaginer qu’une guerre des Huns et des /16/ Burgondes avait suivi immédiatement la défaite des Burgondes par Aëtius. Pour justifier cette guerre supposée, on inventa une première expédition d’Attila dans les Gaules de quatorze à quinze ans antérieure à sa fameuse invasion de 451.
L’absence de tout renseignement historique touchant cette expédition d’Attila dans les Gaules en 436 ou 437, en aurait pourtant fait abandonner l’idée, mais l’étude des traditions poétiques germaines est venue depuis peu la remettre en faveur. D’un côté, le poëme des Niebelungen nous apprend que Gundahar est tombé en effet sous les coups des guerriers d’Attila; d’un autre côté, le poëme latin de Walther d’Aquitaine raconte une expédition d’Attila dans les Gaules dont les détails ne se rapportent point à celle de l’histoire. En combinant ces deux traditions, qu’on envisagea comme basées toutes deux sur des faits réels, on conclut qu’Attila fit en effet deux expéditions dans les Gaules, et que, dans la première, Gundahar avait trouvé la mort.
Fischer, le premier éditeur de Walther d’Aquitaine, se plaça dès l’entrée à ce point de vue 1 . M. Roger de Belloguet a plus récemment cherché à construire les commencements de l’histoire du peuple burgonde en partant de la même donnée 2 . Waitz suit les mêmes errements 3 . En dernier lieu, M. Derichsweiler a reproduit ce système en s’efforçant de l’appuyer sur des indications contemporaines. Selon cet écrivain, Gundahar fut tué par /17/ les Huns déjà en 436 sur la rive gauche du Rhin, mais l’entrée d’Attila dans les Gaules a suivi immédiatement. Seulement, selon M. Derichsweiler, l’adversaire qu’Attila allait chercher en Gaule n’était pas les Romains, mais les Wisigoths, et dans la guerre qu’il aurait faite en 437, il avait pour allié le général romain.
Cette hypothèse nouvelle ne me semble nullement fondée, et les sources citées à l’appui ont un tout autre sens que celui que l’auteur leur donne.
Nous avons vu qu’Aëtius s’était réfugié après sa révolte chez Rugilas; quand il rentra en grâce auprès de Placidie, il amena avec lui un corps nombreux d’auxiliaires huns qui combattirent sous ses ordres pendant plusieurs années, soit contre les Burgondes en 435 et 436, soit ensuite contre les Wisigoths. C’est à ce corps d’auxiliaires, ou mieux à ces mercenaires huns d’Aëtius que se rapportent les passages divers dont on a voulu étayer le système sur l’expédition d’Attila dans les Gaules en l’année 437 1 .
Que voyons-nous en effet dans ces passages? Tandis que le Wisigoth Théodoric assiégeait Narbonne, déjà pressée par la famine, Aëtius parvint à la ravitailler, et Litorius son lieutenant, aidé par les Huns (Hunnis auxiliantibus), mit en fuite les Wisigoths. Mais après ces avantages, il engagea une seconde bataille imprudemment, perdit son armée et fut tué lui-même. Tel est le récit d’Isidore. /18/
Prosper d’Aquitaine, parlant des mêmes faits, distingue mieux les dates. En 437, dit-il, Aëtius fait la guerre aux Goths, ayant avec lui des auxiliaires huns. « Bellum adversus Gothos, Chunnis auxiliaribus, geritur; » en 438 il remporte sur eux quelques succès; « adversus Gothos in Gallia quædam prospere gesta. » En 439, Litorius qui, sous l’autorité du patrice Aëtius, commandait les auxiliaires huns, « Chunnis auxiliaribus præerat » étant désireux de surpasser la gloire de son général, et se fiant aux réponses des Aruspices, engage la bataille imprudemment; il est vaincu et tué. Cassiodore dit simplement qu’en 439 la guerre fut soutenue à l’aide d’auxiliaires huns, et que le général romain Litorius fut fait prisonnier par les Goths 1 .
Depuis la défaite de Litorius, les auxiliaires huns ne sont plus mentionnés dans les guerres des Gaules. Ce corps de mercenaires huns n’a, comme on voit, aucun rapport avec une expédition d’Attila; son chef était Litorius et non point Attila.
Du reste, la présence d’Attila dans les Gaules était impossible entre 436 et 439.
Lorsque commença la guerre des Burgondes avec les Romains, Attila venait de succéder à Rugilas, son oncle; pour lors, il se trouvait chargé d’un commandement aux frontières d’Asie. En 435, il reçut, avec son frère Bléda, à Margus, sur le Bas Danube, une ambassade de Théodose II, empereur d’Orient, et conclut un traité avec lui. Dès lors il fut pendant plusieurs années occupé dans les /19/ régions orientales de son empire; il soumit les Acatzires, peuples nomades de la plaine du Don; puis il eut à combattre les tribus qui voulaient venger l’assassinat, qui lui fut imputé, de son frère Bléda. C’est en 441 seulement, qu’assuré de la fidélité de ses propres sujets, il tourna son activité, non pas sur l’Occident, mais sur l’empire d’Orient, dont à diverses reprises il ravagea les provinces septentrionales. Cette guerre dura jusqu’en 446. En 448 se place l’ambassade dont le grec Priscus nous a laissé l’intéressant récit; elle trouve encore Attila dans sa capitale de bois au milieu des plaines de Hongrie. Il est évident, d’après tout cela, que la prétendue première expédition d’Attila dans les Gaules est une assertion qui ne mérite aucun crédit 1 .
D’autre part, il est vraisemblable que les auxiliaires huns d’Aëtius ont été l’une des causes des confusions déplorables qui ont tellement obscurci l’histoire des Burgondes. Ces cavaliers d’aspect farouche, barbares parmi les barbares, laissèrent dans l’imagination des peuples des souvenirs qui se mêlèrent plus tard avec l’impression plus puissante encore de la grande invasion de 451.
Sigebert, le dernier des chroniqueurs cités, sachant que Gundahar était mort dans un combat contre les Huns, et qu’il avait été vaincu par Aëtius, confondit ces faits en un seul, et corrigea Prosper Tyro, dans ce sens, en disant que Gundahar avait été tué dans la bataille qu’il perdit contre Aëtius. Plus tard, ceux qui savaient que Gundahar était tombé sous les coups des Huns, ont confondu à leur /20/ tour l’affaire où périt Gundahar et la bataille qu’il perdit contre Aëtius. Walther d’Aquitaine aidant, on avait alors tout ce qu’il fallait pour donner naissance à l’hypothèse de l’expédition d’Attila dans les Gaules en 436 et de son alliance avec Aëtius.
C’est la date de 443 que l’on assigne généralement à l’établissement des Burgondes dans l’Helvétie romane et les contrées environnantes, et par conséquent à la fondation du premier royaume de Bourgogne. On a suivi en cela l’indication fournie par Prosper Tyro, lequel place l’occupation de la Sabaudia (la Savoie) dans la vingtième année du règne de Théodose 1 .
On a préféré, à tort ce me semble, cette indication à celle de Marius, évêque d’Avenches, qui était en mesure d’être mieux informé, puisqu’il était sur les lieux mêmes où le premier royaume de Bourgogne avait été fondé. Ce chroniqueur, plus exact d’ailleurs que Prosper Tyro, dont nous avons pu déjà constater une grave erreur, mettait l’établissement des Burgondes dans notre pays immédiatement après la guerre que Gundioch et Chilpéric, successeurs de Gundahar, firent en Espagne, de concert avec Théodoric, roi des Wisigoths, en 456. Après avoir parlé de la chute d’Avitus, qui fut empereur pendant quelques mois seulement après la déposition de Maxime, meurtrier de Valentinien III (455), et raconté la mort de ce prince, ami des Wisigoths et des Burgondes, survenue dans le temps où ceux-ci revenaient d’Espagne, Marius ajoute: Cette année-là, les Burgondes occupèrent une /21/ partie de la Gaule, et en partagèrent les terres avec les sénateurs romains 1 .
M. de Gingins est le seul, que je sache, qui ait donné la date de 456 comme celle de l’établissement définitif, et déclaré hautement sa préférence pour l’indication que nous a laissée Marius. Il l’a fait, soit dans son mémoire sur l’établissement des Burgondes, publié en 1837, soit dans le travail demeuré manuscrit qu’il avait entrepris sur l’histoire de ce peuple avant son établissement définitif.
De tous les auteurs, d’ailleurs très recommandables, qui sont venus après notre savant compatriote, aucun n’a tenu compte de cette opinion, qu’il avait cependant assez fortement établie, aucun n’a même essayé de la réfuter. Gaupp 2 place l’établissement des Burgondes en Savoie et en Helvétie en 443. Le baron Roger de Belloguet 3 a suivi les mêmes errements. Il faut en dire autant de Matile 4 , de Waitz 5 , de Derichsweiler 6 , de Wietersheim 7 , etc.
Je donnerai plus tard les motifs qui m’engagent à suivre dans cette question l’opinion de M. de Gingins; je pourrai le faire plus clairement et plus brièvement lorsque j’aurai exposé les faits concernant l’histoire des Burgondes qui remplissent cette période de treize ans sur laquelle on est en désaccord.
J’observerai toutefois qu’un établissement en Savoie /22/ d’une partie des Burgondes rhénans ne me paraît pas impossible. Ce que je conteste seulement, c’est l’abandon des parages du Rhin mitoyen par la nation burgonde en 443. Leur histoire démontre, selon moi, d’une manière sûre, que la masse de leur nation se trouvait encore dans les environs de Worms et de Mayence en 451, lors de l’invasion d’Attila dans les Gaules.
Les Burgondes affluaient dans la Gaule, car le gros de la nation, établi sur la rive droite, était sans doute déjà pressé à l’orient par les tribus dépendantes du vaste empire fondé par Attila sur les débris de celui sur lequel régnait Hermanaric. Cette circonstance qui les avait engagés à pénétrer dans la Lorraine en 436, peut fort bien s’être reproduite en 443. Il est possible donc qu’une fraction des Burgondes ait été bien aise d’obtenir dans les terres de l’Empire quelques nouveaux campements et qu’Aëtius leur ait fait cette concession. Peut-être n’était-il pas fâché de placer des sentinelles vigilantes auprès des Wisigoths dont l’expansion était alors tout particulièrement redoutable. C’est dans ce sens qu’on pourrait concilier le témoignage de Tyro avec celui de Marius.
Ce chroniqueur, qui croyait les Burgondes en grande partie détruits après la victoire remportée sur eux par Aëtius en 436, a parlé des débris de leur peuple; « Burgundionum reliquiis » mais, à cet égard, il était fort mal informé; car de 436 à 456 les Burgondes livrèrent encore plusieurs grandes batailles, dans quelques-unes desquelles ils firent sûrement de plus grandes pertes que dans la bataille de 436; et pourtant c’est justement depuis 456 que cette nation prend le plus d’importance, joue quelque temps un rôle considérable dans la politique de /23/ l’Occident et fonde un royaume qui s’étendait du Rhin jusqu’à la Méditerranée.
Je reprends maintenant la suite des événements: En 480 seulement, après avoir fait expier à Théodose II sa participation à un projet d’assassinat par un humiliant traité, Attila commença à tourner ses regards vers l’Empire d’Occident. J’ai exposé dans un autre travail 1 les détails de sa fameuse campagne dans les Gaules; je ne reviendrai sur ce récit que pour en résumer les principaux moments et pour faire ressortir le rôle glorieux, et pourtant bien peu connu aujourd’hui, qui échut aux Burgondes dans cette crise, formidable entre toutes, durant cette période de guerres, d’invasions et de bouleversements.
Après avoir combiné son entreprise en diplomate astucieux aussi bien qu’en grand capitaine, après s’être créé des alliés contre ceux qu’il se propose d’attaquer, et avoir semé habilement la défiance parmi ceux dont il avait à redouter l’accord, en annonçant à la cour de Ravenne que son but est seulement de châtier les Wisigoths qui se sont soustraits à sa domination, et en promettant aux Wisigoths de partager avec eux la Gaule, dont il veut chasser les Romains, Attila concentra sur les bords du Danube les contingents de toutes les nations barbares soumises à sa domination, puis vint prendre ses quartiers d’hiver sur les confins de la forêt hercynienne, dans les vallées du Necker et du Mein (450).
Au premier printemps de l’année 451 il passa le Rhin sur un pont de bateaux, dans les environs de Mayence. /24/
Cecidit cito secta bipenni
Hercynia in lintres et Rhenum texuit alvo 1 .
Alors, doit avoir eu lieu cette sanglante bataille entre les Huns et les Burgondes dont Paul Diacre a parlé dans deux ouvrages différents et que les historiens modernes ont passée néanmoins presque tous sous silence 2 .
Jean de Muller, Lebeau et Marcow (Histoire des Germains) ont seuls, avant M. Amédée Thierry, tenu compte du renseignement de Paul Diacre; tous les autres, persuadés par Tyro du fait que les Burgondes n’étaient plus sur les bords du Rhin en 451, négligent absolument cette information d’une haute importance.
Paul Diacre avait tous les moyens d’être bien informé; dans l’Histoire des évêques de Metz, il a résumé les traditions locales des pays dévastés par les Huns; dans son Histoire des Lombards, il avait recueilli les traditions des Germains attachés au parti d’Attila. Je dirai même qu’aucun chroniqueur latin de cette époque n’a possédé sur les barbares des connaissances aussi exactes et aussi étendues, excepté peut-être Jornandès. /25/
Muller n’entre, au sujet de la bataille mentionnée par Paul Diacre, dans aucune explication; il se borne à noter le fait, mais Lebeau et Tourneux d’après lui 1 , préoccupés, comme tout le monde, de l’idée que les Burgondes étaient déjà établis définitivement dans les hauts plateaux du Jura méridional et des Alpes occidentales, supposent qu’Attila avait passé le Rhin à Bâle, pour descendre de là jusqu’à Trêves et retourner ensuite au nord-ouest dans la direction d’Orléans. Ce circuit inutile est plus qu’invraisemblable; il est en opposition avec Sidoine Appolinaire 2 et avec Paul Diacre, qui, dans l’Histoire des évêques de Metz, place la prise des villes du Rhin, par Attila, immédiatement après la victoire qu’il remporta sur Gundahar.
M. Amédée Thierry a cherché à concilier l’idée d’une bataille livrée aux Burgondes, près de Bâle, avec le passage du Rhin à Mayence, que les sources imposent; il pense qu’une partie de l’armée d’invasion s’était dirigée sur Bâle, tandis que l’armée principale, commandée par Attila en personne, passait le Rhin à Mayence, puis s’emparait de Trêves, de Worms, de Spire et de Metz.
Cette supposition aurait toujours contre elle le récit de Paul Diacre. Car, selon cet auteur, ce fut bien Attila en personne qui, au moment d’entrer dans les Gaules, défit Gundahar, et passa sur le corps des Burgondes; du reste, elle n’est plus nécessaire du moment qu’on considère Gundahar comme étant à Worms en 451. /26/
Gaupp a cru, en revanche, que la rencontre rapportée par Paul Diacre n’était autre que la bataille de Châlons. Or le texte repousse encore plus absolument une telle interprétation; il nous parle du premier combat important de cette mémorable campagne, et la bataille de Châlons en est, au contraire, le dernier: il parle d’une rencontre où Attila a le dessus, et non d’une bataille à la suite de laquelle il dut évacuer les Gaules et repasser le Rhin.
Mais, si l’on y regarde bien, Paul Diacre n’est point le seul témoin à invoquer au sujet de la bataille des Huns et des Burgondes; Cassiodore et Prosper d’Aquitaine y font tous deux allusion lorsqu’ils racontent que Gundahar ne jouit pas longtemps de la paix qu’il avait faite avec Aëtius, car il succomba quelque temps après sous les coups des Huns, lui, son peuple et sa race.
Des traditions germaines, répandues principalement parmi les ennemis du nom romain, conservèrent aussi le souvenir de la catastrophe dans laquelle périt Gundahar avec ses deux frères et la fleur de ses compagnons. Le retentissement causé par cet événement doit avoir été grand dans le monde barbare. L’auteur des Niebelungen, qui se taît tout à fait sur la bataille de Châlons, fait du combat de Gundahar avec les guerriers d’Attila, le dénouement de sa remarquable épopée, et deux des poèmes de l’Edda Scandinave, l’Atlamal et l’Atlaquida, l’ont raconté également, il est vrai sous des traits et avec des circonstances fictives qui permettent de ne pas le reconnaître, si on y tient absolument.
Mais quand un tel événement ne nous aurait pas été raconté dans des sources diverses, dès que les Burgondes étaient encore dans le pays de Worms en 451, je dirai /27/ presque qu’il devait nécessairement arriver. La présence d’Attila à Mayence obligeait les Burgondes à prendre parti. Nous savons qu’ils furent alliés des Romains dans la suite de la guerre; donc ils le furent aussi dès le début; donc ils durent livrer combat aux ennemis qui envahissaient leurs établissements.
Notons encore ici une circonstance curieuse: les Niebelungen et l’Edda donnent à Gundahar deux frères qui combattent et meurent avec lui, ce sont Gundomar et Gislahar; tous trois sont fils de Gibika. Eh bien, dans la loi Gombette (tit. III), Gondebaud, petit fils de Gundahar, nomme aussi ses prédécesseurs Gibika, Gundahar, Gundomar et Gislahar 1 , et le texte qui contient cette indication a été rédigé un demi-siècle au plus après la bataille dans laquelle l’aïeul de Gondebaud et ses oncles avaient trouvé la mort! Une coïncidence pareille a une force probative sur laquelle il nous semble bien inutile d’insister.
D’après la nature des choses, on serait porté à penser que le choc des Burgondes et des Huns eut lieu au passage du Rhin, et dès lors, sur la rive gauche. Si l’on veut se rattacher aux traditions germaines, on le placera plutôt sur la rive droite. L’un des textes de Paul Diacre ne serait /28/ certainement pas opposé à cette hypothèse. Cependant le second, celui qui est tiré des Histoires mêlées, oblige d’admettre que le combat eut lieu en effet sur la rive gauche du Rhin.
Quoi qu’il en soit de ce détail, le témoignage de Paul Diacre mérite d’être cru, et il nous apprend en substance que les Burgondes s’étant placés au-devant de l’armée innombrable qu’Attila entraînait sur ses pas, en reçurent le premier choc, que le torrent dévastateur leur passa sur le corps, que dès lors, jusqu’à Orléans, nul obstacle n’arrêta son cours.
Gislahar et Gundomar, les deux frères de Gundahar, mentionnés dans la loi Gombette et chantés dans la tradition poétique, perdirent la vie dans ce combat inégal, ainsi que le roi des Burgondes.
Trêves, Worms, Spire, tombèrent aussitôt après, presque sans résistance. Metz, place très forte, arrêta un moment Attila, qui l’emporta cependant d’assaut la veille de la fête de Pâques 1 . Il est probable qu’après la défaite des Burgondes, Attila divisa son immense armée, soit afin de la nourrir plus aisément, soit pour réunir plus promptement le butin de la Gaule septentrionale. Une colonne peut avoir poussé jusqu’à Besançon en passant par Strasbourg. Le gros de l’armée, de Metz se dirigea sur Reims, qui ouvrit ses portes à la première sommation; une division se dirigea encore plus au nord et ravagea Laon, Soissons, Noyon, Cambrai, Tournai, Tungres, etc. Cette pointe vers la Belgique explique seule les nombreuses traditions du passage des Huns répandues dans cette /29/ contrée; elle serait également en rapport avec l’anecdote de Priscus touchant deux frères de la nation des Francs qui se disputaient le principat et dont Attila prit l’aîné sous sa protection. On a généralement cru que ces deux frères étaient les fils de Clodion, roi des Francs-Saliens, le protégé d’Aëtius, que Priscus dit avoir vu à Rome, remarquable par sa longue chevelure blonde, aurait donc été Mérovée.
Les Burgondes, aux destinées desquels il convient de nous attacher, avaient fait d’immenses pertes; cependant c’est par une forte hyperbole que quelques chroniqueurs les disent anéantis; Jornandès les range au contraire au troisième rang parmi les peuples des Gaules qui furent dans les événements suivants les alliés d’Aëtius 1 ; les Historiæ miscellæ les placent au premier dans leur énumération 2 . Leur active participation à la suite de cette guerre, dans laquelle ils portèrent et reçurent les premiers coups, ne saurait donc être un instant douteuse. Mais de quelle manière eut lieu cette participation? Sur ce point, je ne puis accepter l’opinion suivie par la plupart des historiens.
Partant toujours de l’idée que les Burgondes étaient déjà dans la Sabaudia, on s’est imaginé qu’ils commencèrent /30/ par s’en aller dans la Provence pour y rejoindre Aëtius; de là on les fait venir, avec le général romain, à Toulouse, pour y prendre Théodoric et la puissante armée des Wisigoths; de Toulouse, enfin, Aëtius et tous ses alliés réunis arrivent à Orléans, où ils trouvent les Huns pour la première fois. Ce long voyage circulaire au travers de la Gaule méridionale serait déjà difficile à concevoir dans l’hypothèse où l’on s’était placé. Mais, quand on sait qu’aux premiers jours d’avril les Burgondes se battaient en corps de nation aux environs de Worms et de Mayence, on comprend bien vite qu’une pérégrination qui était déjà une difficulté dans l’ancienne hypothèse deviendrait maintenant une impossibilité toute pure.
Nous n’avons malheureusement que trois dates un peu fixes concernant l’invasion de 451; mais ces dates, combinées avec les distances parcourues par les armées belligérantes, permettent de retrouver les autres plus ou moins approximativement.
Les dates fixes sont:
1° le jour de la prise de Metz, qui est attesté par les Histoires mêlées, il tombe au 8 avril;
2° Le jour où, selon la légende des saints, Aëtius promit à St.-Agnan, évêque d’Orléans, qui était allé le trouver à Arles, d’arriver avec son armée devant la ville d’Orléans, si celle-ci avait pu tenir jusqu’alors; ce jour est le huitième avant les kalendes de juillet, c’est-à-dire le 24 juin. Selon quelques notices, le terme fixé était expiré depuis quelque temps lorsque Aëtius arriva 1 ; selon la légende, il vint exactement au moment qu’il avait annoncé. /31/
La troisième date indiquée, ou du moins rendue probable par des sources du temps, est celle de la bataille que livra Attila aux Francs et aux Burgondes dans les plaines de Mauriac (Mery-sur-Seine), c’est-à-dire dans le delta formé par la jonction de la Seine et de l’Aube. La légende de St-Loup, évêque de Troyes, nous apprend, en effet, qu’à l’approche des Huns, l’évêque députa le diacre Maximianus avec d’autres clercs pour demander à Attila d’épargner la cité confiée à son ministère. Ce prince se trouvait à Brolium, bourgade située à moitié chemin entre Troyes et Mauriac. Le cheval d’un officier s’étant cabré à la vue des prêtres portant les ornements sacerdotaux, Attila fit massacrer ceux-ci, et depuis ce jour Brolium a porté le nom du martyr Maximianus. Or le jour anniversaire de la mort de St.-Mesmin est célébré le 7 septembre.
Les événements de la campagne d’Attila dans les Gaules, tels qu’ils nous sont parvenus, s’accommodent sans difficulté à ces trois dates principales.
La marche d’Attila du côté de Rheims, puis de là sur Orléans, nous amène bien près du mois de juin. Le siége d’Orléans ne fut probablement pas levé le 24 juin, en raison des difficultés qu’Aëtius éprouva pour s’assurer le concours de Theodoric, sans l’aide duquel la lutte contre Attila eût été par trop inégale. Ce sera donc à la fin de juillet ou en août seulement, qu’Orléans aura été délivrée par les Romains et les Wisigoths réunis. /32/
Le retour d’Attila dans les plaines de Troyes et de Mauriac aux environs de septembre n’a donc rien que de vraisemblable; la grande bataille de Châlons-sur-Marne, livrée à vingt lieues plus au nord, dans les champs catalauniques, tombe ainsi sur le milieu ou la fin de septembre, selon le temps qu’on suppose avoir été employé par Attila à construire les redoutes en terre qu’il établit entre la Cheppe (Fanum Minervæ) et la colline de la Croix, le long de la Noblette. Après avoir perdu sa dernière bataille, Attila rentra en Thuringe et y prit ses quartiers d’hiver.
Mais si la marche d’Attila de Metz à Orléans, le long siége de cette place et le retour d’Orléans à Mauriac se placent sans peine dans les cinq mois de bonne saison qui séparent le 8 avril du 7 septembre; si le voyage de St.-Agnan d’Orléans à Arles, les préparatifs d’Aëtius, des négociations plus ou moins longues avec le roi des Wisigoths, et la marche des armées d’Arles à Toulouse et de Toulouse à Orléans, nous amènent presque forcément au delà du 24 juin, époque à laquelle Aëtius crut d’abord pouvoir venir au secours d’Orléans, et concordent par conséquent avec la date des combats de Mauriac fixée aux environs du 7 septembre; en revanche, comment pourrait-on imaginer un seul instant que les Burgondes se fussent ralliés assez tôt après leur première défaite pour venir de Worms à Arles et revenir d’Arles par Toulouse jusqu’à Orléans, dans les mois de mai, juin et juillet, tout au plus? Une difficulté presque égale se présente pour les Gallo-Romains de Lutèce et pour les Francs saliens, même si l’on admet qu’ils rejoignirent Aëtius en avant de Toulouse. Est-il naturel, est-il vraisemblable d’ailleurs, que des peuples braves, /33/ mais peu disciplinés et nullement soumis aux Romains, on a bien pu le voir, aient quitté leurs demeures, envahies par un ennemi rapace et impitoyable, leurs familles, leurs biens, pour courir au devant d’alliés encore douteux, à travers toute la longueur de la Gaule?
Abandonnons donc, une fois pour toutes, ce système qui réunit en une seule armée venant de Toulouse au secours d’Orléans toutes les populations armées pour la défense de la Gaule. Cette réunion dans le midi de tous les alliés d’Aëtius ne ressort nullement des sources, elle choque toute vraisemllance; nous verrons même qu’elle empêche de comprendre d’autres sources dans leur sens véritable, lorsqu’on arrivera au récit de la bataille de Mauriac; bataille sanglante, mais partielle qui précéda probablement de quinze jours au moins la grande bataille des Champs catalauniques, avec laquelle on la confond, on ne peut plus mal à propos.
Les Burgondes, réfugiés dans les gorges des Vosges et du Jura depuis la bataille dans laquelle ils avaient perdu leur roi et avaient été si rudement éprouvés, brûlaient de venger le massacre des leurs. Ils étaient parfaitement placés pour menacer la gauche de l’armée ennemie. Tandis que celle-ci s’arrêtait sous Orléans, mise en état de défense par son énergique évêque et défendue vigoureusement par ses habitants; les Francs saliens et Ripuaires, les Armoricains et les habitants de Paris, encouragés par Ste. Geneviève, formaient aussi sur les derrières des Huns une armée, déjà imposante.
Les sollicitations d’un ami, mais probablement, avant tout, la communication des déclarations faites par Attila à /34/ la cour de Ravenne 1 ayant enfin mis un terme aux hésitations de Théodoric, Aëtius, fortifié des Wisigoths, arrivait à grandes journées sur Orléans, que les Huns, peu experts dans les siéges, n’avaient pu encore emporter. Le temps dans lequel il avait promis d’arriver était cependant expiré, et Attila, informé sûrement des mouvements d’Aëtius, pressait le siége avec un redoublement d’énergie. Déjà, dans un assaut, une partie de la ville avait été prise 2 , quand, du haut des remparts, les sentinelles annoncent l’approche du secours si impatiemment attendu. Le courage des assiégés se ranime aussitôt; un combat furieux s’engage dans les rues mêmes de la cité, que les Huns commençaient à piller, tandis que les Romains et les Wisigoths, accourus en toute hâte, parviennent à occuper un pont sur lequel ils passent la Loire.
Attila, qui ne voulait pas livrer aux hasards d’une seule bataille les résultats de son entreprise, et qui tenait à mettre à l’abri son immense butin, évacua les abords d’Orléans et reprit le chemin par lequel il était venu.
Mais, lorsqu’il eut atteint le cours de la Seine, entre Mauriac et Troyes (Tricassis), son armée en retraite rencontra de nouveaux adversaires; les Francs, les Burgondes, toutes les populations viriles de la Gaule septentrionale, averties de la levée du siége d’Orléans, attendaient Attila vers ce fleuve, pour lui en disputer le passage./35/
Jornandès indique les Francs comme étant ceux qui combattirent à Mauriac; la participation des Burgondes à ces luttes sanglantes qui, selon Jornandès, coûtèrent la vie à quatre-vingt-dix mille combattants, est prouvée par la loi Gombette 1 .
Tourneux, dont Amédée Thierry a adopté l’avis, est le premier qui ait su, dans l’obscurité des textes anciens, discerner clairement la bataille de Mauriac de la bataille de Châlons. Ces deux auteurs sont loin cependant d’avoir accordé à la première toute la portée qu’elle a eue.
Selon M. Thierry surtout, l’affaire de Mauriac n’aurait été qu’un de ces engagements partiels qu’une armée en retraite soutient habituellement, quand elle est serrée de près par ceux qui la poursuivent. Aussi cet historien admet-il, sans autres, une correction au texte de Jornandès proposée par l’abbé Dubos et suivant laquelle le nombre des morts et des blessés serait réduit à quinze mille 2 . Cette correction arbitraire ne me paraît motivée par quoi que ce soit.
Partant de l’idée que tous les alliés d’Aëtius s’étaient réunis au midi de la Loire, M. Thierry était nécessairement /36/ conduit à ne voir dans le combat de Mauriac qu’un combat d’arrière-garde livré par les Gépides contre les Francs afin de protéger le passage de l’Aube par l’armée et les bagages d’Attila. Mais nous avons vu que cette idée était inadmissible.
D’après la position des lieux et les découvertes récentes d’armes et autres objets, témoignant d’une ancienne bataille, voici comment je conçois les différents combats dont l’ensemble prend le nom de bataille de Mauriac.
Deux routes parallèles conduisaient d’Orléans à Châlons-sur-Marne; l’une à l’ouest passait à Mauriac; l’autre, plus directe, passait à Troyes. Attila, usant de cet avantage pour la facilité de sa marche et de ses approvisionnements, marchait sur deux colonnes.
Les peuples du nord de la Gaule, armés pour empêcher les hordes hunniques de rentrer dans un pays qu’elles avaient mis à feu et à sang quelques mois auparavant, rencontrèrent à Mauriac la gauche d’Attila, où se trouvaient les Gépides, sous les ordres de leur roi Ardaric. Dans ces circonstances, une affaire des plus sanglantes aurait eu lieu sans qu’Attila, ni surtout Aëtius, aient eu le temps d’intervenir.
D’après le nom que la bataille a conservé et les lieux où se trouvent les vestiges les plus sensibles d’une lutte, les principaux combats eurent lieu sur la Seine, à Mauriac même, entre la Seine et l’Aube, non loin d’Arciaca, à Vilette et Pouans 1 ; enfin sur la rive droite de l’Aube, entre Viaprès, Plancy et Baudimont./37/
Ces combats furent successifs; Frédegaire nous dit qu’ils durèrent trois jours. L’hypothèse émise par un écrivain récent 1 d’un combat s’engageant à la fois sur trois champs de bataille distincts, séparés par deux puissants cours d’eau et où les corps séparés ne pouvaient se prêter un mutuel appui, doit être rejetée. Dans cette hypothèse ni les troupes d’Attila, ni celle de ses adversaires ne présentent une ligne d’opération tant soit peu intelligible. Un coup d’oeil sur la carte suffira pour le démontrer.
Quant à l’issue de la lutte, le seul passage de Jornandès où les deux combats soient présentés distinctement, nous laisse sans réponse aucune.
Pourtant, si la bataille de Mauriac n’a pas été un succès pour Attila, elle ne fut point pour lui un désastre, preuve en soit l’attitude que Jornandès lui prête immédiatement après. A trois journées de Mauriac, Attila s’arrête, se /38/ concentre, donne du repos à son armée, la ravitaille, élève des fortifications de campagne d’un très vaste développement, commence lui-même l’attaque lorsqu’il voit approcher Aëtius, réuni cette fois à tous les peuples de la Gaule en armes pour le repousser.
L’essentiel, du reste, pour l’intelligence de la campagne et du rôle que les Burgondes y ont joué, est de constater, premièrement: que les combats de Mauriac, si graves et acharnés qu’ils aient été, ne furent, en réalité, qu’un préliminaire important de la bataille définitive; secondement, que, dans ces combats, les Francs et les Burgondes agissaient de leur chef, l’armée ennemie se trouvant tout entière entre eux et les troupes qui venaient d’Orléans, sous le commandement d’Aëtius.
De la campagne de 451, la conclusion surtout est connue; mais l’on discute encore aujourd’hui le lieu précis où Aëtius parvint à briser et à refouler définitivement le flot envahisseur. Le théâtre de cette gigantesque mêlée, désignée habituellement sous le nom de bataille de Châlons, est même un des sujets qui ont servi le plus souvent de but aux recherches des historiens et des archéologues.
J’ai traité cette question selon mes faibles lumières dans un autre écrit; je m’abstiendrai donc d’entrer de rechef dans une discussion critique, à laquelle je n’aurais pas grand’chose à changer 1 .
A mes yeux, les Huns eurent deux batailles à soutenir dans leur retraite: la première à Mauriac, la seconde à Châlons. La confusion dans laquelle est tombé Jornandès, /39/ qui, dans un passage, paraît confondre les champs mauriciens et les champs catalauniques 1 , s’explique par la circonstance qu’il n’avait pas été lui-même dans les Gaules.
Le partage des sources, d’après la nationalité, a du reste quelque chose de frappant en cette circonstance. La loi Gombette, Frédegaire, et la chronique anonyme de l’an 641 2 , en un mot, les sources franques et burgondes indiquent seulement les champs de Mauriac. Les sources gothiques et romaines, Idace, Isidore de Séville, Paul Diacre, Jornandès et Ammien Marcellin parlent toujours des champs catalauniques 3 . Cette divergence vient à l’appui de nos vues. Les Romains et les Wisigoths n’ayant pas combattu à Mauriac, ont surtout parlé de la victoire de Châlons, à laquelle ils eurent la plus grande part. Les Francs et les Burgondes, qui avaient surtout combattu et souffert auprès de Mauriac, ont conservé préférablement le souvenir de ce premier combat.
Transportons-nous maintenant aux champs catalauniques. Entre la Vesle et la Suippe (petites rivières qui coulent de l’est à l’ouest et vont se jeter dans l’Aisne), se /40/ trouve un plateau assez accidenté qui commence à trois lieues au nord de Châlons.
La partie de ce plateau qui nous intéresse forme un parallélogramme de 5 à 6 lieues de longueur sur 3 lieues de largeur; elle est limitée au sud par le cours de la Noblette, principale branche de la Vesle; au nord par la Suippe; à l’est par une ligne qu’on tirerait des sources de la Noblette aux sources de la Suippe; à l’ouest par une ligne joignant le village de Vadenay, placé près du confluent de la Vesle et de la Noblette, au village de Jonchery situé sur les bords de la Suippe. A peu près au centre du parallélogramme sont des hauteurs boisées appelées le Piémont. En partant de ce point on peut diviser en deux régions principales l’espace que nous venons de circonscrire; la première est formée par le versant nord du plateau qui descend à la Suippe par des pentes assez escarpées; la seconde est formée par le versant sud et se subdivise elle-même en deux parties; la portion orientale, sorte de plaine s’abaissant doucement jusqu’à la Noblette, et la portion occidentale, laquelle est découpée par trois petits contreforts qui se détachent du Piémont. Le premier ou le plus oriental est le mont des Vignes, il aboutit à la Cheppe; le second, nommé mont Fresnoy, aboutit à Cuperli; le dernier, mont de Perthes, se termine auprès de Vadenay; ces collines embrassent deux vallons incultes et passablement évasés, mais suffisent à masquer des mouvements de troupes, pour celui qui se trouve au centre du plateau, mais n’occupe pas le Piémont.
Près de la Cheppe, village sur la Noblette, est un camp fortifié connu sous le nom de camp d’Attila. C’est une vaste enceinte munie d’un double rempart en terre /41/ parfaitement conservé. Le fossé, entre les deux épaulements, mesure 50 pieds de largeur et 20 de profondeur. D’après Tourneux, qui en a levé le plan, l’enceinte a 1765 mètres de pourtour; deux ouvertures y sont pratiquées, l’une, s’ouvrant sur la Cheppe, au bord du ruisseau; l’autre au nord, qui conduit sur le mont des Vignes, dont l’espace occupé par le camp forme l’extrémité inférieure et occidentale.
Ce camp retranché est-il l’œuvre des Romains, dont Attila aurait tiré parti, ou bien celle des Huns? Cette question, fort controversée, importe au fond assez peu, dès qu’il est admis que les Huns l’occupèrent et que la bataille a eu lieu dans son voisinage. Or ceci est démontré par de nombreux indices. Le long du cours supérieur de la Noblette, en amont de la Cheppe, des fortifications de campagne, du genre de celles qui entourent le camp, s’aperçoivent encore çà et là, particulièrement à Bussy et à Saint-Rémy. On y rencontre aussi, nombreux et vastes, des tumulus dont la signification n’est point problématique; dans tout le pays, à une lieue à la ronde du camp, le sol fournit une foule d’objets caractéristiques: des armes, des ossements et de petits fers de chevaux. Ces objets se trouvent principalement: 1° au nord-ouest, juste au-dessous de la colline du Piémont, dans un endroit nommé l’Ahan des diables, ce qui veut dire le champ dans lequel les Huns païens et sorciers, selon l’idée du pays, se trouvent ensevelis; 2° sur le mont des Vignes, jouxtant au camp lui-même; 3° à Cuperli, village placé à demi lieue du camp, en aval du cours de la Noblette; 4° à Bussy, situé à demi lieue à l’est du camp, en amont, où l’on compte jusqu’à cinq vastes tumulus; 5° à la Croix, /42/ colline escarpée qui termine à l’est le parallélogramme dans lequel sont comprises les localités dont nous avons parlé; 6° en dehors et au sud-est du parallélogramme se trouve enfin le magnifique tumulus de Poix, que la tradition a nommé le tombeau du roi Théodoric.
Mais de toutes les preuves rassemblées pour démontrer que la bataille décrite par Jornandès eut lieu dans les parages de Fanum Minervæ, ancien nom de la Cheppe 1 , la plus incontestable est bien la facilité qu’on éprouve à se rendre compte des indications de cet historien, lorsqu’on les rapporte aux lieux que l’on vient de décrire.
Attila avait choisi ses positions avec le tact d’un guerrier expérimenté. Il commande deux voies romaines, dont l’une conduit de Reims à Toul, et dont l’autre, un peu plus au nord, conduit directement à Metz. La force de son camp retranché et ses travaux de campagne en amont du ruisseau de la Noblette, assez encaissé parfois, le mettent à l’abri d’une attaque venant du côté de Châlons; ses derrières sont protégés par la colline du Piémont, bien plus boisée alors que de nos jours. Le plateau sur lequel il a rassemblé son armée est assez vaste pour permettre le facile développement de ses masses et les manœuvres de sa nombreuse cavalerie, sur laquelle il compte surtout.
Aëtius ne s’est pas montré moins habile dans ses dispositions préliminaires. Il se gardera d’aborder de front un ennemi aussi bien retranché, mais, tout en attirant son attention du côté du sud par une fausse attaque, il a caché /43/ ses principales forces dans les vallons qui remontent de la Vesle à la colline du Piémont et vient tourner secrètement les positions dans lesquelles il est attendu.
Au commencement de l’action, la droite d’Aëtius, formée par les Wisigoths de Théodoric, s’appuie au confluent de la Vesle et de la Noblette, d’où elle avancera sur le camp retranché; le centre, formé des Alains et des autres auxiliaires qui ont charge de les surveiller, occupe le dernier vallon et s’avance sur le mont Fresnoy, la gauche, composée des légions romaines placées sous le commandement direct d’Aëtius, gagne en toute vitesse les hauteurs du Piémont, clef de la position dans la conception du général romain. Thorismund, fils aîné de Théodoric, commande en outre un nombreux corps de cavalerie destiné à relier l’action de l’aile droite avec celle du centre et de la gauche. L’extrême droite se prolonge sur la rive gauche de la Noblette, tandis que l’extrême gauche suit le revers septentrional des hauteurs voisines du Piémont.
Depuis Mauriac, les Francs et les Burgondes avaient opéré leur jonction avec Aëtius; cependant Jornandès ne les nomme pas dans sa description de l’ordre de bataille; peut-être Aëtius les mit-il au centre et en seconde ligne, en raison des grandes pertes qu’ils venaient de subir.
Le mouvement d’Aëtius a forcé Attila à se déployer du côté du nord, en dessus du camp retranché; après avoir fait face du côté du sud à un ennemi attendu de Châlons, il doit maintenant faire face, à l’ouest, à un ennemi qui débouche du côté de Reims. Sa gauche reste opposée aux Wisigoths et couvre le camp; elle est composée des Ostrogoths et des Gépides. Au centre se trouve le roi /44/ lui-même entouré de ses Huns. A la droite seront les autres nations slaves et germaines qu’il a emmenées avec lui.
Jornandès nous dit qu’Attila prit la précaution de n’engager le combat qu’après midi, afin de pouvoir, en cas d’échec, profiter de la nuit pour se mettre à l’abri de ses retranchements 1 . Je crois qu’il engagea l’affaire aussitôt qu’il eut pénétré le dessein qu’avait Aëtius de tourner ses lignes, en occupant avant lui le Piémont. Cette hauteur était d’abord à distance égale des deux armées, mais Aëtius s’y dirigeant à couvert, réussit à y arriver le premier; force fut donc à Attila de ne pas perdre un instant pour reprendre un poste qui assurait à son possesseur des avantages essentiels.
La bataille s’engage par conséquent par l’attaque qu’Attila ordonne pour enlever aux Romains les hauteurs du côté du nord; mais Aëtius, soutenu par la cavalerie de Thorismund, repousse cette attaque en fondant sur les Huns au moment de leur ascension 2 .
Ainsi, en prenant son ennemi en flanc et à revers, et en le contraignant à improviser un ordre de bataille qui diminue notablement ses ressources défensives, Aëtius s’est assuré, dès le début de l’action, une supériorité que la bravoure des Huns ne saurait contre-balancer.
Pendant qu’Aëtius repoussait les Huns au bas de la colline, /45/ précisément à l’endroit que la tradition nomme aujourd’hui l’Ahan des diables, une lutte plus formidable encore s’engageait en avant du camp retranché, entre deux peuples de même race, les Wisigoths alliés des Romains, et les Ostrogoths, alliés d’Attila. C’est celle-là principalement dont l’historien des Goths nous retrace l’émouvant tableau.
Le théâtre de cet engagement se trouve entre la Cheppe et Cuperli. Là, le ruisseau de la Noblette, qui partage le champ de bataille et forme le fossé du camp, gonflé non pas de pluie, mais de sang, est, suivant l’expression hyperbolique de l’historien, devenu pareil à un torrent. Là, le vieux Théodoric, qui parcourt les rangs en exhortant les siens, est atteint d’un trait qu’a lancé l’Ostrogoth Andagise; il est renversé, foulé aux pieds des combattants, et bientôt son cadavre est recouvert de milliers de cadavres appartenant aux deux partis. Mais ce succès accidentel cause justement la perte de ceux-là qui l’ont obtenu. Furieux de la mort de leur roi, brûlants de la venger, les Wisigoths se séparent alors des Alains et culbutent tout devant eux. Attila, qui s’est placé au centre pour se porter au lieu où sa présence sera la plus utile, les charge vainement avec cette fameuse cavalerie dont il avait formé sa garde personnelle. Il est repoussé, lui aussi, entraîné parmi les fuyards et bien heureux de trouver un refuge derrière l’enceinte des chariots 1 . Du reste, on se bat sur toute la ligne: bataille atroce, multiple, opiniâtre, et, dit /46/ encore Jornandès, telle que l’antiquité n’en raconte pas de pareille 1 .
Ne pouvant pénétrer dans le camp fortifié, les Wisigoths poursuivent l’épée dans les reins ceux de leurs adversaires qui n’ont pu y entrer, et remontent le cours du ruisseau pour s’attaquer successivement aux redoutes moins importantes de Bussy et de Saint-Rémi. Thorismund, descendant sur le soir des hauteurs qu’il avait occupées de concert avec Aëtius, est venu butter à son tour contre le camp des Huns, sur lequel il se précipite. Blessé d’une flèche à la tête, il tomba aussi de cheval; mais les siens purent le dégager 2 . Un peu plus tard encore, Aëtius et le corps qu’il conduit, éloigné des autres par la confusion inséparable d’un combat qui s’est prolongé jusque dans la nuit, et cherchant à savoir ce que les Wisigoths sont devenus, se trouve un moment au milieu de l’armée ennemie. A force de recherches, il parvint enfin jusqu’à l’endroit où les Wisigoths avaient établi leurs campements et passaient la nuit sous les armes. Il demeura avec eux jusqu’au lendemain 3 .
Ce que rapporte Jornandès de l’embarras d’Aëtius à /47/ retrouver les Wisigoths, jette sur sa narration plus de jour, qu’il ne pensait lui-même. En effet, quand, s’acharnant à leur poursuite, les Wisigoths eurent remonté le cours de la Noblette, sans parvenir à la franchir, Aëtius, qui venait du Piémont, se trouva, en réalité, séparé d’eux par le camp d’Attila et tout le gros de l’armée ennemie. Nul, du reste, ne savait exactement ce qui était arrivé dans cet immense conflit prolongé longtemps dans les ténèbres. Au lever du jour seulement, lorsqu’on vit la plaine couverte de morts et les Huns qui se tenaient enfermés dans leur camp, les Romains et leurs alliés jugèrent que la victoire était à eux. Sans des pertes énormes, ils supposaient bien qu’Attila n’aurait pas été si prudent. Celui-ci, cependant, ne paraissait nullement abattu; il faisait sonner les trompes à grand bruit et menaçait incessamment d’une nouvelle attaque. Tel, dit Jornandès, le lion pressé par les chasseurs, parcourt l’entrée de sa caverne, sans oser toutefois s’élancer au dehors, et ne cesse de terrifier le voisinage par ses affreux rugissements.
Les sources varient touchant le nombre des victimes de cette journée qu’on a nommée, à juste titre, la bataille des nations, car les peuples les plus belliqueux de l’Europe y avaient des représentants et quelques-uns dans les deux camps. Jornandès, porte le chiffre des morts à 165 000. Ce n’est pas si exagéré qu’on le croirait, il faut tenir compte des masses qui se trouvaient aux prises. Attila avait amené dans les Gaules 700 000 soldats; il en avait probablement encore près de 500 000. L’armée ennemie ne devait pas être de beaucoup inférieure 1 . /48/
J’ai laissé Aëtius avec les Wisigoths, sur la rive gauche de la Noblette, en face des redoutes de Bussy et de Saint-Rémi. Les Huns occupaient encore la rive droite; l’armée romaine, en poussant ses deux ailes, a fini par les envelopper, mais leur camp, pareil à un promontoire de rocher battu par les vagues de la mer, a soutenu tous les assauts.
Aëtius et ses alliés tinrent conseil et décidèrent de tenir les Huns assiégés; le défaut de vivres les forcerait bientôt à sortir de leur camp. Cette tactique était de beaucoup la plus sage, Attila le comprenait bien; aussi avait-il fait dresser au milieu du camp un bûcher composé de selles de chevaux; il voulait s’y jeter quand viendrait le moment suprême, car nul ne devait pouvoir se vanter d’avoir tué ou fait prisonnier le seigneur de tant de nations. Une circonstance fortuite vint le sauver d’une perte à peu près certaine.
Après de longues recherches, les Wisigoths avaient retrouvé le corps de leur roi Théodoric à l’endroit où les cadavres étaient le plus amoncelés; ils lui rendirent de grands honneurs et choisirent Thorismund pour son successeur. Le jeune prince, inquiet des projets de ses frères, demeurés à Toulouse, et craignant qu’ils ne s’emparassent du trésor royal, voulut alors revenir sur la décision prise et attaquer sur-le-champ Attila dans ses retranchements. Le général romain refusa de compromettre un résultat acquis par une tentative hasardeuse. Les Wisigoths reprirent aussitôt le chemin du midi. /49/
Lorsque du camp des Huns on aperçut les campements des Wisigoths abandonnés, on crut d’abord à quelque piège; quand il fut certain que Thorismund était parti, Attila se flatta que la fortune lui revenait et donna l’ordre du départ. Avec une armée aussi considérablement réduite que la sienne, Aëtius dut se borner à suivre les Huns jusqu’au Rhin, mais à distance respectueuse, et sans entreprendre de nouveaux combats. On présume qu’Attila suivit, en rentrant en Allémanie, la route tendant de Rheims à Metz. Le nom de Hunnesrück que portent les collines situées entre la Moselle et le Rhin pourrait être un souvenir lointain de cette circonstance. Il ne s’arrêta plus qu’en Thuringe, où il fit célébrer des jeux près d’Erfurt avec une magnificence qui n’était pas exempte de forfanterie. Au vrai, il avait été vaincu; sa grande entreprise sur l’Occident avait échoué, il avait perdu plus de la moitié de son immense armée. Des villes brûlées et des provinces ravagées ne compensaient pas un pareil résultat.
/50/
§ 2
Gundioch et Chilpérik fondateurs du premier royaume de Bourgogne.
(446 à 470.)
Depuis la bataille de Châlons, la Gaule demeurait l’arène des peuples germaniques qui avaient aidé Aëtius. Parmi ces peuples, les Wisigoths et les Burgondes étaient les plus en évidence. Thorismund ne régna que trois ans; il mourut assassiné en 454; on accusa de ce crime son frère Théodoric II, lequel devint son successeur. Deux fils de Gundahar, Gundioch et Chilpérik, gouvernaient alors les Burgondes.
Sur la foi d’un passage peut-être mal compris de Grégoire de Tours la plupart des historiens ont écrit que Gundioch et Chilpérik étaient des princes wisigoths, Grégoire de Tours dit, en effet, de Gundioch, qu’il était de la race du persécuteur Athanaric. « Fuit autem et Gundeuchus, rex Burgundionum ex genere Athanarici regis persecutoris, de qua supra meminimus 1 . »
La base sur laquelle cette opinion repose n’est pas des plus solides, surtout, elle est en opposition avec la loi /51/ Gombette, dans laquelle Gundebaud, fils de Gundioch, nommant ses propres ancêtres, cite positivement comme ses aïeux et ses prédécesseurs Gibica et Gundahar. Un pareil témoignage, exprimé dans les lois d’un peuple chez lequel beaucoup de vieillards avaient encore vécu sous Gundahar, ne laisse aucune place au doute. L’auteur de la vie de St. Sigismond, fils de Gondebaud, vient d’ailleurs à l’appui 1 . Observons que dans Gundioch se trouve cette racine Gund (belliqueux, guerrier), qui se retrouve dans presque tous les prénoms de la famille royale burgonde, comme aussi dans le nom du peuple.
Diverses explications pourraient être données du passage cité plus haut. La plus plausible me paraît celle de Marcow 2 . Ainsi qu’on voit par les Historiæ miscellæ, Gondebaud, fils de Gundioch, était neveu de Ricimer par sa mère; or le célèbre patrice, qui était d’origine suève, avait eu lui-même pour mère la fille du roi wisigoth Wallia; Grégoire de Tours, qui connaissait la parenté de Gondebaud avec les rois wisigoths, mais non la cause de cette parenté, aura supposé qu’elle venait du côté masculin. Quoi qu’il en soit de cette explication, on admettra avec nous que Gondebaud a mieux connu son grand’père que l’historiographe des Francs.
L’issue de son expédition en Gaule n’avait diminué ni la hardiesse, ni les ressources d’Attila. Dès le printemps 452, il envahit l’Italie supérieure. Aëtius dut quitter les Gaules pour venir défendre son souverain épouvanté. Une invasion de Marcien, empereur d’Orient, en Pannonie, et /52/ la présence d’Aëtius, défendant la ligne du Pô, engagèrent le roi des Huns à se retirer plus encore que les représentations du pape Léon-le-Grand, auquel la tradition se plaît à attribuer cet heureux résultat.
Attila était, durant l’hiver 452 à 453, dans sa résidence habituelle sur les bords du Danube, où il s’apprêtait à attaquer derechef l’empire d’Orient, quand une mort subite vint mettre un terme à ses vastes projets. L’histoire dit qu’il mourut d’hémorragie à la suite d’un festin donné à l’occasion de ses noces avec une princesse germaine; la tradition poétique et quelques chroniqueurs, dont la version paraît pourtant moins authentique, soutiennent qu’il fut assassiné par sa nouvelle épouse, qui aurait eu à venger le meurtre de son propre père. Ce point, demeuré obscur au moment même, le sera probablement toujours.
La mort d’Attila fut le signal de la dissolution de son empire. Les nations germaines qui avaient obéi à l’ascendant d’un grand homme, bien plus qu’à la prépondérance des Huns, reprirent leur indépendance. Les Huns furent défaits dans une grande bataille livrée sur les bords du lac Balaton et retournèrent en Asie. Les Ostrogoths, les Gépides, les Ruges, les Scyres, les Turcilingiens se partagèrent les mêmes contrées de l’Europe orientale dans lesquelles leur race dominait un demi siècle auparavant.
Valentinien III, débarrassé de la crainte que lui inspirait Attila, voulut se débarrasser aussi de la contrainte que lui imposait l’ascendant du grand capitaine qui avait sauvé l’Occident. Il assassina Aëtius de sa propre main en 454. L’année suivante, Valentinien fut assassiné à son tour par Maxime, sénateur romain, dont il avait outragé la femme. Genséric, roi des Vandales, fut alors appelé en Italie par /53/ la veuve de Valentinien, que Maxime, proclamé empereur, avait voulu forcer à l’épouser. Maxime périt dans une émeute. Rome, prise par les Vandales, fut pillée et saccagée pendant quatorze jours.
Dans ces tristes circonstances, les Gallo-Romains, d’accord avec les Wisigoths et les Burgondes, proclamèrent empereur Avitus, maître de la cavalerie qui, avec l’aide des Burgondes, venait de repousser une redoutable incursion des farouches Allamans 1 .
Le sénat romain avait vu avec une certaine jalousie la province des Gaules disposer de l’empire, il s’unit au patrice Ricimer, personnage très influent en ce temps-là sur l’armée et en Italie. Au bout d’un an à peine, Avitus fut forcé d’abdiquer. Majorien, prince capable, fut élu à sa place; mais le véritable chef de l’Occident était cependant Ricimer. De 455 à 472, celui-ci faisait et défaisait les empereurs; il exerça aussi plusieurs fois, pendant les interrègnes, le pouvoir dictatorial.
Durant le règne bien court d’Avitus, les Wisigoths et les Burgondes entreprirent d’enlever, en son nom, la province d’Espagne aux peuples barbares qui l’occupaient depuis 407. Leurs armées réunies remportèrent, à Astorga, une grande victoire contre les Suèves de Galice. Reckiaire leur roi s’enfuit à Portus-Cale, vers l’embouchure du Douro, où il tomba dans les mains des vainqueurs qui le mirent à mort. Peu après se rendit Braga, capitale du royaume suève. On ne sait pour quelle cause, après ce succès, Gundioch et Chilpérik, laissant /54/ Théodoric II poursuivre le cours de ses conquêtes, revinrent dans les Gaules, où ils occupèrent Lyon encore dans le courant de l’année 456. Un dissentiment éclata-t-il entre les rois des deux nations coalisées ou bien la nouvelle de la chute d’Avitus, survenue pendant cette expédition, fut-elle la cause du retour des Burgondes? Nous ne saurions le dire. Quoi qu’il en soit, les Burgondes et les Wisigoths refusèrent de reconnaître Majorien. Lorsque la mort eut surpris Avitus tandis qu’il fuyait Pavie pour chercher à gagner les Gaules, les Burgondes lui opposèrent un compétiteur nouveau en la personne de Marcellien 1 . Mais Majorien, général habile, aidé par Egidius, chef des milices romaines dans la Gaule septentrionale, après avoir défait les Wisigoths, reprit Lyon à Gundioch 2 . Le gendre d’Avitus, Sidoine Appolinaire, cédant lui-même à la fortune du vainqueur, chercha à rentrer en grâce en écrivant des vers en l’honneur de celui qu’il avait combattu.
C’est pendant l’interrègne qui suit la déposition d’Avitus et précède l’arrivée de Majorien à Lyon, que Marius place ce traité avec des sénateurs gaulois, ou, en d’autres termes, avec les décurions chargés du gouvernement des municipes, qui servit de base à l’établissement des Burgondes dans notre patrie. Comme il s’agit ici d’un fait capital et primordial de notre histoire, je m’arrêterai un moment à la discussion de cette date, sur laquelle je me trouve en désaccord avec presque tous les auteurs précédents. /55/
Les preuves que j’ai données de la présence du gros de la nation et de son roi dans la région du Rhin moyen, au début de la campagne d’Attila, pourraient à la rigueur suffire. L’accord qui existe sur ce point entre Paul Diacre et les traditions germaniques est trop remarquable pour ne pas reposer sur des faits réels; je dirai plus, l’ensemble des événements de cette mémorable guerre ne s’explique d’une façon satisfaisante que moyennant la participation des Burgondes rhénans. A cet égard, ce que nous avons vu touchant la bataille de Mauriac, vient encore à l’appui des témoignages relatifs à la bataille livrée en premier lieu aux environs de Mayence et de Worms.
Sur l’établissement même des Burgondes dans leurs nouvelles demeures, nous pouvons aussi invoquer tout à la fois le témoignage des sources et les vraisemblances résultant de l’appréciation des circonstances générales au milieu desquelles un tel fait a dû avoir lieu.
Prosper Tyro, tout en plaçant l’occupation de la Sabaudia dans la vingtième année du règne de Théodose, c’est-à-dire en 443, ne dit point que le peuple burgonde y ait été transporté en entier, et si la correction apportée par Sigebert de Gembloux à ce texte inintelligible, pene gens cum rege Peretio deleta, doit être supposée juste, en d’autres termes, si l’on croit que Tyro ait écrit: cum rege per Aetium, les mots qui suivent immédiatement après: « Burgundionum reliquiis datur » s’expliquent suffisamment par la persuasion doublement erronée où l’auteur était: 1° que la nation burgonde fût à peu près détruite dans la défaite que lui fit essuyer Aëtius en 436; 2° que dans cette bataille Gundahar avait trouvé la mort.
Mais, tandis que le chroniqueur aquitain n’exclut point /56/ en réalité une émigration partielle dans l’indication vague à laquelle on veut se rattacher, Marius tient un langage autrement clair et positif. Ce chroniqueur, qui était issu d’une famille patricienne du pays des Eduens, c’est-à-dire de la contrée la plus septentrionale comprise dans le nouvel établissement des Burgondes et qui vécut au centre de la Bourgogne dans un temps où la mémoire des faits avait encore pu lui parvenir directement 1 , raconte avec une parfaite exactitude les choses qui précédèrent et celles qui accompagnèrent l’occupation des contrées qu’il habitait. Selon lui, l’établissement des Burgondes eut lieu immédiatement après la guerre que Gundioch et Chilpéric firent de concert avec Théodoric, roi des Wisigoths, contre les Suèves d’Espagne. Il raconte l’élévation, la chute et la mort d’Avitus, tous événements qui eurent lieu en 456; puis ajoute: « Eo anno, Burgundiones partem Galliæ occupaverunt, terrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt. »
Il ne s’agit pas ici, on le voit, d’un district désert et montagneux de la Sabaudia, délaissé par la pitié d’Aëtius aux débris d’une nation déjà en majeure partie exterminée; il s’agit d’un peuple puissant et belliqueux, qui revenant victorieux des champs de la Gallice, partage une partie des Gaules avec les sénateurs gaulois. Et remarquons ici cette expression: « cum gallicis senatoribus diviserunt. » Après la chute d’Avitus, les Gaulois qui l’avaient élevé à l’empire ne reconnurent pas Majorien; il y avait donc interrègne; le pouvoir politique avait /57/ momentanément passé des officiers de Rome aux décurions des municipes; c’était donc bien avec les sénateurs gaulois qu’en 456 un partage de terres pouvait être convenu et réglé.
La chronique d’Eusèbe, dont Frédegaire nous a conservé des extraits, assez informes il est vrai, contient une notice sur l’établissement des Burgondes qui, lorsqu’on l’examine avec attention, concorde tout à fait avec celle de notre évêque Marius 1 .
Cet écrivain rapporte, mais sans indication de date, « que les Burgondes arrivèrent sur les bords du Rhin au nombre de 80 000, qu’ils y séjournèrent un certain temps; qu’ils furent ensuite invités par des députés de la Province lyonnaise, de la Gaule chevelue et de la Gaule cisalpine à s’établir dans ces provinces. En faisant cet appel, les indigènes avaient pour but de s’affranchir par ce moyen des lourds impôts qu’ils payaient à l’Empire. Les Burgondes y répondirent en venant s’établir en effet dans les provinces susmentionnées, avec leurs femmes et leurs enfants. »
Le chiffre de 80 000 guerriers attribué aux Burgondes lors de leur première apparition sur le Rhin, « quod unquam antea nec nominabantur, » comparé avec les indications des autres sources, nous montre qu’Eusèbe parle de la première apparition des Burgondes sur le Rhin l’an /58/ 373, sous le règne de Valentinien Ier. Cette indication montre par là même l’impossibilité du chiffre duobus annis donné comme durée du séjour des Burgondes sur les rives du Rhin. Ammien Marcellin 1 dit d’ailleurs positivement qu’après être arrivés jusqu’au Rhin, les Burgondes voyant que l’empereur n’était pas là, comme il l’avait promis, renoncèrent à attaquer les Allamans et retournèrent dans l’intérieur de l’Allemagne. — Ce chiffre étant donc laissé de côté 2 , tout le reste du récit d’Eusèbe est une confirmation et un développement fort intéressant du témoignage de Marius. La Lyonnaise fut bien occupée en 456; par Gallia Comata, il faut entendre la grande Séquanaise; la Cisalpine comprend le Vallais et la Sabaudia. L’initiative prise par les députés gaulois correspond à la participation des décurions au partage de terres relaté par l’évêque d’Avenches. Le motif des indigènes est d’ailleurs parfaitement naturel pour qui sait l’oppression fiscale qui pesait sur la Gaule aux temps dont il s’agit.
Salvien, autre contemporain, rapporte que les Gaulois avaient été réduits par les rigueurs du fisc romain à se réfugier auprès des barbares ou même dans la servitude. Sidoine Appolinaire dit de son côté 3 que les Burgondes étaient les plus doux (clementiores) entre tous les barbares d’alors. Le même auteur nous apprend encore qu’en 460, Arvandus, préfet des Gaules, fut accusé à Rome d’avoir concerté avec le roi Euric de partager la Gaule /59/ entre les Wisigoths et les Burgondes, suivant le droit usité entre les nations, c’est à-dire suivant la coutume établie en ce temps-là pour le partage des terres entre les anciens habitants et de nouveaux venus auxquels il fallait faire place.
Une chronique anonyme, publiée par Waitz dernièrement vient encore à l’appui des auteurs précédents; elle rapporte, ad ann. 457, que l’occupation de la portion des Gaules qui forma le royaume burgonde, eut lieu du consentement des Wisigoths, dont les Burgondes allèrent couvrir la frontière septentrionale. « Post cujus sedem Gundiocus rex Burgundionum, cum gente et omni præsidio, annuente sibi Theodorico ac Gothis, intra Galliam ad habitandam ingressus, societate, amicitia Gothorum functus 1 . »
Voudrait-on peut-être essayer de reporter les faits racontés par ces divers historiens en 443? Le premier coup d’œil que l’on jettera sur la situation de l’Empire à ce moment-là nous en montre l’impossibilité. En 443, l’Empire romain est plus fort qu’il ne l’avait été depuis un demi-siècle. Le génie d’Aëtius avait rendu, trop momentanément sans doute, au gouvernement impérial une autorité incontestée, dans les provinces occidentales. Les Burgondes, de leur côté, n’avaient aucun motif pour changer volontairement de demeures; les habitants de la Gaule en avaient encore moins pour les appeler parmi eux, quand bien même ils en auraient eu le pouvoir. Aussi ne songe-t-on pas à expliquer l’établissement des Burgondes en 443 comme un partage amiable fait avec les /60/ indigènes, sans la participation du gouvernement impérial. On assimile cet établissement à celui des nombreuses populations létiques que les empereurs du troisième et du quatrième siècle établirent dans leurs provinces par des motifs politiques divers. Pour en arriver là, il faut commencer par refuser toute valeur aux témoignages de Marius, d’Eusèbe et de la chronique anonyme, témoignages parfaitement clairs, catégoriques et circonstanciés.
Quand on aura repoussé ainsi les meilleures sources au profit de la moindre, qu’aura-t-on gagné? Les sectateurs exclusifs de Tyro, qui font exterminer les Burgondes par Aëtius en 436, et transporter leurs débris dans la Sabaudia en 443, voudront-ils bien nous expliquer comment ces débris, comment ces pauvres vaincus, ces misérables lètes de la Sabaudia sont, en sept ans, devenus un grand peuple, qui, selon le témoignage de Paul Diacre, lutte seul contre l’innombrable armée d’Attila; qui en 456 va envahir l’Espagne, et sur la fin de cette même année, la laissant à ses alliés, revient occuper en maître le quart, tout au moins, de la Gaule? Quelle colonie de lètes pourrait-on citer qui ait eu une destinée analogue? Les Wisigoths se firent leur place dans l’Empire d’occident par les armes; les Ostrogoths, les Francs, les Lombards en firent autant, et si quelques colonies létiques de leur race les précédèrent parfois sur le territoire romain, elles rentrèrent bientôt inaperçues dans le sein de la race conquérante à laquelle elles appartenaient. Pour les Burgondes, il n’en fut pas différemment.
Du reste la date de 443, imposée par Prosper Tyro à la fondation du premier royaume de Bourgogne, ne se justifie pas même par la misérable explication que l’on essaye /61/ d’en donner. Si Aëtius avait transporté en Savoie les débris des Burgondes rhénans, il les y aurait envoyés en 436, aussitôt après leur défaite, et non pas après un délai de six ans durant lequel cette nation serait rentrée dans les établissements qu’elle avait fondés sur la rive gauche du Rhin.
Pour satisfaire à Tyro, imaginera-t-on peut-être quelque nouvelle révolte des Burgondes avec quelques nouvelles victoires d’Aëtius, dont personne n’a jamais parlé? Pourquoi pas; n’a-t-on pas inventé la première expédition d’Attila dans les Gaules, et cette belle invention ne trouvet-elle pas, de nos jours encore, de savants et chauds défenseurs?
La fondation du premier royaume de Bourgogne est évidemment l’un des démembrements les plus notables que l’Empire d’occident ait subi dans le cours du cinquième siècle. Or, en 443, un tel démembrement ne se conçoit en aucune façon.
Quelques historiens, M. Roger de Belloguet entr’autres, pour concilier le texte de Tyro avec l’ensemble des faits que l’histoire rapporte, ont cru que les Burgondes vinrent d’abord dans la Sabaudia, puis se répandirent de là, peu à peu, dans les provinces environnantes, dans l’Helvètie et dans la Séquanaise au nord, dans la Lyonnaise à l’ouest, dans la Viennoise au sud. Cette expansion graduelle est en effet la seule hypothèse possible; mais elle est aussi en contradiction formelle avec des sources plus sûres et plus considérables que celle à laquelle on se tient. Marius et Eusèbe ne nous disent rien de cette expansion graduelle, ou ils racontent le fait tout autrement, et tous deux de la même manière. Pourquoi d’ailleurs cette /62/ expansion subite, énorme d’un peuple qui vient d’être à peu près anéanti? « Gens penè deleta. » On se représente mal aisément aussi cette marche compliquée des Burgondes qu’on a amenés depuis Worms en Savoie et qui reviennent bientôt après de la Savoie jusqu’aux territoires des Lingons et des Eduens, et dans les cantons des Vosges qui confinent au Palatinat 1 .
Les hypothèses qui admettent la destruction de la plus grande partie des Burgondes par Aëtius en 436, ou par les Huns en 437 2 , et l’établissement des restes de leur peuple en Savoie en 443, se heurteraient encore à bien d’autres difficultés. Pour ne pas trop allonger, je me borne à rappeler ce passage de la loi Gombette où la bataille de Mauriac est mentionnée comme formant, en quelque sorte, une ère nouvelle dans la vie du peuple burgonde, un moment au delà duquel il est interdit de faire remonter les procès. Si la destruction partielle de ce peuple datait de 436 ou de 437 et si son établissement dans ses nouvelles demeures datait de 443, la loi n’aurait-elle pas choisi l’une ou l’autre de ces dates pour fixer ce moment au delà du quel on ne remonte plus?
Plaçons-nous maintenant l’établissement définitif et la fondation du royaume burgonde à la date qu’indique Marius? Aussitôt les nuages, les obscurités, les contradictions disparaissent. /63/
En 436, Gundahar ayant fait la paix avec Aëtius, comme le racontent Cassiodore et Prosper d’Aquitaine, est revenu dans ses quartiers de Worms, attenant aux anciennes demeures de son peuple sur la rive droite du Rhin. Là il a pu avoir avec Attila ces rapports auxquels les Niebelungen, l’Edda et Walther d’Aquitaine ont fait tant de fois allusion; là il dut recevoir le premier choc de l’invasion hunnique, ainsi que Paul Diacre nous le rapporte expressément.
La contrée où les Burgondes étaient établis en premier lieu était déjà trop resserrée pour les besoins de la nation; en 451, elle fut ravagée affreusement soit au début, soit à la fin de l’invasion; il est donc assez naturel que depuis ce moment les Burgondes aient cherché de nouvelles demeures 1 .
En 452, Aëtius a été rappelé des Gaules pour défendre l’Italie; en 454, ce héros fut assassiné par l’ingrat Valentinien. Les destinées de Rome sont accomplies dès cette heure.
Les nations germaniques qui avaient aidé à défendre la Gaule contre les Huns sont désormais seules maîtresses dans cette partie de l’Empire, déjà aux trois quarts renversé. /64/ L’effroi inspiré aux populations gallo-romaines par les désastres antérieurs, la disparition du pouvoir impérial, la confiance qu’inspire la valeur déployée par les Burgondes dans la terrible guerre par laquelle on vient de passer, expliquent l’appel que les indigènes adressent à ce peuple, selon Eusèbe, et le partage amiable des terres qui, selon Marius, fut opéré en leur faveur par les autorités municipales des provinces gauloises dans lesquelles ils se sont établis. Ainsi, autant la conciliation des divers témoignages serait difficile en 443, autant tout s’arrange aisément et naturellement en 456. A nos yeux il n’est pas de discussion critique et scientifique qui puisse balancer une semblable preuve; la concordance du contenu des sources avec l’ensemble des faits concomittants; la vraisemblance parfaite d’une allégation, comparée aux circonstances générales au sein desquelles elle prend place.
Si la date de 443, donnée à la fondation du royaume burgonde, pouvait aussi s’accommoder avec tout ce que nous savons de l’histoire contemporaine, encore faudrait-il voir si Tyro seul doit l’emporter sur l’unanimité des témoignages de Marius, d’Eusèbe, de Paul Diacre, de la Chronique anonyme, de la loi Gombette et des traditions germaniques. Mais si le fait qu’on place à cette date de 443, ne présente aucune vraisemblance, si en 456 il a pour lui, au contraire, toutes les vraisemblances, convenons que préférer la source unique à des témoignages concordants, nombreux et beaucoup plus plausibles, c’est vouloir proclamer l’erreur!
Un dernier mot sur ce sujet: L’âge de Gundahar ne saurait être objecté à ceux qui pensent que sa vie s’est prolongée jusqu’à l’invasion de 451. En supposant qu’il /65/ eût 25 ans quand, en 412, il participait à l’élévation de Jovin, en 451 il aurait eu 63 ans. D’un autre côté, si Gundahar a vécu jusqu’en 451, il n’y a rien de surprenant à ce que ses successeurs ne soient nommés qu’en 455, à l’occasion de la guerre d’Espagne; s’il était mort, au contraire, en 436, il serait au moins singulier de rencontrer une lacune de vingt ans, durant laquelle les historiens ont souvent parlé des Burgondes, sans rien nous dire de leurs chefs.
Pour celui qui nous a lu jusqu’ici avec quelque attention, il est clair que la mort de Gundahar en 436 ou 437 se rattache nécessairement à la fondation du royaume burgonde en 443, et que Gundahar vivant en 451 suppose au contraire la vérité du récit de Paul Diacre au sujet de sa mort et par conséquent l’établissement définitif des Burgondes en 456.
L’établissement définitif eut donc lieu, croyons-nous, lorsque l’armée burgonde revint d’Espagne, pendant l’interrègne qui suit la déposition d’Avitus.
Cédant aux conseils de Sidoine Appolinaire, chef du parti opposé à Ricimer et à Majorien, Lyon, la cité la plus importante des Gaules après Arles, cherchait alors à s’assurer le secours des sujets du roi Gundioch 1 .
Majorien étant venu dans les Gaules en 450, battit les Wisigoths, puis força Gundioch à lui rendre Lyon, que les Burgondes recouvrèrent seulement douze ans plus tard, par suite d’un traité qu’ils firent avec Anthémius.
Le premier royaume de Bourgogne n’eut donc pas dès /66/ l’origine toute l’étendue qu’il acquit peu de temps après. Lorsque Majorien eut repris Lyon à Gundioch ce royaume se bornait fort probablement aux hauts plateaux du Jura et des Alpes occidentales; il comprenait l’Helvétie méridionale, la Sabaudia et la Séquanaise; par le pays des Lingons, il aboutissait aux Vosges et aux établissements primitifs sur la rive gauche du Rhin.
En 471, Majorien, ayant été vaincu dans une expédition qu’il avait dirigée contre les Vandales d’Afrique, fut assassiné à son retour en Italie, sur les instigations de Ricimer, lequel donna pour successeur à cet empereur de mérite une de ses créatures appelée Livius Severus. Egidius qui était attaché à Majorien s’entendit alors avec Genseric, roi des Vandales, et proclama Olybrius 1 .
Les Wisigoths et les Rurgondes prirent au contraire le parti de Sévère 2 , et ce prince nomma Gundioch maître des milices des Gaules en lieu et place du brave Egidius 3 . Egidius meurt empoisonné en 464; Severus disparaît de la scène à peu près dans le même temps. Après un interrègne de deux ans, Léon Ier, empereur d’Orient, met sur le trône d’Occident un de ses sujets nommé Anthémius.
Euric, roi des Wisigoths, venait de succéder à Théodoric; celui-ci non moins ambitieux que son frère, jugea le moment favorable pour se déclarer totalement indépendant et pour attaquer Rome. Il venait de prendre les riches cités d’Arles et de Marseille, et menaçait de s’emparer aussi de l’Auvergne, lorsque l’empereur Anthémius, afin /67/ de sauver au moins cette province, offrit à Gundioch de lui céder Lyon avec les contrées environnantes, la Bresse, le Maçonnais, le Viennois et le Vivarais. Ces événements se passaient en 470 1 .
Dès ce moment le royaume de Bourgogne eut, ou peu s’en faut, les limites qu’il conserva dès lors. Il s’étendait des Vosges à la Durance, dans la direction du nord au midi, et de l’Aar à la Saône et à la Haute-Loire, en allant d’orient à occident.
L’année précise de la mort de Gundioch ne nous est pas parfaitement connue; cependant on s’accorde à penser qu’il mourut après son frère Chilpérik Ier et que ses quatre fils lui succédèrent dès 471. Le traité conclu avec Anthémius pour la défense de l’Auvergne fut donc le dernier acte politique important de la vie du roi Gundioch. Chilpérik n’avait pas laissé d’enfants et l’on a cru qu’il était mort empoisonné 2 . Comme son frère, il avait été revêtu de la dignité de maître des milices romaines 3 .
/68/
§ 3
Règne de Gondebaud.
(470 à 516.)
I. GONDEBAUD ET SES FRÈRES.
(470 à 500.)
Gundioch avait eu quatre fils, dont Gondebaud ou Gundobald était l’aîné; les trois autres se nommaient Chilpérik, Godomar et Godegésile 1 . A la mort de leur père, chacun d’eux eut sa part du royaume, on le présume du moins; toutefois Gondebaud aurait eu sur ses frères une certaine prééminence, destinée à maintenir l’unité du royaume récemment fondé.
Quelle fut au juste la part de chaque fils de Gundioch? On est réduit sur ce point à des suppositions. Les historiens disent que Gondebaud régnait sur les provinces centrales et avait Lyon pour capitale; que Chilpérik avait /69/ Genève avec la Sabaudia 1 ; Godomar, Vienne et la province de ce nom; Godegésile, la Séquanaise.
En 471, Chilpérik II gouvernait Lyon avec le titre de magister militum que son père et son oncle avaient déjà porté. Gondebaud reçut en 472 de l’empereur Olybrius une dignité plus élevée encore, celle de patrice, avec laquelle Ricimer, oncle maternel de Gondebaud, gouverna si longtemps l’empire 2 .
Olybrius étant mort en 473, le nouveau patrice qui séjournait auprès de la cour impériale en vertu de ses fonctions contribua à l’élection de l’empereur Glycérius 3 .
Selon du Roure 4 , Gondebaud, durant son séjour en Italie, aurait été exilé et dépouillé de sa part au royaume paternel. Dans ses récits du Ve siècle M. Amédée Thierry donne cette version; mais il est infiniment plus probable que la dignité de patrice fut conférée à Gondebaud précisément parce qu’il était le principal chef de la nation burgonde, et parce qu’on voulait s’assurer à Ravenne du concours bienveillant de cette nation.
L’histoire parle d’une guerre qui eut lieu entre Gondebaud et ses frères: mais cette guerre eut lieu seulement en 476. L’exil de Gondebaud en 470, est, à mon sens, une pure imagination.
Tandis que Gondebaud faisait un empereur en Italie, son frère Chilpérik et Ecdicius, fils de l’empereur /70/ Avitus, défendaient vaillamment, mais sans succès, l’Auvergne, contre les Wisigoths. Augustonomète, capitale de cette province (aujourd’hui Clermont), fut prise par Euric . Les Bretons d’Armorique, alliés des Burgondes, furent également défaits par les Wisigoths auprès de Bourges et leur roi Riothyme se retira auprès des Burgondes avec le reste de ses troupes 1 .
Cette guerre d’Auvergne dure presque sans interruption de 470 à 475. Les Wisigoths en demeurent maîtres et Nepos finit par la leur céder définitivement.
Les rapports intimes des Burgondes avec l’Empire romain sont attestés par les faits qui précèdent; mais ils n’ont pas été envisagés, ce me semble, à leur vrai point de vue. On a pris pour dépendance obligée ce qui n’était qu’une politique fort habilement calculée chez les princes de cette nation.
Gondebaud et ses frères avaient alors à redouter la puissance des Wisigoths; de plus, ils avaient à faire accepter et à consolider, parmi leurs sujets gallo-romains, une autorité de toute fraîche date. L’alliance de Rome, qu’ils cultivent, les dignités romaines, dont ils se parent, sont pour eux un moyen de gouvernement. Tout en exerçant le pouvoir monarchique sur leurs nouveaux sujets à l’aide des traditions impériales, les rois burgondes relevaient aussi ce pouvoir vis-à-vis de leurs concitoyens.
Si Gondebaud apparaît dans l’histoire avec une toute autre figure et de tout autres droits qu’un Hendin burgonde, il le doit en partie au titre de patrice dont Ravenne l’avait revêtu. /71/
Tandis que Chilpérik guerroye dans les Gaules, Gondebaud essaya un moment de remplir en Italie le rôle de son oncle Ricimer; mais la cour de Constantinople n’avait pas abdiqué toute prétention à une influence prépondérante dans les affaires de l’empire d’Occident, et Léon Ier, qui avait fait triompher ces prétentions par l’élection d’Anthémius, n’était nullement disposé à les abandonner en faveur d’un prince germain. Il repoussa le choix de Glycérius et envoya en Italie Nepos, son parent, à la tête d’une forte armée. Gondebaud, qui ne connaissait pas à fond les ressorts de la politique italienne, ainsi que son prédécesseur, et que son peuple, à qui les Wisigoths donnaient fort affaire, ne pouvait soutenir utilement, céda la place au protégé de l’empereur d’Orient.
En 474 déjà, Nepos était reconnu en Italie et Gondebaud, qui n’avait pu maintenir Glycérius, était revenu dans ses états héréditaires. Deux ans plus tard, l’empire d’Occident cessait tout à fait d’exister. Romulus Augustule, successeur de Nepos, ayant été détrôné par l’un des chefs barbares préposés à la défense de l’Italie, Odoacre roi des Hérules.
L’histoire de tous les royaumes barbares fondés par la race germanique dans le milieu romain est entachée dans ses commencements par une succession de crimes qui rappellent les jours des Atrides. La descendance de Gibich ne fut pas plus exempte de cette fatalité que celles d’Alboin, d’Euric et de Clovis. Quelles ont été les causes de la discorde qui éclata entre les fils de Gundioch peu après le retour de Gondebaud? Nous sommes réduits sur ce point à des suppositions. — Les faits ayant été rapportés par un seul écrivain, ennemi déclaré des Burgondes et de /72/ Gondebaud, partisan enthousiaste des Francs, leurs rivaux et plus tard leurs vainqueurs, nos renseignements sont assurément fort suspects, et il n’y a nul moyen de les vérifier. Voici, toutes réserves prises, le récit de Grégoire de Tours:
A peu près vers le temps où l’Italie tombait au pouvoir du chef des Hérules (476), Chilpérik et Godomar s’allièrent aux Alamans contre leur frère Gondebaud. Vainqueurs dans une bataille livrée auprès d’Autun, les Alamans ravagèrent cruellement le pays des Burgondes, puis se retirèrent chez eux avec tout leur butin. Aussitôt les Alamans hors du royaume, Gondebaud trouva moyen de relever ses affaires; les populations ne pardonnaient pas à ses frères la conduite qu’ils avaient tenue en s’associant à leurs plus cruels ennemis. Chilpérik et Godomar, repoussés par leurs sujets, se réfugient dans la ville de Vienne, Gondebaud les y poursuit et emporte la ville d’assaut. Godomar périt dans le combat. Chilpérik et toute sa famille tombent au pouvoir du vainqueur, qui fait massacrer Chilpérik et ses deux fils, noyer la reine, sa femme, dans l’Isère, et n’épargne que deux filles, dont l’aînée, nommée Chrona, prit le voile dans la suite et vécut à Genève; la plus jeune, la célèbre Clotilde, qui épousa dans la suite Clovis, demeurait auprès de sa sœur 1 . /73/
Nous savons par Sidoine Appolinaire que la femme de Chilpérik II se nommait Agrippine; il la nomme une nouvelle Tanaquil, la protectrice des Romains 1 ; il est vraisemblable que cette princesse était d’origine gallo-romaine et que son ambition poussa son mari dans la voie où il trouva sa perte.
Dans une lettre adressée par Avitus, archevêque de Vienne, au roi Gondebaud 2 , se trouve un passage où ce prélat fait allusion à la douleur qu’aurait causée à Gondebaud la mort violente de ses frères. Quelques historiens en ont voulu conclure qu’il ne fut pas l’auteur de cette mort. Je ne pourrais me prononcer sur ce point. D’une part, on répugne à attribuer à un prince éclairé, dont les contemporains ont souvent vanté la douceur, la barbarie dont l’accuse Grégoire de Tours; de l’autre, la mort de Chilpérik et de sa famille fut si cruellement vengée plus tard, par Clotilde et ses enfants, qu’on a peine à admettre qu’elle ait été seulement l’effet de quelque malheureux accident, et que Gondebaud n’en fût point imputable.
Après la mort de Chilpérik et de Godomar, un nouveau partage du royaume eut lieu entre Gondebaud et Godegésile. Ce dernier prit pour capitale Genève.
A peine Gondebaud était-il sorti de ces dissensions intestines, qu’il entreprenait de tirer parti de la minorité d’Alaric II, successeur d’Euric, pour s’étendre aux dépens des Wisigoths. La Provence, qu’Euric avait conquise /74/ sur les Romains en 470, fut rattachée au royaume des Burgondes peu après la mort de ce prince, qui était survenue en 484 pendant une expédition qu’il faisait en Auvergne 1 . Gondebaud la conserva jusqu’en 500, où Marseille et Arles, c’est-à-dire toute la Provence méridionale, tombèrent au pouvoir des Ostrogoths, en cette occasion alliés de Clovis 2 .
Gondebaud se mêla aussi activement dans les affaires d’Italie; il avait pris parti pour Odoacre contre les Ostrogoths, lorsque ce prince eut succombé, il chercha encore à enlever l’Italie à Théodoric. Dans une expédition qu’il fit en Ligurie et en Lombardie en 492, il obtint des succès et ramena de nombreux prisonniers.
C’est cette expédition qui donna lieu, en 494, à l’ambassade d’Epiphanius, évêque de Pavie, qui a été racontée par son compagnon Ennodius, évêque de Turin. Théodore-le-Grand avait chargé ses députés de demander à Gondebaud la paix et le rachat des prisonniers qu’il avait faits. Gondebaud rendit sans rançon tous ceux qui n’avaient pas été pris les armes à la main 3 . De Lyon, où ils avaient trouvé Gondebaud, les députés de Théodoric allèrent à Genève, résidence de Godegésile; celui-ci, ayant appris le parti suivi par son frère, crut devoir agir de la même façon. Une autre conséquence de cette ambassade fut le mariage de Sigismund, fils de Gondebaud, avec Ostrogotha, fille du roi Théodoric.
En ce temps-ci, se placerait aussi la légende plus ou /75/ moins romanesque du mariage de Clotilde, fille de Chilpérik, avec Clovis. S’il en faut croire Grégoire de Tours et Fredegaire, un envoyé du roi des Francs, nommé Aurélien, vint à Genève, déguisé en mendiant et remit l’anneau de fiançailles de Clovis à la jeune fille. Celle-ci accepta cette demande, par le conseil de St. Loup. On ajoute que lorsque Gondebaud eut consenti au mariage de sa nièce, Clotilde pressentant qu’il changerait bientôt d’avis, fit faire diligence à son escorte et échappa par cette précaution aux gens que Gondebaud avait envoyés après elle pour la retenir. La première grâce que la jeune reine demanda à son époux fut d’incendier les douze derniers villages de Bourgogne par lesquels elle avait passé en dernier lieu.
Le mariage de Clotilde se rapportant chronologiquement à l’an 491, et la rupture entre Clovis et Gondebaud n’ayant eu lieu que plusieurs années après, la fausseté du dernier trait de ce récit est évidente. Il paraîtrait tout au contraire que Gondebaud crut pendant quelque temps à l’amitié que le roi des Francs lui témoignait, car, s’il eût pensé avoir à redouter cet ennemi, il n’aurait pas entrepris son expédition d’Italie en 492.
Il y a plus, lorsqu’en 496 Clovis défit les Alamans à Tolbiac, Gondebaud était encore son allié, et ce fut à la suite de cette victoire que les Burgondes étendirent leurs frontières en Helvétie, jusqu’aux rives du Rhin et de la Reuss. La présence de l’évêque de Vindonissa au concile d’Epaône est une preuve de cette acquisition, le nom de petite Bourgogne que la contrée située entre l’Aar et la Reuss conserva pendant plusieurs siècles, lui fut probablement donné à la suite de cet événement. /76/
Chacun sait comment au fort de la mêlée de Tolbiac, Clovis, voyant la victoire douteuse, fit vœu, s’il l’obtenait, d’adorer le dieu de sa femme Clotilde; celle-ci était catholique, tandis que les Burgondes, ainsi que les Wisigoths, appartenaient à la secte arienne. Dans cette circonstance, on s’accorde à trouver la véritable cause de la haute fortune à laquelle parvinrent les Francs bientôt après. Les populations gallo-romaines étaient toutes catholiques et leur clergé avait acquis sur elles une immense influence, soit en raison des malheurs éprouvés qui jettent volontiers les esprits dans la religion, soit en raison des services que l’Eglise rendait et des mérites distingués qu’elle déploya.
En ces temps singuliers, les passions religieuses, les haines confessionnelles firent ce que toutes les oppositions de race, de langue et de mœurs n’avaient pas pu faire; elles rallièrent les populations indigènes et mirent ainsi au service du clergé catholique une force matérielle qui aurait peut-être suffi pour sauver l’Empire un quart de siècle auparavant.
Puissant par ses lumières, par ses richesses, par son ascendant sur les populations, le clergé catholique des Gaules entretenait des relations constantes avec Rome et Constantinople. Il forma le hardi dessein de combattre avec l’épée du néophyte franc ses maîtres ariens. Une conspiration peu déguisée s’ourdit dans toute la Gaule au profit de Clovis. Le ressentiment implacable de Clotilde s’unit aux excitations des évêques pour offrir les états de Gondebaud comme but à l’ambition du roi des Francs. Des intelligences furent nouées dans toute la Bourgogne, Godegésile lui-même, gagné par sa nièce, avait secrètement /77/ promis de se joindre, le moment venu, aux ennemis de Gondebaud.
Le chef du parti catholique en Bourgogne était alors Avitus, évêque métropolitain de Vienne et petit-fils de l’empereur dont il portait le nom. La correspondance de ce prélat qui nous est conservée montre que Gondebaud vit les périls dont il était entouré et en comprit fort bien la cause 1 .
Comme les évêques de son royaume, réunis en concile à Lyon en 499, lui demandaient d’abjurer la foi arienne ou, du moins, de permettre une discussion publique entre les sectateurs des deux confessions opposées, Gondebaud leur répondit de manière à faire sentir qu’il pénétrait leurs intentions.
« Si votre foi était la vraie, pourquoi ne vous séparez-vous pas du roi des Francs, qui veut me faire la guerre et s’entend avec mes ennemis. Je n’appelle pas la vraie foi celle qui convoite le bien d’autrui et a soif du sang de mon peuple. » — Avitus lui répliqua en ces termes:
« Nous ne savons pas, prince, si le roi des Francs a les intentions que vous dites, mais l’Ecriture nous apprend que celui qui s’écarte de la loi de Dieu est bien près de la ruine et que, contre l’ennemi de Dieu, des ennemis s’élèveront de toutes parts. Mais entrez dans le sein de l’Eglise et vous n’aurez plus rien à craindre de vos ennemis. »
La dispute de religion eut lieu, mais non pas en public, car l’excitation des partis religieux était si grande qu’on redouta qu’ils n’en vînssent aux mains dans la ville. /78/ Gondebaud assista aux conférences pendant deux jours; elles n’aboutirent à rien.
Je ne sais pas pourquoi M. Derichsweiler, qui apprécie justement la portée de la question confessionnelle dans toute cette partie de l’histoire du premier royaume de Bourgogne, veut cependant, à tout prix, que les Burgondes aient été catholiques dans l’origine, et ne se soient convertis à l’arianisme que par l’effet de l’influence des Wisigoths. Cette supposition est peu probable, car si les Burgondes s’étaient convertis à l’arianisme depuis leur arrivée dans le Lyonnais, par conséquent depuis leur mélange avec des populations plus nombreuses, plus avancées en civilisation et décidément catholiques, on trouverait dans les historiens contemporains quelques indices d’un fait de nature à faire autant de sensation. On voit d’ailleurs par l’histoire de Sigismond, fils et successeur de Gondebaud, que l’arianisme était bien la religion du peuple burgonde, car la conversion de Sigismond au catholicisme compta précisément parmi les causes qui lui aliénèrent le plus les cœurs de ses concitoyens.
L’issue des conférences de Lyon fut le signal d’aller en avant pour Clovis. Le prétexte dont il se servit était la revendication de l’héritage de Clotilde. Gondebaud dut comprendre alors combien son conseiller Arétius avait raison lorsqu’il cherchait à le dissuader de l’alliance demandée par le roi des Francs. On rapporte en effet qu’il avait prononcé à cette occasion ces paroles vraiment prophétiques: « Le mariage que vous autorisez ne sera pas un lien d’amitié entre les deux peuples, mais le commencement d’une guerre sans fin. »
La guerre commença et se termina, ou peu s’en faut, /79/ dans le courant de l’année 500. Godegésile joignit ses troupes à celles de son frère, mais lorsqu’on en fut venu aux mains vers la rivière de l’Ouche, près Dijon, lui et les siens se tournèrent subitement du côté du Salien. Cette trahison inattendue décida du sort de la bataille. Gondebaud poursuivi sans relâche, dut traverser tout son royaume, du nord au sud, avant de pouvoir trouver un refuge et d’être en état de faire une seconde fois face à ses ennemis. Les villes en majorité catholiques, ouvraient les unes après les autres leurs portes aux vainqueurs. Enfin le roi parvint à réunir les forces qui lui restaient dans les murs d’Avignon et les Francs furent arrêtés. La valeur des assiégés fit tirer le siége en longueur. Clovis, inquiet d’être coupé s’il demeurait plus longtemps à une si grande distance de ses états, conclut la paix moyennant un tribut annuel 1 .
Aussitôt les Francs rentrés chez eux, Gondebaud mit ses troupes en marche contre Godegésile. Celui-ci, comme autrefois ses frères, s’était renfermé dans Vienne; Clovis lui avait laissé une division franque, qui avait pour mission de le protéger. Gondebaud parvint néanmoins à pénétrer dans la cité. Godegésile, au rapport de Grégoire de Tours, chercha en vain son salut au pied de l’autel, il fut massacré sans pitié; ses principaux complices furent aussi punis de mort. La garnison franque, faite prisonsonnière en entier, fut livrée par Gondebaud aux Wisigoths, ariens comme lui et, comme lui, fort mal avec Clovis. Plusieurs évêques bourguignons qui avaient manifesté trop clairement leur prédilection pour Clovis furent /80/ obligés de chercher un refuge auprès du roi des Francs 1 .
Gondebaud reconquit ainsi en quelques semaines un royaume qu’il avait presqu’entièrement perdu dans un espace de temps également fort court. Cependant il ne put recouvrer les cités et les territoires d’Arles et de Marseille dont les Ostrogoths s’étaient emparés pendant qu’il était aux prises avec Clovis. Par cette langue de terre le long de la côte le royaume des Ostrogoths touchait à celui des Wisigoths, leurs congénères. Gondebaud acheta par ce sacrifice, sinon l’alliance, du moins la neutralité du plus illustre et du plus puissant d’entre les princes germaniques qui, pour lors, se partageaient les débris de l’empire romain 2 .
II. GONDEBAUD SEUL.
(500 à 516.)
Par un retour subit de la fortune, Gondebaud était venu à bout de tous les ennemis qu’il avait dans son propre royaume. Avitus, lui-même, le chef du parti catholique, entre dès ce moment avec lui dans de bons rapports; dans l’une de ses lettres, ce prélat va jusqu’à avouer que « le nombre des personnes souveraines menaçait la prospérité du royaume, et que la Providence a conservé celui-là seulement qui était le plus apte à l’empire 3 . /81/
Redevenu maître chez lui, Gondebaud refusa à Clovis le tribut stipulé à Avignon, et le monarque franc conclut un autre traité dans lequel il y renonçait. Si, au lieu de traiter en ce moment-là, Gondebaud s’était réuni aux Wisigoths, ces deux peuples auraient probablement pu arrêter dans ses premiers développements la puissance qui devait plus tard les subjuguer; par l’entremise des évêques, Clovis évita ce danger.
Gondebaud, libre désormais de se consacrer aux soins du gouvernement intérieur, s’imposa la tâche d’apaiser les partis et de donner à l’état une organisation régulière. Cela n’était pas chose des plus faciles. Il fallait former un tout de deux peuples de race, de langue, de mœurs et de civilisation différentes.
Une difficulté plus grande encore provenait de ce violent antagonisme religieux qui venait de mettre le royaume à deux doigts de sa perte. Malgré la prompte victoire de Gondebaud, les partis religieux étaient encore puissants et paraissaient irréconciliables. Gondebaud devait-il essayer de la persécution envers la majorité de ses sujets qui professaient la religion de Rome? Le gouvernement énergique d’Euric venait d’employer ce moyen auprès des Wisigoths; il lui avait assez mal réussi. Gondebaud montra la sagesse d’un véritable homme d’état dans le parti qu’il prit d’assurer dans son royaume, aux deux confessions également, liberté et sécurité. Il devait éviter de s’aliéner ses sujets de race germanique, tous ou presque tous ariens, et qui formaient sa principale force. Mais il fallait aussi chercher à se concilier les catholiques et leur clergé, unique dépositaire de ce qui restait alors de civilisation et de lumières./82/
Avitus aida considérablement le roi dans l’accomplissement de ses desseins. Gondebaud poussa de son côté la confiance jusqu’à remettre au prélat catholique l’éducation de son fils Sigismund.
En 501, aussitôt après avoir conclu la paix avec Clovis, Gondebaud proposa aux états de son royaume, réunis à Ambérieux près Lyon, diverses lois destinées à fixer équitablement les rapports des nouveaux et des anciens habitants du pays. Nous examinerons tout à l’heure cette législation, tout au moins au point de vue politique.
La manière même en laquelle Gondebaud a publié ces lois montre un progrès de l’autorité monarchique. Dans l’ancienne constitution germanique, qui était sûrement aussi celle des Burgondes, le pouvoir législatif, le droit de rendre la loi émanait de l’assemblée du peuple; les décrets d’Ambérieux sont proposés et promulgués par le roi, acceptés par les comtes et les grands du royaume. L’assemblée des hommes libres est ainsi remplacée par une sorte de gouvernement représentatif, mieux approprié du reste à l’étendue de l’état.
On voit aussi par l’édit de promulgation de 501 que, là où la loi est muette, c’est la décision du roi qui supplée 1 .
En 506, mourut Caratène, femme de Gondebaud, dont le tombeau se voit encore dans une des églises de Lyon 2 .
En 507, commence entre les Francs et les Wisigoths la grande lutte qui devait décider à qui, de l’arianisme ou du /83/ catholicisme, appartiendrait désormais l’Occident. Dans cette occurrence Gondebaud eut grand tort de ne pas écouter les sages conseils de Théodoric qui l’engageait à se porter médiateur, et pour le cas où il ne pourrait pas empêcher le conflit, à se ranger avec les Wisigoths.
Entraîné par les promesses fallacieuses de Clovis et par ses conseillers catholiques, Gondebaud ne fit ni l’un ni l’autre; il assista passif à la lutte des deux peuples avec lesquels il partageait la Gaule. Par là il compromit à jamais l’avenir de ses propres sujets. Une seule bataille décida tout. Alaric II tomba à Vouglé, et la domination des Wisigoths dans la Gaule méridionale cessa, pour ainsi dire, du même coup. Dès lors, l’équilibre était décidément rompu et Gondebaud, du faîte de la prospérité à laquelle il était parvenu, put déjà prévoir le sort réservé à ses propres enfants.
L’envie de reprendre la Provence méridionale aux Ostrogoths fut peut-être ce qui contribua le plus à égarer la politique ordinairement plus prévoyante, plus sagace du monarque burgonde.
En 508, en effet, Gondebaud entra en campagne et débuta par reprendre Narbonne aux Ostrogoths; il vint en suite assiéger Arles, que Tholuic, général de Théodoric, défendit fort courageusement. La ville était cependant pressée au point de se rendre, lorsque Ibbas amena une armée d’Italie et força la levée du siége 1 .
Les Francs faisaient cause commune, semble-t-il, avec les Burgondes, car les historiens goths rapportent que /84/ dans cette campagne Ibbas en fit prisonniers 30 000 et les envoya au roi Théodoric 1 .
Une certaine obscurité règne sur les mouvements ultérieurs des quatre peuples barbares qui sont aux prises dans la Provence durant cette année 508.
Ibbas reprit Narbonne aux Burgondes et remit tout le pays environnant aux mains des Ostrogoths; puis en 510, autant qu’on le peut comprendre, Arles fut assiégée une seconde fois par les Burgondes et les Francs réunis. Tholuic la défendit encore cette fois avec une remarquable énergie. Les machines avec lesquelles il empêchait l’ennemi d’approcher des remparts rappellent celles dont se servit Archimède pendant le siège de Syracuse. Ce second siége d’Arles a passé quelquefois pour une reproduction du premier, résultant d’une différence de date entre les chroniqueurs, mais cette hypothèse tombe devant la précision d’une lettre de Théodoric aux habitants d’Arles, dans laquelle le roi cède à cette ville tous les impôts de l’année en raison de ce qu’ils ont souffert 2 .
Les assiégeants avaient cependant noué quelques intelligences dans l’intérieur de la cité. Césarius, évêque catholique, étant soupçonné d’y prendre part, fut menacé d’être jeté au fleuve et plus tard exilé à Bordeaux. Les vivres commençaient à manquer, les murailles avaient des brèches sur plusieurs points, quand Marobaud, général de Théodoric, amena d’Italie de nouveaux renforts. Appuyé par une impétueuse sortie des assiégés, il mit les Burgondes et les Francs en déroute./85/
Non-seulement la Provence méridionale demeura aux Ostrogoths, mais Théodoric enleva encore aux Burgondes Orange et Avignon 1 .
Cependant à la paix, qui eut lieu dans la même année, tout le pays situé au nord de la Provence redevint de nouveau bourguignon 2 . Quant aux Wisigoths, ils ne conservèrent dans les Gaules que la Narbonnaise, celle de leurs provinces en deçà des Pyrénées qui se reliait le plus facilement à l’Espagne. L’Auvergne et l’Aquitaine tombèrent au pouvoir des Francs.
Quelques années avant sa mort, Gondebaud, qui connaissait par sa propre expérience les inconvénients du système germanique appliqué à la succession d’un royaume, fit proclamer Sigismund, son fils aîné, comme son successeur présomptif, dans une assemblée des grands du royaume tenue à Quadruvium (Carouge) 3 . Ce prince était déjà en âge de majorité et avait épousé Ostrogotha, fille de Théodoric-le-Grand 4 . La ville de Genève, qui avait été détruite durant la guerre contre les Francs, fut rebâtie en ce temps et destinée à devenir la résidence de Sigismund. En raison de sa position avancée, Lyon paraissait trop exposée aux attaques des Francs.
Gondebaud mourut en 516, après un règne de 44 ans. La période pendant laquelle il a gouverné seul fut incontestablement la plus brillante dans l’histoire du premier royaume de Bourgogne. /86/
Dans une vie mêlée de grands revers et d’éclatants succès ce prince avait fait preuve des grandes qualités que réclame le trône. Brave, éloquent, habile dans le conseil, prompt et énergique dans l’exécution, libéral dans ses vues, prenant feu facilement, mais humain dans ses sentiments; tel est le portrait que nous en ont laissé les hommes qui l’ont le mieux connu; l’évêque Avitus, l’ambassadeur Ennodius 1 .
La mort violente de ses frères lui est-elle imputable? Nous avons déjà examiné cette question sans pouvoir la résoudre. En tous cas, fort probablement cette mort a été dépeinte par Grégoire de Tours, l’historien de ses ennemis, sous des couleurs plus ou moins excessives. Du reste, on ne saurait dire qu’elle fût imméritée, les faits étant tels que l’écrivain franc nous les a rapportés. L’alliance de Gondebaud avec les Francs en 501 est la plus grave faute politique que l’on ait à lui reprocher; elle n’a qu’une excuse insuffisante dans la façon un peu leste en laquelle Théodoric-le-Grand lui avait enlevé la partie de son royaume par laquelle il touchait à la mer Méditerranée.
Si Théodoric, le souverain le plus éclairé, la plus grande figure du VIe siècle incontestablement, ne laissa qu’une œuvre éphémère, si Charlemagne lui-même n’a pu léguer à ses enfants un empire durable, ne reprochons pas trop au législateur des Burgondes la fort courte durée de /87/ sa dynastie. Les destins des empires ne tiennent pas seulement au génie de leur fondateur. Gondebaud unit le goût des lettres et l’intelligence de la culture romaine au sentiment profond de l’esprit de sa propre race. Il voulut être l’éducateur de son peuple. Guerrier habile et intrépide, un ardent désir de paix l’avait saisi à la vue des maux que la guerre causait à ses sujets. « Les temps ne sont-ils pas venus, s’écrie-t-il dans une de ses lettres au métropolitain viennois 1 , où, comme cela a été dit, les peuples feront de leurs épées des socs pour leurs charrues, et où les nations cesseront de lever le glaive les unes sur les autres! »
Les difficultés intérieures et extérieures, peut-être insurmontables, que rencontra son œuvre, ne devraient donc pas ôter à Gondebaud une place honorable, même glorieuse dans l’histoire de notre patrie. La haute tolérance dont il fit preuve dans une époque d’ardentes luttes religieuses, sa tendance constante à en appeler à la raison et à la justice plutôt qu’à la force, dont pourtant il montra savoir se servir, jettent, entr’autres, un jour assez inattendu sur le caractère de ce roi barbare. Ces traits le distinguent fort de la plupart de ses contemporains, même de la plupart de ses successeurs, ils le rapprocheraient un peu de nous autres modernes qui commençons à croire que le piédestal obligatoire d’un grand homme n’est pas la souffrance de l’humanité!
/88/
§ 4
Règne de Sigismund.
(De 516 à 523.)
Les partis politiques et religieux s’étaient apaisés sous l’administration prudente et ferme de Gondebaud; la puissance royale s’était notablement accrue; le pays était en paix et pouvait compter, au besoin, sur l’appui de Théodoric-le-Grand, qui aimait dans le fils de Sigismund son propre petit-fils. L’empereur d’Orient, Athanase II, montra sa considération pour Sigismund en lui conférant le titre de patrice que son père portait autrefois.
Il paraît qu’à son avènement Sigismund avait envoyé une ambassade à Athanase, mais Théodoric, qui était mal avec les Grecs, retint les députés en Italie. Ce fait est indiqué dans la lettre par laquelle Sigismund remercie l’empereur 1 ; lettre dont le style manque passablement de dignité. Les inférences qu’on en veut tirer touchant une prétendue vassalité du royaume de Bourgogne vis-à-vis de Constantinople me paraissent toutefois forcées. L’acte sur lequel on se fonde a la boursoufflure du style de chancellerie d’alors; rien de plus. Le roi s’y plaint de son beau-père Théodoric et désire des mesures contre l’hérésie; ce trait est significatif et montre que la lettre en /89/ question est l’œuvre de l’évêque d’Avitus, plus encore que celle du roi, au nom duquel elle est expédiée. En réalité que pouvait attendre ou redouter Sigismund de la cour de Constantinople? Celle-ci n’avait pas déjà le bras si long.
Le nouveau souverain avait adopté la foi de son précepteur et s’était converti au catholicisme. Un des premiers actes de son gouvernement fut la fondation de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune. La charte de fondation est de 523. Je ne vois pas de raisons pour penser qu’elle ne soit pas authentique. Sigismund donne au couvent qu’il institue de nombreuses propriétés dans les territoires de Lyon, Vienne, Grenoble, Aoste, Genève, Vaud et Valais 1 .
En 517, sur la demande du pape Hormisdas, Sigismund fit convoquer un concile national à Epaone; vingt-sept évêques du royaume de Bourgogne y assistaient, sous la présidence d’Avitus. On est en désaccord sur l’emplacement de cette localité. Quelques-uns ont parlé d’Evionnaz, village près de Saint-Maurice; d’autres en font Yenne en Savoie; selon l’opinion la plus accréditée, Epaone est l’ancien nom d’Albon, ville du Dauphiné. Les canons du concile d’Epaone laissent déjà percer deux tendances également dangereuses: celle d’établir la supériorité de l’Eglise sur le gouvernement civil, et un esprit d’intolérance à l’égard des ariens, des juifs et de tout ce que l’église catholique qualifie alors d’hérésie. La proposition fut même faite ouvertement de chasser les ariens de /90/ leurs églises. Avitus se vit obligé de modérer le zèle de ses collègues; il fit écarter cette proposition, mais il semblerait que Sigismund eût assez volontiers donné la main à des persécutions 1 .
On n’en saurait douter, c’est en abandonnant la ligne de conduite impartiale de son père dans les questions religieuses que Sigismund s’aliéna le cœur de son peuple et qu’au bout de peu d’années, cet avènement qui présentait tant de motifs de hautes espérances, aboutit à la plus triste catastrophe. Le roi était devenu en Bourgogne le centre de tous les rapports entre les deux nationalités; il constituait en sa propre personne l’unité de l’état. Du moment qu’il se montrait partial, une moitié de la nation se trouvait gravement menacée.
Sigismund, élevé par un homme distingué et pieux, était lui-même un prince instruit pour son temps et animé d’intentions excellentes; mais il y avait dans son caractère quelque chose d’incomplet, de féminin, qui ôtait à ses qualités presque toute leur valeur. Méfiant et pusillanime, prompt à passer d’un emportement extrême à l’accablement du désespoir, il compromit sa destinée par de graves fautes et ne sut que se repentir.
Sigismund essaya une fois de maintenir sa prérogative royale contre le haut clergé. Il s’agissait d’un mariage envisagé comme illicite. Avitus avait excommunié le chancelier Stephanus qui l’avait contracté. Sigismund voulut exiger le retrait du décret, menaça de tout son courroux son ancien précepteur; mais lorsque celui-ci eut fait /91/ confirmer sa décision dans un concile national, le roi s’effraya et demanda pardon 1 .
J’arrive au funeste événement qui entraîna sa perte et la chute du royaume burgonde.
Sigismund avait eu d’Ostrogotha, fille de Théodoric-le-Grand, un fils nommé Sigeric et une fille nommée Suavegotha, qui épousa en 515 Théodoric, roi de Metz, fils aîné de Clovis. Sigeric était un jeune homme donnant les plus belles espérances. Par malheur sa mère vint à mourir et Sigismund se remaria avec une femme d’Ostrogotha qui se nommait Constance. Sigeric laissa échapper son mécontentement. La nouvelle reine n’était pas digne, aurait-il dit, de porter les ornements qu’avait porté sa mère. Ce propos, rapporté et commenté, éveilla la haine de Constance; elle accusa Sigeric de viser à détrôner son père. Le faible et crédule monarque avait aperçu le mécontentement causé chez les Burgondes par ses tendances exclusivement catholiques et romaines; il s’effraya, perdit la tête et, sans ultérieures recherches, ordonna la mort de son fils.
Cette action insensée autant que criminelle souleva la tempête partout. C’était en 522. Les Burgondes se révoltèrent aussitôt. Clotilde, qui avait vu sa vengeance lui échapper vingt ans auparavant et n’avait jamais cessé d’y songer, comprit que l’heure était venue. Du cloître où elle vivait retirée depuis la mort de son mari elle supplia ses fils, Clodomir roi d’Orléans, Clotaire roi de Soissons, et Childebert roi de Paris, de ne pas laisser échapper /92/ l’occasion. « Je serais consumée de honte, leur dit-elle, si les fils que j’ai engendrés laissaient peser sur ma mémoire l’affront de n’avoir su venger le meurtre de mon père et de ma mère 1 . »
Les fils de Clovis obéissant à ces sollicitations maternelles entrèrent tous trois en Bourgogne. Théodoric de Metz ne se mêla pas de la guerre, il n’était pas fils de Clotilde. Théodoric-le-Grand, outré du meurtre de son petit-fils, envoya de son côté une armée pour occuper la Bourgogne méridionale. Ses troupes occupèrent les places situées entre la Durance et les Alpes tandis que les fils de Clovis envahissaient tout le nord du royaume 2 .
Dans ce désastre, Sigismund, abandonné de tous, pénétré de remords, ne savait que pleurer dans le sanctuaire d’Agaune et se morfondre en vaines pénitences. Son frère Godomar essaya seul de résister; il alla au-devant des Francs mais ses propres soldats se réunirent à ceux de Clodomir, tant l’exaspération contre Sigismund était forte. A cette nouvelle le malheureux roi chercha une retraite dans les montagnes; il aurait pu y demeurer caché; de perfides amis allèrent l’y chercher et lui persuadèrent de se déguiser sous le vêtement d’un simple moine et de rester à Saint-Maurice. Sigismund les écouta et fut livré par eux à Clodomir, ainsi que la reine Constance et leurs deux fils. Le roi d’Orléans les emmena dans sa capitale, et là, malgré les prières de son clergé, les fit /93/ tous massacrer; leurs cadavres furent jetés dans un puits qui a conservé le nom de la principale victime. On le montra longtemps dans le village de Columna sous le nom de puits de St. Sirmond.
La chronique de Marius indique 523 comme la date de la mort de Sigismund 1 , et Grégoire de Tours rapporte que St. Avit d’Orléans prédit à Clodomir que le sang innocent qu’il allait verser retomberait promptement sur sa tête 2 . En 527, Théodoric de Metz, qui avait succédé à son frère, fit recueillir les restes de la famille de son beau père et les fit porter à Saint-Maurice.
La piété de Sigismund, la prédilection constante qu’il avait montrée pour l’Eglise, lui valurent d’être placé au rang des saints, la légende a fait de sa mort tragique un martyre. Il y avait en effet dans le fondateur d’Agaune l’étoffe d’un saint moine, mais non celle d’un roi appelé à gouverner dans des temps difficiles un état nouvellement constitué. L’auteur de sa vie a pu s’extasier sur ses veilles, ses jeûnes, ses continuelles prières 3 ; mais l’histoire voit /94/ en lui un prince incapable, qui attira par sa faute sur lui-même, sur les siens, et sur tout son peuple, les plus terribles châtiments.
La chute de Sigismund précéda de quelques années seulement celle du beau royaume que son père et son aïeul avaient fondé. C’est par erreur que Grégoire de Tours, et quelques historiens d’après lui, confondent tout à fait ces deux événements.
/95/
§ 5
Règne de Godomar.
(524 à 534.)
Après la retraite des Francs, Godomar, qui avait pu échapper au destin de son frère, fut reconnu roi de Bourgogne 1 . Il s’empressa de faire la paix avec le roi des Ostrogoths au prix de quelques concessions territoriales et appela les Burgondes à combattre de nouveau pour leur indépendance. Clodomir d’Orléans et Théodoric de Metz réunirent aussitôt leurs forces contre lui et entrèrent en Bourgogne. L’armée des Francs rencontra celle des Burgondes à Veseronce, bourg situé dans le Bugey. Clodomir fut tué dans la mêlée, accomplissant ainsi la prophétie de l’évêque d’Orléans qu’on vient de rappeler. Le spectacle de la tête de leur souverain que les Burgondes portaient devant eux au bout d’une pique répandit le désordre et l’effroi dans les rangs des Francs qui, sans même essayer de renouveler le combat, s’enfuirent jusque dans leur pays 2 .
Grégoire de Tours, entraîné par sa prédilection particulière pour les Francs, a voulu nier cette défaite, il prétend que, malgré la mort d’un de leurs rois, /96/ ceux-ci obtinrent la victoire 1 . Son assertion est démentie par celle de contemporains, en cette occasion bien plus dignes de foi. Les suites d’ailleurs démontrent suffisamment à qui demeura la victoire. Godomar repoussa encore pendant dix ans consécutifs tous les efforts des enfants de Clovis. Courtépée, qui dans son histoire de Bourgogne a suivi, comme tous les modernes, la version donnée par Marius et par Agathias, se trompe lorsqu’il croit que, jusqu’en 534, Godomar fut laissé en paix. Les dernières lois burgondes, celles qu’on attribue à Godomar, témoignent d’un état de guerre et de perturbation des rapports sociaux résultant de l’hostilité permanente des Francs. Toutefois, les désordres de tous genres dont les états mérovingiens furent le théâtre depuis la mort de Clodomir peuvent avoir contribué à donner quelques moments de répit à la Bourgogne. Aucune paix ne fut conclue; seulement dans les premières années la guerre ne fut pas reprise avec vigueur. Clotaire et Childebert, après s’être partagé, en 426, les dépouilles des enfants de Clodomir, barbarement assassinés par eux, se ruèrent de nouveau sur Godomar, en 531. Théodoric d’Austrasie, qui était en dissentiment avec ses frères, refusa cette fois sa participation. Godomar se défendit pendant trois ans environ contre ses deux adversaires, sans avantages ni désavantages marqués. A la mort de Théodoric d’Austrasie, Théodebert, son fils et son successeur, joignit ses forces à celles de ses oncles. Les trois princes francs entrèrent en Bourgogne en 534, avec des forces considérables. Vaincu dans une sanglante bataille livrée /97/ dans la partie de son royaume qui limitait aux états de ses ennemis, Godomar rallia dans Autun les restes de l’armée burgonde et soutint un siége. Ce fut là son dernier effort.
Une certaine obscurité règne sur le sort ultérieur du second fils de Gondebaud. Le chroniqueur Addo prétend qu’il fut tué dans un combat; Procope, qu’il fut fait prisonnier 1 ; selon Marius, il se serait réfugié auprès des Wisigoths 2 . Ce dernier, plus rapproché du théâtre des événements, me paraît devoir être le mieux informé.
La Bourgogne, épuisée par de longues et sanglantes guerres, se soumit aux vainqueurs à la condition qu’elle garderait ses coutumes et ses lois et ne paierait pas de nouveaux tributs. Ainsi, tout en acceptant l’autorité des Mérowingiens, elle conservait cependant une certaine indépendance, son nom, son individualité, et durant les quatre siècles et demi que dura la domination franque, elle forma toujours un royaume distinct.
Cent vingt-sept ans s’étaient écoulés depuis que les Burgondes étaient entrés sur les terres de l’empire, et septante-huit ans, depuis leur établissement définitif.
/98/
§ 6.
Des institutions politiques.
I. Histoire extérieure de la législation burgonde.
Les monuments que nous possédons de l’autorité législative des Burgondes sont au nombre de deux: la lex Burgundionum, connue aussi sous le nom de lex Gundobada (loi Gombette), et la lex romana Burgundionum, communément appelée le Papien.
La première, qui régissait les Burgondes de naissance, est tirée essentiellement des coutumes germaniques antérieures à l’établissement; le Papien, destiné à régir les indigènes du royaume, est un abrégé du droit antéjustinien, accommodé aux besoins de la situation et aux nouvelles circonstances. Entre ces deux lois on observe un certain parallélisme et toutes deux témoignent du désir de rapprocher la race conquérante et la race conquise en établissant entr’elles des rapports bienveillants 1 . /99/
Selon de Savigny, la loi Gombette comprend plusieurs parties dont la rédaction remonterait à des époques différentes. Des vues divergentes touchant la composition de cette loi ont été émises par Gaupp (Germ. Ansied), elles ont les unes et les autres trouvé des sectateurs. Cette question a été traitée en dernier lieu avec beaucoup de soin par M. Bluhme 1 . Cet écrivain pense, comme de Savigny, que la première partie de la loi, contenant les 41 premiers titres, remonte à l’époque où le royaume de Bourgogne était encore partagé entre les fils de Gundioch (ainsi 470 à 480 environ). Il estime en revanche, comme Gaupp, que le titre 42, dont de Savigny fait une seconde préface et qu’il attribue à Sigismund, est une véritable constitution, une espèce de loi organique renfermant les prescriptions générales adressées aux officiers chargés de rendre la justice dans les divers lieux du royaume. Bluhme pense qu’elle date du moment où Gondebaud a commencé à régner seul (500 à 502). Seulement, en tête de la constitution de Gondebaud, on aurait intercalé dans le manuscrit une formule de promulgation datée de la deuxième année de Sigismund (517). On observe, en /100/ effet, que parmi les 31 noms de comtes burgondes qui souscrivirent l’ordonnance, un seul se retrouve dans les signatures apposées à la charte de fondation de Saint-Maurice, qui est de 523. Dans un espace de six ans, de pareilles mutations seraient fort improbables 1 .
Outre la partie la plus ancienne, allant jusqu’au titre 41, la loi burgonde se compose d’un grand nombre de lois détachées, d’époques différentes, mais qui, selon Bluhme, ont été placées, sans égard à leur date, dans l’ordre où nous les trouvons. Cet ordre leur fut donné probablement lors de la révision de ces lois qu’ordonna Sigismund à son avènement; Bluhme admet toutefois que le texte qui nous est parvenu puisse renfermer des lois postérieures à 517, en revanche, il doute qu’on en possède qui soient du temps de Godomar.
Partant de ce point de vue, Bluhme a réparti le premier additamentum, cru auparavant de la fin du règne de Sigismund, entre le corps de la loi et les extravagantes. Du deuxième additamentum, qui était attribué à Godomar, soit par de Savigny, soit par Gaupp, il a fait le titre 107, qu’il envisage comme une constitution traitant de /101/ sujets divers, rendue par Gondebaud, en l’année 510 1 . Ici je dois avouer que les arguments du savant critique ne m’ont point convaincu. Le titre 109 et dernier de l’édition de Bluhme contient une nouvelle extravagante de Sigismund, découverte par Pertz à Paris.
On ne peut douter de l’identité du Papien avec le recueil annoncé dans la loi Gombette comme devant être prochainement promulgué pour régler les rapports juridiques des anciens habitants du pays. Le mode de sa composition a donné lieu aussi à quelques controverses; l’opposition entre les critiques est pourtant moins complète que sur la loi Gombette. M. de Crousaz pense que le Papien fut rédigé sous Sigismond; il en donne pour preuve les titres 26 et 28, qui supposent l’existence des titres 51 à 53 de la loi Gombette publiés, comme la formule de promulgation, le 4 des calendes d’avril, sous le consulat d’Agapitus, et par conséquent en 517.
Le Papien rappelle par sa méthode l’édit de Théodoric. On y a fondu en un seul tout les textes romains et les changements que les circonstances forçaient d’y apporter. Le contenu du Papien est moins important que celui de la loi Gombette lorsqu’il s’agit d’étudier essentiellement les institutions politiques; c’est plutôt une loi civile et pénale. Cependant pour se faire une idée juste de la position politique des indigènes, il faut nécessairement mettre ses dispositions en regard de la loi destinée aux Burgondes particulièrement.
/102/
II. Caractère, règles et mode de l’établissement burgonde.
Au commencement du Ve siècle, lorsque les Burgondes arrivaient sur les rives du Rhin, les colonies de vétérans établies par Probus pour la garde des frontières de la Germanie venaient d’être rappelées à l’intérieur. Les Burgondes pouvaient donc se substituer aux colons militaires sans porter préjudice aux populations. Les propriétaires indigènes, accoutumés depuis plus d’un siècle à voir la défense du pays confiée à des légions composées, en partie du moins, de barbares, ne sentirent pas même un changement très notable dans leur situation. Les Burgondes reconnaissaient la suprématie de l’Empire, et la plus grande différence qu’on pût signaler dans la province fut qu’ils obéissaient à un chef de leur nation et non à un préfet romain.
Les Burgondes étaient, comme les Ripuaires leurs proches voisins, des lètes, des fédérés, auxquels l’Empire assignait des terres prises sur le domaine public. Il est probable que, selon la coutume, la répartition en fut faite entr’eux par le sort.
Relativement à l’établissement définitif, les questions dont nous avons à rechercher la solution sont plus importantes et beaucoup plus controversées.
Deux savants ont voué dernièrement à ce sujet une attention particulière: M. Gaupp et M. de Gingins. Ce dernier pense que l’établissement définitif eut lieu en 456, ensuite d’une convention conclue avec les magistrats gallo-romains. Les dispositions de la loi burgonde, postérieures, /103/ en tous cas, à 470, n’ont pas trait à la distribution de terres de 456; elles se rapportent uniquement aux établissements de date postérieure que les Burgondes firent ensuite du traité conclu par eux avec Anthémius, dans le Lyonnais, le Nivernais, le Valentinois, le Viennois et le Vivarais 1 .
Le premier partage, selon cet auteur, eut lieu, non point par une répartition des nouveaux venus entre les propriétaires fonciers, mais par vastes quartiers. Les Burgondes, peuple pasteur plutôt qu’agriculteur, amoureux de la chasse, habitué aux solitudes des forêts, se seraient établis dans les contrées montagneuses et inhabitées du Jura et des Alpes, dans la partie orientale de la Séquanaise, dans la Sabaudia, dans la partie de l’Helvétie occidentale la plus exposée aux incursions des Alamans, et ils auraient laissé aux indigènes les districts de la plaine, plus habités, plus cultivés et plus fertiles.
Le germe de ce système se trouve déjà dans un passage de l’Esprit des lois:
« Toutes les terres, dit Montesquieu, n’avaient pas été partagées entre les Gaulois ou Romains et les Burgondes, et les deux tiers (de ceux-ci) n’avaient été pris que dans certains quartiers. Le Bourguignon, chasseur et pasteur, ne dédaignait pas de prendre des friches; le Romain gardait les terres les plus propres à la culture, et les troupeaux du Bourguignon engraissaient le champ du Romain 2 . »
L’argumentation par laquelle M. de Gingins défend son hypothèse repose principalement sur l’étymologie de /104/ divers noms de lieux. Il serait difficile de la résumer sans lui ôter la plus grande valeur. Je citerai seulement, à titre d’exemple, la Marche de Val de Loue, le bourg des Faramans, tout près d’Arbois; le village de Farama, au pied du mont du Vuache; les nombreux noms de lieux terminés en y et en inges dans les mêmes cantons, le haut Bugey, appelé pays d’Isernore (Eisern-Thorn) à cause d’un ancien arc de triomphe appelé la porte de fer; tout cela comme traces d’une occupation germanique plus ou moins générale. D’autre part, au delà du pas de l’Ecluse, le Val Romey, nom qu’on suppose dérivé de Vallis Romanorum. Mais, je le répète, il faut chercher les détails dans l’ouvrage lui-même.
Une ancienne tradition romane a conservé le souvenir des sept hordes de Gundioch (Schaaren). Or, Schaar, Scara, anglo-saxon, Shire, veut aussi dire district. Cette tradition pourrait donc renfermer l’idée d’un partage de l’Helvétie romane en sept cantons ou quartiers. Or ces sept cantons se retrouvent sans peine dans les désignations de lieux contenues dans les plus anciennes chartes du pays.
Le premier et le plus considérable est le pagus Waldensis, lequel se subdivise en trois districts, plus petits (pagelli), savoir: le pagus Lausannensis, entre la Veveyse et la Venoge; le pagus inter Albonam et Venogiam (entre la Venoge et l’Aubonne), et le pagus Ebrodunensis, dont le centre était Ebrodunum (Yverdon).
Viennent ensuite: 2° le pagus Aventicensis, qui entoure le lac de Morat.
3° Le pagus Neurolis, de Neurol ou Nugerol, bourgade située sur l’emplacement de la Neuville; il allait jusqu’à Soleure et fut plus tard appelé le comté de Pepin. /105/
4° L’Uchtland (de Hochland), qui s’étendait le long du cours inférieur de la Sarine; il porta quelque temps le nom de comté de Tyr.
5° Le Hochland ou pays d’Ogo, comprenant tout le cours supérieur de la Sarine, Gruyère, Pays-d’Enhaut et Gessenay.
6° Le pagus Caput-lacense, Chablais, qui des hauteurs alpestres du pays d’Ogo vient tomber sur l’extrémité orientale du Léman et la vallée du Rhône. Le celtique Penn-lech, qui a le même sens (caput lacus), s’est conservé dans Pennilucus, Villeneuve.
7° Le pagus Equestricus, canton des Equestres, à l’autre bout du lac, comprenant le territoire de la cité équestre (Nyon) et le pays de Gex ou de Jays, nom qui, selon de Gingins, vient de gaium, une épaisse forêt.
De ces cantons ou quartiers, ceux d’Avenches, de Neurol et d’Ogo auraient été assignés aux Burgondes; l’Uchtland et le canton des Equestres furent l’apanage du domaine royal; le pagus Waldensis et le pagus Caput-lacense restèrent aux anciens habitants.
Un peu plus tard les Burgondes pénétrèrent aussi dans le Vallais et en formèrent un seul grand pagus ou comitat, sous le nom de pagus Vallensis.
En Savoie on trouve encore sept cantons ou pagi extrêmement anciens, puisque Charlemagne a mentionné l’un d’eux dans son testament 1 . Selon M. de Gingins, cette division devrait remonter aux Burgondes. Ces cantons sont: 1° le pagus Genevensis, qui forma au moyen-âge /106/ le Genevois; 2° le pagus Albanensis, l’Albanais; 3° le pagus Falciniacensis, le Faucigny; 4° le pagus Alingiensis, plus tard appelé le pays de Gavot, de Gaw et Oti, Oede, désert, ou bien de Gaium, comme Gex; 5° le pagus Tarentasiæ, la Tarentaise; 6° le pagus Savoyensis, la Savoie propre; 7° le pagus Mauriacensis, la Maurienne.
M. de Gingins croit que les Burgondes s’établirent dans le Faucigny et dans le canton des Alinges; que le roi eut pour sa part la Tarentaise et le sud du Genevois, et que le nord du Genevois avec la ville et l’Albanais demeurèrent propriété des indigènes. La Savoie propre ne fut occupée qu’en 470 et par conséquent appartient à un second partage. La Maurienne ne fit point partie du premier royaume de Bourgogne; elle appartenait aux Ostrogoths, passa aux Lombards et ne fut conquise par les Francs que vers 561.
Dans la province séquanaise, les Burgondes occupaient, selon le même auteur, le pagus Warascus, qui embrasse la chaîne du Jura, de Poligny à Montbéliard. M. de Gingins cherche l’origine de ce mot Warascus dans Fara-mann, nom du chef de famille burgonde. La partie la plus méridionale du Jura, appelée Schilt-ding et plus tard Scoding ou aussi pays d’Escuens, aurait appartenu au roi et tirait son nom des armoiries royales affichées aux limites de ce territoire. La moitié occidentale de la province, qui, moins montagneuse et plus fertile, s’étend jusqu’à la Saône, serait demeurée entièrement aux Gallo-Romains. Elle formait deux pagi: le pagus Camovorum, pays d’Amaus, qui tirait son nom de lètes chamaves transportés dans la province par les ordres de Constance Chlore, et le pagus Portensis, plus tard comté de Port, qui est ainsi nommé /107/ d’après la station militaire, Portus Abucini, aujourd’hui Pont-sur-Saône. Besançon, Bisuntinum, capitale de la province, située aux confins des deux zones, resta romaine, comme la plaine, et conserva intact tout son gouvernement municipal. Lorsque quelques siècles plus tard la Franche-Comté fut réunie sous un comte supérieur, les quatre comtés de Warasque, de Scoding, d’Amaus et de Port devinrent des vicomtés; Gray représentant l’Amaus; Vesoul, le Port; Baume, le Warasque; Salins, le Scoding.
M. de Gingins résume ainsi son point de vue:
« Dans les contrées qui passèrent volontairement sous la domination des Burgondes, par convention faite avec leurs chefs et les magistrats municipaux, l’occupation et le partage s’effectuèrent de la manière suivante:
»1° Les Burgondes occupèrent militairement le territoire des cités contractantes à titre de protecteurs et de défenseurs, et leurs kendins y furent reconnus en qualité de souverains, comme l’avaient été jusque-là les sénateurs romains;
» 2° Le territoire de chaque cité, pris en masse, fut partagé entre les deux peuples par quartiers dans la proportion de leurs besoins respectifs;
» 3° Les villes épiscopales, comme Besançon et Genève, conservèrent leur population gallo-romaine et leurs institutions municipales. »
L’auteur pense que les conventions pouvaient avoir fixé les deux tiers du territoire pour la part des Burgondes, mais que cette proportion ne fut pas appliquée à la rigueur, parce que dans l’Helvétie romane les dévastations opérées par les Alamans dans les quartiers les plus exposés à leurs invasions et l’existence de vastes contrées /108/ montagneuses, incultes et inhabitées, permirent aux nouveaux hôtes de s’établir sans préjudice pour les habitants du pays.
Le partage politique circonscrivit les droits respectifs des deux nations en consolidant celui des Gallo-Romains sur les cantons qui leur furent réservés et créa en faveur des Burgondes un droit semblable, mais collectif. La distribution ultérieure des territoires abandonnés à ces derniers fut dès lors une mesure que ceux-ci eurent à accomplir entr’eux, suivant leurs usages et leurs convenances.
Mais l’état des provinces cédées par l’empereur Anthémius, en 470, ne ressemblait nullement à celui des territoires montagneux que les Burgondes occupèrent d’abord; bien que celles-là eussent souffert des calamités générales qui pesèrent alors sur la Gaule, qu’elles fussent entr’autres écrasées sous le poids des charges fiscales, elles étaient cultivées, habitées, semées de villes populeuses.
Un partage du sol par quartiers aurait, ici, nécessité le déplacement d’un trop grand nombre de régnicoles; il fallut donc recourir à un autre mode de division. Observons d’ailleurs que l’occupation de ces territoires eut lieu dans des conditions différentes. Les magistrats municipaux, représentants des propriétaires fonciers, n’y intervinrent point. La cession était faite en vertu d’une décision du pouvoir impérial. Les intérêts des indigènes n’étaient plus ici la considération prépondérante. Anthémius consent à ce que les Burgondes, dont l’assistance lui est nécessaire pour contenir les Wisigoths, prennent possession des provinces délaissées avec tous les droits territoriaux et domaniaux que possède l’empire, se réservant seulement la suzeraineté. Ainsi, quoique la prise de possession des /109/ provinces méridionales et occidentales du royaume burgonde ait été une occupation militaire, elle s’opéra pacifiquement, en vertu d’un traité analogue à ceux qui avaient établi tant de populations barbares dans l’empire et les Burgondes, eux-mêmes, sur la rive gauche du Rhin. Cependant comme ces provinces centrales n’avaient ni colonies militaires, ni terres létiques dont on pût disposer, il fallut nécessairement, pour cette fois, répartir les Burgondes sur toute la surface du sol et partager avec eux les héritages des anciens habitants. C’est à ce dernier partage que se rapportent toutes les dispositions que la loi burgonde renferme.
Gaupp, quoique plus récent, puisque son bel ouvrage sur les migrations germaniques a paru en 1844, n’a point connu, semble-t-il, ou, du moins, n’a pris aucune notice de ce système ingénieux. Il prend pour unique base de son explication des partages burgondes les textes légaux; de plus, les données historiques qui lui aident à les interpréter diffèrent assez notablement de celles auxquelles nous croyons que l’on doit s’arrêter.
Selon Gaupp, l’établissement définitif eut lieu en 443, sous le règne de Gunther ou Gundahar, et ce prince aurait trouvé la mort, avec toute sa famille, dans la bataille de Châlons; les Burgondes choisirent alors pour les gouverner deux jeunes princes wisigoths de la race des Balthes. J’ai cherché à montrer précédemment que l’établissement définitif eut lieu en 456, que Gundahar tomba dans la contrée de Worms, lors de la première rencontre qu’eurent les Burgondes avec les hordes d’Attila; enfin que Gundioch et Chilpérik Ier sont fils de Gundahar. — Ces divergences, la première surtout, pouvaient difficilement /110/ ne pas avoir leur influence sur la manière dont on envisage les diverses questions que soulève l’établissement. C’est ainsi que, pour Gaupp, l’établissement définitif des Burgondes a lieu, non-seulement du consentement, mais du fait des empereurs, dont les rois burgondes reconnurent la suprématie. Cependant, selon lui, les dispositions légales relatives au partage ne datent point de 443, car il les attribue à Gondebaud. Il suppose donc un état intermédiaire d’une trentaine d’années environ entre l’occupation du territoire des Gaules et le partage avec les indigènes. Il est permis de croire que le partage ne se fit pas du jour au lendemain, mais trente ans, la vie moyenne d’une génération humaine! cela semble bien fort. Les Burgondes seront-ils restés tout ce temps, avec femmes et enfants, chez leurs hôtes romains? Une telle charge aurait écrasé des propriétaires plus aisés que les malheureux Gallo-Romains du Ve siècle, que le fisc romain avait déjà tant et si fréquemment pressurés. En ce temps-là, les bras et les capitaux manquant à l’agriculture, beaucoup de terres cultivées étaient redevenues friches; un partage du sol, quand le nouveau venu se contentait justement des friches, des pâturages et des forêts, n’avait rien de bien lourd. Qu’on se représente en revanche la position d’un propriétaire déjà surchargé d’impôts, qui, à grand’peine, fait rendre à ses fonds ce qu’il faut pour payer ses dettes, et qui, en outre, se verrait obligé d’entretenir toute une bande d’étrangers pendant plusieurs années. En tous cas, un tel état de choses aurait amené des plaintes, des conflits dont le bruit serait parvenu jusqu’à nous. Eh bien! tout au contraire, des écrivains romains contemporains vivant dans la Bourgogne même, Sidoine, Salvien, vantent /111/ à l’envi la douceur des Burgondes, leur modération, les préférant aux Wisigoths et à tous les autres barbares.
On pourrait, du reste, citer un exemple de ce que fut la charge de recevoir tout un peuple en cantionnements: les Lombards s’arrangèrent ainsi à leur entrée en Italie; ils exigèrent le tiers des terres de leurs hôtes romains. Les historiens italiens nous apprennent qu’un tel état de choses, qui pourtant ne dura pas trente ans, fut si insupportable pour les indigènes, que, pendant cette période de l’occupation, une grande quantité périrent, ou bien tombèrent en servitude 1 . Aussi, quand Autaris fit procéder au partage, les Romains envisagèrent-ils cet acte comme un immense soulagement. Dès lors, seulement, ils eurent de nouveau une existence tolérable 2 . On remarquera pourtant que dans la riche plaine lombarde le partage du produit brut devenait moins onéreux, et le partage du sol plus pénible en revanche, pour le propriétaire, que dans des contrées où la culture exige de plus grands efforts, par exemple dans l’Helvétie romane, la Savoie ou la Franche-Comté.
A ces considérations de l’ordre économique, auxquelles on ne saurait refuser quelque poids, il faut joindre le témoignage des auteurs anciens. Eusèbe, Marius, Prosper /112/ Tyro, lui-même, nous parlent d’un partage qui a eu lieu dès le début.
Gaupp a parfaitement senti qu’un régime de cantonnements, appliqué à tout un peuple, pour un temps plus ou moins long, était inadmissible. C’est pourquoi cet auteur imagine que chaque propriétaire romain commença par céder au barbare établi sur son fonds la moitié de sa terre. J’observerai d’abord que cette hypothèse est purement gratuite; ensuite qu’elle ne concorde pas avec certains faits affirmés par les contemporains. Grégoire de Tours, ce même historien qui a poursuivi Gondebaud d’accusations en partie au moins exagérées, reconnaît quelque part que ce prince rendit des lois dont le but était d’adoucir la condition de la population gallo-romaine « Burgundionibus leges mitiores instituit, ne Romanos opprimerent. »
Si le Romain avait d’abord partagé par moitié, Gondebaud, en fixant la part du Burgonde aux deux tiers, aurait évidemment aggravé sa position, au lieu de l’adoucir.
Dans le système de M. de Gingins, toutes ces difficultés disparaissent, et la loi de Gondebaud sur le partage a bien les caractères d’équité et de douceur qui lui ont été reconnus par les contemporains. Que M. Gaupp n’ait pas connu ce système, publié dans les mémoires d’une société savante d’Italie, lorsque lui-même élaborait le sien, cela se comprend tout à fait; mais que les concitoyens de M. de Gingins, écrivant après lui sur le même sujet, se soient inclinés devant l’autorité de Gaupp au point de méconnaître absolument les mérites du système opposé, c’est ce qui a droit de surprendre. Ainsi M. Matile, dans ses études sur la loi Gombette, ainsi, /113/ Wurstemberger, dans sa savante et judicieuse histoire de l’ancienne campagne bernoise, ne jurent que par Gaupp et laissent entièrement de côté les vues de M. de Gingins.
J’en conviens nettement, la vérité de ces vues n’est pas positivement démontrée; mais leur auteur les appuie d’indices assez nombreux pour établir leur vraisemblance, d’autant plus qu’aucun texte ne les contredit. Il aurait donc fallu au moins les discuter. Je crois, du reste, trouver dans la loi Gombette elle-même un argument en leur faveur qui n’a pas été présenté. Au titre IV, article 1er, nous lisons:
« Quoique dans le même temps où notre peuple reçut le tiers des esclaves et les deux tiers des terres, nous ayons fait défense à quiconque aurait reçu de notre munificence ou de celle de nos parents un domaine avec des esclaves, d’exiger dans le lieu où l’hospitalité lui a été assignée, le tiers des esclaves ou les deux tiers des terres; néanmoins, comme nous nous sommes aperçus que plusieurs, oubliant le danger qu’ils courent, ont transgressé notre défense, il est nécessaire de prévenir de nouvelles transgressions par une loi nouvelle qui aura force pour l’avenir et de rétablir la sécurité que le passé a compromise. Nous ordonnons donc que ceux qui, après avoir reçu de notre munificence des champs et des esclaves, seront reconnus s’être en outre emparés de terres appartenant à leurs hôtes, devront être tenus de les restituer aussitôt 1 . » /114/
Cette loi, qui est évidemment de l’auteur de la loi sur le partage, et par conséquent de Gondebaud, montre qu’avant Gondebaud, c’est-à-dire sous Gundioch et Chilpérik I, des Burgondes avaient déjà reçu des domaines entiers. D’où pouvaient-ils venir? et surtout, comment se fait-il que ces domaines ne fussent point une part aliquote quelconque du domaine d’un ancien habitant?
Pour répondre à ces deux questions il faut bien recourir à l’idée d’un premier établissement par quartiers, dans lequel on n’avait pas eu à exproprier individuellement les anciens habitants.
Vraisemblablement des Burgondes établis d’abord dans les régions montagneuses et incultes que ce peuple occupa en 456, vinrent ensuite, en 470, dans les bassins du Rhône et de la Saône, où le partage des domaines individuels s’opérait, et quoique déjà nantis ailleurs, ne craignirent pas de se faire adjuger une nouvelle part. C’est à quoi les préceptes royaux auront voulu remédier: Un double lot accordé indûment étant en pareille matière la principale chose à éviter, si l’on voulait procéder régulièrement à la répartition.
L’article de loi que l’on vient de citer nous montre aussi quelles bases on fixa pour le partage exigé des propriétaires romains. L’article suivant nous apprend que les terrains à défricher, les jardins et les vergers étaient partagés par moitié.
Le titre XIII prouve que les terres incultes, pâturages, marais, etc., étaient utilisés en commun par le propriétaire romain et son hôte, et que si l’un des deux en défrichait une portion, l’autre avait droit d’en défricher aussi une égale étendue. /115/
Les Burgondes n’avaient pas changé de demeures tous à la fois; il en venait encore de temps en temps soit de la province rhénane, soit du bassin du Mein, et ceux ci réclamaient aussi une part à la terre. Le 2e additamentum (art. 11) contient une disposition à ce sujet: « Les nouveaux venus, est-il dit, pourront réclamer des propriétaires romains, auxquels ils seront assignés, la moitié des terres, mais aucun esclave. » On voit par là que beaucoup de propriétaires romains ne furent pas dans le cas de céder une part de leur bien, lors des premiers partages. Mais ceux-ci demeuraient toutefois soumis à l’obligation de partager quand un chef de famille burgonde non encore colloqué, se présentait et réclamait son droit.
Le principe du partage par tiers observé dans les lois burgondes dérivait des lois impériales relatives aux cantonnements; il fut d’abord appliqué tel quel, à l’occasion des tribus barbares reçues à titre d’auxiliaires; puis on le modifia d’après les circonstances, lorsqu’il s’agit de recevoir dans l’empire des peuples entiers. Alors la concession du tiers des fruits que la loi imposait aux proriétaires fut transformée en concession d’une partie aliquote du sol.
Il paraît même que la loi romaine reçut deux interprétations. Quand Théodoric-le-Grand conquit l’Italie sur les Hérules, il ne prit que le tiers des terres pour l’établissement des Ostrogoths. Lorsque Ataulphe, roi des Wisigoths, occupa la Gaule méridionale, il prit au contraiie les deux tiers des terres cultivables et laissa un tiers aux Romains. Peut-être, en raison de la quantité considérable de terres abandonnées par leurs propriétaires indigènes qui existaient dans les provinces gauloises, le /116/ résultat ne fut-il pas très différent. Le partage opéré par les Wisigoths fut, du reste, beaucoup plus onéreux pour les indigènes que celui des Burgondes, bien que les bases légales en soient à peu de chose près les mêmes. C’est un fait constaté par maintes indications des écrivains du temps. Pour le comprendre il faut se représenter que la majeure partie de la nation burgonde resta fixée dans les quartiers montagneux qu’elle avait occupés d’abord; je n’y vois, pour mon compte, pas d’autre explication, car en tenant compte de la conquête de l’Espagne, faite par les Wisigoths dès 456, les Burgondes étaient relativement aux terres romaines occupées, aussi nombreux, pour le moins, que les Wisigoths.
La possession de contrées boisées, montagneuses, en partie désertes, convenait éminemment à un peuple chasseur et pasteur, qui n’avait aucune habitude des travaux agricoles. L’art de travailler le bois, que Socrate dit avoir été l’industrie favorite des Burgondes transrhénans, est un de ceux qu’exercent communément les peuples forestiers 1 .
Tout comme parmi les propriétaires gallo-romains, l’obligation de partager atteignit en premier lieu les riches, de même dans la répartition il est à croire qu’on assigna aux plus riches Romains les principaux de la nation burgonde, pour autant toutefois que ces derniers n’avaient pas déjà reçu des domaines dans les terres dont la possession avait été attribuée au prince.
Ces dons de terres royales, qui, chez les Burgondes, ont /117/ eu lieu dès le commencement, eurent pour conséquence immédiate de transformer en un rapport réel le rapport personnel qui existait auparavant entre le roi et les membres de son gasindi. Il est curieux de trouver dans la loi burgonde la plus ancienne disposition connue statuant l’hérédité des fiefs.
Titre I, § 3. « Il nous a plu d’ajouter à la présente loi que si l’un de nos sujets tient quelque chose de la munificence d’un de nos aïeux ou de la nôtre, il soit tenu de la transmettre à son fils. »
§ 4. « Il devra toujours être en état de représenter la charte de donation, afin que sa postérité continue à nous servir avec zèle et fidélité. »On trouve encore dans le second additamentum, art. 13, la forme en laquelle ces concessions des bénéfices royaux sont demandées et accordées.
III. Le système des droits personnels.
Le système des droits personnels, tel qu’il se développa au début de l’époque barbare, est d’origine purement germanique. Le droit romain a le caractère opposé; c’est un droit purement territorial. Lors de la conquête les Germains en étaient encore au principe du droit de la race, à ce point de vue dans lequel chaque race a un droit particulier qui n’est pas proprement le droit de l’Etat, de sorte que si plusieurs tribus de races différentes sont réunies dans un même état elles conserveront néanmoins leurs droits particuliers. /118/
On admet généralement que le système des droits personnels est né de la conquête. Je pense comme Gaupp, qu’il existait auparavant dans les grandes confédérations de tribus différentes qui se formèrent plus d’une fois, en Germanie même, durant les premiers siècles de notre ère, par exemple, celles des Suèves, des Marcomans, des Goths du temps d’Hermanaric. Les Germains appliquèrent aux nouveaux rapports dans lesquels ils entrèrent avec la race latine les règles qu’ils observaient entre eux de tribu à tribu. Le système des droits personnels ne fut pas le fruit d’une politique réfléchie, comme on se l’est imaginé; il était l’expression du degré de culture auquel la race germanique était parvenue: son idée touchant le droit des gens.
L’existence d’un peuple peut se concevoir indépendamment de la possession d’un territoire déterminé. Les Burgondes, par exemple, font leur première apparition dans l’histoire, juste au moment où ils cherchent à se procurer une demeure fixe. D’autres peuples n’éprouvent pas même ce besoin; on les voit changer de séjour continuellement. Pour un tel peuple il ne saurait y avoir un droit territorial, néanmoins il y a un droit national.
Chez un peuple à demeure fixe, la nation ce sont les habitants du territoire de l’état; chez le peuple non encore fixé, le lien commun est le sang.
Mais que ce peuple errant acquière un territoire fixe, la transition entre les deux points de vue ne s’opérera pas immédiatement. Il y a un moment où le peuple a déjà une demeure fixe et où, cependant, son idée de l’état repose toujours sur le rapport d’origine, où celui qui n’est pas né membre de la nation est encore envisagé comme /119/ étranger, quoique demeurant avec elle. Ce moment-là, c’est celui dans lequel se trouvaient les barbares quand ils vinrent s’établir dans les provinces de l’empire romain.
Ainsi la manière en laquelle les Germains envisageaient l’état, jointe au sentiment profond des droits de la personnalité qui sont un des traits de leur génie propre, les conduisaient à adopter, soit vis-à vis des Latins, soit vis-à-vis des Germains d’une autre nation, le système de la législation personnelle. Usage tout à fait particulier qui caractérise l’époque barbare à tel point qu’en Europe on ne le retrouve un peu généralement admis, ni avant, ni après.
Dans un pareil ordre de choses, la loi ne régit pas le territoire de l’état, mais la personne en raison de son origine; les individus faisant partie du même état ne sont pas pour cela censés appartenir à la même nation, ils conservent la nationalité de leurs ancêtres, ils sont régis par les lois qui régissaient ceux-ci. L’état n’est pas encore, à vrai dire, entièrement constitué, car plusieurs peuples subsistent au sein d’un même état.
Sous ce rapport il y a quelque analogie entre le système des droits personnels et celui des castes, mais avec cette différence que le droit des diverses castes est subordonné au principe unique dont les castes découlent, principe dont l’état est le représentant.
Chez les Burgondes, comme chez tous les autres peuples barbares, à l’exception des Goths, le système des droits personnels a prévalu complètement dans l’origine. La transition entre ce système et celui du droit territorial s’est opérée à mesure que les populations de races diverses qui vivaient d’abord comme juxtaposés dans un même état, se mélangèrent de plus en plus. La pleine /120/ application du droit territorial coïncide avec le triomphe complet du système de la féodalité: c’est par le fief que le territoire a repris possession de l’individu. Des traces manifestes du maintien du régime des droits personnels se sont même retrouvées au delà de cette limite et dans des temps purement féodaux.
Dans l’application le système des droits personnels devait présenter des difficultés assez grandes. Et d’abord, comment faire juger les hommes des nations subordonnées par des magistrats connaissant bien leur droit spécial? Les Burgondes, comme les Ostrogoths, avaient créé pour les Romains des magistrats romains. L’Eglise fournit fréquemment aussi à la race latine une sorte de magistrature officieuse que les barbares toléraient en raison de l’ascendant qu’elle sut obtenir sur eux.
Ensuite comment faire lorsque les deux parties appartiennent à des nations différentes? La loi Gombette avait prévu ce cas. La règle était alors le for du défendeur. Mais cette règle pouvait souffrir des exceptions; ainsi le possesseur d’un immeuble dont la propriété est contestée suit la loi de son auteur 1 . Cela est juste, puisque le droit du possesseur dépend au fond du droit de son auteur.
En cas de mariage entre un Burgonde et une Romaine, on voit le principe germanique du mundium impliquer la tutelle du mari sur la fortune de la femme 2 .
En matière pénale, le serment purgatoire appuyé de conjurateurs est admis également pour tous les sujets du royaume, qu’ils soient barbares ou Romains 3 . /121/
Ces bases sont incomplètes, nous pourrions citer bien des cas de conflit de statuts pour lesquels nos sources ne donnent aucune solution. La pratique les résolut sans doute, mais de quelle manière? C’est à peine si l’on peut maintenant le conjecturer, car, en pareille matière, les principes de solution sont souvent des plus incertains.
IV. Des divers ordres et de leurs rapports politiques.
La diversité des conditions provint principalement de la conquête et de la diversité des races. La conquête de l’empire romain fut pour la race germanique un moment de crise dans lequel les rapports multiples qui déterminent la condition des personnes se sont singulièrement compliqués.
Sur la rive droite du Rhin, l’état de l’homme libre, son droit, ses moyens d’action étaient chose claire et bien définie. Les longues migrations, un état de guerre permanent pendant plus de deux siècles altérèrent les anciens rapports; l’établissement en créa de nouveaux et nécessita par là même des dispositions légales nouvelles.
L’édifice majestueux des anciennes institutions romaines couvrait encore le sol de ruines dont les conquérants cherchèrent à profiter. La juxtaposition de la race germaine et de la race latine produisit de grands changements. Les diverses classes de la population indigène durent prendre place dans des cadres qui n’avaient pas été faits pour elles. Les modifications survenues dans l’état économique d’un grand nombre de familles eurent aussi leur influence. /122/ Tel homme libre devient un propriétaire foncier, tel autre vit au pain de son chef. Un troisième habite un manoir dont il a seulement l’usufruit; un quatrième engage sa personne dans des services qui le placeront sur la voie de la servitude. Le Romain riche prend place parmi les nobles et va de pair avec les chefs barbares; le barbare pauvre et isolé devient un colon sans défense contre les usurpations du riche dont sa subsistance dépend. Les lois barbares, rédigées avec la mémoire fraîche encore de l’état antérieur à la conquête, ont pour base essentielle de classification entre les hommes la liberté et la nationalité. Durant la longue époque de transition qui précéda l’avénement de la féodalité, l’égalité de droits des hommes libres tendit à disparaître; le souvenir de l’origine des individus disparut. Dès lors, la puissance personnelle ou la protection des puissants furent les seuls moyens de se maintenir et de s’élever à un rang supérieur. Les relations de vassalité ou la possession des bénéfices et des honneurs contribuèrent surtout à déterminer la place des individus dans la société civile.
Nous pouvons distinguer chez les Burgondes quatre classes de personnes entre lesquelles se répartissent également les hommes de race germanique et les Gallo-Romains.
Ce sont: 1° Les hommes libres qui sont élevés au-dessus de la condition générale, soit par leur naissance, soit par les offices dont ils sont revêtus; les nobles;
2° La masse des simples hommes, libres;
3° Toutes les catégories intermédiaires entre la liberté et la servitude;
4° Les non libres, qui durant la période barbare sont /123/ dans un état de transition entre l’esclavage antique et le servage féodal.
Les hommes libres d’origine barbare forment le noyau de la nation; les nobles n’ont que les droits du Germain libre dans une mesure un peu plus forte. Pour jouir de tels droits, il faut être né d’un père et d’une mère libres. Frey, dit Grimm, signifie en même temps liber et ingenuus.
Une marque de distinction propre à la classe libre était la longue chevelure. Les Burgondes, comme les Goths, la repoussaient en arrière sur le cou et sur les épaules; le Franc la laissait plutôt flotter en boucles tout autour de la tête; le Lombard la laissait pendre le long des joues en la relevant seulement sur le front. Les hommes libres avaient seuls le droit de porter l’épée, la lance et le bouclier. Seuls aussi ils pouvaient posséder un fonds de terre en pleine propriété, c’est-à-dire en alleu. C’est pourquoi, chez quelques peuples, arimannia a pris le sens d’alleu. Ne doit-on placer dans la classe des hommes libres que ceux-là qui sont demeurés en dehors de toutes relations de compagnonage ou de vassalité? Faut-il en exclure tous les leudes, voire même les leudes du roi? M. de Savigny a soutenu cette opinion de son incontestable autorité; pour ce qui me concerne, je ne pourrais pourtant y adhérer.
Les monuments législatifs ne montrent nulle part les compagnons exclus des assemblées nationales et des plaids.
D’après la loi Gombette, les hommes libres se subdivisent en trois catégories: les nobles (optimates), la classe moyenne (mediocres homines), et la classe inférieure /124/ (minores homines). La deuxième classe paraît appartenir elle-même à la noblesse, en sorte que la troisième comprend seule les simples hommes libres. La loi contient du reste, trop peu de textes relatifs aux droits des divers ordres pour qu’on puisse s’en faire une idée sans recourir à des comparaisons avec les autres lois du même temps. Le wergeld de la première classe est de 300 sous, celui de la seconde de 200, celui de la troisième est de 75.
M. Wurstemberger 1 entend la loi autrement; selon lui les mediocres homines sont les simples hommes libres, tandis que les minores sont seulement des affranchis. L’analogie des autres lois est contre cette idée 2 .
Les barbares libres et propriétaires d’alleux formaient, avons-nous vu, le corps de la nation; mais leur indépendance même causait leur isolement et cet isolement les mit au bout d’un certain temps dans la dépendance des fonctionnaires et des grands propriétaires immobiliers. Cette révolution s’opéra graduellement; toutefois elle commence de bonne heure à se faire sentir dans le royaume de Bourgogne, circonstance qui doit être attribuée sans doute à l’influence que prit dès le début la classe des Gallo-Romains.
Parmi les optimates burgondes on rangera les comtes et ceux que la loi désigne sous le nom de convivæ regis. Nous n’avons pas d’indications au sujet des mediocres homines; il est permis de supposer que c’étaient des fonctionnaires inférieurs et des propriétaires au-dessus du niveau moyen. Les leudes ne sont nommés qu’une fois /125/ dans la loi 1 . Bluhme les assimile aux simples hommes libres; Peyré voit en eux des mediocres homines. Le texte est certainement fort obscur; cependant je pencherais pour l’opinion de Bluhme, mais en entendant la loi comme si le leude était une minor persona engagée vis à-vis d’un noble dans le lien de la vassalité.
De tous les peuples barbares, ce furent les Burgondes et les Goths qui établirent le moins de différence entre eux et les populations soumises à leur gouvernement.
Les Burgondes, appelés par les populations gallo-romaines, se placèrent d’entrée avec elles sur le pied de la plus complète égalité. Ainsi, pour l’une des races comme pour l’autre, la triple catégorie établie par la loi entre les hommes libres a trouvé son application.
La noblesse gallo-romaine conserva donc entièrement sa position. Cet ordre avait été constitué dans les provinces par les réformes administratives de l’empereur Dioclétien; c’était une hiérarchie d’offices militaires et civils, des conditions de fortune fixaient la plupart des positions civiles; l’aristocratie de fortune s’unissait ainsi à celle qui reposait sur les fonctions. Dans le bouleversement social qui suivit la chute de l’empire d’Occident, cette classe fut encore celle qui se maintint le mieux. Ce qui lui restait de richesses et, plus encore, la supériorité intellectuelle qu’elle avait en regard de la foule d’esclaves, de colons et d’ouvriers prolétaires qui se pressaient autour d’elle, suffirent pour lui conserver une influence sur laquelle les chefs des nouveaux états s’empressèrent de s’appuyer. Chez les Burgondes, entre autres, comme chez /126/ les Wisigoths, le système municipal romain demeura intact dans les villes, et par conséquent l’aristocratie gallo-romaine resta en possession du gouvernement des cités.
Cette aristocratie, accoutumée à manier le pouvoir dans les offices impériaux, s’efforça de son côté d’entrer en plein dans le nouveau système, de se rendre nécessaire, de capter la faveur des princes par sa souplesse et son habileté.
Guilliman, parlant de la condition politique des Romains dans le royaume de Bourgogne, s’exprime ainsi: « Les Bourguignons ne changèrent dans leur nouveau royaume aucune autorité constituée de la part des Romains et des indigènes, comme firent dans le même temps les autres nations barbares dans les contrées dont elles s’emparèrent. Au contraire, ils associèrent les Gaulois aux places et aux commandements, ils leur firent part des honneurs du royaume, ils ne réservèrent pour eux aucune prérogative, voulant que les deux nations fussent en parfaite égalité pour remplir les magistratures. »
Cette conduite si favorable aux indigènes était la conséquence naturelle des circonstances qui avaient présidé à l’établissement définitif. Nous avons vu qu’elle était aussi dans les intérêts de la politique royale.
La condition des Gallo-Romains s’améliora donc, bien loin de se détériorer, par suite de la conquête burgonde, ils eurent une part plus grande, plus réelle à l’administration du pays, les charges qui pesaient sur eux furent aussi fort allégées 1 . /127/
M. de Gingins estime que le système des impôts romains fut entièrement aboli. La loi burgonde ne nous dit rien à ce sujet; on en est donc réduit aux conjectures. Ce silence même fait voir qu’on n’établit pas l’impôt romain sur les Burgondes, comme on le fit chez les Ostrogoths et chez les Wisigoths 1 . En fut-il de même pour les Gallo-Romains? Je partage à cet égard l’opinion de M. de Crousaz 2 . Le Papien nous démontre en particulier que le droit de mutation (census) continua à être prélevé 3 . « Agros comparari non posse nisi eis censum statutum qui possessionem ingressi fuerunt, susciperint dissolvendum. »
On ne peut expliquer ici le mot census comme une redevance payée pour la jouissance de certains biens fiscaux. La loi cherche à remédier à un abus qui s’était conservé du temps de l’empire, et elle rappelle que le census est une charge réelle qui suit le fonds en quelque main qu’il passe.
Mais si quelques impôts romains continuèrent d’être perçus, d’autres tombèrent assurément; puis leur perception devint aussi beaucoup moins dure et vexatoire.
V. Du territoire et de ses divisions.
Les divisions civiles et politiques que les peuples barbares adoptèrent dans leurs nouveaux états étaient basées /128/ en général sur celles qui avaient existé du temps de l’empire romain. Autant que faire se pouvait ils adaptèrent leurs offices germaniques à des circonscriptions qu’ils trouvaient déjà faites et auxquelles les anciens habitants étaient habitués.
Voyons donc quelle était la division territoriale romaine qui servit de point de départ.
Au Ve siècle, les provinces transalpines étaient soumises au préfet du prétoire des Gaules dont le vaste gouvernement s’étendait du Rhin et des Alpes jusqu’aux confins du monde connu, à l’occident, et jusqu’aux colonnes d’Hercule, au midi. Il comprenait trois diocèses, savoir les Gaules, l’Espagne et la Bretagne. Dans chaque diocèse était un lieutenant ou vicaire. Le diocèse des Gaules comprenait 17 provinces réparties entre le préfet et son lieutenant. Le préfet résidant à Trêves gouvernait directement les dix provinces situées au nord de la Loire; le vicaire, résidant à Vienne, gouvernait les sept provinces du midi. A la tête de chaque province était un proconsul ou président. Chaque province était formée par la réunion de plusieurs cités ou municipes ayant des territoires quelquefois assez étendus.
Les municipes étaient administrés par des magistrats pris dans la localité et dans la classe des propriétaires fonciers (curiales), mais sous le contrôle d’un gouverneur qui était un fonctionnaire impérial.
Les districts ruraux composant le territoire du municipe étaient régis par des fonctionnaires subordonnés au gouverneur.
En dehors de ces divisions, applicables seulement aux régions peuplées et cultivées qui avaient été érigées en /129/ provinces (in formulam provinciæ redactæ), il y avait, soit aux frontières, soit dans l’intérieur, des territoires soumis à un régime exceptionnel.
Ceux-ci avaient reçu quatre destinations distinctes et formaient:
1° Aux frontières, les agri limitanei, ou agri veteranorum, destinés à des légionnaires mariés dont on avait formé des colonies militaires destinées à la défense du pays;
2° Les terres létiques, occupées par des populations barbares admises dans l’empire à titre d’alliés (cohortes laetorum). Au centre d’un tel établissement était ordinairement placé un fort ou camp retranché (castra);
3° Les terrains vagues bordant les routes, fleuves ou canaux, ou situés entre les territoires des cités, tels que landes, bruyères, marécages, montagnes et forêts; ils constituaient la classe des fundi limitrophi et faisaient partie de l’ager publicus. Dans cette catégorie rentrerait la Sabaudia qui, selon Ammien Marcellin, ne faisait partie ni de la Viennoise, ni de la Séquanaise, et ne formait pas une province à part.
4° A la dernière catégorie appartiennent les immenses possessions appartenant à l’empereur, fiscus, (res privata). L’intendant du domaine privé, Comes sacrarum largitionum, administrait ces territoires; ses agents étaient les agents du palais (palatini).
Les conquérants s’emparèrent de ces quatre catégories de terres; les Francs, entr’autres, en trouvèrent assez dans le nord de la Gaule pour pouvoir se dispenser de recourir à un partage du sol avec les anciens habitants.
Lorsque le christianisme devint religion officielle, les /130/ divisions politiques qu’on vient de mentionner servirent de bases pour les circonscriptions ecclésiastiques qui furent alors instituées.
Chaque cité municipale devint le siége d’un évêché, chaque province civile devint province ecclésiastique et eut à sa tête un évêque métropolitain. Ceux-ci, plus tard, ont été nommés archevêques.
Après la chute de l’empire d’Occident l’ancienne division de la Gaule en provinces ne se maintint point comme division politique, mais dans le gouvernement de l’Eglise elle s’est perpétuée, pour ainsi dire, jusqu’à nos jours.
La division politique eut pour base les territoires des cités, lesquels formaient maintenant les diocèses épiscopaux. Un tel arrangement ne changeait pas les habitudes des indigènes, qui se groupaient autour de leurs évêques comme autour de leurs protecteurs naturels.
La division territoriale demeura donc romaine, mais le chef du nouveau district fut un magistrat d’institution purement germanique. Ce fut le graf ou comte, l’ancien chef du gau germanique, qui primitivement était élu par le peuple mais depuis la conquête fut plutôt à la nomination du roi. Le nom de comte, comes, que reçut ce magistrat, était porté pendant le Bas-Empire par des officiers remplissant déjà des fonctions analogues 1 .
Le premier royaume de Bourgogne embrassait plusieurs provinces romaines: la Séquanaise, la première Lyonnaise et les deux Viennoises, avec une portion des Alpes maritimes, la Sabaudia et les Alpes pennines. Ces provinces se retrouveront plus ou moins dans les provinces /131/ ecclésiastiques; mais au point de vue civil elles furent subdivisées d’après les bases indiquées il y a un instant.
Ainsi les territoires des cités dont la réunion formait telle province devinrent indépendants les uns des autres, en tant que division administrative et judiciaire, et chacun d’eux, chaque pagus, forma désormais un comté.
Bien que nous n’ayons pas la division en comtés du premier royaume de Bourgogne, nous savons par divers actes que les comtes y étaient nombreux.
En s’aidant de renseignements de l’époque mérovingienne et de l’ancienne division ecclésiastique des Gaules, on peut reconstruire, approximativement du moins, la principale division du territoire de l’état burgonde comme suit:
I. Dans la province séquanaise, qui forma la province ecclésiastique de Besançon:
1° Le pagus Waldensis, correspondant à l’évêché qui avait alors pour siége Aventicum; 2° le pagus Warascus; 3° le pagus Schiltding; 4° le pagus Camavorum; 5° le pagus Portensis. Ces quatre formant l’évêché de Besançon (Bisuntinum); 6° le pagus Bellicensis, évêché de Belley. Quant au prétendu diocèse de Nyon, il n’a pas existé.
II. Dans la province Viennoise, province ecclésiastique dont l’évêché métropolitain est Vienne:
1° Le pagus Genevensis, évêché également; 2° le pagus Wallensis, évêché d’Octodurum, dépendant peut-être encore de la province de Milan; 3° le pagus Viennensis; 4° le pagus Gratianopolensis, évêché de Grenoble; 5° le pagus Valentinensis, évêché de Valence; 6° le pagus Diensis, évêché de Die; 7° le pagus Ebrodunensis, évêché d’Embrun; 8° le pagus Sabaudiæ, évêché de Tarantaise; 9° le /132/ pagus Vapinacensis, évêché de Gap; 10° le pagus Tricastinensis, évêché de Tricastinum (St-Paul-trois-Châteaux); 11° le pagus Diniensis, évêché de Dignes; 12° le pagus Vivarium, évêché du Vivarais.
III. Dans la province d’Arles, dont le chef-lieu ecclésiastique était l’évêché de ce nom:
1° le pagus Avenionensis, évêché d’Avignon; 2° le pagus Aptensis, évêché d’Apt; 3° le pagus Arausionensis, évêché d’Orange; 4° le pagus Carpentoractensis, évêché de Carpentras. Arles, avec toute la partie de la province située entre la Durance et la mer, ne fit partie que peu de temps du royaume, ayant été enlevée à Gondebaud par Théodoric-le-Grand pendant que la Bourgogne était aux prises avec Clovis.
IV. Dans la province Lyonnaise, dont la métropole est Lyon:
1° Pagus Lugdunensis, avec le vaste évêché métropolitain de Lyon comprenant le Lyonnais, la Bresse, le Beaujolais et le Forez; 2° pagus Matiscensis, évêché de Mâcon; 3° pagus Cabillonensis, évêché de Châlons-sur-Saône; 4° pagus Augustodunensis, évêché d’Autun; 5° pagus Nivernensis, évêché de Nevers, peut-être celui-ci relevait-il ecclésiastiquement de la province de Sens; 6° pagus Lingonensis, évêché de Langres; 7° pagus Alasiensis, lequel aurait tiré son nom d’Alésia.
/133/
VI. Du pouvoir royal.
Aussitôt après la conquête, la royauté barbare débute partout par un vigoureux effort pour s’emparer de la société et fonder, à l’aide de ce qui est encore resté debout des institutions romaines, l’ordre et la discipline si nécessaires dans une telle confusion d’idées, d’usages, de nationalités. — Cet effort est très visible dans les lois attribuées à Gondebaud.
Dans le principe, d’après un renseignement que nous a laissé Ammien Marcellin, les Burgondes avaient deux chefs, l’un militaire et politique, nommé hendin, l’autre religieux, qu’on appelait siniste. Les Burgondes en agissaient parfois cavalièrement avec le premier de ces chefs; ils le déposaient lorsque le succès n’avait pas couronné ses entreprises, ou lorsqu’une disette désolait le pays, supposant alors que les dieux lui étaient devenus contraires; le grand prêtre n’était pas soumis à des chances de cette nature 1 .
Suivant la coutume germanique, le hendin était élu par le peuple, dans une famille déterminée; lors de son /134/ élection, il était élevé sur le bouclier 1 . La preuve de l’hérédité dynastique chez les Burgondes se trouve dans la loi Gombette 2 .
La conversion des Burgondes au christianisme fit disparaître le pouvoir du siniste aussitôt après l’établissement des Burgondes sur la rive gauche du Rhin.
Plus tard, les grands biens territoriaux échus aux rois dans le partage définitif donnèrent à ceux ci la faculté de s’attacher personnellement les plus vaillants guerriers et les personnages les plus influents. Ces concessions de terres (munera, beneficia,) se faisaient sous condition d’un engagement personnel de fidélité contracté par le concessionnaire; elles étaient transmissibles de père en fils, mais révocables pour cause d’infidélité à la personne du souverain.
Lorsque le roi laissait plusieurs enfants, ceux-ci gouvernaient en commun ou bien recevaient chacun une part du royaume. C’est ainsi que Gundahar gouverna en commun avec les deux autres fils de Gibica, Godomar Ier et Gislahar; que Gundioch partagea la couronne avec Chilpéric I, son frère; et que Gondebaud partagea le royaume avec Godomar, Chilpéric et Godegésile.
L’aîné, semble-t-il, conservait un certain pouvoir sur ses frères, qui étaient plus ou moins, vis-à-vis de lui, dans la position de vice-rois. Pourtant les guerres cruelles de Gondebaud tendraient à prouver que le droit de primogéniture demeura contesté. /135/
Les monarchies barbares se trouvèrent d’abord en présence de l’élément démocratique, constitué dans l’assemblée des hommes libres. Mais, peu à peu, l’aristocratie du gasindi vient s’interposer entre les deux pouvoirs et acquiert elle-même une influence considérable dans l’état. On peut voir par la constitution de Gondebaud, appelée communément la seconde préface, combien en Bourgogne les éléments monarchique et aristocratique étaient déjà prépondérants.
L’élément démocratique n’est pourtant pas encore tout à fait sur l’arrière plan. L’assentiment des hommes libres est toujours nécessaire pour donner force aux lois que propose le prince.
La formule de promulgation, soit première préface, contient une indication à ce sujet. « Nous avons réfléchi avec les grands de notre royaume et nous avons ordonné que le résultat de nos délibérations fût mis par écrit, etc. »
La seconde préface porte: « Nous avons d’abord, dans un conseil tenu avec nos comtes et les principaux de la nation, fait défense, etc. »
Si l’on compare ces formules avec le préambule de la loi Salique: « Gens Francorum inclyta …dictavit salicam legem per proceres ipsius gentis, » la différence est assurément fort sensible. On voit que les Francs, quand ils rédigeaient la loi Salique, étaient encore dans une phase de leur histoire où l’élément démocratique avait le premier rang.
Chez les Burgondes, c’est le roi qui fait et qui ordonne, après avoir pris conseil des grands du royaume qui représentent la nation auprès de lui.
Dans le dernier paragraphe de la seconde préface, on /136/ trouve cependant la preuve de l’intervention de la nation elle-même dans l’œuvre de la législation.
Art. 13: « Nous avons voulu que la présente constitution fût revêtue de la signature de nos comtes, afin que les règles tracées par nous, du consentement de tous, soient observées par nos descendants ainsi qu’un pacte perpétuel. » « Ut definitio quæ ex tractatu nostro, et communi omnium voluntate conscripta est, etiam per posteros custodita perpetuæ pactionis tenent firmitatem. »
En somme, il paraît résulter de ces textes que l’autorité royale est limitée par l’assemblée des grands (optimates, proceres), mais que l’assentiment du peuple entier est jugé nécessaire.
Le progrès rapide de l’autorité monarchique qui se remarque chez les Burgondes ainsi que chez les Goths, provient évidemment de l’influence plus considérable qu’eut chez ces peuples la classe des Gallo-Romains. Cette classe, habituée au despotisme, s’entendit mieux avec le roi qu’avec les hommes libres d’origine barbare, et contre-balança, tant par son nombre que par l’influence de ses chefs, l’élément démocratique encore assez vivace et fort qui existait parmi les conquérants.
L’institution du Gasindi royal, par les développements qu’elle prit après la conquête, devait conduire aux mêmes résultats. Tous les grands fonctionnaires, les comtes, les juges locaux, faisaient partie de la trustis du roi. Ainsi, pour arriver aux emplois, le premier échelon était de prêter au roi une fidélité spéciale. Les bénéfices, qu’on trouve pour la première fois chez les Burgondes, étaient aussi donnés exclusivement aux compagnons, aux convives du roi, c’est-à-dire aux personnes enrôlées dans son gasindi. /137/ — Une loi 1 nous apprend que ces personnes avaient le droit de recevoir l’hospitalité gratuite dans tout le royaume. Le même droit appartenait aux ambassadeurs étrangers chargés d’une mission auprès du roi.
Le fisc royal tirait ses principaux revenus des terres considérables qui lui avaient été attribuées, ainsi que des amendes et des confiscations. Dans les peines que les lois statuent le fisc n’est jamais oublié et les amendes, principale peine en usage pour les hommes libres, étaient parfois très élevées. La confiscation, si fort en usage dans les lois impériales, se rencontre encore dans quelque cas 2 . Nul doute que le fisc n’ait aussi recueilli les successions vacantes; le Papien 3 nous apprend que tous les affranchis du roi, lorsqu’ils n’avaient pas de descendants directs, devaient laisser au roi la moitié de leur bien.
Nous avons abordé plus haut la question fort difficile consistant à savoir si les impôts romains furent tous abolis, comme quelques-uns le pensent, ou s’ils furent maintenus en partie. La dernière opinion nous a paru la plus probable. En tous cas, on voit par ce qui précède, que le fisc des monarques burgondes était assez abondamment pourvu.
VII. Des fonctionnaires du royaume.
Un trait commun aux Etats fondés par la race germanique, c’est que l’organisation politique y sort proprement /138/ de l’organisation judiciaire. Ainsi dans le royaume burgonde comme dans les autres états barbares, l’organisation de la justice n’est pas seulement liée aux institutions politiques, il y a entre elles une complète identité.
La loi gombette, particulièrement dans l’ordonnance connue sous le nom de seconde préface, nomme toute une série d’employés qui sont aussi chargés de l’administration de la justice. Ce sont les comites, les judices, les consiliarii, les majores domus regiæ, puis aussi des cancellarii, des notarii. Le titre 52 fait encore mention d’un spatarius, celui qui porte l’épée, mais toujours sans nous dire au juste quelles sont leurs fonctions.
Quant aux comtes et aux juges, leur nom et l’analogie des autres lois barbares sont cependant des indications déjà suffisamment précises. Les juges sont même distingués dans la loi, en juges ordinaires et juges délégués, juges civils et juges militaires, juges romains et juges burgondes, etc.
Les principaux d’entre ces fonctionnaires sont les comtes. M. de Crousaz 1 estime que chaque comté (pagus) avait à sa tête un comte, présidant le tribunal de la province et ayant autorité sur les Burgondes et les Romains également; mais qu’au-dessous des comtes provinciaux se trouvaient dans chaque subdivision du district ou pagus, dans chaque pagellus un juge uniquement affecté aux Burgondes, et un autre uniquement affecté aux Romains. Ce dernier aurait été, selon l’ouvrage cité, le personnage que la loi appelle comes civitatis, car la population indigène libre résidait plutôt dans les villes. /139/
Cette explication me semble plus plausible que celle des auteurs qui, comme Davoud Oghlou 1 placent à la tête de chaque pagus un comte burgonde et un comte romain. Car, dans ce cas, l’unité d’administration eût été rendue impossible. Seulement je ne crois pas que le comte de la cité (comes civitatis) ait été un romain. En effet, on trouve fort peu de noms romains parmi les comtes dont la signature se lit, soit au bas de la seconde préface, soit dans la charte de fondation d’Agaune 2 . Je crois donc que le comte supérieur du pagus avait son siége dans la cité. Il est peu probable que les Burgondes eussent laissé les cités riches et populeuses de leur royaume sans un chef politique tiré de leur nation. Du reste, le texte de la préface place les comites civitatum avant les comites pagorum: « Tam Burgundiones quam Romani civitatum aut pagorum comites 3 .»
Nous n’avons pas de preuves directes que les fonctions judiciaires aient été exercées par le peuple directement. D’après la loi gombette, il semblerait même que cela n’eut pas lieu, car ce sont les juges qui sont rendus responsables personnellement pour avoir rendu un mauvais jugement. Dans chaque tribunal siégeaient deux juges, l’un burgonde, l’autre romain, lesquels rendaient la justice selon la loi des parties en cause. Ils siégaient ensemble et le jugement de l’un n’était pas valable si l’autre n’était pas présent. /140/ Il est pourtant à présumer que les juges burgondes, comme ceux des autres peuples germaniques, étaient assistés d’assesseurs choisis parmi les hommes libres. La différence entre eux et les juges des peuples qui avaient conservé intact l’usage germanique, auraient donc été simplement dans le mode de nomination.
On s’est souvent demandé ce qu’il fallait entendre par ces judices deputati, juges délégués, dont la loi fait mention. Matile 1 croit qu’ils fonctionnaient à la place du juge ordinaire dans des causes d’une certaine gravité. Bluhme voit en eux les assesseurs du comte, et ils lui rappellent l’institution romaine des judices pedanei. Je supposerais volontiers qu’ils sont des délégués du comte provincial, jugeant à sa place dans les pagelli. Nous voyons en effet dans les textes 2 qu’il dépendait d’eux qu’une cause fût jugée ou différée; cela suppose qu’ils remplissaient les fonctions de président du tribunal.
Les consiliarii, ministeriaux et majordômes sont, croyons-nous, des officiers attachés à la personne du prince; les judices locorum pourraient être des magistrats municipaux.
A chaque tribunal est attaché un greffier nommé notarius et des huissiers nommés wittisscalci, en latin pueri regis 3 . Le Papien les nommait apparitores.
Le fonctionnarisme se serait-il développé chez les Burgondes comme il le fit chez les autres peuples germaniques /141/ établis dans les terres de l’empire et spécialement chez les Francs? C’est infiniment probable. La prompte absorption de leur royaume dans l’empire franc empêcha que l’expérience pût s’accomplir.
Les bénéfices accordés dès le début aux fonctionnaires royaux, nous indiquent du reste quelle était la tendance invincible des institutions. La concession des honneurs à ces fonctionnaires n’aura sûrement pas manqué.
Si l’on a confondu souvent l’honneur et le bénéfice, l’inféodation des terres et celle des offices, c’est qu’il y avait entre ces deux institutions, entre ces deux modes de rattacher à soi et de récompenser ceux dont le prince avait besoin, une relation naturelle. De sorte que, on peut le dire, la concession des bénéfices implique en quelque sorte, là même où les sources ne nous le montreraient pas clairement, la concession correlative des honneurs.
L’honneur qui dans le principe était une exemption d’impôts accordée aux anciens magistrats romains, aux militaires, à la noblesse sénatoriale, et en général, aux influences considérables, était déjà devenu, du temps du bas empire, une façon de rétribuer des fonctionnaires en leur attribuant une part dans l’impôt qu’ils devaient percevoir, par exemple le cens d’une localité, les corvées d’un village, le péage d’un pont. L’arrivée des barbares ne devait pas changer un état de choses qui avait pris naissance dans de mauvaises conditions économiques, car elle ne faisait qu’aggraver encore ces conditions. Ce fut donc principalement dans la distribution des charges qui donnaient droit à percevoir l’impôt sur les vaincus que consista la part et le privilège des chefs. Les honneurs furent germanisés, et cette institution inaperçue fit plus, comme l’a /142/ si bien démontré Championnière 1 , pour amener le triomphe de la féodalité, que le bénéfice dont on parle toujours.
VIII. Des institutions locales et communales.
L’origine des institutions communales doit-elle être cherchée dans la marche germanique ou dans le municipe romain? Cette question tant controversée, ne saurait être résolue qu’après une étude attentive des vestiges que ces deux ordres d’institutions ont laissés au milieu de nous. Sous ce rapport, le sujet que nous allons aborder est au nombre des plus intéressants parmi ceux qui se rattachent à notre histoire juridique.
Il est fort vraisemblable que les Burgondes apportèrent avec eux l’organisation nationale propre à la race germanique. Cela était surtout facile dans les contrées où leur établissement fut opéré par masses compactes, établies dans certains quartiers que les indigènes abandonnaient en leur faveur.
Lorsque nous prenons la Germanie au temps de Tacite, nous y trouvons un grand nombre de tribus diversement nommées et dont chacune forme un état distinct 2 . Le territoire /143/ de cet état est un gau. Quelquefois ces états sont gouvernés par un roi, souvent ils ont à leur tête un magistrat électif. Les gau se subdivisent en centenies, et cette fraction du gau portait aussi le nom de marche 1 . Dans le nord, la centenie se retrouve sous le nom de Herad, Herred (d’où horde). C’est un district composé de 100 domaines (Hufen, Hafnir). Chez les Anglo-Saxons, le Hundred est une division du comté. Le centenier et la centenie se retrouvent aussi, soit chez les Goths, soit chez les Francs.
D’après l’interprétation que j’ai donnée précédemment à certain passage de la loi gombette, les comites pagorum de cette loi seraient aussi des centeniers. Très souvent, en effet, le mot pagus, par lequel on traduisait gau, le comté, a signifié aussi la subdivision du comté, le territoire de la centenie; pour éviter l’équivoque, on employa aussi l’expression pagellus afin d’exprimer une division du comté, mais cet usage est à peine la règle.
On a voulu poursuivre encore plus loin la subdivision territoriale; on a dit que la centenie était divisée en décanies, mais la décanie n’est qu’une subdivision militaire adoptée chez les Wisigoths, tandis que le friborg, qu’on pourrait assimiler à la décanie, est une institution de police, propre au gouvernement anglo-saxon. La marche et la centenie, au contraire, sont des institutions plus antiques, plus générales, dont tous les peuples issus de la race germaine ont conservé des restes ou, tout au moins la tradition. /144/
Le marche (marka) est proprement le territoire de la centenie, comme le gau était le territoire de l’état et devint dans la suite le territoire du comté.
Cependant le mot marche, n’a pas eu cette seule acception. D’après l’étymologie, il vient de mearc (anglo-saxon), qui signifie signum, marque, et c’est dans ce sens qu’Ulphilas a employé le gothique marka 1 . Car pour marquer les confins d’un territoire ordinairement fort boisé, les Germains se bornaient à incruster une marque sur les grands arbres de la forêt. En se rapprochant de cette signification primitive on a donné à marche le sens de limites, frontières, confins; tel est celui qu’il a dans le mot com posé mark-grafschaft, par lequel les Carlovingiens désignaient les comtés situés aux frontières, dont le chef mark-graf a donné naissance au mot français marquis. — Dans la marche germaine chaque famille avait une maison entourée d’une cour, d’un jardin et d’une ou deux pièces de terre labourable; le reste du territoire de la marche, composé de forêts et de pâturages, était possédé par la communauté.
La part de la propriété individualisée et la part réservée à la jouissance commune, ont pu varier selon les temps et les lieux, mais, en général, la première s’est accrue aux dépens de l’autre. — L’autorité communale avait dans ses attributions les partages de propriétés, leurs renouvellements, lorsqu’ils n’avaient été faits que pour un temps limité, le jugement des contestations qui pouvaient naître à ce sujet. Les communiers formaient à cet effet une sorte de conseil ou de tribunal, qui administrait, jugeait, faisait la police rurale et dirigeait l’exploitation du sol. /145/
J’ai considéré les judices locorum de la loi gombette comme ayant été de la catégorie de ces juges communaux, de ces juges de la marche, que d’autres peuples barbares ont nommé centeniers; je dois appuyer de quelques preuves une telle assertion.
Ces preuves, je les vois, ou des présomptions si l’on veut, dans la loi burgonde elle-même: Au titre 82, § 1, sur les fidéjusseurs et dans le Papien, tit. VI, § 1, nous retrouvons les juges des localités, et leurs fonctions sont assez analogues à celles d’un maire, soit syndic; ainsi d’après le Papien, c’est à ce juge qu’on doit dénoncer, dans un bref délai, l’arrivée d’un étranger soupçonné d’être fugitif.
La loi des Wisigoths 1 mentionne aussi le judex loci, qu’elle nomme encore major in loco, ou villicus loci. Major fut plus tard le nom de l’officier féodal dont on a tiré le titre de maire, lequel, en France, fut de tous temps celui du principal magistrat communal. Dans les formules de Marculf 2 il est question du senior communæ.
Nous ne trouvons pas, il est vrai, dans la loi burgonde les termes de marche et centenie; en revanche, nous y trouvons plus d’une disposition légale qui témoignerait de la présence d’une semblable institution. Ainsi l’existence de bois et de pâturages communs résulte clairement des passages de la loi gombette qui autorisent un certain usage en commun même des bois appropriés 3 et surtout /146/ de la disposition qui base la jouissance des biens communaux sur la propriété privée de chacun des participants 1 .
A leur arrivée les Burgondes étaient un peuple de mœurs essentiellement pastorales. La stabulation et le système d’engraissement leur étaient même inconnus, on n’avait que des pâturages naturels et des races rustiques, demi-sauvages, faites pour vivre en plein air et utiliser les ressources du plus maigre sol. Ce stage de l’industrie pastorale suppose nécessairement le pâturage libre sur de très vastes étendues. Cette nécessité économique vient à l’appui du sens dans lequel nous entendons les lois sur l’usage des biens communaux.
Langethal 2 a calculé, d’après la comparaison des lois barbares, qu’un troupeau de 12 vaches ou de 12 juments appartenait à trois villæ, tandis que ces mêmes villæ avaient entre elles 80 moutons et 40 porcs.
Probablement dans le principe ce bétail appartenait à la communauté. On trouve très souvent mentionnés dans les lois barbares le troupeau du roi et les troupeaux communs, beaucoup plus rarement ceux des particuliers.
La liberté du parcours allait si loin que le voyageur pouvait toujours faire paître ses bêtes sur les terres traversées par lui 3 . Non-seulement le pâturage fut libre dans /147/ les terres communes, mais il eut lieu aussi, pendant les jachères et après les moissons, sur les terres déjà appropriées. Les lois distinguent avec soin les champs clos et mis en défens, de ceux qui ne le sont pas, les premiers étaient les moins nombreux 1 .
Souvent plusieurs villages réunissent leurs troupeaux qu’ils envoient paître dans une marche commune sous la garde de pâtres communs 2 .
Toute possession immobilière crée une association des ayant-droit à cette possession, implique des règles pour en régler la jouissance, des chefs pour appliquer ces règles et tenir la main à leur exécution.
De plus, si le terme même de marche ou quelques-uns de ses équivalents ne se rencontre pas dans la loi burgonde elle-même, on les trouve, en revanche, dans une foule de documents remontant à une époque où la loi était en vigueur.
Déjà dans le premier établissement que les Burgondes avaient formé, dans le bassin du Mein, sur la rive droite du Rhin, il y avait un district nommé Burgundeiba; or eiba a le sens de mark 3 . Burgundeiba ou Wurgundhaib, comme /148/ l’écrit Paul Diacre, signifie donc la marche des Burgondes. Dans la même contrée, au milieu du mont Taunus, exista presque jusqu’à nos jours, sous le nom de haute marche du Taunus, un vaste territoire forestier, possession commune d’une trentaine de villages. Les habitants de cette marche se gouvernaient eux-mêmes, dans la forme démocratique, avaient des réunions annuelles appelées mark ding, et se nommaient des chefs chargés d’appliquer aux contrevenants une bizarre législation forestière dont les peines cruelles et d’une nature toute symbolique paraissent remonter à la plus haute antiquité 1 .Quoique la langue germanique ait promptement disparu des contrées où les Burgondes s’établirent définitivement, le mot de marche s’y retrouve encore çà et là. Ainsi un canton de la Franche-Comté est nommé par d’anciens documents, marchia de val de Loue.
La communauté de Bouchayage ou Bochirage du comté des Varasques (pays Varais), composée de 22 villages possédés en franc alleu par des paysans libres, communauté qui a existé jusqu’au XVIe siècle, dont les membres portaient le titre de barons bourgeois et avaient conservé le privilège de nommer les assesseurs de leur prévôt, ne rappelle-t-elle pas au plus haut point la haute marche du Taunus?
Les hommes royes de la grande communauté de Valangin, au comté de Neuchâtel, et les dixains du Valais, dont le nom allemand Zenten, Centen signifie clairement centenie, me paraissent également avoir conservé toute la physionomie /149/ de véritables marches, malgré les altérations que le laps des siècles dut nécessairement entraîner avec soi.
Je reconnais tout particulièrement la marche germanique dans cette expression fines, employée si souvent comme désignation topographique dans nos plus anciens documents. Fines, confinium, est en effet la traduction littérale de marche 1 . Dans les documents du VIIIe siècle cette expression est employée comme synonyme d’allmend, or l’allmend est le territoire commun de la marche 2 . Dans les mêmes documents les possesseurs de ces fines sont appelés convicani, compagenses; or, la finis prise dans le sens de marche est bien un pagellus.
La loi des Bavarois 3 donne à la marche le nom de commarchia ou commarca et appelle ses ressortissants les commarcani; comme on voit, compagenses est identique à commarcani et par conséquent marca est bien le sens dans lequel on emploie finis.
Les convicani, à leur tour, sont devenus en vieux français le veciné, ou voysiné. Or le veciné n’est pas le voisinage, mais bien la combourgeoisie, tout comme vecino en espagnol signifie bourgeois. « Tout fils de voisin est voisin, » dit la coutume de Bearn. Si le voisin n’était pas un communier, cet adage n’aurait pas de sens 4 .
En Italie les mots in fines, en italien, nei fini, servent encore actuellement à indiquer le territoire de la commune. Dans notre langage cadastral, il s’est conservé quelque chose de cette acception. /150/
Quand de nombreux renseignements propres à la nation burgonde ou aux territoires occupés par eux ne s’accorderaient pas, comme ils le font, dans le sens de la conservation de la marche germanique, les inductions morales et économiques et l’analogie des autres peuples conduiraient à la faire admettre. Chez les Wisigoths, chez les Lombards, chez les Francs, chez les Anglo-Saxons, on trouve la centenie, qui n’est pas autre chose. Elle y joua le rôle d’une institution politique et judiciaire fondamentale, jusqu’aux temps où le système purement germanique, que l’on a aussi nommé barbare, fait place au régime féodal 1 .
Lors de l’établissement définitif des Burgondes dans notre pays, la marche ou centenie aurait donc subsisté, mais elle dut s’adapter à de nouveaux rapports. Le gau étant devenu la division principale, la marche continua à en être une sous-division, pagus, pagellus. Sur le territoire encore assez étendu du pagellus se trouvent divers groupes d’habitations, tantôt isolées selon la coutume allémanique, tantôt un peu plus rapprochées selon la coutume burgonde. Ces groupes sont la villa, en allemand dorf, weiler, will.
Dans les quartiers réservés aux Burgondes en Savoie, en Helvétie et dans la portion montagneuse de la Séquanaise, un tel arrangement ne souffrit point de difficultés. Dans les pays plus cultivés, plus habités, dans les plaines arrosées par le Rhône et la Saône où les Burgondes durent partager le sol avec une population plus dense et plus stable, les rapports primitifs se modifièrent. Ici les /151/ propriétés communales furent naturellement plus restreintes et le caractère économique de la marche tendit de plus en plus à s’effacer.
De plus, les populations agricoles trouvant leur entretien sur un espace plus circonscrit, les marches se subdivisèrent à leur tour en communautés plus petites qui, tout en conservant quelquefois leurs droits de parcours et de bochérage sur les biens communs de la marche, eurent cependant des territoires particuliers et formèrent dans la communauté primitive de nouvelles communes, celles qui existent aujourd’hui. Dans les contrées montagneuses et boisées, les défrichements s’augmentant avec l’accroissement de la population, les mêmes faits se produisirent peu à peu. Ainsi, presque partout, avec le temps, les biens communaux diminuèrent dans une forte proportion et les petites communautés remplacèrent les grandes.
/152/ /153/ /154/
NOTES ADDITIONNELLES
/155/A.
GÉNÉALOGIE DES ROIS BURGONDES.
Cliquez 1X ou 2X sur l'image pour une vue agrandie
/156/NOTES DU TABLEAU PRÉCÉDENT
1 Gibika est appelé de ce nom dans la loi Gombette et dans tous les poëmes du cycle de Théodoric, dans Walther d’Aquitaine et dans le chant du voyageur, poëme anglo-saxon; c’est le Giuki de la Volsunga saga et le Dankrath des Niebelungen. L’étymologie serait le gothique giba, gabe; cadeau, d’où geben, donner; le sens de ce nom comme celui du nom vandale Ginamund et du nom gothique Gibimir est généreux, aimant à donner. L’identité de Gibika avec le scandinave Giuki se démontre par la racine anglo-saxonne Gifuka.
Atta weol Hunuu, Ermanrik Gotum,
Becca Baningum, Burgundum Gifuka.
(Chant du voyageur.)
Gibika est l’un des nombreux surnoms que la mythologie appliquait à Odin. Dankrath me paraît traduire le sens de ce mot; il peut signifier reconnaissant ou qui aime à rendre les autres reconnaissants, à leur donner sujet d’être reconnaissants. — Dans l’Edda, la femme de Giuki est Grimhilde; de Grimm, colère et hilda, une vierge guerrière.
2 Gundahar donne par contraction Gunther, forme allemande et Gunnar, forme scandinave; le nom latin est Gundicarius. La Criemhilde (Grimhilde), des Niebelungen et du Heldenbuch est sa sœur; mais l’Edda nomme cette sœur Gudruna, nom dont le sens serait l’épouse du guerrier. Gundahar a, dans la tradition allemande comme dans la tradition scandinave, épousé la Walkyrie Brynhilde (de Brünne, cuirasse). On la trouve quelquefois appelée seulement Hilda, quelquefois aussi Sigruna, c’est-à-dire, la victorieuse.
3 Gundomar, Godomar d’où Guttorm, forme scandinave, signifie l’illustre guerrier, de Mâri célèbre.
4 Gislahar, Giselher, de Gesell, signifie le compagnon d’armes.
5 Gundioch. Latin Gundheucus et Gundicarius a aussi été nommé Gunderich, ce qui a fait croire qu’il avait un frère ou un fils de ce nom. La terminaison euchus, vechus, se retrouve dans Merowée et dans Chilpérick, Hilférick de Hilpan Goth. Helfen all. Gundeuch voudrait dire secourable à la guerre, Hilperik, abondant en secours.
6 Gundobald, du goth. balth, hardi, signifie le vaillant guerrier.
7 Sigismund: celui qui commande à la victoire.
/157/
B.
SUR LES BURGONDES.
J’ai admis avec plusieurs écrivains que les Burgondes étaient un rameau de la branche gothique. Derischweiler, IVe Beilage, pag. 146, me confirme dans cette opinion. Il cite, à ce sujet, un passage d’Agathias, auteur qui a bien connu les nations germaniques, où les Burgondes sont nommés Εθνος γητικον, race gothique 1 . L’auteur de la vie de St. Rémi 2 , n’est pas moins explicite; il dit des Burgondes: « Burgundiones Ariani quoque et Gothi, quorum princeps erat Gundobadus. »
Ainsi l’origine gothique ou vandalique, attribuée au peuple burgonde au temps de Pline, était encore reconnue comme telle au temps de Gondebaud.
Quant à la langue burgonde, elle ne nous est connue que par un bien petit nombre de mots, mais, dans tous ceux qui nous sont parvenus, les racines gothiques se reconnaissent aisément; on en a vu des exemples justement dans la note précédente. Malheureusement les Burgondes n’ont pas eu comme les Goths un Ulphilas pour conserver leur dialecte en l’écrivant. Lorsqu’ils commencèrent à écrire, ils employèrent de suite le latin. Depuis leur conversion au catholicisme, ils employèrent aussi la langue latine dans le culte. Leur caractère, plus facile que celui de plusieurs autres nations germaniques, leur esprit plus accessible aux impressions étrangères, peuvent aussi avoir contribué à empêcher la conservation de la langue burgonde. /158/
Elle a certainement été parlée quelque temps dans plusieurs parties du royaume, car dans l’Helvétie romane, la Savoie, la Franche-Comté, les noms de lieux en offrent maintes traces. Toutefois, là aussi, elle fit promptement place aux dialectes romans, que les familles burgondes se mirent à parler aussi bien que les indigènes.
/159/
C.
EXEMPLES DE L’EMPLOI DU MOT FINES DANS LES CHARTES ROMANDES
1° Ann. 616. Dans la fondation de l’abbaye d’Agaune par le roi Sigismund, l’un des rares documents qu’on ait conservés des temps du premier royaume de Bourgogne, nous lisons: « Et, in pago Waldense, in finem Aventicæ, seu Juranense, alias curtes, Muratum (Morat), Auronum (Oron), Lustriacum (Lutry), etc. Le roi donna au couvent de nombreuses propriétés dans les comtés de Lyon, de Vienne, de Grenoble, d’Aoste, de Genève, de Vaud et du Valais. Mémorial de Fribourg, de l’année 1857, pag. 388.
2° Ann. 890; troisième du règne de Rodolphe Ier, le comte Manassès donne à l’église de Lausanne une terre située in pago Genovense, in fine Ercolane, in villa Mustiniaco. La fin Ercolana est le territoire d’Evian, Mustiniacum est le village de Montigni, situé entre Lugrin et Saint-Paul. Reg. Gen., N° 107.
Une charte de 892, du même comte Manassès, contient les mêmes indications. Reg. Gen. n° 109.
3° Ann. 896. Donation faite par le comte Gerlandus in pago Lausannense, in fine Runingorum. Renens est une localité qui paraît avoir été importante après la destruction de l’ancien Lausonium, et qui donna son nom au pagellus, longtemps après la construction de la nouvelle ville de Lausanne et le transfert du siège de l’évêché, comme on le verra par les chartes suivantes M. D. R. VI, Cartulaire de Lausanne, pag. 88.
4° Ann. 913. Fredarius donne à l’église de Lausanne ce qu’il possède en villa Bero (le Bied) in pago Lausannense, in fine Runingorum. M. D. R. VI. Cart., pag. 87. /160/
5° Ann. 920. Aymon donne à l’église de Lausanne des biens in pago Lausannense, in fine Runingorum, in villa Modernaco (Mornex). M. D. R. VI. Cart., pag. 32.
6° Ann. 929. Le prêtre Vitalis fait donation à l’église de Lausanne de terres situées à Mésery in fine Runingorum. M. D. R. VI. Cart., p. 231.
7° Ann. 965. Ricardus donne à l’église de Lausanne un casal in pago Lausannense, in fine Graniacensi (Granges), in villa Losinges (Lucens). M. D. R. VI. Cart., pag. 3.
8° Ann. 1031. Gilinus donne au monastère de Romainmôtier une manse située in comitatu Waldense, in pago Lausannense, in fine Runingorum, in villa Rangerensis (Ranges).
Ici nous voyons une double division du comté.
On observera que l’emploi du terme finis dans les exemples ci-dessus est tout à fait le même que celui qu’on fait du mot marche dans les chartes de la petite Bourgogne ou Bourgogne allémanique (le pays situé entre l’Aar et la Reuss). Ainsi, dans l’acte de fondation de l’abbaye de Frienisberg, Udelhard, comte de Seedorf, donne son alleu de Frienisberg in super et lacum potestati nostræ in marchia Seedorf sitam.
/161/
D.
SUR L’ORIGINE DES COMMUNES RURALES.
Les institutions municipales avaient acquis sous le gouvernement romain une importance considérable, mais elles n’existaient que dans les cités; les campagnes étaient possédées et administrées par les cités, où la population libre se trouvait concentrée. Les possesseurs du sol n’allaient dans leurs terres que pour les visiter, pour y séjourner momentanément; ils n’y vivaient pas et en abandonnaient la culture aux esclaves et aux colons, dont la condition était un demi esclavage.
Constitué à l’image de Rome, le municipe provincial avait son sénat (la curie), son assemblée du peuple, ses magistrats particuliers, choisis parmi les plus riches d’entre les décurions. A la tête de ceux-ci furent d’abord les duumviri, en fonctions pendant une année, institution créée à l’image du consulat romain; ou bien un principal, désigné par le gouvernement. A mesure que la décadence économique se fit sentir, la position de ces décurions et de ces magistrats municipaux, qu’on rendait responsables des sommes qu’ils devaient recueillir pour le fisc, devint de plus en plus insoutenable. Les décurions finirent par fuir de toutes les façons possibles un honneur trop chèrement payé.
A peu près dans le même temps apparurent dans le gouvernement de la cité deux personnages nouveaux: l’évêque et le défenseur; ce dernier, nommé aussi syndic, était dans le principe le procureur chargé de soutenir les procès que la cité pouvait avoir. Dans la seconde moitié du IVe siècle, le défenseur, pris en dehors de la curie, nommé par le peuple et confirmé par le préfet provincial, est le seul magistrat municipal; il est chargé, comme son nom l’indique, de protéger les citoyens contre les exactions des /162/ employés du fisc. Le pouvoir du défenseur fut tout de circonstance et dura peu; celui de l’épiscopat, au contraire, était destiné à aller grandissant. Depuis Constantin, l’évêque avait eu la juridiction civile sur les clercs de son diocèse; il acquit ensuite par l’usage, même sur les laïques, une sorte de juridiction arbitrale et certaines attributions de police et de justice non contentieuse. Après la conquête barbare, les évêques se virent placés, de fait et de droit, à la tête des cités dans lesquelles ils avaient résidence, c’est-à-dire dans toutes celles qui avaient joui autrefois du droit municipal. C’est autour d’eux que se groupait la population romaine, c’est chez eux que les rois barbares trouvèrent leurs plus influents, leurs plus habiles conseillers. Lorsque Majorien tenta de restaurer les municipes, il s’efforça de relever les fonctions de défenseur, qu’on fuyait comme toutes les autres, et de ramener les décurions dans les cités. Cette tentative était trop tardive, elle ne sauva pas l’empire, dont la chute était inévitable, mais elle eut, par suite même de la chute de l’empire, un effet fort inattendu. En présence de l’invasion germanique, devenue un fait accompli, la population romaine sentit le besoin de s’unir, de s’organiser, afin de compter pour quelque chose vis-à-vis des nouveaux occupants. Le cadre de cette organisation se trouva dans les curies municipales. Une fois tombées les lois fiscales qui avaient rendu la position des décurions intolérable, les curies purent se repeupler; c’est alors qu’elles prirent volontiers le nom de sénat.
St. Avitus nous apprend dans sa correspondance que vers l’an 500 le sénat de la ville de Vienne était nombreux et rempli d’illustres personnages. « Senatus Viennensis cujus tunc numerosis illustribus curia florebat. » Dans Grégoire de Tours, il est constamment question des familles sénatoriales. Ainsi, dans la Gaule, la renaissance des municipes correspond avec la destruction de l’ordre de choses au sein duquel ils ont été constitués.
Les municipes romains furent donc, cela me semble bien prouvé, l’origine des institutions municipales dans les cités, et surtout dans les cités épiscopales. Mais en quoi cette institution aurait-elle pu contribuer à la formation des institutions communales dans les campagnes, où elles n’étaient pas connues? où, d’après /163/ les institutions romaines, elles n’étaient pas seulement possibles?
Les barbares, comme leurs ancêtres, dont Tacite a décrit les mœurs, aimaient peu le séjour des villes; ils préféraient vivre isolés dans la campagne, chacun choisissant l’emplacement de sa maison selon les convenances du lieu, chacun laissant un espace vide autour d’elle 1 . De nos jours encore, dans les pays où la race germanique domine, on peut observer l’effet de ces anciennes habitudes.
C’est donc dans les campagnes que les barbares, transportés sur le sol de l’empire, s’établissaient de préférence; c’est dans les campagnes que leurs institutions locales ont dû s’implanter et se maintenir.
J’ai montré, dans le § VIII, comment de nombreux indices nous permettent de penser que l’institution de la marche, avec ses diverses applications soit économiques, soit politiques et judiciaires, exista parmi les Burgondes.
Pour établir le lien entre l’état de choses de l’époque burgonde et le moment où nous voyons fonctionner la commune chez nous sous le régime féodal, il ne sera pas inutile de démontrer que la marche existait aussi chez les Francs.
Ni la loi Salique, ni la loi Ripuaire n’ont prononcé le mot de marche; mais nous y rencontrons à chaque instant la centenie, qui est au fond la même institution, et dont le rôle est très important, surtout dans l’organisation judiciaire. Le Tunginus ou centenier présidait les plaids ordinaires à l’époque où la loi Salique a été rédigée.
A cette époque, antérieure, croyons-nous, à la conquête de Clovis, le comte ou graphio n’apparaît encore que comme l’officier chargé de veiller à l’exécution des jugements rendus devant le Tunginus. Plus tard, après Clovis, le graf présida le plaid du comté et le Tunginus continua ses fonctions dans le plaid de la centenie, dont les attributions ont quelque peu diminué.
Un passage, souvent peu compris, de la loi Salique, me paraît jeter beaucoup de jour sur l’organisation de la centenie dans le royaume franc. /164/
Sous le nom de villa la loi désigne alternativement deux choses différentes: un domaine (Hof) et une petite communauté rurale, fraction de la marche, le Dorf.
Or le titre 57 de la lex Emendata établit la procédure à employer lorsqu’une personne étrangère vient se placer au milieu d’une de ces communautés rurales, sans l’assentiment des membres dont elle est composée. Chaque communier a, dans ce cas, le droit de soulever opposition; à cette fin, il somme l’intrus de déguerpir dans les dix jours. Après trois sommations il le somme à comparaître au plaid. Si le nouveau venu fait défaut le troisième jour, le graphion se transporte chez lui et l’oblige à partir. Mais si l’étranger à la communauté avait été toléré pendant un an, sans opposition, le droit d’y demeurer lui est acquis et ce droit lui confère des droits égaux à ceux des autres habitants.
Ces dispositions montrent que les habitants d’un village formaient entre eux une corporation dont les habitants avaient la jouissance indivise de certains fonds. Le nouveau venu ne doit participer à ces jouissances qu’avec l’assentiment de tous les ayant-droit.
Déjà lors de la rédaction de la lex Emendata, cette loi semble avoir été mal comprise. En effet, le rédacteur donne au titre pour intitulation: « De eo qui villam alienam occupaverit, vel si duodecim mensibus eam tenuerit, » ce qui indique que le rédacteur a cru qu’il s’agit ici d’un domaine, et prend villa pour Hof. Dans les anciens textes 1 on s’est gardé de cette faute; l’intitulé est de Migrantibus.
Un décret de Chilpéric, de 574, fait aussi allusion aux jouissances foncières auxquelles ont droit les membres d’une communauté rurale 2 . /165/
Le titre 78 de la loi Ripuaire parle de forêts communales. « Si quis Ripuarius in sylva communi, seu regis, vel alicujus locatum materiamen, vel signa fissa abstulerit. »
Les §§ 20 et 30 du titre 29 de la loi Salique constatent aussi le droit qu’avait chaque habitant de prendre du bois pour ses besoins, pourvu qu’il ne prenne pas celui qui, dans l’année même, avait été marqué et réservé pour d’autres.
Enfin le décret de Childebert, de l’an 596, ch. 11 et 12, essaie, comme mesure de police, d’instituer entre les membres de la villa la garantie mutuelle pour les délits dont l’auteur demeure inconnu.
En somme, si les lois franques ne nomment pas la marche, l’institution elle-même, avec ses caractères propres, s’y trouvait clairement indiquée. — Les Francs n’apportèrent pas la centenie dans le royaume de Bourgogne; l’institution communale existait déjà sous des noms différents, mais sûrement ils ne l’abolirent pas, la possédant eux-mêmes. Les dixains du Vallais la rappellent par leur nom allemand Centen; on la trouve partout dans l’Helvétie allémanique.
Dans l’Helvétie romane, le comté des Equestres n’est autre chose qu’une centenie ou un vicomté du comté de Genève 1 . Dans le comté de Haute-Bourgogne, la division principale porte le nom de vicomté; dans le Lyonnais, cette division s’appelle vicarie ou viguerie. Ce terme de viguerie se retrouve aussi dans la Bourgogne française et quelquefois dans le midi./166/
Plusieurs actes de l’époque mérovingienne constatent les progrès de la clôture sous les Francs 1 . Avec leur aide, on peut mesurer les progrès que fit alors l’appropriation privée. Il se faisait pour la pâture communale abolie quelque chose d’analogue à notre pratique moderne des cantonnements.
L’extension de la propriété individuelle aux dépens des communaux avait lieu de diverses manières. D’abord on avait l’occupation dans le désert (in eremo), mode d’acquérir fort usité, car les chartes de l’époque franque y font de nombreuses allusions. On exigeait seulement pour garantie de légitime acquisition la preuve du défrichement; proprisa ou aprisio 2 .
On appelle encore aujourd’hui dans le Jura une propriété privée une prise et en vieux français un pourpris.
L’appropriation aux dépens des communaux eut encore lieu sous la forme de concession emphithéotique. Les rois, les églises, les seigneurs, firent une foule de concessions de ce genre, dans lesquelles le domaine utile était seul concédé, et où le domaine direct fut gardé par le donateur.
L’histoire des communautés rurales se présenterait à nos yeux de cette manière:
La tribu germaine a occupé un canton (marca, fines, burgia), dont les ressortissants ont un droit commun sur la totalité des terrains non clos de leur territoire à l’exclusion de ceux qui ne sont pas de la communauté.
La communauté politique est unie à la communauté économique. La propriété privée du chef de famille est le signe apparent de son droit aux jouissances communes et de sa participation aux droits de citoyen.
La réunion des citoyens rend la justice dans le tribunal de la communauté, dans le mallum ou placitum minor, présidé par le /167/ centenier, vicaire ou tunginus. L’assemblée des hommes libres du comté formait le placitum major, devant lequel étaient portées les causes portant sur un fait de rupture de la paix publique, tandis que les petits délits et les causes civiles appartenaient dans le principe au plaid mineur, au tribunal du centenier, lequel se réunissait périodiquement, et au moins tous les quinze jours.
Mais, comme on le comprend aisément, cette organisation, qui date de la conquête barbare, ne traversa pas intacte le régime de la féodalité. Les chefs des marches, comme les chefs des gau, sont devenus d’abord des officiers du roi, plus tard des seigneurs féodaux. Ils ont absorbé leur juridiction et en ont fait leur chose propre; ils ont réuni dans leurs mains tous les droits politiques, ils ont usurpé le domaine éminent sur les biens communaux. Cependant, en général, les rapports civils demeurèrent tels quels, souvent même les communes conservèrent, au travers des siècles, leurs anciennes jouissances, sous la condition de certains droits et de certaines prestations.
Ainsi la commune rurale, opprimée, effacée, mais non anéantie, a traversé les siècles, a subi tour à tour les influences les plus opposées. Relevant la tête au XIIe et au XIIIe siècle, lors de la grande révolution communale, retombant dans l’obscurité et la faiblesse lors de la réaction féodale qui suivit ce puissant mouvement; se maintenant toutefois comme véritable commune partout où elle conserve comme base, dans une mesure quelconque, des fonds de terre dont ses membres jouissent en commun.
Sous le point de vue politique, la commune rurale fut absorbée dans le système féodal; le seigneur paraît seul dans cette sphère. Sous le point de vue juridique il en fut de même, dans la règle, mais exceptionnellement, la commune conserva çà et là, fort avant dans le moyen âge, des restes visibles de son ancienne activité.
Dans nos districts ruraux, surtout, semble-t-il, dans les contrées montagneuses où les Burgondes auraient eu autrefois leurs quartiers, nous retrouvons encore au XIIIe et au XIVe siècle ces boni homines, ces anciens rachimbourgs ou arimans, qui rendaient la justice dans la marche et dans la centenie 1 . Ce ne sont plus /168/ sans doute des hommes libres dans l’ancienne acception du mot, ce ne sont pas davantage des nobles ou des bourgeois proprement dits; mais ils subsistent comme communauté exerçant elle-même la juridiction, sous la surveillance, mais en dehors de l’action directe des seigneurs féodaux. Comme preuve palpable de la préexistence de nos communes rurales au régime féodal et de leur persistance à travers ce régime, un tel fait avait certes une haute signification.
/169/
E.
VESTIGES DE L’INSTITUTION DE LA MARCHE DANS LES PETITS CANTONS.
Les écrivains allemands qui ont étudié les antiquités juridiques de leur pays considèrent tous la marche comme une institution, sinon tout à fait primitive, du moins fort ancienne. Quelques ouvrages spéciaux ont été consacrés à rassembler les traces de cette institution qui se sont conservées. On peut consulter avec fruit, à cet égard, von Löw: Ueber die Markgenossenschaften (1829). Il a surtout traité des marches de la région du Rhin et von Maurer: Geschichte der Markverfassung in Deutschland. (1856).
Mais pour retrouver la marche germanique réellement vivante dans les institutions contemporaines, il faut surtout considérer celles de nos petits cantons. Là, grâces à la puissance conservatrice propre aux pays de montagne, comme aussi à des conditions économiques et politiques favorables, la marche s’est conservée d’une façon véritablement surprenante. Elle n’est pas disloquée en petites communes, comme dans les cantons de la plaine; elle existe à côté de la commune rurale (Dorfgemeinde); quelquefois même cette dernière lui reste encore subordonnée 1 .
Durant les périodes allemanique et franque, l’Helvétie orientale était divisée en gau d’étendue assez différente.
Le Thurgau, comprenant d’abord presque tout le nord-est, fut divisé sous les Carlovingiens en Thurgau et Zuric-Gau. Dans ce dernier furent compris les districts forestiers d’Uri, Schwytz et /170/ Zoug. L’Argau s’étendait sur Lucerne et Unterwald. Glaris, avec la Rhétie, faisait partie du Churwalden-gau. Le Linz-gau réunissait au Vorarlberg actuel le Rheinthal et l’Appenzell.
Les documents relatifs aux cantons démocratiques ne remontent guère au delà du Xe siècle. Les centenies franques étaient déjà effacées alors, comme institution judiciaire, par la juridiction des seigneurs et les immunités, mais elles subsistaient comme institution économique et comme division territoriale. L’étendue des anciennes marches ne peut plus être complètement déterminée. Bluntschly pense que les Waldstætten en formaient trois; cette hypothèse est appuyée par l’emploi du mot pagellus, désignant le pays d’Uri dans le document de fondation de l’abbaye des dames de Zurich, de l’an 853.
Le canton d’Uri se compose aujourd’hui de deux districts inégaux, Uri et le val d’Urseren, et le district d’Uri constitue une véritable marche, dont les ressortissants sont copropriétaires (Markgenossen). Ainsi chaque citoyen y a droit aux pâturages et aux forêts 1 . La jouissance des biens communs se rattachait autrefois à la propriété particulière; il en est résulté des lois destinées à empêcher la propriété particulière elle-même de tomber dans les mains d’étrangers au district.
Le district de Schwytz-Intérieur forma, dès les temps les plus reculés, une commune d’hommes libres. Dans un document du XIIe siècle, le comte de Lenzbourg parle déjà des cives de villa Suites, expression bien remarquable, lorsqu’on la voit appliquée à de simples paysans. Villa doit ici se traduire par commune, car le bourg de Schwytz n’existait pas alors.
Sous le nom d’Allmenden, on comprend à Schwytz non-seulement des montagnes, des pâturages et des forêts à l’usage de la communauté, mais encore des marais et des tourbières. A la jouissance des droits politiques était rattachée la jouissance des Allmenden. En 1798 seulement, on créa pour l’administration économique des Allmenden une autorité distincte des autorités politiques. A Schwytz, comme à Uri, la commune proprement dite /171/ n’est pas encore entièrement développée. L’ancien pays de Schwytz forme une seule grande Markgenossenschaft sous le nom d’Oberallmend. Le quartier d’Arth forme l’Unterallmend. Une institution analogue existe à Einsiedlen et dans le district de la Marche.
A Unterwald, les communes économiques (Theilsame) sont distinctes des communes politiques et possèdent les Allmend; elles sont plus petites que les communes politiques appelées dans le haut Kirchgänge, dans le bas, Uertene.
Appenzell était divisé en douze Rhodes, dont six ont formé l’Appenzell-Extérieur, et six l’Appenzell-Intérieur. Le nom indique qu’elles étaient autrefois une division militaire (Rotten); leurs chefs s’appellent capitaines. Dans l’Appenzell-Intérieur le pays a absorbé la commune comme à Uri, et la Rhode n’est plus qu’une division territoriale. Dans l’Appenzell-Extérieur, la commune s’est entée sur la Rhode et l’a subdivisée. Il y en a 20 pour 7 Rhodes. On croit qu’anciennement l’Appenzell a formé une seule marche, la haute marche du Linzgau.
Il y a beaucoup d’analogie entre l’organisation du canton de Glaris et celle d’Appenzell-Extérieur. Il est divisé en 15 Tagwen, qui se subdivisent en genossamen, c’est-à-dire en communes économiques. L’assemblée de la Tagwe s’occupe de la jouissance des allmend et des forêts, ainsi que de la police.
Nous prenons, comme on voit, sur le fait, dans les cantons démocratiques de la Suisse, les diverses transitions par lesquelles la marche germaine a passé pour arriver à nos communes actuelles.
Dans l’Helvétie romane, les dixains du Vallais, les grandes communautés du canton de Neuchâtel, quelques grandes communautés du canton de Vaud, aujourd’hui subdivisées en communes ordinaires, font le pendant plus effacé de ce même tableau.
On peut déduire de ces faits non-seulement la grande persistance de la marche germanique dans certaines conditions données, mais la tendance que la marche avait naturellement à se subdiviser selon les besoins locaux, et à former par là des communes rurales comme celles qui existent aujourd’hui.