MÉMOIRES ET DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE
SECONDE SÉRIE
TOME XIV
MOUDON SOUS LE RÉGIME SAVOYARD
PAR
† BERNARD DE CÉRENVILLE
ET
CHARLES GILLIARD
LIBRAIRIE PAYOT & CIE
LAUSANNE - GENÈVE - NEUCHATEL
VEVEY - MONTREUX - BERNE
1929
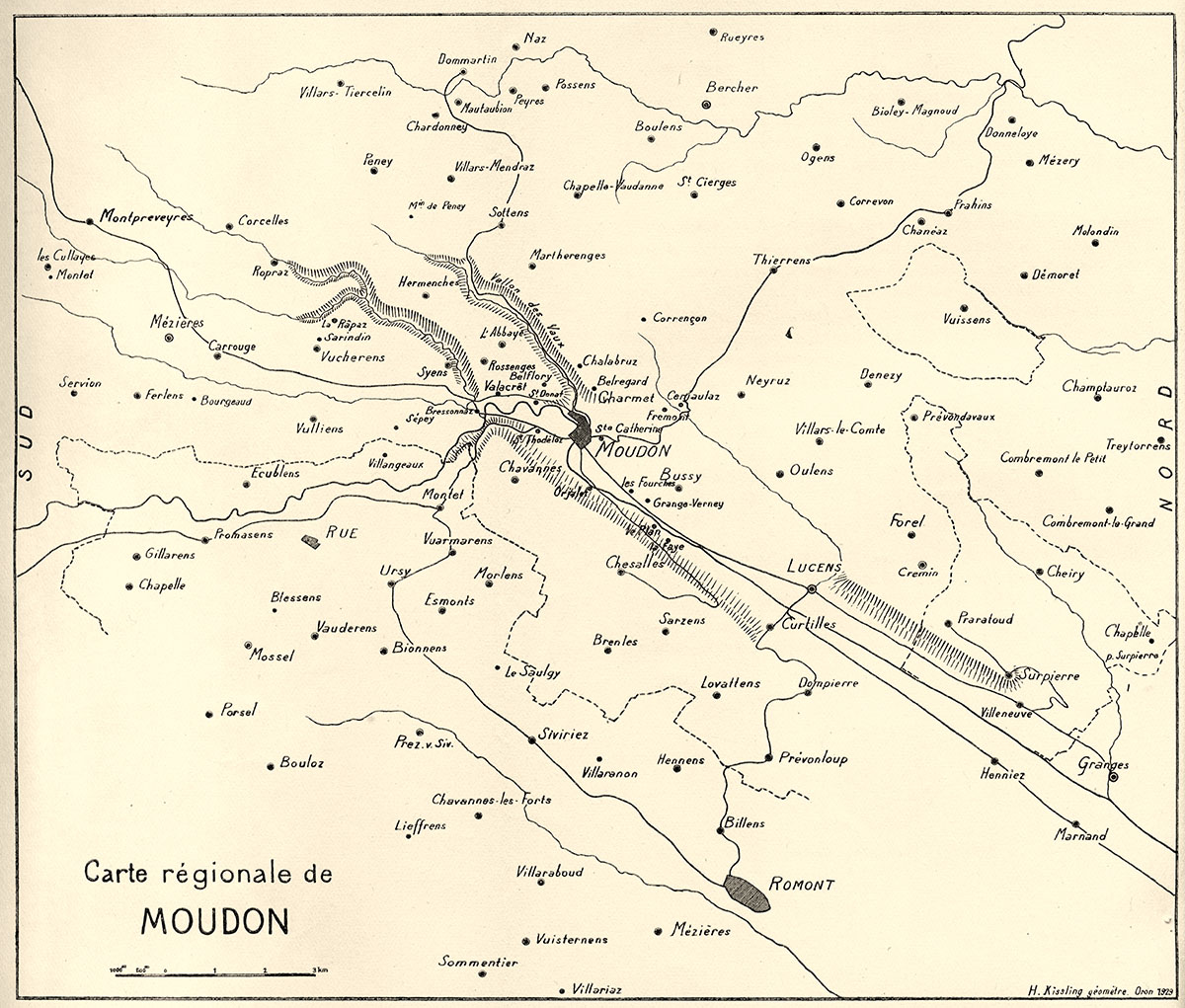
Pl. I : Carte de la Vallée de la Broye
/1/
CHAPITRE PREMIER
L’EPOQUE ROMAINE
Nous ignorons quel fut le peuple qui, le premier, s’établit dans la verte et fertile contrée où Moudon prospéra plus tard et quand des hommes s’installèrent pour la première fois au confluent de la Mérine et de la Broye. Aucune trouvaille, jusqu’ici du moins, ne nous a apporté la preuve que ce lieu ait été occupé aux époques préhistoriques.
Le plus ancien témoin que nous ayons de l’existence de Moudon, c’est son nom : Minnodunum 1. Nous n’en saisissons guère le sens 2; tout ce que nous savons c’est que nous avons là un mot d’origine celtique, d’une forme analogue à ceux que nous retrouvons dans les noms d’Yverdon et de Nyon, /2/ dans notre pays, et à ceux de tant de villes françaises. Il nous apprend que Moudon fut un bourg des Helvètes, peut-être avant la conquête romaine (58 avant J.-C.), peut-être après cette date seulement, en tout cas dès le début de l’ère chrétienne.
Comme partout ailleurs, Rome y laissa son empreinte ineffaçable; le bourg se romanisa. Depuis plus de trois siècles le sol de Moudon nous a livré de nombreuses médailles romaines 1. La plus importante de ces trouvailles semble avoir été faite vers 1760 dans une carrière de molasse, au lieu dit en Orjalet, sur la rive droite de la Broye, un peu à l’orient de la ville 2. Ce trésor — il s’agissait de pièces d’argent — fut dispersé, la plupart des pièces ayant été achetées à vil prix par des étrangers qui en connaissaient la valeur; quelques-unes seulement, sur un ordre tardif de LL. EE., parvinrent au cabinet des médailles de /3/ la Bibliothèque de Berne 1. D’autres entrèrent dans une collection particulière qui n’existe plus 2. Les monnaies trouvées à Moudon paraissent avoir appartenu à toute l’époque romaine; elles ne nous donnent aucun renseignement dont l’historien puisse se servir utilement 3.
Le nom de Moudon figure aussi sur les Itinéraires, ces guides officiels des fonctionnaires impériaux : sur la route du Grand Saint-Bernard à Avenches par Vevey, Minnodunum est un relai entre Uromagus et Aventicum 4. /4/
Nous ne sommes pas fixés sur son tracé exact. Elle arrivait à Bressonnaz par la rive gauche de la Broye; franchissait-elle la rivière en ce point par un gué et continuait-elle par la rive droite pour traverser de nouveau la Broye par un pont à l’endroit où se trouve aujourd’hui le pont St-Eloi ? Restait-elle sur la rive gauche et atteignait-elle le vicus par le quartier actuel du Bourg ? Nous ne le savons; la première hypothèse paraît plus probable.
A Minnodunum, la voie romaine se partageait en deux, semble-t-il : pour éviter les terrains marécageux de la plaine, toutes deux gagnaient les collines, l’une par Bussy, Lucens, Cremin et Surpierre; l’autre, plus importante, franchissant encore une fois la rivière, se dirigeait sur le Plan, Chesalles et Lovatens. Une route moins fréquentée se détachait la première à Bussy et, par Thierrens, rejoignait la route du Jura à Yverdon 1.
Un relai, une bifurcation, un pont probablement, voilà les origines de Moudon. Le bourg n’était pas très considérable : quelques hôtelleries, des écuries, des entrepôts; il n’est resté aucune trace de bâtiments romains. Les rares objets, statuettes de divinités, animaux, ou menus ustensiles en bronze trouvés à Moudon, sont de petites dimensions et de peu de valeur; ils ont appartenu à une population aux ressources modestes 2.
Le seul monument qu’ait laissé l’époque romaine /5/ est un autel votif, découvert en 1732 à la tête nord du pont sur la Broye; il orne aujourd’hui le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville 1. Il a été élevé /6/ en l’honneur de Jupiter et de Junon par Q. Aelius Aunus, sévir augustal; ce personnage appartenait donc à cette corporation, souvent composée d’affranchis, qui avait pour objet spécial de son activité l’entretien du culte impérial et qui occupait dans les villes de province un rang privilégié, après les décurions ou magistrats, mais un peu au-dessus des autres habitants; celui qui y arrivait était tenu de donner des repas et des jeux 1. Pour s’acquitter de cette obligation, celui dont nous nous occupons, donna à ses concitoyens un modeste capital de 3000 francs environ 2; les intérêts devaient servir à leur procurer chaque année pendant trois jours le spectacle de concours sportifs ou de représentations analogues à celles que donnent aujourd’hui nos cirques ambulants 3. /7/ Le donateur, qui savait ce qu’il voulait, stipule que, si l’on détourne de leur destination les revenus de sa fondation, celle-ci reviendra aux habitants d’Avenches. Cet affranchi qui avait fait de bonnes affaires tenait à ce que son nom ne fût point oublié; il fut mieux servi qu’il ne pouvait l’espérer : ses concitoyens lui fournirent une place pour y élever ce petit monument que de lointains descendants gardent encore pieusement.

Pl. II : Autel votif, de l’époque romaine
Placé aujourd’hui sous les arcades de l’Hôtel-de-Ville.
Cette inscription, qu’il n’est pas possible de dater avec précision, paraît être de la fin du second siècle de notre ère 1. Le tailleur de pierre qui l’a gravée ne savait pas le latin : il a croisé les lignes et déformé les mots, ce qui rend l’interprétation assez difficile.
Une autre inscription, trouvée en 1853 dans les mêmes parages, est si mutilée qu’on n’en peut rien tirer 2.
Où était la bourgade romaine ? Au nord de la Broye, entre le pont St-Eloi et l’église St-Etienne, fort probablement 3. C’est en effet à la tête nord du pont qu’ont été trouvées les deux inscriptions; on sait aussi que les églises paroissiales occupent d’ordinaire l’emplacement des premiers sanctuaires chrétiens. Il est /8/ peu probable que le bourg se soit étendu également sur la rive droite de la rivière 1.
Nous ne savons pas si, comme Avenches, Moudon eut à souffrir des premières invasions, vers 265, puis vers 350; la route romaine continua à être quelque peu fréquentée, puisqu’on a trouvé des monnaies postérieures, mais les documents s’arrêtent avec le IVe siècle : dès le début du Ve nous sommes dans l’obscurité la plus complète.
CHAPITRE II
LE PREMIER MOYEN AGE
Sept cents ans de silence enveloppent maintenant l’histoire de Moudon; nous n’essayerons pas de percer les ténèbres de cette longue nuit 1. Une chose est certaine : Moudon ne joua aucun rôle pendant la durée /10/ du royaume de Bourgogne. Les rois de la dynastie rodolphienne séjournèrent volontiers dans notre pays; nous les voyons à Orbe, à Eysins, à Corsy sur Lutry, à Vevey, à Lausanne. Jamais nous ne les rencontrons à Moudon. Et quand, après la mort de Rodolphe III, son héritage passe à l’empereur Conrad II, c’est à Payerne que celui-ci vient se faire couronner, le 3 février 1033 1.
Ce n’est qu’au XIIe siècle, dans des documents relatifs à Haut-Crêt, que le nom de Moudon réapparaît.
L’abbaye cistercienne de Haut-Crêt, fondée en 1134 par l’évêque Guy de Maligny 2, jouit dès le début de la faveur des seigneurs et des gens d’alentour; les /11/ donations affluèrent; elle devint riche et eut des difficultés avec certains de ses voisins. Or, plusieurs actes concernant ces donations ou ces différends ont été passés à Moudon, dans le château fort de Moudon 1.
Ces mots ne signifient pas : au château de Moudon, et ne désignent pas un bâtiment; il s’agit d’un bourg entouré de murailles, d’une forteresse. Et voici ce que nous devons en conclure : comme à Lausanne, comme à Avenches et en tant d’autres lieux, à la fin de l’époque romaine les habitants, chassés de la plaine par l’insécurité des temps, ont cherché un refuge sur une hauteur voisine. Il y avait justement à côté de la bourgade romaine, entre la Broye et la Mérine, une colline abrupte; des falaises de molasse tombant à pic la rendaient inaccessible sur trois de ses côtés, le dernier très étroit était d’une défense facile. Ce rocher, inoccupé jusqu’ici, semble-t-il 2, servit d’abri aux restes de la population gallo-romaine; il protégea pendant les siècles troublés du premier moyen âge les rares et pauvres colons qui cultivaient ces lieux et, d’assez loin, les propriétaires de la contrée venaient s’y réfugier quand le danger menaçait.
Puis des temps moins mauvais revinrent : un peu moins de violences, un peu moins de guerres, un peu plus de sécurité; l’humanité reprit courage; à mille ans de distance, les mêmes causes produisirent les mêmes effets : la route, un relai et un pont avaient /12/ créé le bourg romain; ce sont eux aussi qui vont le ressusciter.
Le Grand St-Bernard n’avait jamais été complètement abandonné; dès que les temps furent un peu meilleurs, il fut de nouveau assez fréquenté. Le réveil religieux des Xe et XIe siècles augmenta le nombre des pèlerins qui se rendaient à Rome. La réunion de la Bourgogne à l’Empire assura au Grand St-Bernard le trafic de l’Allemagne 1. L’essor commercial qui suivit les croisades fit le reste.
Comme à l’époque romaine, le voyageur qui venait du nord devait remonter la vallée de la Broye et aller rejoindre à Vevey la route d’Italie; à Moudon, il pouvait la quitter et se diriger sur Lausanne ou Genève. Comme les Romains d’autrefois, les voyageurs s’arrêtèrent auprès du pont, réparé ou rétabli, sur la Broye; ils descendirent de cheval, ils déchargèrent leurs sommiers et trouvèrent dans le bourg naissant des relais et des auberges 2.
Si l’on examine attentivement les documents de Haut-Crêt, on peut y trouver quelques renseignements sur les habitants de Moudon au milieu du XIIe siècle 3.
L’un est un serf 4, un autre est déjà un bourgeois, peut-être un marchand, probablement un homme /13/ libre 1; d’autres sont chevaliers 2. Moudon est une paroisse et a son curé 3. C’est un petit centre où la noblesse des environs vient passer ses actes et traiter ses affaires et où plusieurs de ses membres se sont établis à demeure pour profiter de sa situation forte 4. On y rencontre les prêtres des environs et les dignitaires du Chapitre de Lausanne 5.
La ville est administrée par plusieurs fonctionnaires : un sautier 6 qui préside à l’exécution des jugements, un métral 7 qui est un intendant au service du /14/ propriétaire et qui a sous ses ordres un homme d’armes 1, enfin un vidomne 2, accompagné de son huissier.
Le vidomne, ou vidame, est un gros personnage : il est le représentant du seigneur; il est chargé de défendre ses droits, de le remplacer, quand il est absent; il fait régner l’ordre, il rend la justice en son nom; en retour il perçoit le tiers des amendes et des redevances diverses qui découlent des droits de justice, ou même de simple police 3. Suivant l’usage du premier moyen âge, la vidamie est un fief qui est devenu la propriété d’une famille, dans le sein de laquelle nous la voyons se transmettre héréditairement.
De la présence d’un vidomne à Moudon nous pouvons conclure que cette ville appartient à un seigneur ecclésiastique, car la vidamie ne se rencontre, à l’origine du moins, que sur les terres de l’Eglise. Celui-ci ne saurait être que l’évêque de Lausanne. C’est sans doute de la donation du comté de Vaud à l’évêque /15/ par le dernier roi de Bourgogne, en 1011, que découlent les droits du prélat sur la ville de Moudon 1.
Cette seigneurie devait causer aux évêques de Lausanne bien des soucis et des déboires, ainsi qu’en témoigne une lettre de saint Amédée, non datée, mais qui est du milieu du XIIe siècle puisque cet évêque régna de 1144 à 1159.
Absent de Lausanne, le prélat s’adresse à ses ouailles de la cité épiscopale pour les exhorter à se préparer aux fêtes de Pâques et, dans un style d’une élégance très recherchée, il leur dit 2 :
« … Absent de corps, mais présent de cœur, je sens croître de jour en jour mon amour pour vous, au point que je désire souffrir l’exil pour votre liberté … En effet, ce m’est chose plus amère que la mort que de voir … dans la cité de Lausanne jeter des fondements criminels, s’élever un édifice scélérat, se dresser un toit orgueilleux qui menace l’Eglise. J’ai honte de rappeler l’impudence de ces hommes qui se sont dressés contre nous iniquement, frauduleusement, perversement. Des hommes, oublieux de notre souveraineté et de leur propre hommage, prompts à commettre l’injustice et lents à témoigner leur reconnaissance, ont tendu des embûches à notre vie et n’ont point tenu compte du respect qu’ils nous devaient. Je renonce à en dire plus. Le visage pâle d’émotion, nous avons vu couler le sang innocent; les vêtements de votre évêque ont été déchirés par les armes; ils /16/ ont été éclaboussés du sang de son compagnon, et, pour ce traitement indigne, ils crient vengeance au Seigneur. Nos mains qui souvent, quoique indignes, se sont approchées des choses saintes respiraient encore les sacrements qu’elles venaient de célébrer; mes mains avaient accompli les mystères du Christ, mes mains venaient d’embrasser un ami, et, par une audace sacrilège et avec l’appui du diable, cet ami fut blessé entre mes bras qui l’enlaçaient : son sang a coulé sur mon sein … Je me suis avancé tout sanglant du sang d’un ami ! …
» Maltraités, battus, déchirés, nous sommes sortis du château de Moudon, emportant de cette forteresse l’opprobre qui avait été infligé à notre ami. Donc, partant nu-pieds, nous nous sommes soustrait au contact de ce lieu qui nous souillait et, en témoignage, nous avons secoué contre les habitants la poussière de nos pieds, selon la parole du Seigneur …
» C’est pourquoi, l’esprit encore tout frappé de la stupeur que me causait un événement si inattendu, à cette heure ténébreuse, je me suis saisi des armes de l’humilité, j’ai eu recours à l’aide de la prière … Notre âme, comme un passereau, … a été arrachée aux lacs des gens de Moudon.
» Château de Moudon, que ni la rosée de la miséricorde, ni la pluie de la grâce ne tombent plus sur toi, puisque tu n’as eu ni pitié pour ton pasteur, ni respect pour ton prélat ! Comme un dragon sifflant qui ne songe qu’à faire périr, tu as rampé hors de ta caverne; comme un lion infâme qui ne songe qu’à dévorer, tu t’es précipité hors de ton antre; brebis enragée, tu /17/ t’es dressée contre ton berger ! Race parricide, tu as mêlé le sang à l’hostie, le sang à l’huile sainte ! Race de Cham ! descendance de Canaan ! … que ta postérité soit frappée de malédiction à cause des opprobres dont tu as couvert le Seigneur Jésus-Christ ! Sous les yeux de Dieu, tu as agi avec ruse; la trahison a habité en toi; que ton sang retombe sur ta tête ! Forteresse du diable, tu as été fondée sur l’injustice; tu as grandi par la rapine; tu t’es enrichie par l’iniquité ! Les grandes eaux ne pourront t’en laver; tu ne peux être lavée de ton péché si tu n’es détruite; tu ne peux être justifiée tant que tu n’auras pas été détruite de fond en comble, tant qu’on ne t’aura pas arraché ces ailes avec lesquelles tu as volé au crime.
» Nous voulons transmettre au souvenir de la postérité qu’Amédée, comte de Genevois, a détruit injustement le château-fort appelé Lucens qui était situé sur l’alleu de l’Eglise et qu’ailleurs, sur les terres de cette même Eglise, il a élevé contre tout droit un château-fort dressé contre notre Eglise. Il ne servit à rien au vénérable évêque Girold 1, d’être parent du comte; ni sa résistance, ni sa malédiction, ni ses prières ne purent empêcher le comte de fortifier ce château, haïssable pour Dieu lui-même. Mais voici ce qui en résulta : peu de temps après, le comte entra en lutte avec le noble duc Conrad 2; le comte n’osa le regarder /18/ en face, il prit peur, et s’enfuit, à son grand dam et dommage et après avoir perdu bon nombre des siens. J’aime le comte, mais non ses fautes; je hais le mal qu’il fait en secret, les crimes qu’il commet ouvertement quand il pille les clercs, dépouille les moines, ravage les églises … »; aussi l’évêque prie-t-il pour sa conversion.
Voilà, traduite aussi exactement que possible, cette lettre où nous voudrions trouver moins de fleurs de rhétorique, d’antithèses et de métaphores, et plus de faits précis, de dates et de noms. Nous allons essayer cependant de l’interprêter et d’en dégager ce qu’elle peut nous apprendre sur l’histoire de Moudon.
Au cours des ans qui suivirent la dissolution de l’empire carolingien, la plupart des églises épiscopales acquirent l’immunité : elles furent soustraites par là à la juridiction du comte; l’évêque exerça bientôt sur ses domaines l’autorité politique; il devint prince souverain. Mais sa qualité d’ecclésiastique l’empêchait de mener ses vassaux à la bataille, ou de présider un tribunal qui aurait dû condamner à des peines sanglantes. Dans ces fonctions incompatibles avec son caractère, l’évêque se faisait représenter par un laïque : l’avoué.
Celui-ci était à l’origine un fonctionnaire, choisi par le prélat et rétribué par une portion des revenus de la justice. Suivant l’usage du temps, cette charge se transforma peu à peu en un fief héréditaire. Devenus ainsi quasi-indépendants, les avoués cherchèrent à s’approprier la puissance temporelle sur les terres de l’évêché et à reléguer l’évêque dans son rôle religieux. /19/
Depuis une date que nous ignorons, les comtes de Genève possédaient l’avouerie épiscopale de Lausanne. Aymon de Genève, avoué dès le début du XIIe siècle, fut le premier, semble-t-il, qui chercha à se servir de son titre d’avoué pour se procurer une puissance territoriale considérable; il engagea une lutte acharnée avec les évêques de Lausanne et de Genève. Les deux prélats « faisaient entendre les mêmes plaintes. Le comte de Genevois était accusé de fouler aux pieds les droits de l’évêque de Genève, de dévaster, ou de dépouiller son église et de l’affliger de toutes sortes de maux. A entendre ses accusateurs, il n’y avait, pour ainsi dire, pas de crime dont il ne se fût rendu coupable envers l’église de Lausanne et son chef. Nous n’avons d’autres rapports que ceux d’un parti, ceux du clergé. Il serait aussi peu digne d’une saine critique de représenter l’évêque comme un martyr, comme une victime de l’ambition brutale du comte, qu’il serait peu sage de vouloir disculper celui-ci de toutes les mauvaises actions qui lui sont imputées 1. »
C’est à des épisodes de cette longue querelle que fait allusion la lettre de saint Amédée 3; le fait le plus ancien est celui qui est cité en dernier lieu : Du temps de l’évêque Girard de Faucigny, c’est-à-dire avant le premier juillet 1129, date de sa mort, Amédée de Genève, qui avait succédé à son père Aymon au plus tôt en 1125 2, a détruit le château de Lucens qui défendait les terres de l’Eglise dont Curtilles était le centre. Il a commis un autre acte d’hostilité : sur une /20/ terre qui dépendait de l’Eglise et pour menacer les domaines de celle-ci, il a élevé, contre le gré de l’évêque, une forteresse que Dieu lui-même a en horreur. Cette forteresse paraît bien être Moudon 1.
Nous pouvons deviner les raisons qui ont dicté son choix : il possédait des biens nombreux dans la Haute-Broye 2; Moudon était une forteresse naturelle à laquelle la Broye et la Mérine servaient de fossé; de là le comte pouvait commander toute la vallée; il coupait les communications de l’évêque avec Lucens et Avenches. Là encore, il pouvait profiter des revenus du péage installé sur le pont et exiger des marchands qui passaient qu’ils lui payassent la protection qu’il voulait bien leur accorder.
L’évêque était hors d’état de s’opposer à ce coup de force. Mais la vengeance divine ne devait pas tarder; elle trouva un instrument dans la personne du duc de Zæringen.
Reprenant pour leur compte les projets de Rodolphe de Rheinfelden, qui avait voulu se tailler un vaste Etat en Souabe et sur le plateau suisse, les Zæringen cherchaient à étendre leur domination au delà de l’Aar. Dans des circonstances que nous ignorons, le duc Conrad, qui avait succédé en 1127 à son frère Berthold III, fit une expédition dans nos contrées et battit le comte Amédée de Genève 3. /21/
Quelque vingt ans après, la lutte recommença entre le comte et l’évêque, qui était alors saint Amédée. Le comte de Genève bâtit à Lausanne, tout près de l’église cathédrale, une maison forte d’où il pût surveiller et menacer le prélat qu’il était chargé de défendre 1. Celui-ci manquait de la force militaire qui lui eût été nécessaire pour qu’il pût s’opposer aux projets de son avoué infidèle; plutôt que de paraître approuver par sa présence cet abus de pouvoir, il préféra s’en aller, s’exiler pour défendre la liberté de son Eglise. Où alla-t-il ? à Puidoux où il aimait à séjourner ? à Haut-Crêt auprès des moines auxquels il était attaché ? à Curtilles ? Nous ne le savons. Le fait est que, se trouvant un jour à Moudon, il y fut le témoin d’un attentat dirigé contre un de ses amis; celui-ci fut blessé à ses côtés par des gens de Moudon, dévoués à la cause du comte de Genève et qui trahissaient pour ce dernier celui qui était à la fois leur pasteur et leur souverain. Attristé et irrité, l’évêque considéra la chose comme une injure personnelle; il quitta 2 la ville en la maudissant. Mais il ne chercha pas à se /22/ venger; il consentit même à implorer la grâce, ou la liberté, de cet ami auquel il tenait tant et qui semble avoir été retenu prisonnier à Moudon.
Si, comme il est possible, le comte profita de cette circonstance pour y installer sa domination, celle-ci fut de courte durée. Comme ses prédécesseurs, l’évêque de Lausanne était bien vu de l’empereur; Conrad de Hohenstauffen l’avait assuré de sa protection en 1145 1; saint Amédée s’adressa à son successeur, Frédéric Barberousse, qui, de plus, était son parent; il sollicita son intervention. Frédéric, qui venait de monter sur le trône (1152), était précisément en train de réorganiser la Bourgogne 2; en 1155, il prit sous sa protection l’évêché de Lausanne 3 et, l’année suivante, ayant retiré à Berthold de Zæringen le rectorat de Bourgogne, il lui donna à la place l’avouerie impériale dans les trois évêchés romands 4.
Fort de cette dignité qui faisait de lui le représentant de l’empereur, et, semble-t-il, à l’instigation de l’évêque Amédée, Berthold de Zæringen obtint du comte de Genève — nous ne savons par quels moyens — que celui-ci abandonnât l’avouerie de l’église de Lausanne. Elle passa à un vassal de Berthold, puis, un peu plus tard, au duc lui-même 5. /23/
Il résulte de ce qui précède que, si Amédée de Genève s’était installé à Moudon, il en fut dépossédé peu après. Il semble toutefois qu’il se soit arrangé avec le successeur de saint Amédée, Landri de Durnes; il est possible que le comte ait repris quelque autorité dans cette ville 1. Mais tout espoir d’en faire la base d’une domination militaire et territoriale était dorénavant perdu pour lui.
Pour l’instant l’avenir appartenait aux Zæringen; ils avaient pour eux la faveur impériale et, ce qui est plus sûr, la force; ils parurent redoutables à l’évêque lui-même, qui se plaignit en vain à l’empereur 2. Trouvant la situation avantageuse, ils s’installèrent à Moudon, à une date que nous ignorons 3.
C’est à peu près au même moment que Berthold IV fondait Fribourg sur la Sarine et que Berthold V bâtissait Berne sur l’Aar. Ces trois villes, d’inégale importance il va sans dire, avaient entre elles des analogies cependant : solidement défendues par la nature, elles commandaient toutes les trois le cours des trois rivières qui, dans la Suisse occidentale, /24/ coulent du sud au nord; elles permettaient à celui qui les possédait de surveiller trois des routes qui, venant d’Italie, se dirigeaient vers l’Allemagne.
Elles devaient fournir aux ducs une base d’opération pour la conquête de ce que l’on appelait alors la Bourgogne; elles devaient leur servir de points d’appui dans les conflits qu’ils prévoyaient avec les seigneurs féodaux; outre ces avantages militaires, ils trouvaient en elles une source de revenus assurés. Ils ne se doutaient pas que la fondation de deux d’entre elles allait devenir leur titre de gloire le plus durable.
La troisième, Moudon, située plus à l’ouest que les autres, plus loin des terres patrimoniales des Zæringen, était une forteresse avancée en pays hostile. Elle était, plus que toute autre place, exposée à l’attaque des ennemis; le duc la fortifia; la grosse tour carrée qui domine la ville est, aujourd’hui encore, un témoin de ses projets politiques et militaires 1.
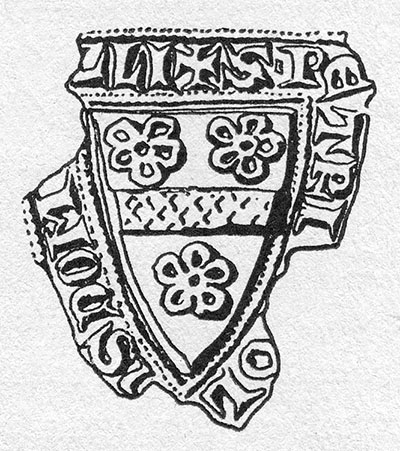
Sceau de Pierre de Vulliens, donzel
1296
CHAPITRE III
LA CONQUETE SAVOYARDE
La période qui suit fut une époque troublée; la guerre ravagea le pays. Quoique nous n’en connaissions pas les motifs, il n’est pas interdit de penser que la vallée de la Broye fut le théâtre d’un des épisodes de la lutte qui partout mettait aux prises les partisans du pape et ceux de l’empereur.
L’évêque de Lausanne, Roger de Vico-Pisano, était guelfe; Berthold de Zæringen, autrefois gibelin, avait passé au même parti, nous ne savons ni quand ni pourquoi. Dès les premières années du XIIIe siècle ils virent se dresser en face d’eux un adversaire redoutable : le comte Thomas de Savoie. Ce nouveau venu avait passé du parti guelfe à celui des Gibelins, pour des raisons que nous ignorons. Il fit la guerre à l’évêque, dont le duc était, semble-t-il, l’allié. Thomas avait des raisons particulières d’en vouloir au prélat et au Zæringen : héritier des comtes de Genève, il revendiquait leurs droits sur Moudon.
Profitant de circonstances qui nous sont inconnues, il s’empara de cette ville; puis, pour justifier cette possession par un titre, il demanda à l’empereur Philippe de Souabe, et obtint de lui, le 1er juin 1207, qu’elle lui fût remise comme un fief 1. /26/
Cette donation portait atteinte aux droits incontestables de l’évêque et du duc, son avoué. L’empereur n’en avait cure, trop heureux qu’il était de pouvoir récompenser un nouvel allié aux dépens de ses ennemis. La conséquence fut une guerre prolongée entre ceux-ci et le comte Thomas.
Les deux princes laïques s’arrangèrent les premiers, le 18 octobre 1211, à Haut-Crêt, nous ne savons à quelles conditions 1. Une chose est certaine : le comte de Savoie demeurait maître de Moudon où il avait installé une garnison et un châtelain 2. Mais l’évêque restait intraitable; il ne voulait pas admettre la perte des droits de son église. Tant que vécut Berthold de Zæringen, il espéra un retour de fortune. Lorsque, le 12 février 1218, ce prince eut succombé et que sa maison se fut éteinte avec lui, lorsque ses héritiers se furent entendus avec le comte et qu’à Moudon même, le 1er juin de la même année, eut été scellée la charte des fiançailles de Marguerite, fille de Thomas, avec Hartmann de Kybourg, neveu de Berthold 3, alors /27/ l’évêque dut se résigner à traiter avec son redoutable adversaire.
Le 3 juillet 1219, l’évêque de Lausanne, Berthold de Neuchâtel, rencontra au prieuré de Burier, aujourd’hui la Maladeyre, le comte Thomas de Savoie; tous deux avaient amené une suite brillante; l’abbé de Saint-Maurice et l’évêque de Sion étaient présents eux aussi; ce dernier semble avoir présidé à la réconciliation des deux adversaires. Le comte recevait Moudon à titre de fief, aux conditions où l’avaient jadis possédé les comtes de Genève, et il prêtait hommage à l’évêque pour cette ville; il jurait de la défendre ainsi que les droits de l’église de Lausanne; il s’engageait à faire prêter le même serment à son châtelain de Moudon et à tous les successeurs de celui-ci de même qu’aux habitants de la ville. L’évêque, de son côté, s’engageait à maintenir le comte en possession de son fief et à ne faire ni paix ni trêve sans son aveu au cas où la place aurait été prise. Les hommes qui appartenaient en propre à l’évêque ne devaient pas être reçus comme habitants à Moudon sans l’autorisation du prélat; quant à ceux qu’il pouvait posséder encore dans la ville, ils continueraient à lui appartenir; s’il survenait quelque difficulté à leur sujet, elle serait tranchée par le jugement de trois hommes de Moudon et de trois hommes de Curtilles. Le comte enfin remettait à l’évêque 100 livres (20 000 fr.) à titre d’indemnité pour les dégâts commis pendant la guerre, mais il était formellement déclaré que les successeurs de l’évêque ne pourraient pas considérer cette somme /28/ comme un droit de mutation et s’en prévaloir pour réclamer un nouveau versement aux successeurs du comte; elle était versée une fois pour toutes 1.
Ce traité réglait le sort de Moudon pour des siècles. La suzeraineté de l’évêque, en tant que comte de Vaud, était reconnue; ses droits étaient sauvegardés en principe; une indemnité lui était accordée sans doute, mais elle était bien faible et le véritable bénéficiaire était le comte Thomas. Moyennant un hommage, qui n’était à vrai dire qu’un geste de politesse, il se maintenait à Moudon où il était le maître incontesté. Ainsi la Savoie s’installait solidement au centre du Pays de Vaud; elle allait pouvoir en faire la base d’une domination militaire. Le lien de vassalité qui la rattachait à l’évêque était de pure forme et si peu gênant que les successeurs de Thomas ne songèrent pas à s’en dégager dans la suite 2.
Le traité de Burier nous donne aussi de précieux renseignements, sur Moudon et ses habitants. Cette ville n’est encore qu’une place forte (castrum); elle ne s’étend pas au delà du quartier qui, aujourd’hui encore, a gardé son nom primitif, le Château. L’esplanade qui occupe le sommet de la colline est défendue à son extrémité orientale par la grosse tour dont une partie a subsisté jusqu’à ce jour; pour le reste de son pourtour, des palissades ou des murs s’élèvent sur les points où la nature elle-même n’a pas rendu tout accès à peu près impossible. /29/
Les habitants appartiennent encore au seigneur qui est le propriétaire du sol. Avec le fief de Moudon et suivant l’usage d’alors, le comte Thomas a acquis la population du lieu, qu’il possède maintenant au même titre que jadis le comte de Genève.
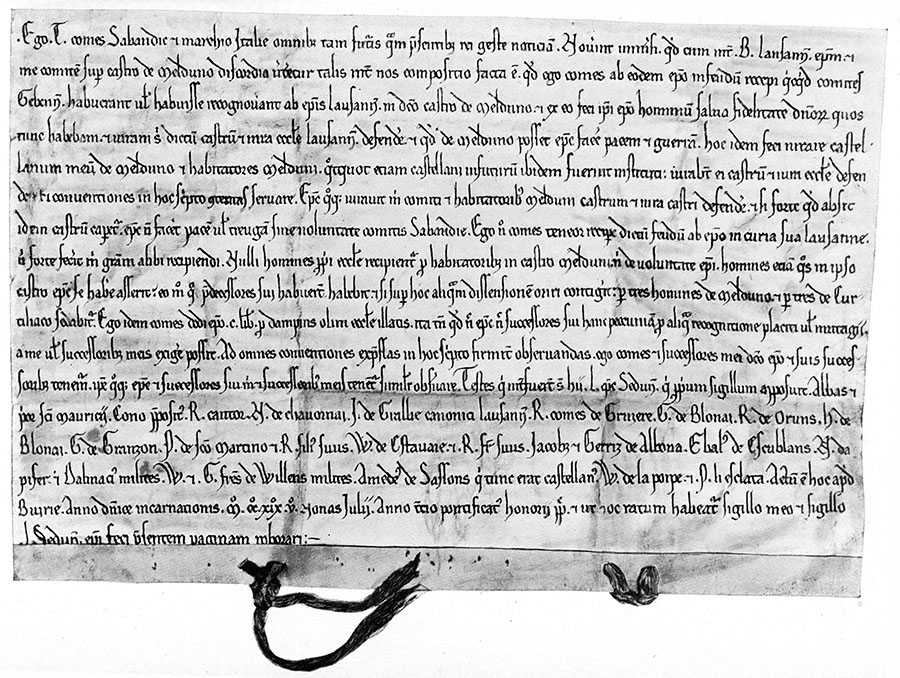
Pl. III : Le Traité de Burier, 1219
D’après une photographie de l’exemplaire original, déposé aux Archives de Cour, à Turin, Baronnie de Vaud 32, Moudon n° 1.
Cliquez 2X sur l’image pour une vue agrandie
Mais Moudon exerce un attrait visible sur les campagnes environnantes; des villages des alentours on vient s’y établir pour y gagner quelque argent ou pour y vivre à l’abri de ses fortifications. L’évêque craint que ce voisinage dangereux ne vienne à dépeupler sa terre de Curtilles, ce qui ne manquerait pas de se produire si le comte y créait une ville neuve comme à Chillon; aussi prend-il ses précautions : il spécifie que si de ses hommes vont à Moudon ils n’y seront pas reçus comme habitants, c’est-à-dire qu’ils ne passeront pas dans la propriété du comte, sans son aveu; quant à ceux qui sont déjà dans le bourg, l’évêque reste leur propriétaire, ce qui veut dire qu’ils ne sauraient être dégagés de leurs obligations vis-à-vis de lui par la prescription usuelle d’un an et un jour. Toute contestation sera réglée par des arbitres pris par moitié à Moudon, chez le comte, et à Curtilles, chez l’évêque, soit par des gens qui connaissent parfaitement la naissance et la situation sociale des personnes en cause.
Non libres encore, les habitants n’ont pas d’organisation municipale 1; Moudon n’est pas une commune. Le représentant du comte, son châtelain 2, est à la /30/ fois le commandant de la garnison, l’administrateur du domaine et le magistrat de la ville. Toutefois, il y a à Moudon des personnages notables. La famille des nobles de Vulliens, dont les domaines s’étendent sur tout le versant nord du Jorat et comprennent Mézières, Carrouge, Vulliens et Sépey, est venue s’y établir; à l’extrémité occidentale de la colline, ils ont bâti une maison forte où ils résident; ils bénéficient de la sécurité que leur procure la place; ils lui donnent en retour l’appui de leurs bras, de leur expérience militaire et de leurs ressources en hommes et en argent. Avec quelques roturiers auxquels leur fortune ou leur talent ont fait une place en vue, ils sont les chefs naturels de la population urbaine, tout au moins lorsqu’il s’agit de défendre la place.
Ne nous étonnons donc point de voir le comte associer à son serment comme témoins deux membres de la famille de Vulliens, deux frères, tous deux chevaliers, et deux notables de la ville 1.
CHAPITRE IV
MOUDON SOUS LES PREMIERS PRINCES SAVOYARDS
Nous ne savons rien du régime que le comte Thomas imposa à Moudon, rien de ses rapports avec les habitants de cette petite ville; nous ignorons s’il eut de nouveaux conflits avec l’évêque, son suzerain et son voisin.
Le XIIIe siècle est l’époque où, dans notre pays, les villes se développent et s’affranchissent. On peut supposer que Moudon suivit cette loi commune. Dès 1227 nous voyons des habitants de Moudon qualifiés de bourgeois 1; si ce n’est pas la preuve absolue de l’existence d’une communauté indépendante 2, nous avons au moins la certitude que ceux qui portent ce titre — car c’en est un — sont des hommes libres. Nous ne trouvons plus aucune trace de servage à Moudon depuis le traité de Burier; d’où nous pouvons conclure que, si Thomas n’a pas affranchi formellement ses habitants, il les a pourtant /32/ toujours traités comme s’ils étaient libres. C’était conforme aux habitudes du temps et cela ne peut qu’avoir contribué au développement de la ville.
Le comte était représenté à Moudon par un châtelain 1.
Thomas de Savoie mourut en 1233; il laissait une nombreuse famille et le règlement de sa succession ne fut pas facile. Moudon fit partie de l’apanage de son quatrième fils, Aymon, le prince pieux qui fonda l’hôpital de Villeneuve. Un de ses premiers soins fut de donner au couvent d’Hauterive une rente annuelle de 6 livres (environ 1200 fr.), la prébende d’un moine; il l’assigna sur deux des quatre moulins qui étaient situés au pied de la tour du château de Moudon 2. Parmi les témoins de cet acte, qui fut passé à Chillon, nous trouvons entre autres le châtelain de Moudon, Humbert de Fernex, Humbert, chevalier de Sottens, Pierre de Vulliens et Rodolphe de Moudon 3; on le voit : le jeune prince était assisté de plusieurs membres de la noblesse broyarde qui, habitant Moudon, étaient à la fois ses vassaux et ses conseillers naturels et formaient autour de lui comme une petite cour.
A la mort d’Aymon 4, son frère cadet, Pierre, /33/ qui avait quitté l’Eglise pour le siècle, eut sa part de l’héritage laissé par le défunt. En 1240, nous le voyons en possession de Romont et de Moudon, où il passe un acte dans la maison de son châtelain, Humbert de Fernex 1.
L’acquisition de ces deux villes, on le sait, fut pour Pierre de Savoie l’origine de sa domination sur le Pays de Vaud; c’est son point de départ sur la route de la conquête; dès lors, chaque année, pour ainsi dire, marque un nouveau progrès dans son entreprise.
Cette politique, dont les conséquences furent si grandes pour notre pays, a eu sur le sort de Moudon un effet plus considérable encore. A mesure que les biens du prince s’accroissent, l’importance de cette ville grandit. Il serait exagéré de dire, comme on l’a fait 2, qu’elle devient la capitale d’un petit Etat; on peut affirmer tout au moins qu’elle est dorénavant un centre administratif et une base d’opérations militaires. C’est à Moudon, par exemple, que Pierre de Savoie vient recevoir en 1243 et 1247 l’hommage des seigneurs de Bioley 3, hommage qu’il achète à beaux deniers comptants, avec cet argent qu’il rapporte d’Angleterre, où règne son neveu Henri III. /34/
Mais l’or anglais ne suffit pas toujours à vaincre toutes les résistances; la force des armes vient alors en aide à la diplomatie. Ainsi, à la fin de l’année 1251, Pierre de Savoie eut de sérieuses difficultés avec les Fribourgeois. Il fallut l’intervention d’Hartmann de Kybourg et de Marguerite de Savoie, sa femme, la sœur de Pierre, pour mettre fin aux hostilités 1.
Quoique les documents soient muets à cet égard, nous pouvons être certains qu’un conflit avec Fribourg ne put laisser indifférents les gens de Moudon; ils étaient trop proches voisins pour pouvoir rester neutres.
Quand, trois ans plus tard, il y eut une guerre véritable entre le prince et ces mêmes voisins, les gens de Moudon combattirent sous sa bannière, et la part qu’ils prirent à cette lutte dut être assez importante, puisqu’ils participent au traité qui établissait un armistice et qui fut signé à Payerne le 25 février 1255 2.
La ville avait été mise en état de défense 3. Sans se laisser aller à des hypothèses trop hardies, on peut penser que, pendant ces années troublées, plus d’une fois elle avait retenti du bruit des armes que l’on prépare, des ordres donnés d’une voix claire et des pas des chevaux qui partent pour la bataille.
Et ce n’est point malgré eux, du moins /35/ pouvons-nous le penser, que les gens de Moudon furent entraînés dans ces campagnes; Pierre de Savoie était un prince puissant et l’on n’avait pas à regretter de le servir. Ceux qui n’avaient pas l’avantage de l’avoir pour maître recherchaient ce privilège et ne croyaient pas le payer trop cher du prix de leur indépendance, comme Morat, comme Berne qui ne craignit pas de se mettre sous son protectorat 1.
En juillet 1263, le jeune comte Boniface de Savoie vint à mourir; il n’avait pas dix-neuf ans et ne laissait pas de postérité. Pierre, son oncle, lui succéda 2. Son avènement ne changea pas grand’chose à sa position au nord du lac Léman : il y possédait déjà à titre d’apanage toutes les terres savoyardes.
Pierre de Savoie donna à ses Etats une organisation nouvelle; un peu partout les fonctions administratives et judiciaires étaient devenues des fiefs héréditaires; c’était, par exemple, le cas de la vidamie à Moudon. Ce régime n’assurait pas l’exécution rapide des ordres du souverain; il limitait considérablement sa puissance en lui enlevant tout contrôle sur l’activité de ses fonctionnaires et toute sanction en cas de désobéissance de leur part; il ne pouvait convenir à un prince tel que Pierre de Savoie. Partout celui-ci plaça des fonctionnaires salariés et révocables, d’un caractère analogue à celui de ces châtelains que nous avons vu son père installer à Moudon. /36/
A la tête de chaque province, il mit un bailli, chargé de le représenter en matières administratives et financières, judiciaires et militaires. Ce bailli est un fonctionnaire d’allures modernes : c’est un préfet.
Depuis bien des années Moudon était le centre de la domination du comte dans le Pays de Vaud; aussi cette ville devint-elle le siège du bailliage nouvellement créé. C’est là que résida dorénavant le bailli de Vaud, qui, en général, ajoutait à cette fonction celle de châtelain de Moudon 1.
Nous ignorons la date exacte de cette mesure 2; elle eut une très grande importance pour la ville dont nous nous occupons. C’est elle qui, pour plusieurs siècles, lui a donné son importance. Le châtelain qui jusqu’ici y avait représenté le comte était un personnage d’un rang modeste 3, d’un caractère plus civil /37/ que militaire; le bailli est un fonctionnaire supérieur. Choisi par le prince parmi les seigneurs de sa cour, il jouit de sa confiance; c’est à lui qu’on doit s’adresser si l’on a quelque affaire importante à traiter; c’est par son intermédiaire seulement que l’on peut aborder le souverain. Juge suprême, non de la châtellenie seulement, mais de tout le pays, c’est devant sa cour que se plaident et se terminent les procès de quelque gravité. Sa présence à Moudon attire dans cette ville des solliciteurs et des plaideurs de tout rang. Siège du tribunal d’appel et résidence du gouverneur général du pays, il est tout naturel qu’elle ait été regardée bientôt comme un centre politique.
Moudon, par sa position même, attirait déjà les seigneurs des environs, et non les moindres; c’est là qu’ils venaient passer des actes 1; c’est là qu’ils s’engageaient à tenir otage 2; c’est là qu’ils venaient discuter d’affaires; c’est là qu’ils se présentaient devant le prince pour lui faire hommage ou se soumettre à son arbitrage 3. Cela amène du mouvement dans la petite ville : chevaux et cavaliers passent dans ses rues; seigneurs laïques, ecclésiastiques de tout rang et de toutes robes descendent aux bonnes auberges. Nul doute que tout cela n’ait contribué à l’agrandissement de Moudon. Mais les documents sont muets à ce sujet.
Une chose est certaine; si Pierre de Savoie /38/ considérait Moudon comme une citadelle avancée et veillait à ce que la forteresse fût toujours munie de vivres et de provisions 1, il n’y a jamais séjourné et n’y a pas possédé de château 2.
Quels furent ses rapports personnels avec les habitants ? Nous ne le savons guère 3. Plusieurs auteurs 4 affirment que c’est lui qui a donné à la ville sa première charte; cette question, fort difficile demande une étude sérieuse que, après tant d’autres, nous allons tenter.

Sceau de Pierre de Vuippens
CHAPITRE V
LA CHARTE DE MOUDON
La plus ancienne rédaction que nous ayons de la charte de Moudon date de 1285; en septembre de cette année, Amédée V, au moment où il succédait à son oncle Philippe, donna aux habitants de Moudon une confirmation de leurs franchises. L’original en a disparu 1; mais nous en possédons plusieurs copies 2. L’une, tardive et malheureusement médiocre, a été publiée en 1872 par F. Forel dans la collection des Chartes communales du Pays de Vaud 3; il y en a une meilleure aux Archives cantonales que je suivrai 4. /40/ Nous avons aussi une traduction française très ancienne 1 et des études modernes 2.
Comme dans tous les documents du moyen âge, il y a un apparent désordre dans ce texte qui n’est point ordonné par chapitres et paragraphes comme nos lois d’aujourd’hui 3. Toutefois, lorsqu’on y regarde de plus près, on peut, sauf dans les derniers articles, suivre la pensée qui a présidé à la rédaction de cette charte.
L’article premier 4 est bien le plus important : Le seigneur est tenu de jurer qu’il respectera les privilèges et les coutumes de Moudon, c’est-à-dire aussi bien le droit coutumier, non écrit, qui est établi par /41/ le prononcé des bourgeois notables, que le droit écrit que l’on peut lire dans les chartes. Par ce serment, qui est le premier acte de son autorité et sans lequel il ne peut exercer son pouvoir dans la ville, le comte limite sa propre puissance; il n’est pas à Moudon un souverain absolu. Les bourgeois de leur côté prêtent serment de respecter fidèlement les droits du seigneur et de lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Il y a en quelque sorte contrat bilatéral entre les parties : tout refus de la part du seigneur de se conformer aux clauses de celui-ci entraînerait de plein droit le refus d’obéissance de la part des bourgeois 1.
Les articles 2 à 14 sur le statut des étrangers et la police du marché forment un tout. Il s’agit de mesures d’ordre économique plus que politique; elles sont essentielles et destinées à assurer le recrutement de la population et la prospérité de la ville.
Ils garantissent tout d’abord à l’étranger et au voyageur, c’est-à-dire au marchand 2, la pleine propriété de ses biens. S’il vient à mourir à Moudon, ceux-ci — son argent et ses marchandises — ne deviendront pas la proie du seigneur, comme à Villeneuve; /42/ ils seront remis en dépôt, pendant un an et un jour, entre les mains de deux notables et ils seront intégralement délivrés à ses héritiers légitimes, s’ils se présentent, comme il est probable; si aucun ayant-droit ne s’annonce dans le délai fixé, le seigneur peut, à son gré, les faire distribuer, sans doute à des fondations religieuses, car le texte ne peut pas signifier qu’il se les approprie (art. 2).
La ville n’est pas seulement un lieu où passent les voyageurs; elle est aussi un asile où viennent chercher refuge, un endroit où viennent chercher fortune les hommes du voisinage. Ils lui apportent leur activité et leurs bras; ils sont utiles au premier chef. Mais il faut éviter tout conflit avec les seigneurs voisins. Si quelqu’un vient à Moudon, s’il jure d’observer les règlements et les lois de la ville, s’il y demeure sans interruption un an et un jour, si son ancien maître ne le réclame pas, bien que sachant où il est, alors il devient bourgeois. Mais si son maître le réclame, s’il prouve par le témoignage de deux des pairs du réfugié que celui-ci est son taillable, la ville ne peut l’agréger à la bourgeoisie à moins qu’il ne réussisse à prouver qu’il est dégagé de toute obligation vis-à-vis de son propriétaire. Le réfugié, qui ne peut devenir bourgeois, peut cependant continuer à séjourner dans la ville, où il jouit de la protection des bourgeois et du comte; s’il veut quitter Moudon, on lui fera escorte pendant un jour et une nuit, afin qu’il ne tombe pas entre les mains de son ancien seigneur (art. 3) 1.
Viennent ensuite les prescriptions qui concernent le /43/ marché. Cette institution est, pour la ville, d’une importance capitale; une partie de ses habitants, en effet, les artisans, ne se livrent plus à la culture du sol; la ville consomme donc plus de denrées qu’elle n’en produit et il faut qu’on lui apporte chaque semaine ce qui est nécessaire pour sa nourriture, non les légumes, comme aujourd’hui, car chacun a son jardin, mais les céréales, le fromage et les fruits; il faut aussi qu’elle puisse se procurer les objets en bois ou en vannerie qui se fabriquent dans les villages, puis les matières premières telles que la laine, le chanvre, le cuir, etc. Plus le nombre des vendeurs sera grand, plus les prix baisseront et plus la ville sera prospère.
Pour que le marché soit fréquenté, la première condition c’est d’assurer à ceux qui s’y rendent la plus grande sécurité possible; il faut qu’ils n’aient à craindre ni d’être détroussés par les brigands, ni d’être dépouillés par des seigneurs. La charte leur promet donc un sauf-conduit; le marché étant le lundi, protection leur est assurée depuis le dimanche matin jusqu’au mardi soir; en retour de cette sauvegarde, ils doivent au comte les vendes, sorte d’octroi sur toutes les denrées et les objets qu’ils vendent pendant ces trois jours (art. 4). Si l’un d’entre eux tombe malade le mardi et ne peut rentrer chez lui, il jouira de la même protection le jour où il sera rétabli (art. 5). Si l’un de ces marchands cherche à éluder l’obligation où il est de payer les vendes, il sera puni d’une amende de 60 sous et une obole 1; c’est l’amende la plus /44/ élevée que connaisse la charte; on considère donc ce délit comme grave (art. 6). Les vendes ne sont dues que ces jours-là 1; les denrées vendues un autre jour ne paient pas de droits, puisque le marchand ne jouit pas de la protection du seigneur (art. 7). Les bourgeois ont le privilège d’être exempts des vendes aussi bien les jours de foire que les jours de marché (art. 8 et 9).
Car les foires sont aussi importantes que les marchés, si ce n’est plus. Ces jours-là, ce ne sont plus seulement des denrées de consommation ou des objets d’usage courant que l’on apporte, mais bien des marchandises de toutes sortes et de toute provenance. On vient de très loin pour vendre et de très loin pour acheter; ce sont, pour la ville, des journées de vie intense, de gros bénéfices et de fêtes joyeuses. Les jours de foire, le seigneur touche les vendes sur toutes les transactions qui se font entre non-bourgeois; l’acheteur comme le vendeur doit les payer (art. 9). Les habitants de Moudon 2, artisans ou marchands, qui ont des objets à vendre, peuvent les exposer à la fenêtre de leur échoppe, comme cela se voit encore parfois dans les vieilles rues des villes anciennes; ils ne sont donc pas /45/ obligés de tenir un banc de foire. Exception est faite pour la viande qui ne peut se vendre qu’à la boucherie (art. 10), pour que le contrôle sanitaire soit possible.
Les trois articles suivants sont destinés à assurer la paix du marché, élément si important pour la prospérité et le développement des villes que certains savants y ont vu l’origine du droit communal 1. Il y a bris du marché, c’est-à-dire violation de la paix du marché quand des non-bourgeois troublent l’ordre un jour de foire ou de marché, quand un bourgeois attaque un non-bourgeois ou enfin quand un non-bourgeois se prend de querelle avec un bourgeois; dans tous ces cas, la peine encourue est l’amende maximum de 60 sous (art. 11 et 13). Seules les rixes entre bourgeois ne sont pas considérées comme une violation de la paix du marché; elles sont jugées suivant le droit pénal ordinaire (art. 12), qui est plus indulgent, comme nous le verrons plus loin.
Les articles qui suivent sont d’ordre politique; ils tendent à régler les rapports du comte avec ses administrés. Remarquons qu’ils ont tous trait à la justice pénale et dénotent des habitudes très différentes des nôtres. Tandis qu’aujourd’hui l’obligation de châtier les délinquants est pour l’Etat une charge fort onéreuse, la justice pénale était alors un droit utile, qui rendait et que l’on exploitait. Que le souverain l’exerçât directement, qu’il en fît un fief héréditaire ou qu’il l’affermât, cela revenait au même : le détenteur de ce droit était toujours entraîné à en abuser pour en /46/ tirer le plus de profit possible, et la seule manière d’échapper aux injustices et aux exactions était de limiter la justice seigneuriale. C’est à cela que tendaient toutes les chartes.
Celle de Moudon assure tout d’abord la liberté personnelle des habitants 1 contre toute arrestation arbitraire : Nul ne peut être arrêté dans les limites 2 des franchises de Moudon, sinon de l’aveu 3 des bourgeois. Dans chaque cas, les plus notables d’entre les bourgeois constitueront une sorte de jury d’accusation devant lequel comparaîtra l’inculpé; là, les intérêts du comte et de ses fonctionnaires ne pourront prévaloir sur la voix de l’opinion publique et celle de l’intérêt de la communauté. Cette mesure, dont l’importance n’échappe à personne, est une garantie efficace contre les excès de l’absolutisme seigneurial; elle ne comporte qu’une exception : le cas du brigand, du traître et de l’assassin, en un mot de celui qui commet un crime ressortissant à la haute justice 4, et dont les actes menacent la sécurité de la ville tout autant /47/ et plus que celle du seigneur, mais encore faut-il qu’il y ait flagrant délit ou que le crime soit évident (art. 14), car les bourgeois ne sauraient prendre trop de précautions contre des abus toujours possibles.
Le seigneur ne peut pas non plus fixer des amendes, ou plus exactement édicter des lois et règlements qui prévoient des amendes 1 sans l’assentiment des bourgeois; il y a trois exceptions cependant; s’il y a violation de la paix du marché, si des bourgeois ont été faits prisonniers 2, enfin en cas de chevauchée (art. 15). Dans les deux premiers cas, l’intérêt des bourgeois coïncide avec celui du comte et les amendes qu’il infligera aux défaillants ne paraîtront pas excessives, quelles qu’elles soient; le troisième cas se comprend de lui-même.
Enfin le seigneur n’a pas le droit d’introduire dans la bourgeoisie qui il lui plaît; le recrutement de la bourgeoisie appartient aux bourgeois qui peuvent ainsi empêcher l’intrusion d’éléments gênants ou suspects (art. 16) 3. /48/
Les articles suivants traitent de la procédure pénale et en particulier de la régiquine. Ce terme a fort embarrassé nos historiens du droit 1; il désigne, semblet-il, une procédure d’enquête avantageuse pour le plaignant. Il en résulte qu’elle peut avoir pour l’accusé des conséquences graves; aussi en entoure-t-on l’emploi de garanties nombreuses. Cette procédure, qui est applicable au délit de coups et blessures (art. 17), est publique et exige la présence des prud’hommes et de l’accusé, à moins qu’il n’y renonce (art. 20); le serment de régiquine ne peut être déféré ni à la partie demanderesse, ni à qui que ce soit qui aurait part ou intérêt au procès (art. 18) et il suffit de deux témoins pour en exclure un individu (art. 19); enfin ne sont admis à la régiquine ni les gens du comte, qui pourraient avoir intérêt à multiplier le nombre des coupables, ni les gens du plaignant, qui sont suspects de partialité (art. 69). Quand il est interrogé par régiquine, le bourgeois a le privilège de ne pas devoir /49/ prêter serment : en vertu du serment 1 qu’il a prêté à la ville, sa parole fait foi (art. 21).
Comme toutes les chartes, celle de Moudon contient un embryon de code pénal; elle fixe les maxima des amendes, dans le but de protéger les bourgeois contre l’avidité du seigneur ou de ses officiers de justice. Seuls les crimes qui entraînent des châtiments corporels et dépendent de la haute justice sont abandonnés à l’arbitraire du seigneur (art. 51); l’intérêt de l’ordre public l’exige; peut-être aussi le comte n’a-t-il pas voulu se dessaisir d’attributions qui lui paraissent inséparables de la souveraineté 2. En même temps qu’elle fixe l’amende qui doit être payée au seigneur, la charte établit le chiffre de l’indemnité qui sera versée au lésé; celle-ci est régulièrement la moitié de la première. Mais il est spécifié que le lésé n’y aura droit que s’il a porté plainte; si le délit est poursuivi d’office et par voie de régiquine, le lésé perd tous ses droits à des dommages-intérêts, preuve nouvelle de /50/ la répugnance que cette procédure inspirait à nos aïeux 1.
Est puni de l’amende de 60 sous celui qui frappe avec un bâton, qu’il y ait ou non effusion de sang (art. 22) 2, celui qui a une rixe avec autrui et lui lance une pierre, même s’il ne l’atteint pas, pourvu que la trace des coups de pierre soit visible sur le lieu du délit (art. 23), celui qui tire son couteau ou son épée, ou celui qui sort de sa maison la lance à la main (art. 24) 3, celui qui frappe de la paume de la main, s’il y a effusion de sang (art. 26), celui qui dépouille autrui avec violence (art. 30) 4, celui qui frappe autrui dans sa maison (art. 31). Est punissable d’une amende de 10 sous celui qui traîne son adversaire après l’avoir saisi des deux mains (art. 27), celui qui le frappe du pied (art. 28) et celui qui déchire ses vêtements (art. 29); d’une amende de 5 sous celui qui frappe de la paume de la main, sans effusion de sang (art. 26); d’une amende de trois sous celui qui frappe du poing (art. 25). La femme, moins responsable que l’homme de ses actes, ne paie que la moitié de l’amende (art. 32); de même le bourgeois qui a une rixe en dehors des limites de la ville (art. 33), car dans ce cas le trouble apporté à la paix publique est beaucoup moins grave.
La répression du délit d’injures part d’un point de /51/ vue différent du nôtre : Si l’on dit à quelqu’un « bâtard, punais 1 ou lépreux », on encourt une amende de 10 sous et l’on doit à sa victime une indemnité de 5 sous, mais au cas seulement où ces qualificatifs désobligeants ne correspondraient pas à la réalité (art. 34). De même, si l’on traite quelqu’un de voleur ou de traître, d’une façon générale, l’injurié n’est pas tenu de poursuivre son accusateur; par contre, si l’accusation a été précisée, il doit l’actionner; toutefois le diffamateur, qui retire alors ses accusations, ne peut être frappé d’une amende de plus de 60 s. (art. 36)2.
Si quelque mauvais garnement, garçon ou fille, se permet d’injurier une personne honorable et qu’il en soit puni par une giffle bien appliquée, il n’a rien à réclamer (art. 35).
L’adultère est puni d’une amende de 60 sous; encore faut-il que la constatation du flagrant délit soit faite, et avec une telle précision qu’elle ne laisse place à aucun doute (art. 70).
Les bourgeois qui intentent une action ne sont pas tenus de déposer une caution (art. 37) 3; tous ceux /52/ qui sont l’objet d’une plainte doivent déposer une caution (art. 38) 1.
Le commerce fait la prospérité de la ville; il importe donc que la sincérité des transactions commerciales soit garantie, autant que possible; l’une des obligations du seigneur est d’y veiller : on remet à sa merci celui qui tient deux sortes de mesures, une grande pour acheter et une petite pour vendre (art. 39) et il incombe à un de ses officiers, le métral 2, de sceller les mesures; le seigneur peut les faire vérifier quand il lui plaît; il fait détruire celles qui seraient trop faibles; celui en possession de qui une mesure non scellée et fausse sera trouvée paiera une amende de 60 sous (art. 40) 3.
Le moyen âge n’a pas connu la liberté du commerce et de l’industrie et les chartes contiennent toutes des articles qui réglementent d’une façon très étroite la plupart des métiers. Lorsque la ville a une industrie qui fait sa richesse, la charte entre dans les plus menus détails. Nous ne trouvons rien de pareil à Moudon où il n’y avait pas d’industrie de ce genre; la réglementation ne vise que la fabrication ou la vente des denrées de consommation : pain, viande et vin. /53/
Le bourgeois, qui est consommateur, tient à avoir des garanties contre la cherté des vivres; les bénéfices du boucher (art. 41), du boulanger (art. 47) , du meunier (art. 48), du fournier (art. 49), du cabaretier (art. 57) sont fixés par des dispositions très strictes 1, mais que, dans la pratique, il devait être bien difficile de faire respecter. Il veut aussi être protégé contre la mauvaise marchandise; de là des mesures très sévères à l’égard du boucher, qui ne doit pas vendre de la viande de mauvaise qualité ou provenant de bêtes malades (art. 42, 43, 44, 45, 46) 2. Sur ce point, les /54/ bourgeois de Moudon, si jaloux par ailleurs de leurs privilèges, admettent que le seigneur procède à des enquêtes d’office et contraigne les témoins à parler (art. 46); tous leurs scrupules juridiques à l’endroit de la procédure inquisitoire tombent devant le souci de leur intérêt immédiat, ce qui est très humain.
La vente du vin, qui a toujours joué un très grand rôle dans notre pays, fait l’objet d’une série de prescriptions concernant les taverniers. Le prix du vin est fixé d’un commun accord entre les bourgeois et le seigneur; nul ne peut vendre du vin à un prix plus élevé sans encourir une amende de 3 sous par mesure 1 (art. 57).
S’il y a contestation entre un cabaretier et un de ses clients, le serment du premier fait foi jusqu’à la somme de 5 sous, pour peu que l’autre partie reconnaisse avoir bu du vin chez lui (art. 60). On considère sans doute que le client peut n’avoir plus très claire souvenance de ce qu’il a consommé. Celui qui part sans payer est coupable d’une faute grave, à moins qu’il ne se soit entendu avec le tavernier et, s’il en /55/ est convaincu par deux témoins, il est puni de l’amende de 60 sous (art. 61).
A Moudon où il y avait beaucoup de passage, les auberges étaient nombreuses et prospères; leurs propriétaires étaient des gens importants; nous ne serions point étonnés que quelques-uns d’entre eux eussent été du nombre des notables qui ont collaboré à la rédaction de la charte.
Le moyen âge exécrait les usuriers, et l’on entendait par là tous ceux qui faisaient le commerce de l’argent et prêtaient à intérêt; l’Eglise les condamnait, les princes les poursuivaient et l’opinion publique approuvait cette sévérité. Toutefois, dès que les transactions commerciales se multiplièrent, on s’aperçut bientôt qu’on ne pouvait se passer d’eux et le droit s’adoucit : à Moudon, le seigneur ne confisque leurs biens que s’ils sont des usuriers manifestes 1, s’ils meurent sans enfants et sans s’être réconciliés avec l’Eglise (art. 52).
La charte limite ensuite l’arbitraire du seigneur en matière fiscale; elle fixe les redevances qui lui sont /56/ dues. Les bourgeois ne doivent rien au comte, sinon l’impôt foncier; encore celui-ci ne concerne-t-il que la propriété bâtie sise en ville et le chiffre en est-il établi une fois pour toutes. Il est proportionnel à la longueur de la façade, ou à la surface de la parcelle 1, et, pour cela, s’appelle teyse (toise) : il est de deux deniers par toise 2. Les bourgeois sont libres et entièrement propriétaires de leurs biens; ils peuvent vendre leurs propriétés sans l’autorisation du seigneur et il n’existe pas de droit de mutation; la seule trace qui en subsiste est l’obligation pour l’acheteur de donner au comte une coupe de vin (art. 53) 3.
Ces dispositions sont très favorables pour l’époque 4; elles ont eu, de plus, pour conséquence d’assurer à toutes les villes vaudoises, et cela jusqu’à la Révolution, l’exemption de tout impôt direct.
Le comte touche aussi une redevance de la part de certains artisans; c’est une sorte d’impôt sur les patentes. Le boulanger paie une fois l’an 2 sous et un denier; le boucher 3 sous; le cordonnier doit donner au seigneur une paire de souliers, celle que /57/ celui-ci trouvera la meilleure 1; le tavernier une coupe de vin (art. 54, 55 et 56) 2
L’argent était rare alors et le crédit inexistant : beaucoup de transactions n’étaient possibles que si l’acheteur donnait un gage au vendeur. Nous trouvons plusieurs dispositions à ce sujet : Le vendeur est tenu d’accepter un gage quand celui-ci vaut un tiers de plus que la chose achetée (art. 59) 3; il doit le garder 40 jours, s’il a été remis par le seigneur, 15 jours, s’il provient d’un chevalier ou d’un donzel 4 habitant Moudon (art. 66) 5. Passé ce délai, le gage peut être vendu; dans certains cas il peut y avoir réemption du gage (art. 67) 6. /58/
Après le gage, la saisie : La charte de Moudon accorde au bourgeois le privilège, qui nous paraît aujourd’hui excessif, de pouvoir saisir directement son débiteur, sans l’intervention d’un officier de justice. Il est vrai qu’il faut que le débiteur ait reconnu sa dette et que, si la saisie a été faite à tort, le bourgeois fautif paie une amende de 60 sous (art. 62). Les bourgeois de Moudon comptaient sans doute être plus souvent créanciers que débiteurs, c’est pour cela qu’ils maintenaient dans leur droit une coutume qui, partout ailleurs, disparaissait devant des considérations impérieuses d’ordre public 1.
Le seigneur surveille les pâquis communs; il peut en faire vérifier les limites et obliger les bourgeois à en reconnaître l’exactitude; s’il se trouve quelqu’un qui ait empiété sur le domaine commun 2, il paiera une amende de 3 sous (art. 63).
Jusqu’ici tous les articles, ou à peu près, sont tout /59/ à l’avantage des bourgeois et au détriment du comte; en voici deux, d’importance inégale, qui établissent les droits du seigneur : Celui-ci ne veut pas être exploité s’il vient à Moudon; il est spécifié qu’on ne pourra pas lui vendre plus cher qu’à un autre (art. 65); un autre article fixe les obligations militaires des bourgeois. Ils n’aimaient pas les expéditions guerrières qui les entraînaient loin de leurs affaires; ils réservaient leur ardeur belliqueuse pour leurs voisins, qui étaient aussi leurs ennemis, et pour la défense de leurs murs. Si, dans le reste de la charte, en matière judiciaire et administrative, le seigneur avait été large, il le fut moins en matière militaire; la Savoie était une monarchie guerrière, et le comte tenait à avoir des soldats; la charte imposait aux bourgeois de Moudon l’obligation du service militaire dans les évêchés de Lausanne, Genève et Sion, jusqu’à cette ville, et cela pendant huit jours et à leurs frais (art. 64).
Les derniers articles sont peut-être des adjonctions au texte primitif. L’un prévoit que le père n’est pas tenu de doter son fils 1, mais il lui doit remettre de quoi vivre 2; alors il n’est plus responsable de ses dettes (art. 71). Ainsi chacun est averti; il ne faut pas faire crédit à un fils de famille.
Un autre article prévoit l’expulsion du meurtrier /60/ (art. 75) 1; un autre la punition de celui qui pénètre sans droit dans le clos d’autrui (art. 76); s’il ne peut payer l’amende encourue, il peut être condamné à un châtiment qui le couvrira de ridicule : il devra courir nu par la ville 2.
Enfin on règle quelques points de procédure sur la production des témoins (art. 68 et 69), sur le règlement des frais de justice (art. 74) 3, sur la condamnation par défaut, l’appel et la constitution même des tribunaux (art. 72).
Ce dernier article est de toute première importance; il énumère les fonctionnaires du comte : ceux-ci sont au nombre de quatre, le bailli, le châtelain, le vidomne et le métral; ces deux derniers, anciens officiers de l’évêque 4, ont passé au service du prince savoyard; à côté de leurs fonctions administratives, tous les quatre ont des compétences judiciaires; ils président le tribunal 5. Mais ils ne peuvent juger qu’à /61/ Moudon et ils ne peuvent prononcer de jugement qu’après avoir pris l’avis des bourgeois et conformément à leur opinion; au tribunal, ils sont assistés par les plus notables d’entre eux et le magistrat qui préside ne fait que rapporter le jugement de la cour ainsi constituée.
Il peut en appeler à la cour du comte, si les bourgeois ne veulent pas se prononcer — car leur droit de juger est un privilège, non une charge — ou s’ils ne peuvent tomber d’accord; enfin, si l’une des parties s’estime lésée, elle peut aussi recourir en appel.
En somme, cet article assure aux bourgeois un très grand avantage : Sauf en appel, ils ne seront pas jugés hors de chez eux, par un juge étranger 1 et ignorant de leur coutume; ils seront jugés par leurs pairs à Moudon. C’est pour eux l’autonomie judiciaire, objet suprême de l’ambition des hommes de ce temps, que nous retrouvons sous une forme légèrement différente dans un des paragraphes les plus importants du Pacte de 1291 2.
Telle est la charte de Moudon 3. On peut s’étonner /62/ de n’y point trouver des dispositions sur l’héritage 1. Elle dit ce qu’il advient des biens des étrangers; elle ne prescrit rien en ce qui concerne les biens des bourgeois. Sans doute, une coutume bien établie rendait de telles prescriptions inutiles; les bourgeois ne pouvaient pas être soumis à un droit moins favorable que les étrangers dont le seigneur n’hérite qu’à défaut d’héritiers légitimes 2; s’ils avaient eu lieu de craindre que le comte vînt leur réclamer une part dans une succession, nous pouvons être sûrs qu’ils auraient pris leurs précautions et fait introduire un article à ce sujet 3.
La charte ne donne pas non plus à la ville une organisation municipale. Cela a surpris et l’on a supposé que, là aussi, la coutume suppléait au silence du document écrit 4. Je ne le crois pas. Les notables, — ceux que l’on appelait les coutumiers — peuvent bien prononcer d’une manière définitive sur des questions de droit civil ou de droit pénal; seule, au XIIIe siècle tout au moins, une concession explicite du souverain pouvait accorder aux bourgeois le droit /63/ d’établir des autorités communales. Nous savons par ailleurs que, ni en 1297, ni même en 1311, Moudon n’avait de magistrats municipaux 1. Sur ce point notre pays était un peu en retard; l’autorité du comte de Savoie était plus complète que celle de bien des dynastes de la Suisse allemande.
Certes, si on la compare à celle de Villeneuve (1214) 2 ou à celle d’Evian (1265) 3, la charte de Moudon était libérale; elle l’était cependant moins que celle de Fribourg ou celle de plus d’une ville du plateau suisse; elle n’accordait pas aux bourgeois l’autonomie administrative; libres dans leurs personnes et dans leurs biens, ils restaient dans la dépendance politique de leur ancien propriétaire, qui demeurait leur souverain; leur ville n’était pas encore une commune, au sens propre de ce mot.
Nous ne sachions pas qu’ils l’aient déploré. La charte leur assurait l’autonomie judiciaire; elle les préservait largement de l’arbitraire du seigneur ou de ses officiers; elle favorisait le développement commercial et assurait la prospérité de leur ville; elle réduisait à un taux très modéré leurs obligations financières. C’est à cela qu’ils tenaient surtout.
Ainsi on ne saurait comparer cette charte à la Grande Charte d’Angleterre de 1214 pas plus qu’au Pacte de 1291; c’est une œuvre moyenne et qui est le produit d’une conception politique assez généralement /64/ répandue à cette époque plus que la preuve d’une sagacité ou d’une magnanimité particulières aux princes de la maison de Savoie 1.
Ce sont précisément ces qualités moyennes qui firent sa fortune, comme nous le verrons plus loin, ainsi que celle de la ville de Moudon.
De quand date-t-elle ? et quel est le prince qui l’a octroyée ? Diverses opinions, avons-nous dit, ont été émises à ce sujet 2.
Une chose paraît hors de doute : La charte, confirmée en 1285 par Amédée V, est antérieure à cette date. En effet, en 1283 déjà, les coutumes 3 de Moudon sont mentionnées dans la charte de Nozeroy 4. Autre preuve : l’article 53 de la charte de Moudon dit que la teyse est due pour les chesaux 5 sis entre la Broye et la Mérine 6. Cet article ne peut avoir été rédigé qu’à une époque où toute la ville se groupait encore autour du château et ne contenait ni le quartier situé sur la rive droite de la Broye (le Mauborget), ni ceux situés sur la rive gauche de la Mérine (le St-Bernard et Grenade); or nous savons que ce /65/ dernier ne fut englobé dans les murailles de la ville qu’en 1281 1. La charte est donc antérieure à cette date.
Nous pouvons remonter plus haut encore : Il est possible que la charte d’Arlay en Franche-Comté (1276) dérive de celle de Moudon 2; fait plus certain, en février 1272, nous voyons des bourgeois de Moudon vendre une maison dans cette ville « suivant les bons usages et les coutumes de Moudon 3 » et cette formule ne peut se rapporter qu’à l’art. 53 de la charte. En 1266, certaines dispositions de celle-ci sont appliquées à Yverdon qui avait reçu la charte de Moudon 4.
D’autre part, la charte ne peut être de Thomas 5; elle est trop différente de celle de Villeneuve 6 sur laquelle elle marque un progrès évident; elle semble postérieure à l’année 1263, puisqu’à l’art. 72 il est question du bailli, institué à ce moment 7; enfin, elle paraît avoir subi l’influence de la charte d’Evian qui est de 1265 8.
Nous sommes donc amené à placer l’octroi de cette charte en 1265 ou en 1266 et à l’attribuer ainsi à la /66/ fin du règne du comte Pierre. Nous n’en savons pas davantage 1.
Nous ignorons en particulier quelle part elle renferme de traditions et d’usages anciens qu’elle ne ferait que codifier; nous avons tout lieu de croire que cette part est grande.
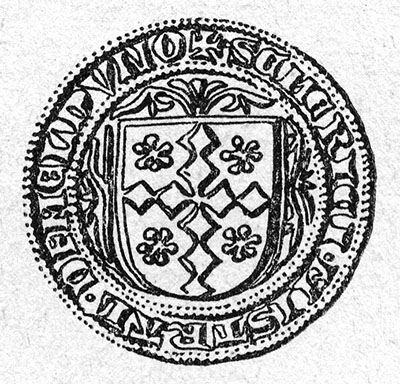
Sceau d’Émery mestral
1304
CHAPITRE VI
LE SUCCESSEUR DU COMTE PIERRE
Pierre de Savoie mourut au milieu de mai 1268; moins de quinze jours après, son successeur était déjà à Moudon 1. C’était son frère Philippe; comme lui, il avait passé par l’Eglise, puis était revenu au monde, quand il avait eu la perspective de régner. Mais, s’il avait suivi la même voie que son frère, il ne possédait pas ses talents politiques.
Peu capable, il montait sur le trône dans un moment difficile; un ennemi dangereux se dressait en face de lui : Rodolphe de Habsbourg. Depuis l’ouverture de la succession des Kybourg, ce prince était en état d’hostilité avec le comte de Savoie; l’objet immédiat du conflit était la possession de Fribourg. Grâce à l’habileté diplomatique et aux conquêtes militaires du comte Pierre, la Savoie encerclait cette ville; Morat, Gümmenen, Laupen, Grasbourg étaient entre ses mains; elle avait établi son protectorat à Berne et pouvait nourrir l’espoir d’étendre son influence dans la vallée de l’Aar 2. Le comte de Habsbourg voulait s’emparer de Berne et reprendre les places /68/ fortes de la Singine, pour pouvoir défendre Fribourg qui lui appartenait; et, au delà de cette ville, il voyait s’étendre le pays de Vaud, proie séduisante pour un prince qui avait l’ambition d’être le successeur des Zæringen.
Philippe ne se sentait pas de taille à lutter contre son redoutable adversaire; il préféra lui abandonner les dernières conquêtes de son frère, Laupen et Grasbourg, et pendant les premières années de son règne, il s’occupa essentiellement de sa guerre avec ses voisins d’occident, la dame de Faucigny, le dauphin du Viennois et le comte de Genevois.
L’élection de Rodolphe au trône impérial modifia et aggrava la situation; le nouveau roi songeait à reconstituer le royaume de Bourgogne en faveur d’un de ses fils, ce qui ne pouvait se faire qu’aux dépens de la Savoie. En octobre 1275, il rencontrait le pape Grégoire X à Lausanne et se réconciliait avec lui; il s’assurait ainsi l’appui de l’Eglise. Aux fêtes grandioses qui marquèrent la présence à Lausanne des deux chefs de la chrétienté, le comte de Savoie ne parut pas. Absence significative et qui montre à quel point les rapports étaient tendus entre lui et le roi. Rodolphe, en effet, réclamait Morat, Gümmenen, l’avouerie de Payerne, qui, d’après lui, dépendaient de l’Empire; le comte refusait de les rendre 1.
Nous sommes mal renseignés sur les événements qui suivirent. Il se peut que les hostilités aient commencé en 1276 déjà 2. La guerre proprement dite n’éclata /69/ qu’en 1281. Moudon fut mis en état de défense; un châtelain s’y installa avec une garnison; il fit creuser des fossés et bâtir des murailles 1. Si l’on en croit un vieux chroniqueur, les terres savoyardes furent ravagées par les soldats allemands 2. L’année 1282 paraît avoir été remplie par des négociations infructueuses; en 1283, le roi vint en personne mettre le siège devant Morat et devant Payerne que les Savoyards défendirent opiniâtrement 3. Rodolphe de Habsbourg dut assiéger cette dernière ville pendant sept mois, du 4 juin au 27 décembre; il l’obligea enfin à capituler 4, et, le jour même, il traita avec le comte Philippe. Celui-ci abandonnait l’avouerie de Payerne; il renonçait à Gümmenen et à Morat, à qui le roi faisait grâce; par contre, Rodolphe restituait au comte tout ce qu’il lui avait pris 5. /70/
Moudon est-il compris dans cette expression générale ? Un chroniqueur allemand l’affirme 1, mais nous n’en avons aucune preuve, ni même le plus léger indice. Quoi qu’il en soit, il paraît impossible que la guerre ait sévi si longtemps tout près de cette ville sans qu’elle en ait subi le contre-coup.
Philippe de Savoie mourut peu après, le 15 ou le 16 août 1285 2; il était si décrépit et si faible que, de son vivant, ses neveux se disputaient son héritage 3; les choses en étaient arrivées à un tel point que le vieux comte n’osa pas désigner son successeur et laissa ce soin aux souverains d’Angleterre, ses parents. Sitôt qu’il fut mort, l’un de ses neveux, Amédée V, se fit reconnaître par les grands vassaux. C’est à ce moment qu’il confirma la charte de Moudon, comme nous l’avons vu plus haut 4.
On put croire un moment que le nouveau comte et son frère Louis allaient se faire la guerre à propos d’un héritage qui, à vrai dire, ne revenait ni à l’un, ni à l’autre 5. Louis ne craignit pas d’appeler à son aide le /71/ roi Rodolphe, l’ennemi de sa maison, qui était trop heureux d’une discorde si opportune 1. Cependant un traité, passé à Lyon le 14 janvier 1286, mit fin au conflit. Amédée cédait à son frère les terres savoyardes situées au nord du lac, entre l’Aubonne et la Veveyse; elles devaient former une baronnie pour laquelle Louis prêtait hommage à son frère aîné 2.
Il ne paraît pas que le nouveau baron 3 ait été très satisfait de l’arrangement; ses rapports avec son frère et suzerain restèrent difficiles. Une guerre fratricide était toutefois évitée.

Sceau de Jean [de Vuippens ?]
curé de Moudon
1308
CHAPITRE VII
LE DEVELOPPEMENT DE MOUDON AU COURS DU TREIZIÈME SIÈCLE
Il est peu de sujets sur lesquels nous soyons plus mal documentés 1, si bien que nous en sommes réduits à ne formuler que des hypothèses.
L’histoire de la ville pendant cette époque peut se résumer en trois mots : agrandissement, accroissement, enrichissement.
La ville s’étend. A défaut de documents écrits nous pouvons interroger le sol lui-même et nous servir des indications que nous donnent les noms des rues et des quartiers. Jusqu’au XIIIe siècle, avons-nous vu, Moudon n’est qu’une forteresse. Le quartier qui va de la grosse tour à l’Institut des sourds-muets 2 nous a conservé le souvenir de ce temps; il s’est toujours appelé et s’appelle encore le Château (castrum).
A un moment que nous ignorons la ville a débordé au delà de son enceinte primitive, devenue trop /73/ étroite; des rues nouvelles sont nées, des bourgs (burgi), comme on les appelle alors.
On a d’abord construit des maisons du côté du couchant, le long de la route qui conduisait à Lausanne, de l’autre côté du fossé naturel qui défendait la forteresse; puis, ces édifices, en bois, ayant pris quelque importance, on les a munis d’un système de défense, dont la configuration des lieux rendait l’installation facile. Ainsi s’est formé le Bourg, que l’on appellera bientôt le Vieux-Bourg.
Car un phénomène analogue s’était produit à l’autre extrémité de la colline; au bas de la pente abrupte, le long du chemin, une rue, fort courte, s’est formée; ce n’est pas même un bourg, c’est un borgeau (burgellus); dès les temps les plus anciens, on lui donne le nom de Rotto ou Rotiou Borgeau 1.
Plus bas, au pied de la Tour et entre la Broye et la Mérine, des maisons s’élevèrent aussi; deux rues naquirent; elles s’appellent les Borgeaux sous la Tour et les Plans Borgeaux, aujourd’hui le Coude et la Grand’Rue. /74/
Ainsi la ville s’était allongée jusqu’au pont sur la Broye; c’est le point qu’elle avait atteint lorsque fut fixée la disposition sur l’impôt foncier que l’on trouve dans la charte 1. Elle ne s’arrêta pas là.
Le pont débouchait sur un carrefour; si une route traversait la ville pour se diriger ensuite sur Lausanne, la voie principale, qui venait du sud-est, continuait du côté de Lucens. Dès que les temps furent un peu sûrs, les marchands qui se rendaient à Payerne ou plus loin renoncèrent à entrer en ville; un nouveau quartier se créa sur les bords de cette route qui était très fréquentée. Le terrain était favorable pour la construction de maisons cossues; le seigneur avait tout intérêt au développement de ce faubourg, où les voyageurs passaient nombreux et s’arrêtaient tous; il y fonda une ville neuve. Cela veut dire qu’il favorisa les constructions et y attira des habitants par des promesses et des privilèges.
Quel fut ce prince ? Thomas, Aymon ou Pierre ? Nous ne le savons pas. Quels furent les privilèges concédés aux habitants du quartier neuf ? Nous l’ignorons aussi. Nous pouvons supposer, sans risquer de nous tromper beaucoup, que le fondateur de la ville neuve de Moudon accorda à ses habitants les droits dont jouissaient déjà les bourgeois de la ville elle-même, car nous ne constatons aucune différence de droits entre les uns et les autres. Cela nous engagerait à attribuer cette fondation à Pierre de Savoie.
Ce quartier récent était resté sans défense jusqu’en 1281; /75/ nous avons vu 1 qu’à cette date, devant les menaces de guerre, on l’entoura d’un fossé et d’un rempart; il fallut exproprier quelques particuliers et c’est grâce à cela que la chose est parvenue à notre connaissance 2. Ces travaux frappèrent l’imagination des contemporains qui appellent souvent ce quartier la Bâtie 3.
Enfin, de l’autre côté du pont de la Broye, un groupe de maisons plus modeste prit naissance autour de l’hôpital de St-Jean de Jérusalem 4; il s’appela le Mauborget; l’adjectif par lequel ce mot débute doit être considéré comme un diminutif plutôt qu’un péjoratif : c’était une toute petite rue, plutôt qu’un quartier dédaigné.
Si la ville s’agrandit, c’est que la population s’accroît. Aux noms que portent les bourgeois nous reconnaissons leur origine : ils s’appellent Pierre de Surpierre, Giraud de Vuippens, Jaques de Saint-Cierges, Raymond de Neyruz, Berthold de Denezy, Pierre de Sottens, etc. 5 Les villages voisins ont été la pépinière d’où sont sortis beaucoup de ceux qui se sont transplantés à Moudon.
D’autres viennent de plus loin : Ulrich de Payerne, Thorenc de Gruyères, Guillaume d’Albeuve. Ces quelques exemples suffisent; de toutes parts nous voyons affluer de nouveaux venus, qui, petit à petit, finiront /76/ par doubler au moins le chiffre de la population primitive, proportion qui ne doit pas nous étonner, puisque la surface bâtie a plus que doublé. N’avons-nous pas vu un phénomène analogue se produire presque sous nos yeux au XIXe siècle ?
C’est, pour une grande part, aux circonstances politiques qu’il faut demander l’explication de cet accroissement de la population. Base de la puissance savoyarde dans le Pays de Vaud dès le début du siècle, arsenal et place de concentration militaire dès 1240, centre administratif dès 1263, Moudon exerce un grand attrait sur les populations avoisinantes. Les franchises que la charte a données à la ville y attirent bien des hommes qui veulent jouir de ces privilèges.
Mais cela ne peut tout expliquer; une autre circonstance, primordiale, vient s’y ajouter : Moudon est le grand entrepôt savoyard au nord du lac Léman.
De bonne heure, les princes savoyards ont compris l’avantage qu’il y avait pour eux à posséder les passages des Alpes, le Grand Saint-Bernard en particulier. En 1214, Thomas accorde une charte à Villeneuve dont le péage devient important; en 1251 et 1255, Pierre s’arrange avec des marchands d’Asti et de Plaisance 1 pour leur faciliter le passage à travers ses Etats; quelques années plus tard, il acquiert les péages qui se trouvent sur la route du Grand Saint-Bernard 2 ainsi que, à l’autre extrémité de ses domaines, celui de Grandson 3. Il comptait par là attirer le trafic sur /77/ ses terres : de Vevey, on passait par Châtel-Saint-Denis dans la vallée de la Broye, comme à l’époque romaine; de là, les marchandises, balles de laines florentines ou produits orientaux qui venaient de Venise, se dirigeaient soit sur la Suisse allemande en descendant la vallée, soit sur la Franche-Comté, en passant par Thierrens, Yverdon et les cols du Jura 1. En sens inverse passaient les draps des Flandres.
Son successeur suivit la même politique; les dernières guerres du comte Pierre en Valais avaient été funestes au trafic; un des premiers soucis de Philippe fut de s’entendre avec l’évêque de Sion 2, de veiller à la sécurité des chemins et de prendre à cet égard des engagements vis-à-vis des marchands de Milan et de Novarre 3. Dans ses propres états il fait la police des routes, punit les brigands et indemnise les marchands qu’ils ont dépouillés 4.
L’importance de Moudon comme centre commercial est attestée encore par la présence dans cette ville de banquiers, que nous n’y retrouverons plus un /78/ siècle plus tard 1. Des Cahorsins — c’est le nom qu’on leur donnait alors — y vivaient aux temps du comte Philippe 2 et ils avaient pour clients les agents mêmes du seigneur 3.
Nous avons d’autres preuves de l’importance de la route qui passait par Moudon; ainsi la présence dans cette ville des Hospitaliers. A une date que nous ne connaissons pas, mais qui est antérieure à 1228, les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem se sont installés sur la rive droite de la Broye, tout près du pont 4. Il n’est pas interdit de penser que, dès que la route fut un peu fréquentée, c’est-à-dire dès le début de la domination savoyarde, le besoin se fit sentir d’hommes pieux et généreux, prêts à offrir un asile aux passants.
La même tâche amena peu après la fondation, de l’autre côté de la rivière, à l’endroit où se détache la route de Thierrens, d’un second hôpital, dépendant /79/ du Saint-Bernard. Il était utile que cette maison bienfaisante prolongeât jusque dans la plaine les soins et la protection dont elle entourait les voyageurs. Elle s’y installe entre 1231 et 1245 1, nous ne savons dans quelles conditions. Peut-être faut-il y voir l’action d’Aymon, le prince pieux qui fonda en 1236 2 l’hôpital de Villeneuve; peut-être est-ce un acte dont l’initiative remonte au comte Pierre.
Ce trafic considérable enrichit la ville. Pierre de Savoie, déjà, tire de celle-ci d’abondantes ressources : en 1251, il assigne une rente de 20 livres (4000 fr.) sur les vendes de Moudon 3; dans son testament il assure à un de ses fidèles une rente de 10 livres, assignée sur les fours de la ville 4.
De cette prospérité croissante nous avons d’autres indices certains : l’évêque de Lausanne possédait à Moudon /80/ le personat, ou droit de présentation du curé. Ce droit, qui s’est transformé en une redevance, vaut en 1254 10 livres, en 1275 20 livres et 35 livres en 1294 1. Nous devons admettre que cette augmentation, qui va du simple au double, puis à plus du triple, est proportionnelle à l’accroissement de la population et de sa richesse et que les effets de celui-ci se sont fait sentir avec un certain retard dans les exigences du fisc épiscopal; d’où nous pouvons conclure que c’est bien le règne du comte Pierre et celui de son successeur immédiat qui ont été les témoins de l’extraordinaire essor de notre petite ville 2.

Pl. XIII : Eglise Saint-Etienne
L’église paroissiale de Moudon en est aujourd’hui encore une preuve visible. Nous ne possédons aucun document écrit parlant de sa construction et comme aucun des testaments du début du XIVe siècle ne mentionne une offrande en faveur de cet édifice, nous en pouvons conclure qu’il était achevé alors 3. Les archéologues sont d’accord pour dater cet édifice de la seconde moitié du XIIIe siècle; il est postérieur à la cathédrale de Lausanne et contemporain de l’église de Romont, avec laquelle il présente plus d’une analogie 4. Or on sait que cette église fut bâtie par Pierre /81/ de Savoie, peu après 1244 1. Il n’est donc pas interdit de penser que c’est à l’instigation de ce prince, sinon à ses largesses, que l’on doit l’église de Moudon.
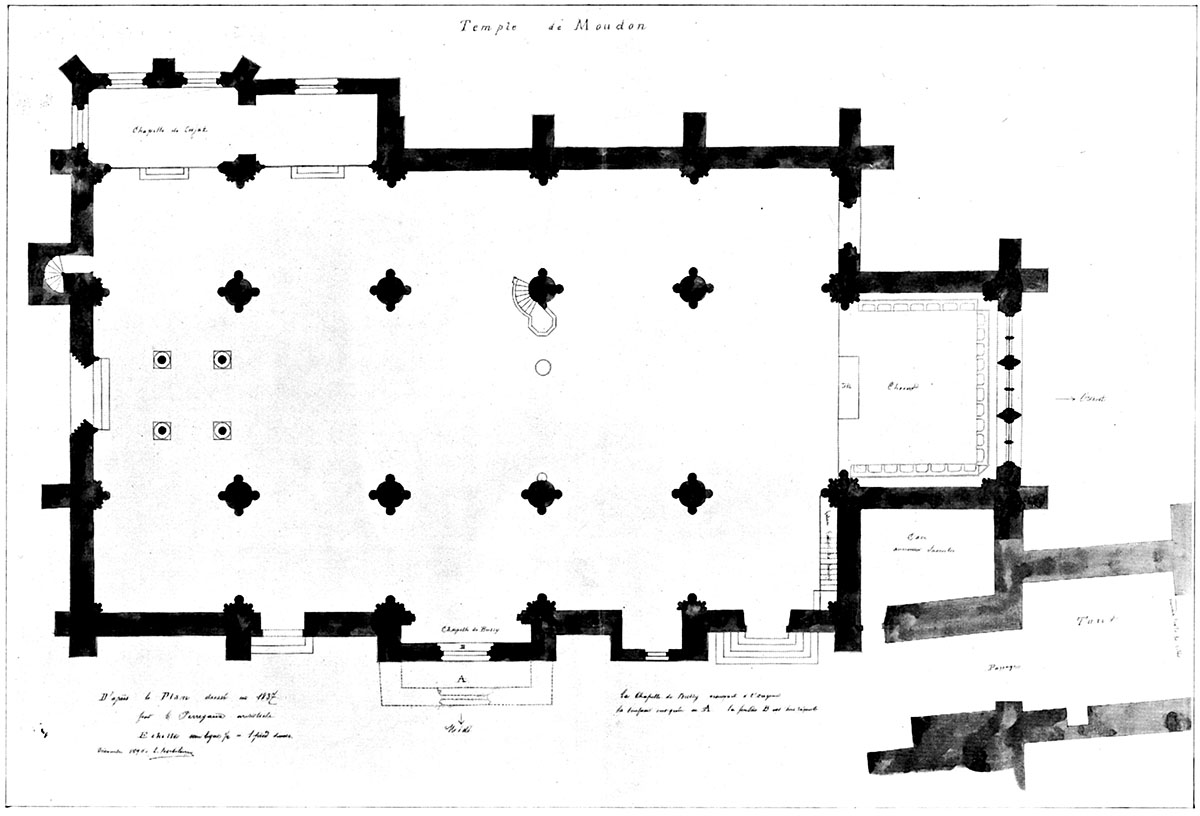
Pl. XV : Plan de l’Eglise Saint-Etienne
A cette époque où, autour d’eux, s’élevaient des églises nouvelles, les habitants de Moudon voulurent, eux aussi, remplacer leur antique et modeste église par un bâtiment neuf, au goût du jour, et qui montrât, par ses dimensions comme par sa beauté, la profondeur de leur piété et l’étendue de leurs ressources. La ville se peuplait; de vastes espoirs animaient ses habitants; ils voulurent faire grand; l’église, dédiée à saint Etienne, est de belles dimensions et la sobre élégance de ses colonnes et de leurs chapiteaux réjouit encore les yeux de leur lointaine postérité 2.

Pl. XIV : Intérieur de l’Eglise Saint-Etienne
Les bourgeois qui ornaient leur ville d’une construction aussi luxueuse avaient sans nul doute d’abondantes ressources. D’où provenaient-elles ? quels métiers pratiquaient-ils ? quels étaient les éléments les plus influents de la population ? Nous l’ignorons.
Nous rencontrons à Moudon quelques seigneurs des environs, comme les Vulliens 3; nous y voyons des /82/ bourgeois acquérir des fiefs dans la vallée de la Broye 1; nous y trouvons quelques notaires, dont l’un est créancier du comte de Gruyère 2. Voilà les seules indications qui aient échappé à l’oubli; elles sont insuffisantes pour nous permettre de dessiner un tableau un peu complet.
Les plus notables des bourgeois nous paraissent être Thorenc de Gruyères et Rodolphe de Glane 3; le second sera l’ancêtre d’une famille dont nous aurons à parler plus d’une fois 4.
Ces bourgeois nombreux et riches ne possèdent pas d’organisation municipale. La ville est encore administrée par les fonctionnaires du seigneur, essentiellement par le châtelain et le vidomne; cependant les bourgeois les plus considérables sont consultés lors des affaires importantes et l’administration des /83/ pâturages communs paraît ressortir à la communauté tout entière qui en a la jouissance 1.

Sceau de Georges de Glane
seigneur de Cugy, 1456.
CHAPITRE VIII
MOUDON SOUS LES BARONS DE VAUD
Le Pays de Vaud et Moudon en particulier avaient donc échappé à la domination immédiate de la maison de Savoie et avaient passé sous l’autorité d’une branche cadette apanagée. Ce changement n’eut guère d’importance pour notre pays 1.
Il semble que le nouveau seigneur, Louis de Vaud, se soit montré plus avide que ses prédécesseurs; sans doute, ses besoins d’argent étaient plus grands. C’est pour cela, pensons-nous, qu’il demanda à Rodolphe de Habsbourg et obtint de lui le droit de lever un péage dans ses mandements de Moudon, Yverdon et Romont 2.
Toutefois ses rapports avec le Habsbourg se gâtaient et il se préparait à recommencer la guerre quand le roi mourut le 15 juillet 1291, à Spire. Aussitôt, tous les adversaires de la maison d’Autriche se groupèrent et /85/ formèrent cette grande ligue qui, par une coïncidence singulière, réunit pendant quelque temps tous les éléments qui devaient plus tard former la Suisse 1. Le 5 août, Louis et le comte Amédée s’entendaient sur le partage du butin qu’ils escomptaient déjà 2; moins d’une semaine après, ils occupaient Morat 3.
Mais la grande alliance anti-autrichienne fut défaite devant Winterthour au printemps suivant; l’élection d’Adolphe de Nassau détacha de la ligue ceux qui y étaient entrés pour empêcher la couronne impériale de rester en possession des Habsbourg; l’énergie d’Albert d’Autriche fit le reste : à la fin de 1292, la ligue était dissoute et Louis de Savoie signait la paix avec les Fribourgeois qui, dans la guerre, avaient fidèlement tenu le parti du duc. Ceux-ci, qui, semble-t-il, avaient conquis un assez gros butin sur les gens du baron de Vaud, s’engagent à rendre leurs prisonniers avec leurs chevaux et leurs armures, de même que les chevaux et les armures des hommes qui avaient été tués; ils font trêve et paix avec Louis et avec le comte Amédée, pour trois ans; pendant ce temps, les chemins seront sûrs. Le baron de son côté promet paix et trêve en son nom et au nom de son frère; il s’engage à faire rendre, moyennant rançon, deux bourgeois de Fribourg, que Pierre de Blonay détient. Des arbitres fixeront le chiffre des indemnités dues de part et d’autre 4. /86/
C’est là tout ce que nous savons d’une guerre où le succès ne paraît pas avoir toujours accompagné les armes savoyardes; Fribourg était trop près pour que Moudon n’en ait pas ressenti les contre-coups; c’est tout ce que nous pouvons en dire.
Au reste, peu après, la politique savoyarde se modifia; le comte regarda vers le sud 1; le baron eut d’autres préoccupations; tous deux renoncèrent à leurs ambitions au delà de la Sarine; cela mit fin à leurs conflits avec les Habsbourg qui, eux aussi, abandonnèrent l’idée d’une expansion du côté du couchant.
Mais cela ne mit pas fin aux guerres; loin de là, Louis de Vaud passa la fin de sa vie à cheval et la lance au poing, si l’on peut dire, occupé à imposer son autorité aux seigneurs vaudois qui s’en voulaient affranchir 2.
Cette guerre fut malheureuse pour le baron; la féodalité l’emporta. Il manquait probablement de ressources militaires suffisantes et, surtout, il trouvait au nombre de ses adversaires l’évêque de Lausanne, dont la puissance morale était redoutable.
Pour lutter contre ses grands vassaux, les Cossonay et les Grandson, Louis s’appuya sur la petite noblesse 3 et sur les villes; les Fribourgeois et les Bernois étaient ses alliés 4; les bourgeois de Moudon avaient pris fait et cause pour leur seigneur. Pour lui rendre service, /87/ ils n’hésitèrent pas à se réconcilier avec les Fribourgeois. Voici la lettre qu’ils leur adressèrent à cette époque : « Aux respectables, provides et discrets seigneurs l’avoyer et les nouveaux conseillers de Fribourg et à toute la communauté du dit lieu, salut et accroissement ininterrompu d’amitié, de la part de l’ensemble de la communauté des bourgeois de Moudon. Vous saurez tous par les présentes que le très illustre prince Louis de Savoie, sire de Vaud, notre très cher seigneur, a bien voulu nous rappeler clairement et complètement et nous dire les bons offices, l’appui, le secours et l’amitié qu’il a trouvés à nouveau auprès de vous, grâce à vos bonnes dispositions, ainsi que les honneurs, services et satisfactions de toute sorte que vous lui avez rendus. Nous avons entendu cela avec plaisir et nous vous en félicitons tous du fond du cœur. Nous n’oublions pas que notre dit seigneur Louis nous a donné les injonctions et les ordres les plus formels de protéger et de défendre vos personnes et vos biens de tout notre pouvoir et plus que les siens ou les nôtres propres; puis il nous a ordonné aussi de nous tenir à votre disposition pour exécuter vos ordres, sans difficultés et sans retard quelconques, dès que nous y aurons été requis par vous ou vos messages. Nous sommes prêts à le faire en tout et partout, de toutes nos forces et en vous donnant les preuves de toute notre amitié. Nous vous souhaitons bonne et longue prospérité. Et pour que votre communauté ait de nos sentiments un document authentique, nous vous envoyons la lettre officielle présente, scellée, sur notre demande, des sceaux de dom André, curé de Moudon, de Pierre Belex, /88/ châtelain de Rue, de Pierre de Vuippens, bourgeois de Moudon, et de Thomas du Bourg, notaire. Donné à Moudon, le jeudi avant la fête de la purification de la sainte Vierge, l’an du Seigneur MCCXCVI (31 janvier 1297) 1 ».
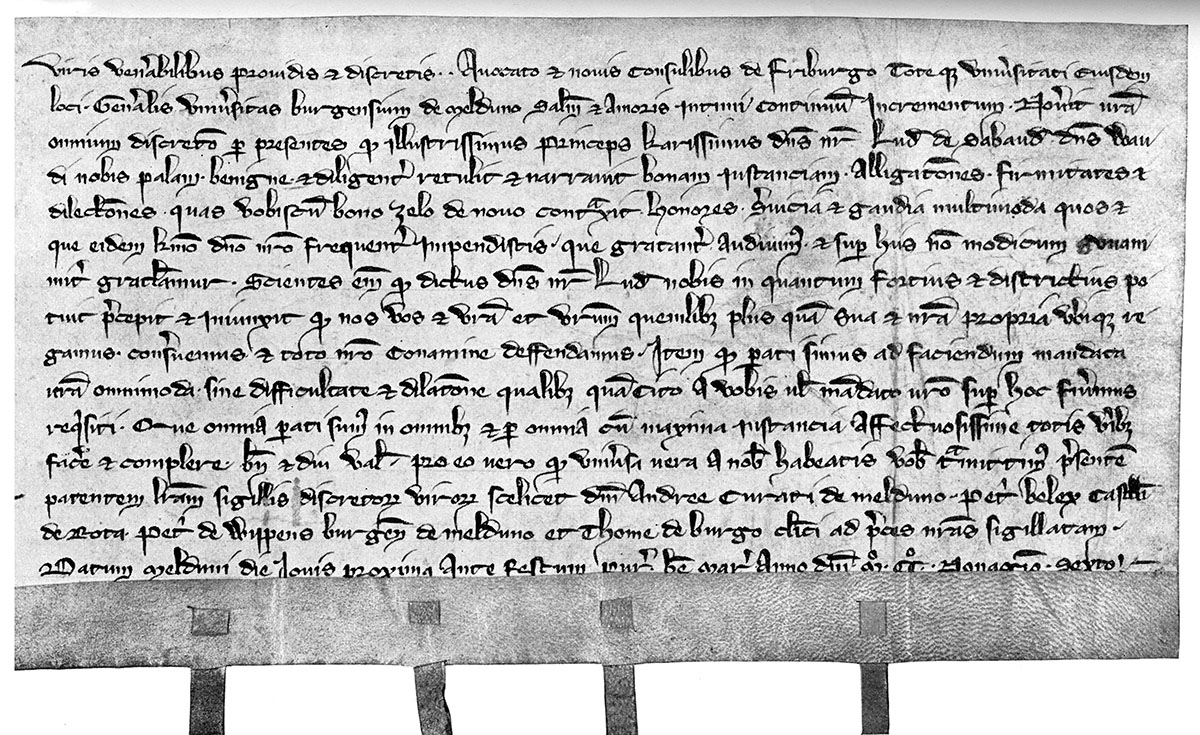
Pl. V : Lettre des bourgeois de Moudon aux autorités de Fribourg (1297)
Cliquez 2X sur l’image pour une vue agrandie
Au milieu de la phraséologie compliquée de ce document diplomatique 2, nous avons peine à discerner les sentiments véritables des Moudonnois; étaient-ils vraiment si bien disposés envers les Fribourgeois qu’ils le veulent bien dire ? ou bien ne faisaient-ils qu’exécuter les ordres de leur maître qui, ayant grand besoin de l’aide des Fribourgeois, ne voulait pas que des querelles entre voisins vinssent entraver sa politique ? Nous ne le saurons jamais.
Ce que nous savons, par contre, c’est que les gens de Moudon eurent leur part des malheurs que la guerre amena : leur ville fut frappée d’interdit par l’évêque 3 et, lorsque une trêve intervint, en juillet 1297, le vidomne de Moudon et un bourgeois de marque durent se porter garants, pour 100 livres (20.000 fr.) chacun, /89/ de l’indemnité que le baron de Vaud s’engageait à payer à l’évêque de Lausanne 1.
La paix ne fut signée que trois ans plus tard, à Ouchy 2. A cette date la ville de Moudon s’était déjà réconciliée avec l’évêque, puisqu’il n’est fait aucune mention de la sentence dont elle avait été frappée, et son nom n’intervient dans le traité que parce que l’on confie un arbitrage à six de ses bourgeois 3.
La guerre avait coûté fort cher au baron; pour se dégager des obligations qu’il avait contractées vis-à-vis de l’évêque, il dut lui abandonner une partie des bois du Jorat, le long de la route qui va de l’hôpital (de Sainte-Catherine) vers Moudon 4. L’évêque s’engageait à ne bâtir aucune forteresse dans ces parages, jusque vers Rue et Moudon; le baron prenait ses précautions; il ne voulait ni menace ni concurrence dans la Haute-Broye, dans le voisinage des deux villes qu’il y possédait.
C’est le dernier de ses actes qui nous intéresse; il mourut à Naples peu après, en janvier 1302.
Son fils, Louis II de Savoie, fut un grand prince; par sa bravoure, par l’étendue de sa réputation, par le rôle qu’il joua en Europe 5, il acquit une situation /90/ considérable. Mais précisément parce que son activité s’exerça surtout hors de notre pays, son action sur l’histoire de Moudon fut très réduite. Elle se résume en quelques mots : les Moudonnois durent l’accompagner à la guerre; ils durent lui payer des impôts extraordinaires.
Louis II, en effet, fut un prince belliqueux que nous voyons combattre aux côtés de son oncle Amédée et de ses cousins, les comtes Edouard et Aymon. C’est ainsi que les hommes du baron de Vaud furent amenés à participer à plus d’une entreprise savoyarde.
En janvier 1305, par exemple, Edouard, prince héritier de Savoie, mettait le siège devant le château de Lullin en Faucigny et le prenait au bout de onze jours. Parmi les assiégeants se trouvait le vidomne de Moudon avec cinq hommes d’armes 1. En 1307, des hommes de la châtellenie de Moudon participèrent à la campagne qui aboutit à la prise du château voisin de Ravorée 2.
Le baron de Vaud faisait aussi la guerre pour son compte : en 1308, nous le trouvons aux prises avec l’évêque, allié aux Fribourgeois 3; après quelques /91/ violences de part et d’autre, on convint d’une trêve 1, qui fut renouvelée à plus d’une reprise et dura ainsi plusieurs années.
Nous ne savons pas quand Louis de Savoie s’arrangea avec l’évêque; le 4 avril 1311, la trêve avec les Fribourgeois, le seigneur de Montagny et d’autres de leurs alliés était prolongée une fois de plus; elle devait durer jusqu’au 1er mai 1312. Dans cette circonstance, le bailli de Vaud, qui agissait au nom de son maître, était assisté des châtelains de Romont, Yverdon et Moudon, de trois bourgeois de Romont, cinq d’Yverdon et quatre de Moudon, ainsi que des curés de ces trois villes 2.
Peu après, la paix fut signée avec les Fribourgeois; nous n’en connaissons pas toutes les conditions; elles étaient dures pour eux; ils devaient entre autres payer au baron mille livres (200.000 fr.) pour le rachat de leurs prisonniers et comme indemnité pour les ravages qu’ils avaient commis sur ses terres 3. La coalition anti-savoyarde était dissoute et Girard de Vuippens, l’ancien évêque de Lausanne devenu évêque de Bâle, l’ennemi acharné de Louis, se portait caution pour les Fribourgeois.
Moins de quatre ans après, nous retrouvons le baron de Vaud de nouveau (ou encore) en lutte avec /92/ l’évêque 1, qui est alors Pierre d’Oron. Ce dernier, semble-t-il, avait élevé des prétentions sur le territoire qui s’étend au delà de la Venoge, dans la direction de Morges, à Bremblens en particulier. De son côté, Louis II cherchait à s’emparer de Forel sur Lucens; il avait occupé le château de Villarzel et pris sous sa protection Conon de Villarzel, le prieur de St-Maire, révolté contre l’évêque 2. Le prieur avait juré bourgeoisie à Moudon ce qui nous montre que la ville avait pris son parti; en outre, les bourgeois revendiquaient des droits d’usage étendus dans les bois du Jorat qui appartenaient à l’évêque; le baron soutenait les prétentions de ses gens.
Un arbitrage mit fin au conflit; les torts étaient compensés : Forel était restitué à l’évêque, ainsi que Villarzel; le prieur de St-Maire était abandonné à son sort; Louis de Savoie restait maître de Bremblens et l’on spécifiait les surfaces sur lesquelles s’exercerait le droit d’usage des bourgeois de Moudon 3.
Tous ces conflits intéressaient directement les gens de cette petite ville et, malgré l’absence de tout document, nous pouvons être certains qu’ils y prirent une part active 4. /93/
Mais la guerre continuait avec le comte de Genève, en dépit de l’intervention du pape Jean XXII, et le baron de Vaud y combattait aux côtés de son oncle, le comte de Savoie 1. En avril 1320, il amena avec lui au siège du château de Genève des soldats qu’il avait levés dans ses châtellenies vaudoises 2. L’année suivante, il menait ses troupes contre le dauphin et, dans l’arrière-automne, il participait au siège du château de Corbières sur le Rhône, qu’Amédée V prit au bout de quarante-deux jours. Nous savons que 565 soldats de la châtellenie de Moudon s’y trouvaient le 23 novembre; mais, une fois écoulés les huit jours qu’ils devaient, la plupart rentrèrent chez eux, malgré que la solde eût été augmentée : le 6 décembre, il n’y en avait plus que cent; le 7, leur nombre était réduit à 70 et le 16, à 11, plus le ménétrier; les hommes de Moudon manœuvraient le bélier 3.
Au demeurant, le baron de Vaud s’intéressait toujours davantage à la politique extérieure; bientôt, /94/ avec les autres princes de sa maison, il entre au service de Philippe de Valois et devient un de ses conseillers habituels 1.
C’est pendant qu’il était en France qu’éclata, entre Berne et les seigneurs romands, alliés à Fribourg, la guerre qui devait aboutir à la bataille de Laupen. Tandis que le comte de Savoie, Aymon, fidèle aux traditions de sa maison, conservait son alliance avec Berne 2, Louis II s’en détachait et se rapprochait de Fribourg. Il en était devenu bourgeois 3, et, renonçant aux avantages que lui avait valus sa victoire de 1311, il avait, en 1326, conclu avec les habitants de cette ville, une alliance formelle 4. Voilà pourquoi, le jour de la bataille, son fils unique, Jean de Vaud, se trouvait dans les rangs des ennemis de Berne. On sait qu’il y fut tué 5. Evénement des plus importants pour notre pays, puisqu’il prépara son retour à la Savoie.
Mais la guerre de Cent Ans avait commencé; Louis de Savoie s’y distingua 6. Cette politique lointaine /95/ ne touchait guère les gens de Moudon; le baron de Vaud n’emmenait avec lui que des chevaliers. Elle eut toutefois une influence très directe sur les affaires de notre pays.
Si Louis de Savoie se couvrait de gloire, il se ruinait aussi. Comme tant d’autres princes, comme le chef de la maison de Savoie lui-même, il n’avait pas des ressources suffisantes pour pouvoir faire la guerre presque en permanence et, en même temps, soutenir le train de maison luxueux que l’époque imposait au seigneur qui voulait faire figure dans le monde. Louis de Savoie se trouva bientôt à court d’argent. Il eut recours alors à l’impôt extraordinaire, ou subside, ressource que les princes n’employaient alors qu’à la dernière extrémité.
En ces temps où la notion d’Etat était peu comprise et où les rapports de prince à sujet étaient encore basés en quelque sorte, sur un contrat tacite, toute prétention extraordinaire du souverain faisait l’objet de négociations avec ses sujets qui devaient y consentir. Plus les besoins du premier étaient pressants, plus s’accroissaient les exigences des seconds.
Ainsi, en 1328, il leva dans toute l’étendue de ses terres un impôt extraordinaire de six gros, ou six sols (60 fr.), par famille (ou feu) 1; mais il dut le payer par des concessions de toutes sortes, ténorisées dans des lettres que l’on appelle reversales, et qui sont de véritables chartes 2. Dans celle qu’il accorda à Moudon, /96/ le baron reconnaissait, qu’il n’avait aucun droit à percevoir cet impôt, qu’en conséquence celui-ci était de la part de ses sujets un pur don et ne pouvait créer de précédent; par un serment solennel, il s’engageait à ne pas renouveler une semblable demande; pour témoigner de sa reconnaissance, il confirmait la charte de Moudon et garantissait en particulier aux habitants le privilège de ne point être jugés hors de cette ville, sauf en appel 1.
Il faut croire que cette disposition, contenue déjà dans la charte 2, tenait fort à cœur aux Moudonnois ou qu’ils avaient lieu de craindre qu’elle ne fût pas appliquée, sinon ils ne l’auraient pas fait insérer à nouveau dans cet acte.
On sait ce que valent en ces matières d’impôt les promesses les plus solennelles des princes et des gouvernements; ils les oublient vite. En 1341, Louis réclama un nouveau « don gratuit », pour la décharge de quelques dettes et pour la dot de sa fille unique qui venait de se marier pour la seconde fois 3. Moudon accorda un don de 500 livres (100.000 fr.), payable en plusieurs fois; en retour, le prince reconnut, par une /97/ nouvelle reversale, que la ville n’était nullement tenue à faire ce versement, que ses habitants et leurs hoirs à perpétuité étaient libres et francs de tout impôt et que, s’ils avaient consenti à celui-ci, c’était « de grâce spéciale »; le baron de Vaud vint en personne à Moudon pour y passer cet acte 1.
Au reste, ces ressources étaient insuffisantes pour combler le vide croissant du trésor. Accablé par les dettes, le baron de Vaud est obligé d’aliéner ses terres domaniales que les bourgeois de Moudon lui achètent à beaux deniers comptants, comme nous le verrons plus loin 2; il engage le revenu de ses châtellenies; en 1342, il dut constituer, en faveur d’Antoine Cornu, seigneur de Vulliens, une rente de 32 livres 2 sous 6 deniers et une obole et lui payer ainsi, au taux de /98/ près de 8 %, les intérêts de la somme de 413 livres 6 sous et 8 deniers qu’il lui devait 1. Louis II est même hors d’état de payer ses fonctionnaires 2.
La mort de son fils unique engagea Louis de Savoie à régler de son vivant la question de sa succession. Au printemps de l’an 1340, il convoqua devant lui, à Morges probablement, les représentants des villes qui lui appartenaient et il leur fit reconnaître sa fille comme son héritière 3. Le comte de Savoie, Aymon, approuva cet acte en 1341, quoiqu’il fût contraire à ses intérêts et aux traditions de sa maison 4. Deux ans après, il mourait et Louis de Savoie assumait la tutelle du jeune Amédée VI, le futur Comte Vert.
Ce dernier venait d’atteindre ses quatorze ans et arrivait ainsi à sa majorité, quand Louis II succomba à son tour, au début de 1349 5.
Sa fille Catherine, la nouvelle dame de Vaud, était /99/ alors hors du pays; mariée une première fois à un prince italien, elle avait épousé ensuite Raoul de Brienne, comte de Guines et d’Eu, connétable de France 1. Isabelle de Chalon, veuve de Louis II, prit possession de la baronnie au nom de sa fille; elle vint à Moudon en personne et, le 29 janvier 1349, elle y confirma toutes les franchises de la ville 2.
Elle déclarait, en particulier, qu’aucune peine arbitraire, c’est-à-dire aucune amende autre que celles spécifiées dans la charte, ne pouvait être infligée aux habitants; que le bailli et le châtelain, chaque fois qu’ils entreraient en fonctions, devaient jurer dès leur arrivée d’observer les franchises de Moudon. « Attendu la fidélité des gens de Moudon », elle leur confirmait le privilège de ne pas être cités en justice hors de leur ville, sauf en appel 3; en outre, la capacité d’hériter des usuriers était étendue; le droit de confiscation du seigneur 4 était limité au cas où le défunt aurait tenu une table (de changeur) devant sa maison et pratiqué ouvertement l’usure et fût mort sans hoirs quelconques et sans s’être réconcilié avec l’Eglise. Ces quatre conditions ne pouvaient guère se rencontrer ensemble; le fait est que nous ne trouvons pas de cas de ce genre dans les comptes de la châtellenie. Enfin, la dame de Vaud autorisait expressément les bourgeois de Moudon /100/ à se fournir dans ses « noires joux » (bois de sapin) de tout le bois qui leur était nécessaire 1; elle s’engageait à faire surveiller par ses officiers et par des notables les fours et les moulins — dont les tenanciers, devons-nous croire, exploitaient les habitants de la ville — et à les rétablir dans les conditions prévues par les franchises 2; la fixation d’un tarif sommaire devait mettre fin à la rapacité, toujours insatiable, des gens de justice; leur nombre devait être réduit; de plus, les bourgeois de Moudon se voyaient confirmer leur droit de saisir directement les biens de leurs débiteurs 3.
Au fond, les concessions de la dame de Vaud n’ajoutaient rien d’essentiel aux franchises de 1285, mais cet acte précisait certains points qui avaient pu donner lieu à des contestations et donnait force de loi à l’interprétation extensive que les bourgeois faisaient de leur charte. Isabelle de Chalon était une princesse énergique, mais sa situation n’était pas facile; les bourgeois de Moudon surent profiter de l’occasion favorable.
Accusé de trahison, Raoul de Brienne fut décapité à Paris, le 18 novembre 1350, sur l’ordre du roi Jean. Au printemps 1352, sa veuve épousa en troisièmes noces Guillaume, comte de Namur, auquel elle apporta la baronnie de Vaud. Le 12 juin de la même année, celui-ci était à Moudon et, sur la place devant l’église de Notre-Dame 4, au Château, il jura d’observer les /101/ franchises de la ville; puis, conformément à l’article premier de la charte, tous les membres de la communauté, convoqués à cet effet, levant le doigt, jurèrent à leur tour d’être fidèles et obéissants envers leur seigneur. Au sortir de cette cérémonie, le comte reçut, au château, l’hommage de ses vassaux, seigneurs des environs ou bourgeois de Moudon 1.
Pendant quelques années, le comte de Namur administra la baronnie de Vaud. Mais ce pays était bien loin de ses terres patrimoniales et, d’autre part, la succession de Louis II était grevée de lourdes dettes. Aussi, Guillaume et Catherine se décidèrent-ils à vendre leur seigneurie à leur cousin le comte de Savoie pour le prix de 160.000 florins 2. C’est ainsi que le Pays de Vaud fit retour à la Savoie.
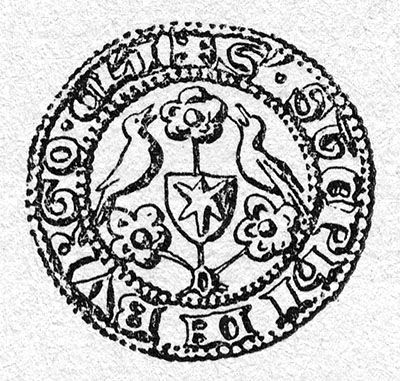
Sceau d’Etienne du Bourg,
notaire, 1341.
CHAPITRE IX
LA VIE A MOUDON PENDANT LE RÈGNE DES BARONS DE VAUD
Nous sommes moins renseignés que nous ne le voudrions sur les habitants de Moudon; nous connaissons toutefois les noms de beaucoup d’entre eux; c’est déjà quelque chose.
Petit à petit, on voit naître le nom de famille; sans doute, le prénom est encore l’essentiel et le nom qui l’accompagne est avant tout un surnom; mais il perd son caractère individuel : il se met au féminin quand il désigne la femme de celui qui le porte 1; de plus en plus fréquemment, il se transmet à ses enfants. Dès le milieu du XIVe siècle, il est devenu héréditaire.
Souvent c’est un patronymique : le prénom du père, mis au génitif, ainsi Vionnet Fabri, c’est Vionnet, fils du favre (forgeron); son fils, Rolet Vionnet, c’est Rolet fils de Vionnet 2; plus souvent c’est un locatif : le nom indique l’endroit où habile le personnage, par /103/ exemple : Pierre du Bourg, Rodolphe de la Porte, Girard du Chaffa 1, ou bien il désigne le village d’où il vient. D’autres sont tirés du métier ou de la fonction de leur propriétaire ou d’un de leurs ancêtres, comme Favre, Marchand, Teinturier, Mestral; d’autres enfin sont des sobriquets : Allemand, Anglais, le Beau, Bonfils, Belenfant, Bottacu, Pleurelesel, le Coucou; une femme — est-ce compliment ou ironie — s’appelle Débonnaire. Beaucoup d’autres, déformés par la prononciation et par la transcription des copistes, n’ont plus de sens apparent 2.
Parmi ces habitants, nous rencontrons des gens de tous les métiers et de toutes les conditions sociales. Il y a des ecclésiastiques nombreux : le curé tout d’abord, un assez gros personnage, souvent chanoine de Lausanne, comme Pierre de Lasernia, au XIIIe siècle, et plus tard Pierre Soutey, Jaques Joutens et Nicolas de Billens 3. Dans ce cas, le curé ne réside pas et se fait remplacer par un vicaire, tel ce Jean /104/ de Germagny qui fut chapelain de l’évêque Jean de Rossillon 1.
L’évêque Pierre d’Oron 2, pour augmenter ses ressources, obtint du pape Jean XXII que l’église de Moudon fût réunie à la mense épiscopale 3, ce qui fut fait à la mort de Pierre Soutey, en 1324 4 : l’évêque de Lausanne — c’était alors Jean de Rossillon — prit le titre de curé de Moudon. Il ne le garda pas longtemps; Louis de Savoie se plaignit au pape 5; il lui représenta que Moudon était une ville importante, la capitale du pays 6; il n’était pas convenable qu’elle n’eût qu’un vicaire; la population en était scandalisée. Le pape révoqua alors sa première bulle — c’était en 1329 7 — et Moudon eut de nouveau un curé 8. /105/
A partir de 1359, le curé est un bourgeois de Moudon, Rodolphe, fils du notaire Robert de Cussey; il resta en fonctions pendant près de 30 ans 1. Tous les curés de Moudon sont des gens considérables; la charge n’était pas donnée au premier venu.
A côté du curé ou de son vicaire, plusieurs chapelains assuraient le service de l’église paroissiale; au milieu du XIVe siècle, ils semblent avoir été au nombre de trois, en général; ils étaient assistés d’un ou deux clercs 2. D’autres prêtres desservaient les autres églises et chapelles qu’il y avait à Moudon. Plusieurs de ces ecclésiastiques sortaient de familles moudonnoises; ils étaient souvent titulaires de cures situées dans les environs 3.
On trouve aussi à Moudon toute une petite noblesse 4, donzels et chevaliers; propriétaires de fiefs dans les environs, ils ont maison en ville. C’est là qu’ils font rentrer leurs récoltes; là, les revenus de leurs domaines sont à l’abri du pillage. Considérés comme des bourgeois de la ville, à laquelle ils prêtent l’appui de leur bras et de leur expérience militaire, ils peuvent se dispenser de bâtir ou d’entretenir à grands frais des maisons fortes sur leurs terres 5. /106/ Tels sont les donzels de Combremont 1, de Servion 2, de Sottens 3, et surtout les Vulliens, dont nous avons déjà parlé 4 et qui, à cette époque, sont divisés en trois branches, résidant toutes à Moudon 5. Ajoutons les descendants de sire Amédée, chevalier de Moudon, appelé Escot (c’est-à-dire l’Ecossais), nous ne savons pourquoi 6.
Une autre circonstance encore les attire à Moudon : la présence du bailli de Vaud. Ils l’accompagnent et forment son escorte naturelle 7; ils sont mis ainsi en rapport avec le baron de Vaud et le comte de Savoie, au service desquels ils peuvent entrer, se distinguer et faire fortune. Plus d’un y gagna ses éperons de chevalier : d’autres devinrent châtelains; /107/ Antoine Cornu de Vulliens devint bailli de Vaud. Ils habitent à Moudon le quartier du Château; ce sont eux peut-être qui ont fait construire ces vastes et puissantes substructions qui servent aujourd’hui de caves et de réduits à de très modestes demeures.
Les habitants roturiers pratiquent tous les métiers dont a besoin alors une ville qui doit se suffire à ellemême : ils sont bouchers, fourniers, merciers, etc.; nous trouvons plusieurs tanneurs qui travaillent le cuir le long de la Mérine; des peauciers qui préparent les pelisses, ces vêtements indispensables pour l’hiver, car on les porte même à l’intérieur des maisons que l’on ne réussit guère à chauffer; nous trouvons encore plusieurs tisserands, un tondeur de draps, des couturiers, un tonnelier, des barbiers, un chaudronnier, des charpentiers, un arbalétrier 1. Il y a plusieurs « cochers », qui ont l’air fort à leur aise; ce sont des entrepreneurs de transports 2. Les cahorsins, ces changeurs et banquiers italiens, ont leur casane, leur officine, sur la place du Château 3. Il y a, enfin, /108/ de très nombreux notaires, ecclésiastiques et laïques, Il y a même un bourreau, aux services duquel on a recours jusqu’à la Tour-de-Peilz 1.
Tout ce monde trafique, vend et achète, prête ou emprunte 2, sans que rien de bien saillant n’apparaisse à nos yeux dans toutes ces transactions. Moudon n’a pas d’industrie particulière et n’exporte pas de produits fabriqués. L’aisance paraît avoir été assez générale, une très modeste aisance 3, comme il /109/ convient à une petite ville, qu’on ne saurait comparer à Fribourg, à Genève ou à Berne.
Le travail, l’économie ou la chance enrichissent quelques familles et les distinguent de la masse; mais le métal précieux reste rare, et l’on thésaurise. Tel bourgeois amasse un à un les florins d’or en vue du mariage de sa fille 1; un prêtre, dans son testament, réserve à un de ses collègues deux pièces d’argent qu’il a gardées soigneusement 2; dans les familles, on conserve religieusement un ou deux gobelets d’argent; seule, une grande dame, Nicolette de Wallardens, possède un service d’argenterie et un collier de perles 3.
Les vêtements sont simples et se transmettent par testament comme des objets rares auxquels on tient : la garde-robe d’un prêtre se compose de quelques robes, d’un corset (veste ou gilet) de blaud 4, d’un corset de gris 5, d’un manteau 6; celle d’une femme de qualité, de trois ou quatre robes, dont l’une de drap vert, couleur assez prisée alors, et une autre de drap brun, ainsi que d’un manteau 7; une autre /110/ dame possède une tunique et une surtunique de velours et deux pelisses 1. Une toge de drap blanc, une chemise d’homme, quatre draps de lit sont mentionnés comme des choses de prix, et le mobilier se réduit à des lits de plume, des arches (coffres) et quelques pots de métal ou d’étain 2. Un seul testament fait allusion à des livres 3.
Quand leurs ressources s’accroissent, les bourgeois achètent des rentes foncières, ou de bonnes terres au soleil, dans la banlieue immédiate ou dans les villages voisins; ce sont les seuls placements sûrs. Au reste, ces bourgeois sont très près de la terre et la ville a conservé un caractère très rural.
Lorsqu’ils parviennent à la fortune, ils font l’acquisition de vignes à Lavaux et de grands domaines dans la vallée de la Broye; les vendeurs sont des familles féodales qui se ruinent 4, et même le baron de Vaud, dont les difficultés financières sont grandes 5. Alors ces bourgeois épousent des filles de noble famille et leurs filles redorent les blasons ternis des seigneurs d’alentour 6. Leur richesse leur /111/ permet d’accompagner à cheval, tout comme les seigneurs, le baron ou le comte, quand ils vont à la guerre. Ils leur achètent des offices 1 et pénètrent par là dans les rangs de la noblesse; à la deuxième ou à la troisième génération, ils sont appelés nobles et portent le titre de donzel.
Ainsi, par un processus régulier, la noblesse, qui n’est pas une caste fermée, tire de nouvelles forces du sol plantureux de la bourgeoisie.
Voici quelques exemples qui montreront plus clairement cette ascension :
Parmi les personnages les plus considérables de Moudon, on voyait, dans le dernier quart du XIIIe siècle, les deux frères Jaquet et Pierre de Vuippens 2; ils avaient tous deux leur sceau propre, ce qui les classe d’emblée 3. Ils étaient riches 4; /112/ mais leur famille s’éteignit à la seconde génération 1.
Nous avons déjà cité le nom de Thorenc de Gruyères 2; son crédit était tel qu’il fut un des garants de l’indemnité que Louis de Vaud s’était engagé à payer à l’évêque en 1297 3; cela ne le ruina pas; il conserve jusqu’en 1320 4 une situation en vue et ses enfants en héritent après lui 5.
Pierre Belex, châtelain de Rue 6, eut un fils, Pierre /113/ Girard, qui épousa l’héritière des Vuippens 1; celui-ci possédait deux maisons à Moudon, dans la rue du Château, des terres à Chapelle et la plus grande partie du territoire qui forme aujourd’hui la commune de Martherenges; c’était un beau domaine 2.
Vers la fin du XIIIe siècle, une famille de lombards, originaire de Verceil, s’était établie à Moudon; ils étaient devenus bourgeois de la ville 3. Leurs affaires avaient prospéré, ce qui leur avait valu des alliances distinguées 4. Au début du XIVe siècle, ils étaient deux frères que nous voyons se partager la fortune paternelle 5 : il y en a pour plusieurs centaines de livres, sans qu’il nous soit possible d’en évaluer le total. Chacun des frères a deux maisons à Moudon 6, des créances hypothécaires contre des seigneurs des environs 7, des censes foncières et des terres à Chavannes-le-Chêne, à Rovray, à Donneloye, la moitié du village de Démoret, qui vaut à elle seule 350 livres (près de 70 000 fr. en valeur actuelle) et /114/ qui comporte la moitié des droits féodaux, sauf la dîme que l’un des frères reçut en fief du Chapitre 1.
Parmi les notables on trouve, en 1305 2, un Vionnet Fabri; il était riche; sa fille épousa Jaquinod Cerjat 3; un de ses fils, Jaques, qui était prêtre, fut recteur de l’hôpital St-Jean et curé de Dommartin, puis de Curtilles 4; un autre, Rolet Vionnet, acheta du baron Louis de Vaud, en 1336 et 1338, un grand domaine de 300 poses à Chapelle avec des droits de justice 5. Le fils de Rolet, Perronet, acquit de même pour 100 livres des terres à Combremont-le-Petit; en 1358, /115/ il possédait la plus grande maison de Moudon et des biens considérables 1.
C’est à cette époque que l’on voit apparaître la famille des Cerjat 2. Le premier que nous connaissions, Jaquet, est déjà un homme fort riche : quand, de son vivant 3, il partage ses biens entre ses fils; il se réserve une rente de trente livres, ce qui représente un capital de plus de cent mille francs; ses fils, Jaquinod et Rolet, augmentent encore cette prospérité : ils achètent des dîmes et des terres aux nobles désargentés 4; /116/ ils prennent à ferme fours et moulins 1; Rolet possède deux bancs de boucherie 2; il est fermier des redevances en argent dues au seigneur 3; il remplit les fonctions de métral 4.
L’ascension de la famille de Glane est plus rapide encore 5 : dès la fin du XIIIe siècle, Luiset, fils de Rodolphe de Glane est un personnage important qui jouit de la faveur du prince, en particulier de Louis II; celui-ci lui vendit en 1328 le grand domaine de la Cerjaulaz. Luiset eut pour fils Thomas, qui accrut la fortune de sa maison; son mariage et celui de son fils avec les héritières des Villardin firent tomber entre ses mains cette seigneurie importante; un troisième mariage avec une Estavayer nous le montre l’égal des plus vieilles familles féodales.
*
* *
S’il est déjà difficile d’apprécier la fortune de ces antiques habitants de Moudon, il est plus malaisé encore de pénétrer leurs sentiments; il est impossible de les faire revivre devant nos yeux. Tout ce que nous savons d’eux provient d’actes notariés, impersonnels et impassibles; seuls leurs testaments, assez /117/ nombreux, nous laissent entrevoir un peu de leur âme.
Au moment où ils vont quitter la vie et où ils disposent de leurs biens, ils pensent à l’Eglise et aux œuvres charitables; ils se montrent généreux; de ces richesses qu’ils ne peuvent emporter dans l’au-delà, mais auxquelles ils attribuent le pouvoir de racheter leurs péchés. Leur générosité s’étend très loin : aux hôpitaux de Fribourg, de Romont, de Morges, d’Yverdon; « à chacun des hôpitaux du diocèse de Lausanne où l’on reçoit et visite les pauvres »; aux frères prêcheurs et aux frères mineurs de Lausanne; aux divers couvents du pays, et jusqu’à l’hôpital de la Vierge Marie du Puy et à celui de St-Antoine en Viennois 1, lieux de pèlerinage fort en vogue et qui envoyaient leurs collecteurs dans notre pays.
Mais les donateurs ne négligent pas pour cela les œuvres plus rapprochées : la léproserie de Lucens 2 et les hôpitaux de Moudon. Celui qui jouit de la plus grande faveur est l’hôpital neuf, fondé en 1297 par Valentine, veuve de Jaquet Allamand et son beau-frère /118/ Pierre; il était dédié à la Vierge Marie 1, comme celui de Fribourg 2, qui lui servit peut-être de modèle. Situé dans la Villeneuve, au delà du pont, entre la Broye et la rue qui mène à l’église 3, cet hôpital, largement doté déjà par ses fondateurs, est l’objet préféré de la générosité des Moudonnois, qui ne l’oublient pas dans leur testament. En 1331, par exemple, Johannod Emery 4 lui lègue son armure, qui comme tous les objets fabriqués représentait une grande valeur, une créance de 125 livres dont le sire Louis de Cossonay 5 est le débiteur, ainsi qu’une autre, dont le chiffre /119/ manque, et qui est due par le baron de Vaud; il substitue l’hôpital à ses enfants au cas où ils mourraient sans héritiers; le tout à condition que l’hôpital fournisse chaque année un repas d’une valeur de six livres 1 aux pauvres voyageurs; le surplus sera remis au prêtre qui dira la messe dans l’hôpital. Celui-ci en effet contient une chapelle où la messe peut être célébrée chaque jour; c’est une faveur qui lui a été accordée par l’évêque Jean de Rossillon, à la requête des bourgeois 2.
L’hôpital reçoit aussi des dons des gens du voisinage; il acquiert ainsi des terres et des revenus dans toute la contrée; à Ménières (Fribourg), par exemple, il possède une rente foncière 3, qui lui a été donnée par des gens coupables d’un meurtre et qui composaient par ce moyen avec les amis de leur victime.
Une autre fois, c’est le baron de Vaud lui-même qui abandonne à cette institution charitable un morceau de ses bois et qui autorise l’hôpital à établir des forestiers pour défendre son bien contre toute déprédation 4.
Cet hôpital n’était pas essentiellement destiné, comme les autres, à héberger les passants; c’était un hospice, au sens moderne du mot, qui avait pour /120/ mission de recevoir les orphelins, les malades, les pauvres et les vieillards. Aussi voyons-nous des bourgeois faire de l’hôpital leur héritier, mais en se réservant le droit d’y aller finir leurs jours 1. Certains s’engagent même à travailler pour lui 2.
De bonne heure l’hôpital fut riche; les dons qu’il reçoit dépassent les dépenses courantes et il capitalise : il prête 3; parmi ses débiteurs il compte le baron de Vaud qui, toujours à court d’argent, lui emprunte 70 livres 4, pour lesquelles il donne en gage les revenus ordinaires de Moudon. En général, l’hôpital se sert de ses ressources pour acheter des revenus en nature, des rentes foncières, des terres qui constituent de bons domaines de rapport 5; il possède même des vignes à la Côte 6.
Au cours des années qui suivent, il continue à bénéficier de la générosité des fidèles : riches et pauvres, /121/ nobles, bourgeois et petites gens, tous pensent à cette institution charitable quand vient pour eux l’heure de faire leur testament; on voit un chapelain lui donner tout son bien « à cause de la dévotion et affection qu’il nourrit depuis longtemps pour les pauvres de l’hôpital … » 1. Plus important encore est le legs du notaire Antoine de l’Étang : un capital de 200 livres dont les intérêts devaient servir, à la St-Georges et le lendemain (23 et 24 avril), à une distribution de salé et de séré, qui subsistait encore au XVIe siècle 2. Un autre donateur avait institué une distribution de drap aux pauvres 3. Un autre donne une rente en vin, à Lutry 4; une veuve lègue son propre lit 5.
Les documents nous manquent pour établir le chiffre de la fortune de l’hôpital; il est certain cependant qu’alors déjà elle est considérable.
L’hôpital est dirigé par un fonctionnaire, laïque ou ecclésiastique, qui porte le titre de recteur 6; c’est un économe : il recueille les revenus en nature et perçoit ceux en argent; il préside au ménage et veille à l’entretien des pauvres, auxquels il sert les repas prévus par les donateurs. Un des premiers que nous connaissions étant mort, sa femme continua seule ces fonctions pendant quelques années. Finalement, « ne /122/ pouvant plus suffire à sa tâche », elle se remaria; peut-être avait-elle pour cela d’autres raisons que l’acte ne donne pas. Elle épousa donc en secondes noces un bon bourgeois de Moudon, qui ne manquait pas de biens de son côté. Il vint habiter l’hôpital, à titre de recteur. Il s’engagea à rendre ses comptes deux fois par an, à placer tout l’argent liquide dès que la somme disponible dépasserait dix livres; si des personnes, ecclésiastiques ou laïques, venaient s’installer à l’hôpital pour y finir leurs jours, il devait les recevoir à sa table, ou, si cela lui était désagréable, leur fournir une chambre confortable; enfin, il prenait l’engagement de ne pas se remarier sans l’aveu de l’autorité, si sa femme venait à mourir avant lui 1. On tenait, on le voit, à avoir à l’hôpital une maîtresse de maison sur qui l’on pût compter. Les documents postérieurs nous apprennent que le recteur est nommé d’ordinaire pour trois ans; parfois c’est un ecclésiastique, plus souvent un bourgeois, et non des moindres : les noms des plus considérables, ceux des notaires les plus en vue se retrouvent sur la liste des recteurs.
L’hôpital appartenait aux bourgeois de Moudon qui déléguaient quelques hommes de confiance pour en surveiller la marche. Ces conseillers de l’hôpital 2 passaient en son nom les actes les plus importants; ils contrôlaient l’administration du recteur. Ils sont /123/ généralement trois ou quatre, plus tard cinq, et ce ne sont pas les premiers venus : en 1306, c’est Emery Mestral, châtelain de Morges, Guillaume d’Albeuve et Jean le Torchy 1; dès 1333 ce sont Ant. de Vulliens l’aîné, chevalier, le donzel Girard de Vulliens et Jean de Verceil; le notaire Perrod Arma se joint à eux de 1336 à 1338 et, à partir de 1341, Thomas de Glane remplace Girard de Vulliens. C’est une fonction à laquelle sont appelés les personnages les plus notables et qu’ils conservent en général jusqu’à leur mort.
C’est devant cette autorité que, arrivé au terme de son mandat, le recteur rend ses comptes. Il arrive que l’institution redoive à son gérant 2; mais le plus souvent, les revenus de l’hôpital dépassent ses dépenses et le recteur reste redevable de sommes qui peuvent être assez fortes et qu’il a de la peine à restituer 3. Il arrivait même que le recteur eût distrait et mis en gage à son profit des objets mobiliers /124/ appartenant à l’hôpital : une grande chaudière et deux poêles de cuivre, trois pots de métal, une hache 1.
D’autres institutions charitables bénéficiaient de la générosité des Moudonnois; ainsi les Confréries du Saint-Esprit. C’est le nom que l’on donnait à une sorte de société de bienfaisance que l’on retrouve dans la plupart de nos communes vaudoises 2 et à Fribourg 3. A Moudon, il y en avait deux, celle du Bourg et celle des Borgeaux. La première était sans doute la plus ancienne et remontait aux temps primitifs de la ville; lorsque celle-ci s’était agrandie, les habitants des nouveaux quartiers avaient tenu à avoir aussi la leur; peut-être y avaient-ils été forcés par l’exclusivisme des anciens bourgeois.
On entrait dans la confrérie en souscrivant une rente perpétuelle en sa faveur 4. Des dons et des legs assez nombreux accroissaient sa fortune 5; ces derniers comportaient l’obligation de servir aux pauvres des repas et distributions de vivres, le lundi de Pentecôte.
Les fidèles de Moudon font aussi des dons aux églises de la ville et aux prêtres qui les desservent. Il est rare que le curé de Moudon, ou, quand il ne réside pas, /125/ son vicaire ne reçoive pas des testateurs quelque legs en argent; dans leurs dernières dispositions, ceux-ci assurent aux chapelains et aux prêtres, quels qu’ils soient, qui assisteront à leurs funérailles une somme d’argent ou un repas 1.
Lorsqu’un bourgeois est suffisamment riche, il fonde un autel ou une chapelle; il verse pour cela une somme en capital, ou, plus souvent, il s’engage pour lui et ses successeurs à payer une rente à l’Eglise; en retour, une messe sera dite à cet autel pour le repos de son âme et celles des membres de sa famille; d’autres fondations viennent s’ajouter aux premières et les ressources des chapelles s’accroissent ainsi. Certains autels sont entretenus par des collectivités, qui s’appellent aussi des confréries.
Les revenus des chapelles servent à l’entretien matériel de celles-ci 2 et pourvoient aux besoins du culte; mais la plus grosse part sert à assurer au chapelain un traitement suffisant. Souvent le donateur le désigne et réserve à ses hoirs le droit de les désigner.
C’est ainsi qu’en 1335 le notaire Perrod Arma et Jaquet Cerjat fondent un autel en l’honneur de saint Georges dans l’église Notre-Dame, au Château, et le dotent de cinq livres de rente chacun pour une messe quotidienne; ils se réservent le droit d’y être ensevelis et désignent un fils de Perrod Arma comme chapelain 3.
En 1340, c’est un prêtre et un bourgeois qui versent /126/ un capital, l’un de 35, l’autre de 55 livres, auquel ils ajoutent quelques petites rentes pour fonder dans l’église St-Etienne un autel en l’honneur de la Vierge et de sainte Marie-Madeleine 1. En 1345, c’est Jaques et Rolet Vionnet qui fondent dans la même église une chapelle en l’honneur de saint Jaques 2. En 1349, Guillaume de Gruyères 3 dote largement un autel qui est placé au pilier où l’on met l’eau bénite 4. A la même époque, la famille Salamin fondait un autel en l’honneur de sainte Catherine 5.
Dans l’église Notre-Dame, le donzel Guillaume de Vulliens fonde, en 1357, pour le repos de son âme et de celle de sa femme Marguerite, une chapelle en l’honneur de saint André, de la Vierge et de tous les saints 6. Le donateur se réserve le droit de s’y faire /127/ ensevelir; il lui assure un revenu de dix livres, assigné sur ses biens de Ropraz; une messe journalière y sera célébrée 1.
Il y avait encore dans cette église un autel dédié à saint Antoine 2 et un autre dédié à saint Pierre, sur lequel se disait une messe de requiem, fondée par Jaquinod Cerjat et Jeannette Fabri 3.
En 1347, nous trouvons une confrérie de saint Nicolas 4, deux ans plus tard, une confrérie de la Conception de la Vierge Marie 5, attachées aux autels de ces noms.
C’est aussi une confrérie qui avait la charge de la pittoresque chapelle de saint Eloi, qui faisait saillie sur le pont de Moudon; elle avait été fondée en 1356 par la ville, semble-t-il 6. /128/
On le voit : les bourgeois de Moudon étaient généreux, envers l’Eglise; les familles les plus riches rivalisaient de fondations pieuses. Il est impossible d’évaluer le total des sommes ainsi distribuées et d’apprécier la part de la fortune privée qui passait entre les mains du clergé. Notre impression est que cela faisait un chiffre très élevé.
D’autres se donnent eux-mêmes à l’Eglise et, quittant le monde, entrent en religion : une fille de Pierre Mestral, après avoir donné tous ses biens au couvent de Montheron, entra au couvent de Bellevaux 1. Le fils d’une famille importante, Jean, fils de Girard du Chaffa, devint moine à Montheron 2 où l’on avait déjà vu au siècle précédent un Guillaume d’Albeuve, bourgeois de Moudon, et Pierre, des nobles de Vulliens 3; un Thorenc de Gruyères fut moine à Haut-Crêt; il devint même abbé de cette maison 4. Un autre Moudonnois, de famille riche, fut dominicain à Lausanne et professeur de droit à l’école épiscopale 5.
Deux autres furent moines à Lutry; tous deux étaient nobles; l’un s’appelait Pierre Escot; l’autre, Humbert de Donneloye, était le fils unique du vidomne Ottonin 6. /129/
Nous connaissons le nom d’une béguine : Lausonnette de Bevouges; elle n’avait pas quitté le monde, elle continuait à vivre au milieu de lui, mais elle s’était imposé cette claustration morale, cette obligation de faire du bien autour d’elle qui caractérisent ces pieuses femmes. Le clergé de Moudon hérita de ses biens 1.
Des mœurs des hommes de ce temps nous ne savons pas grand’chose : ils n’étaient probablement ni pires ni meilleurs que nous; il leur arrivait de se repentir et de restituer par testament aux hoirs d’un défunt ce qu’ils avaient injustement gagné en traitant avec lui autrefois 2, ce qui est un scrupule rare. Ils avaient des bâtards; ils les avouaient ingénument et les entretenaient 3. Nous possédons encore le testament par lequel un homme recommande sa bâtarde à sa veuve 4, et, chose plus extraordinaire encore, nous apprenons par le testament de celle-ci qu’elle fit de cette enfant son héritière 5.
Au reste, une circonstance grave allait mettre à /130/ l’épreuve les sentiments religieux de la population : la peste. Cette terrible maladie ravagea l’Europe à partir de 1347; elle dura six ans et fit des millions de victimes 1. En Savoie, elle fit son apparition en août 1348 et elle sévit jusqu’au mois de novembre 2. A Moudon dès le milieu de l’année les testaments se multiplient; ils deviennent très abondants vers la fin de l’hiver de l’année 1349, si bien qu’il y en a plusieurs par jour 3, ce qui doit coïncider avec la période la plus grave de l’épidémie. Celle-ci n’était pas encore terminée en avril, puisque, à cette date, un bourgeois qui laisse tous ses biens à l’hôpital réserve un legs de dix livres à ses cousins, à moins qu’« ils ne meurent de cette peste 4 ».
Tous ceux qui firent leur testament en ces jours d’angoisse ne succombèrent pas à la peste, car nous retrouvons leur nom plus tard, mais beaucoup furent atteints 5; des familles entières disparurent; la ville fut en partie dépeuplée. Dix ans après, on cite encore des foules et battoirs sur la Mérine qui, abandonnés alors, n’avaient pas été repris et tombaient en ruine 6. Cette seule indication suffit pour nous faire comprendre l’étendue du désastre. /131/
Les institutions religieuses seules en profitèrent. Voyant venir la mort, les hommes se montrèrent plus généreux que jamais; les biens des familles qui s’éteignirent passèrent à l’hôpital, que depuis longtemps il était d’usage de substituer à ses héritiers légitimes. Sa fortune s’accrut ainsi dans des proportions considérables 1.
*
* *
Au cours de la première moitié du XIVe siècle, Moudon a vu se produire une évolution importante : la ville a acquis une administration municipale.
Nous avons vu qu’au XIIIe siècle Moudon, pas plus que Lausanne du reste, n’était une commune, au sens propre de ce terme 2. Quand, en 1297, les gens de Moudon écrivent aux Fribourgeois la lettre que nous avons reproduite plus haut 3, ils agissent comme des particuliers qui passent un acte : ils requièrent l’office d’un notaire et font sceller leur missive par le curé et deux bourgeois de marque.
On sait que la possession d’un sceau est un signe de l’autonomie communale; Moudon n’en a pas encore, pas plus que de magistrats.
Cet état de choses se maintient pendant la première moitié du XIVe siècle. Lorsqu’il s’agit de passer un acte, — qu’il intéresse ou non l’ensemble des /132/ habitants — on a recours au sceau d’un particulier 1, souvent à celui d’un membre de ces familles nobles qui habitent la ville 2, ou à celui d’un ecclesiastique 3.
Pour défendre les intérêts de la ville, on forme, chaque fois que le besoin s’en fait sentir, des délégations occasionnelles, formées de bourgeois influents, de prud’hommes, qui représentent la communauté. Comment étaient-ils choisis ? Nous ne le savons pas. Peu importe, du reste; les questions électorales ne se posaient pas; les fonctions étaient des charges, que briguaient seuls ceux qui les pouvaient remplir. Elles étaient données par un procédé analogue à celui que l’on emploie aujourd’hui dans nos villes quand il s’agit d’organiser une fête ou une exposition : on n’a pas recours au suffrage universel, ni à une élection en forme; pour peu que l’opinion publique ne soit pas irrémédiablement divisée, les petites rivalités se taisent et les hommes compétents sont désignés d’un commun accord.
Les choses ne se passaient pas autrement alors : en 1311, quand on signe une prolongation de trêve avec les gens de l’évêque et les Fribourgeois 4, c’est Perrod d’Illens, donzel, qui représente Moudon, assisté d’un donzel de Vulliens, de Pierre de Vuippens et /133/ de Thorenc de Gruyères, que nous connaissons déjà, ainsi que de Jeannod de Gruyères, le frère de ce dernier probablement.
Trente ans plus tard, c’est une délégation de sept bourgeois qui va à Morges pour approuver le règlement de la succession de Louis de Vaud. Elle est présidée par le chevalier Antoine de Vulliens qu’accompagnent Thomas de Glane, Jean de Verceil, Conon et Jean Salamin, Rolet Vionnet et Jaques Thorein 1, un fils probablement de Thorenc de Gruyères. Ce sont tous des gens considérables dont nous avons déjà cité les noms. Ce ne sont pas des magistrats.
Et pourtant la communauté existe, quoiqu’elle n’ait pas d’organes politiques réguliers; elle vit et elle possède; la ville a des murailles qu’il faut entretenir, des bois dont il faut répartir les produits suivant les besoins, des pâquis qu’il faut utiliser. Il est indispensable que les bourgeois s’assemblent parfois pour discuter de la gestion des biens communs. Qui les convoque et qui les préside ? Ils ont des privilèges financiers, judiciaires et politiques qu’il faut défendre et développer. Qui en a la charge ?
Dans bien des villes, on le sait, ce furent les chefs des groupements professionnels, les syndics et les conseils des corporations qui prirent soin des intérêts communs avant que la commune eût des magistrats et qui, plus tard, furent les cadres des premières autorités municipales. Ce phénomène ne se produisit pas à Moudon; nous n’y avons trouvé aucune trace de corporations. La ville fut toujours trop petite, elle /134/ n’eut jamais d’industrie assez importante pour que des organismes de cette sorte aient pu s’y développer.
Ailleurs, ce sont des institutions religieuses, les confréries, qui ont groupé les bourgeois et ont préparé l’apparition des administrations communales; c’est le cas à Lausanne, par exemple 1. Les confréries du Saint-Esprit n’ont pas joué le même rôle à Moudon.
La ville possédait cependant une œuvre charitable à laquelle tous s’intéressaient : c’était l’hôpital des pauvres, dédié à la Vierge. Or, voici ce que nous constatons : ces conseillers ou ces procureurs de l’hôpital, dont nous avons parlé plus haut 2, ce sont précisément les mêmes hommes que ceux que la ville envoie traiter en son nom avec ses voisins ou avec son seigneur, à Fribourg ou à Morges. Ces fonctions à la tête de l’hôpital étaient permanentes, avons-nous vu; les missions politiques étaient temporaires. Nous en pouvons conclure que c’est au sein de la commission chargée de surveiller la marche de l’hôpital que se sont formés les premiers magistrats de Moudon; c’est là qu’ils ont appris à administrer les affaires de la communauté et gagné la confiance de leurs combourgeois; leur tâche a petit à petit dépassé les limites étroites d’une maison charitable; elle s’est étendue à toutes les questions d’utilité publique qui intéressaient les bourgeois; elle a fini par embrasser toutes celles qui se posaient devant leur intelligence ou leur ambition. Ainsi, lorsque la nécessité s’en est fait sentir, la ville a trouvé /135/ en la personne de ces conseillers des hommes qui possédaient à la fois l’expérience et l’autorité.
Voici une preuve encore qui vient à l’appui de cette hypothèse : l’hôpital a été jusqu’au milieu du XVIe siècle l’Hôtel de Ville de Moudon 1. Les intérêts de cette institution étaient alors si intimement unis à ceux de la commune que c’est à l’hôpital que se réunissait toujours le Conseil de la ville. Cela est bien naturel puisqu’il était primitivement le Conseil de l’hôpital.
Le passage de l’un à l’autre s’est fait insensiblement, au milieu du XIVe siècle : En 1356, nous voyons le bailli de Vaud accorder à un particulier le droit de tenir un étal de boucherie à la Bâtie, de l’avis de plusieurs notables; ceux-ci sont au nombre de douze, parmi lesquels nous trouvons quatre membres de la famille de Vulliens, Thomas de Glane, les deux frères de Verceil, Jaquinod Cerjat, etc. 2; l’année suivante, une concession analogue est donnée, de l’avis du Conseil de Moudon 3.
Ainsi, l’évolution est terminée : à la place de notables, pris dans le Conseil de l’hôpital et parmi les bourgeois de marque, il y a maintenant un Conseil régulier et permanent pour la ville elle-même. Nous ne savons ni combien de membres il possédait, ni comment il était élu 4. C’est lui qui est, auprès du /136/ bailli, l’interprète de l’opinion des bourgeois, qui l’assiste dans les cas où la charte l’exige, qui défend devant lui les intérêts, les libertés et les franchises de la ville.
On ne voit pas apparaître, au sein du Conseil ou à côté de lui, de magistrat prépondérant, bourgmestre ou avoyer. Peut-être la chose était-elle rendue impossible par la présence à Moudon du bailli et du châtelain savoyards; occupant déjà la place, ils eussent difficilement supporté à côté d’eux la présence d’un homme dont l’autorité eût pu porter ombrage à la leur. Il est possible aussi que les rivalités locales, qui sont si puissantes dans les petites villes, aient empêché la création d’une charge qui aurait suscité trop de jalousies.
Parfois, nous voyons mentionnés des syndics ou procureurs; ce ne sont pas les chefs de l’administration urbaine, mais bien de simples agents de l’autorité, des fondés de pouvoirs auxquels, pour une circonstance précise, ou pour un temps fort court, le Conseil a remis le soin de régler une affaire, d’ordre financier en général. Ces missions temporaires sont d’ordinaire confiées à des notaires; ce sont des fonctions subalternes.
*
* *
Au cours de l’automne de l’année 1358, le comte de Namur fit procéder à l’enregistrement de ses droits. Les habitants vinrent, l’un après l’autre, déclarer devant un notaire le détail de leurs biens et des redevances qu’ils devaient au seigneur 1. Ce terrier, /137/ cadastre et registre d’impôt, servait, entre autres, à dresser les comptes annuels de la châtellenie. Nous possédons encore ce livre précieux, en parchemin et d’une fort belle écriture. En le parcourant, nous pouvons nous rendre compte à peu près de l’aspect que présentait alors Moudon 1.
Il y a à cette époque plus de 216 maisons 2; les unes sont très petites et ne se composent que d’une pièce 3. Ce sont de pauvres masures, telles qu’on n’en voit plus dans le plus misérable de nos villages. La plupart sont très étroites : serrées les unes contre les autres, elles présentent des façades de quatre à six mètres 4. Elles sont en bois, et d’une médiocre valeur; elles ne peuvent loger qu’une famille.
Seuls quelques riches bourgeois et quelques nobles seigneurs possèdent des maisons en pierre 5.
Cependant, l’aisance que nous avons vu naître, favorise la construction de maisons plus spacieuses 6. /138/
De temps en temps, un espace non bâti (chesal), souvent sur la place occupée jadis par un bâtiment, détruit par un accident ou démoli par son propriétaire qui voulait se donner un peu de place; parfois de petits jardins 1; mais de toutes parts on est serré et, si l’on veut plus d’espace, il faut sortir de la ville, aux abords immédiats de laquelle on trouve des granges, ou fermes, quelques vergers et un assez grand nombre de chenevières (oches) et de plantages.
L’impôt foncier, ou cense, payé pour ces terrains à destination rurale, est plus élevé que celui payé pour les bâtiments sis en ville, ce qui pourrait nous étonner au premier abord; cela s’explique fort bien quand on songe à la minime surface occupée par ces derniers 2. Sur un total un peu supérieur à vingt-huit livres, la moitié à peine provient des biens-fonds situés à l’intérieur des murs, quoiqu’ils soient beaucoup plus nombreux 3.
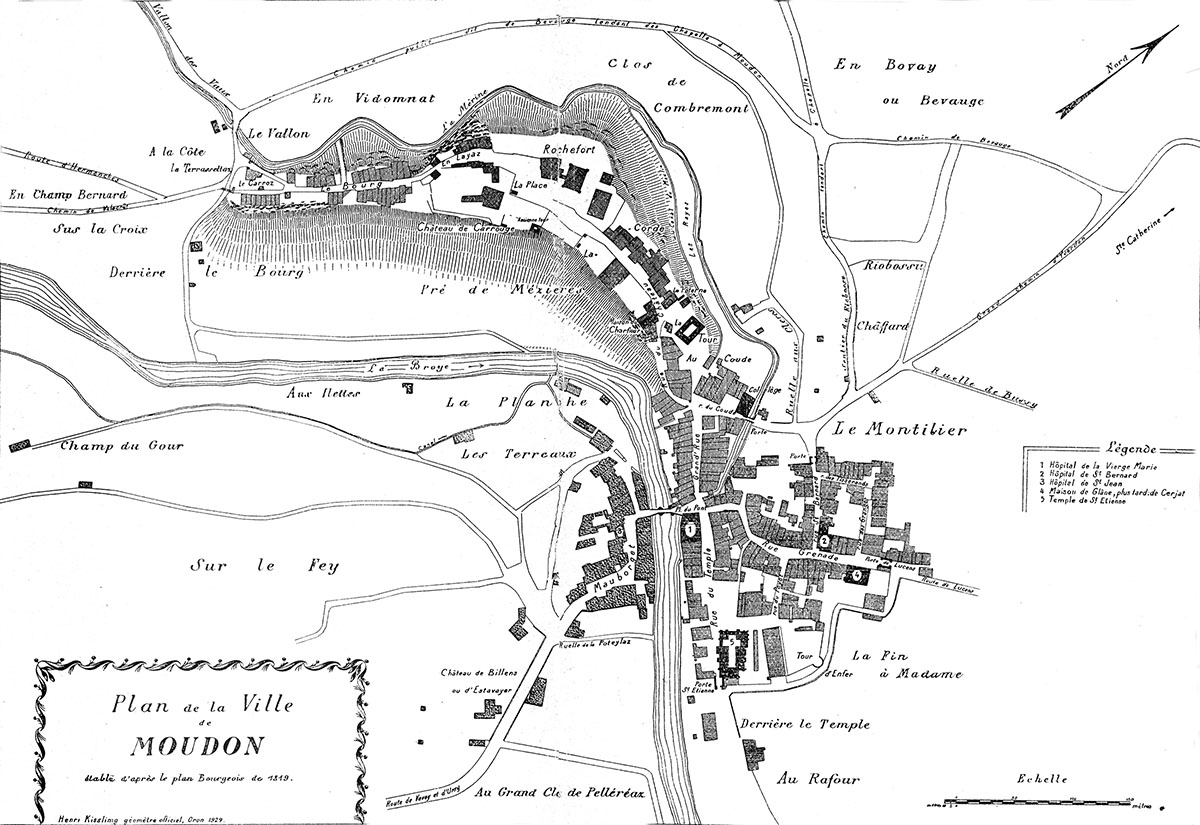
Pl. VI : Plan de la ville de Moudon
Cliquez 2X sur l’image pour une vue agrandie
Le voyageur qui arrivait de Lausanne n’entrait pas à Moudon, comme aujourd’hui, par la rive droite de la Broye et le pont St-Eloi. La route ordinaire, arrivée au pied des collines du Jorat, ne franchissait /139/ pas la Broye à Bressonnaz, où il n’y avait pas de pont 1. Cette rivière qui n’était pas encore endiguée, serpentait librement dans la plaine, où son lit capricieux formait des « îles » 2; la route, pour rester sur du terrain solide, longeait la côte, passait tout près du domaine de Valacrêt 3, puis, à l’entrée même de la ville, rejoignait le chemin qui vient d’Hermenches 4 et de Belflory 5.
C’était la route d’Echallens et aussi celle de Morges 6, par Dommartin et Cheseaux 7. Elle était très fréquentée; c’était par là que passaient les marchandises que l’on transportait à Genève, les draps de Fribourg, par exemple 8. Morges était le port où l’on s’embarquait pour passer le lac. Peut-être le trafic était-il plus intense sur cette route que sur celle de Lausanne : Morges appartenait au même prince que Moudon; ce n’était pas le cas de Lausanne. /140/
Au bord du chemin, une grande croix qui avait donné son nom à une sorte de faubourg. Celui-ci ne paraît pas avoir été clos de murs; un fossé le protégeait 1. Il n’y avait là que quelques maisons, bien petites, une grange, une chenevière 2.
On entrait en ville par le Vieux-Bourg; ce quartier, qui se compose d’une seule rue, formait presque une ville à part : il avait ses murs, sa tour, son four 3, sa fontaine et, à chacune des extrémités, une porte avec pont-levis 4. Un fonctionnaire spécial tenait du comte la charge de garder ces portes 5. Les maisons, dont la surface ne doit guère avoir changé depuis lors, sont de dimensions moyennes pour l’époque; elles ont de six à neuf mètres de façade; l’une a même douze mètres, ce qui est énorme. Du côté de la Broye, il y a une trentaine de maisons, la plupart avec jardin et chenevière descendant sur les flancs de la colline jusqu’aux fossés de la ville et à la Broye; du côté /141/ nord, il y a vingt-cinq maisons environ, avec jardins sur la Mérine 1.
Une porte conduisait du Bourg dans la vieille ville, au Château. La rue par laquelle on y accède s’appelait en Laya; elle n’avait qu’une douzaine de maisons, toutes du côté de la Mérine. A sa droite, on avait les jardins des seigneurs de Vulliens, aujourd’hui ceux de l’Institut des sourds-muets.
La Place — on ne la désigne pas autrement alors — est le centre de la vie moudonnoise et le quartier aristocratique. Au milieu un grand crucifix 2. A droite, les maisons des seigneurs de Vulliens 3; de l’autre côté celles du vidomne 4; une fontaine fournit aux habitants de l’eau potable 5; l’église Notre-Dame les invite à faire leurs dévotions. C’est là, dans cette église et sur cette place si déserte aujourd’hui, que se passent les cérémonies officielles, telles que la prestation du serment du seigneur, de ses baillis et de ses sujets 6. On y voyait encore plusieurs maisons en pierre appartenant à de riches bourgeois 7. C’est là /142/ que se tenait le marché, dans une halle qui y avait été bâtie à cet effet; une partie de la place s’appelait la Place de la Mercerie 1. Ce nom indique que le commerce de la ville s’y concentrait. C’est là aussi qu’habitaient les banquiers lombards ou cahorsins 2.
Ensuite vient la rue du Château, maintenant la Corde; c’est aussi un quartier élégant. Les maisons sont assez grandes; elles sont habitées par les bourgeois les plus distingués : les Verceil, les Arma, les Salamine, les deux frères Cerjat, Pierre Girard, le notaire Perrod de Syens, les donzels de Combremont, les filles du donzel de Bottens, etc. 3.
A l’extrémité de la rue, on voyait le château proprement dit, qui a complètement disparu, au point qu’on ne saurait aujourd’hui fixer son emplacement avec certitude.
Pierre de Savoie, avons-nous vu 4, n’avait pas de château à Moudon, où il ne résida jamais. Il semble que l’on ait commencé à en bâtir un, ou tout au moins que l’on y ait songé, vers la fin de son règne ou au début de celui de son frère Philippe : un acte de 1274 /143/ fait allusion à des charrois qui pourraient être exigés des gens de Peney-le-Jorat pour la construction d’un château à Moudon 1.
Il s’agissait, pouvons-nous supposer, de procurer une demeure au bailli de Vaud. A côté de la Tour, que l’on maintint comme donjon, on construisit un corps de bâtiment destiné au logement de ce haut fonctionnaire. Nous devons nous représenter cette bâtisse comme très modeste et peu luxueuse : les barons de Vaud n’en ont jamais fait une de leurs résidences.
C’est en 1341 que, pour la première fois, nous voyons mentionné le château de Moudon 2; en 1356, il contenait, entre autres pièces, une grande salle et une chambre réservée au prince 3. Il nous paraît qu’il était situé un peu à l’ouest de la Tour, à laquelle il n’était pas attenant; les substructions allaient jusqu’à la Mérine que franchissait un pont-levis; la poterne actuelle pourrait en être le dernier vestige.
La rue qui descend, et que l’on appelle aujourd’hui la rue du Château, portait alors le nom de rue du /144/ Charfiour 1. Fort courte, elle ne contenait que cinq maisons; elle était fermée par deux portes.
Faisait-elle partie de la ville ancienne ? Nous ne le savons pas. Il semble probable que, primitivement, cet emplacement, entre le pied de la Tour et les fossés que formaient la Broye et un bief de la Mérine, ne contenait pas de constructions; c’était une sorte d’avant-cour, dont la défense devait pouvoir disposer librement. A la rigueur aurait-on pu y élever quelques bicoques de peu de valeur, que l’on pouvait détruire au premier danger. Cela expliquerait pourquoi il n’y avait là, au XIVe siècle, que des maisons modestes et peu nombreuses. C’est la rue que l’on appelle aussi le Rotto-Borgeau 2.
Lorsqu’on avait franchi la porte inférieure de la rue du Charfiour, on arrivait dans la partie récente de la ville, et tout d’abord aux Borgeaux sous la Tour, c’est aujourd’hui le Coude. Cette rue contient une quinzaine de maisons, la plupart larges et vastes; celle de Perronet Vionnet a vingt-quatre mètres de façade 3; c’est la plus grande de Moudon. On trouve /145/ là aussi la maison de Jaquerod le mège, de Jeannet Serragin 1, d’André Estoppey, qui sont tous de riches bourgeois. Devant plus d’une maison, des banques ou étals, où l’on vend de la viande; aussi le quartier est-il parfois appelé le Mazel.
Les Plans Borgeaux (Grand’rue) sont un quartier plus vaste et plus peuplé; outre des moulins sur le bief de la Mérine et sur la Mérine elle-même, on y trouve un four et une boucherie, des étuves ou bains, appartenant au seigneur. Cette rue se terminait par une porte qui date du temps où la ville ne s’étendait pas au delà; elle aboutit au pont de la Broye, sur lequel il y a une fontaine 2.
Celui-ci, qui est bordé de boutiques 3, mène au quartier du Mauborget; c’est encore un vrai faubourg qui ne contient qu’une dizaine de maisons, très modestes; une boucherie s’y installe en 1357 4. La plus grande partie du terrain appartient à l’hôpital St-Jean et ne dépend pas du comte. C’est par là qu’arrive la route de Rue et de Vevey 5. /146/
Sur la rive gauche de la Broye : la Villeneuve ou la Bâtie, la partie la plus récente de Moudon 1. On y distingue trois rues : l’une se dirige vers l’église St-Etienne où elle se termine par une porte, la seule qui existe encore aujourd’hui. Autour de l’église, le cimetière 2. Une autre rue, qui n’est autre que la route de Thierrens, conduit au Montellier où il y a aussi une porte 3; la troisième, la rue Grenade actuelle, aboutit à la porte de Lucens 4. Le quartier n’est pas complètement bâti 5; il y a plusieurs granges et quelque peu de rural, l’hôpital du St-Bernard occupe une grande partie du terrain disponible. Le nombre des maisons habitées est faible. Mais on voit que le quartier se développe : il a sa fontaine et son four 6; des boucheries s’y installent 7 et la valeur des maisons s’élève. /147/
Hors des murs, on trouvait des chenevières, des vergers et des jardins (ceux-ci surtout au Montellier), ainsi que des plantages. Tous étaient clos, car, pendant la plus grande partie de l’année, le bétail des bourgeois pâturait sur les pâquis communs, qui s’étendaient jusque sur les bords marécageux de la Broye, et même sur les champs des particuliers qui étaient livrés au parcours dès la récolte.
Il y avait même quelques vignes, par exemple en Bevouges 1 au-dessus du Montellier. Le dernier baron de Vaud n’avait pas craint d’acheter du terrain pour y planter de la vigne afin que le domaine du château produisît aussi son vin 2. Mais le climat, défavorable, n’encourageait pas ces tentatives et, plus sages, les bourgeois de Moudon préféraient posséder de bonnes vignes à Lavaux ou à la Côte 3.
Enfin, les plus riches d’entre eux avaient dans la banlieue immédiate des fermes, que l’on appelait des granges.
Les cours d’eau appartenaient au prince : il affermait les forces motrices qu’ils pouvaient produire. /148/
Un bief, dérivé de la Broye, faisait tourner quelques roues au Mauborget 1; mais ce n’est, semble-t-il, qu’à la fin du siècle qu’on l’utilisa; on redoutait l’irrégularité du débit et la faible pente de cette rivière. La Mérine, avec son cours rapide, se prêtait mieux à des utilisations industrielles. Déjà dans le vallon des Vaux, il y avait des foules à drap et des battoirs à chanvre 2; plus bas, à l’entrée de la ville, des tanneries 3; plus bas encore, derrière le Château et au pied de la Tour, un bief faisait tourner plusieurs moulins qui appartenaient au comte 4; des particuliers en possédaient aussi 5; leur nombre s’accrut à la fin du siècle par de nouvelles constructions sous le Rotto-Borgeau 6.
Le seigneur tirait profit de tout cela 7; il donnait ces usines à bail, à long terme, en laissant au locataire le soin d’entretenir les machines 8; certains d’entre eux /149/ s’engageaient même à construire celles-ci à leurs frais, pourvu que le comte leur permît de prendre le bois dans ses forêts 1. Ce fut le cas surtout dans la seconde moitié du XIVe siècle, quand il fallut rétablir entièrement beaucoup d’installations abandonnées lors de la peste de 1349 et tombées en ruine depuis 2.
Plus loin, quelques chapelles isolées 3, et, sur le chemin de Bussy, les Fourches 4, c’est-à-dire le gibet.
*
* *
Combien y avait-il d’habitants à Moudon ? Nous manquons de données précises sur ce sujet. Nous en sommes réduits à des calculs approximatifs. En 1358, 195 personnes reconnaissent tenir à Moudon des biens mouvant du comte de Namur; si nous comptons une moyenne de six à sept personnes par famille, cela fait environ 1300 habitants. Nous arrivons au même résultat, si nous comptons 220 maisons à six personnes par maison. Quoiqu’il y ait quelques lacunes dans le document 5 qui sert de base à ces calculs, il semble impossible de dépasser ce chiffre qui nous paraît un maximum. Il est peu probable que le XIVe /150/ siècle ait été une période d’accroissement rapide comme le XIIIe l’avait été 1.
La ville à laquelle la présence du bailli de Vaud, le plus haut fonctionnaire savoyard au nord du lac, donnait pourtant un certain lustre, était petite et n’avait rien d’une capitale 2.

Sceau de Thorenc, abbé de Haut-crêt
1361.
/151/
CHAPITRE X
LE REGNE DU COMTE VERT
Le pays de Vaud, avons-nous vu 1, était rentré en la possession de la maison régnante de Savoie; événement important de notre histoire, car, si notre pays était resté aux comtes de Namur, il aurait fini, probablement, par tomber entre les mains des ducs de Bourgogne, ce qui aurait changé bien des choses.
Sitôt le contrat de vente passé, Amédée VI se mit en route pour visiter les terres qu’il venait d’acquérir. Le 14 juillet 1359, il était à Morges, où il recevait le serment des châtelains de la plupart des villes vaudoises et l’hommage d’un grand nombre de vassaux 2. Parmi eux se trouvait Thomas de Glane, qui se joignit, sans doute, à la délégation des bourgeois de Moudon, venus pour demander à leur nouveau prince la confirmation de leurs franchises; cette confirmation leur fut accordée, le même jour, à Morges, en même temps qu’à plusieurs autres villes du pays 3.
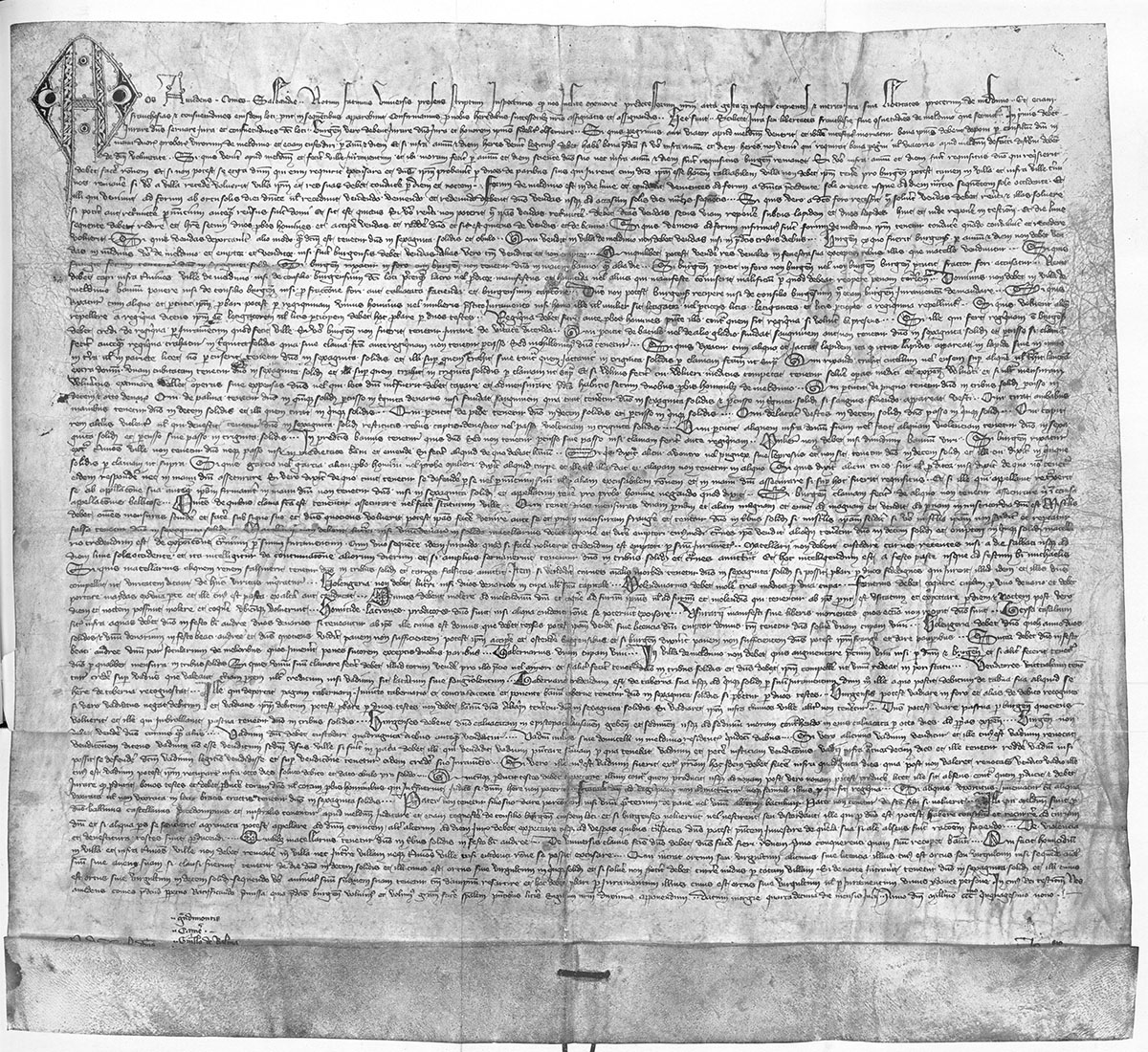
Pl. IV : Charte de Moudon. Confirmation par Amédée VI, en date du 14 juillet 1359
Photographie de l’original déposé aux Archives de Moudon.
Cliquez 2X sur l’image pour une vue agrandie
Le lendemain, le Comte Vert vint à Moudon, où il /152/ fut fort bien reçu : la ville fournit 100 florins pour son entretien et celui de sa suite 1. D’autres vassaux se présentèrent pour prêter hommage, en particulier les bourgeois de Moudon qui tenaient des fiefs du comte; celui-ci semble y avoir passé la nuit du 15 au 16, au château probablement; le 16 au matin, il continuait son voyage sur Romont.
Les contemporains s’aperçurent à peine qu’ils avaient changé de maître. Du temps du baron Louis II, les rapports avec la Savoie avaient été très étroits; sous le règne des dames de Vaud, l’influence savoyarde avait été prédominante et elle l’était restée sous Guillaume de Namur. Quoique jeune encore, le Comte Vert avait cet ascendant que donnent à un prince une volonté forte et une décision prompte.
En 1352, — il venait d’avoir dix-huit ans puisqu’il était né le 4 janvier 1334 2, — il fit deux campagnes contre les Valaisans qu’il battit les deux fois 3. Les troupes des communes vaudoises avaient pris part à ces deux expéditions 4 auxquelles le comte avait convoqué ses vassaux et ses rière-vassaux. La seconde fut l’occasion d’un arrangement entre les dames de Vaud et les communautés; les premières reconnaissaient, et faisaient reconnaître par le comte Amédée, que leurs gens n’étaient pas tenus de marcher /153/ dans ces circonstances et qu’ils le faisaient de leur plein gré 1.
L’année suivante, Amédée VI fit la conquête du Pays de Gex; l’opération la plus importante fut le siège du château de Gex, à la fin d’octobre 1353. Le comte avait fait venir les milices de Vaud, 2570 hommes et 160 chevaux, ainsi que de lourdes machines de guerre, qui avaient été fabriquées et étaient manœuvrées par des habitants du Pays de Vaud et même de Moudon 2. L’un d’entre eux, maître Jaques l’ingénieur, est un spécialiste fort apprécié; entré au service de Louis de Vaud, il avait été installé par lui à Moudon 3, où il touchait du prince une pension /154/ régulière 1; en retour, il s’était engagé à ne servir de son art que son seul seigneur.
En 1355, c’est à la conquête du Faucigny que le comte appela les soldats de son vassal, le comte de Namur; les milices des communes vaudoises prirent part à deux campagnes 2, l’une en mars, l’autre en juin; la première fois, la châtellenie de Moudon fournit 120 fantassins 3, la seconde 400 4.
En 1356, en septembre et en octobre, le bailli savoyard du Chablais requit à deux reprises l’aide du bailli de Moudon pour expulser de Payerne le prieur Pierre Mestral. Les deux fois, une quarantaine de bourgeois de Moudon, nobles et roturiers, accompagnèrent à cheval leur bailli pour soutenir l’autorité du prince 5.
Ainsi, quand le Comte Vert acquit le Pays de Vaud, il n’était pas un inconnu pour ses nouveaux sujets et il trouvait parmi eux des soldats dont il avait pu, à plus d’une reprise, apprécier les services.
Il put les employer pour empêcher l’invasion des Grandes Compagnies. Des bandes de soldats, inoccupés depuis le traité de Brétigni (1360), infestaient la /155/ France de l’Est; il était à redouter qu’elles ne pénétrassent dans notre pays. Aussi, quand le pape qui résidait alors à Avignon, prêcha contre elles la croisade 1, ni le curé de Moudon 2, ni les hôpitaux de St-Jean et du St-Bernard 3 ne firent de difficultés pour verser leur contribution à la collecte qu’il avait ordonnée à cet effet (1361).
Dans le courant de l’automne de la même année, on craignit une attaque de ces routiers contre la Bresse. Les délégués de communautés du Pays de Vaud se réunirent à Morges 4 et accordèrent au comte une chevauchée, soit la faculté de convoquer les milices vaudoises. Le bailli du Chablais se hâta de se rendre à Moudon pour y lever le contingent; mais des nouvelles rassurantes, reçues en novembre, permirent de renoncer, pour le moment, à l’expédition projetée 5. Pendant le mois d’octobre, une autre bande avait menacé le Pays de Vaud lui-même; les députés des communautés se rassemblèrent à nouveau; des mesures militaires furent prises; quelques routiers furent saisis et exécutés à Montagny 6.
A Moudon on eut peur, sans doute; on sentit le besoin de se mettre sur ses gardes et l’on se prépara à résister à ces brigands. La ville était insuffisamment /156/ défendue 1 par des murs qui dataient d’un siècle. Pour améliorer son système de défense, elle avait besoin de ressources financières. Le 19 mai 1362, elle obtenait du comte le longuel du vin, c’est-à-dire le droit de percevoir une redevance sur la vente du vin à Moudon et dans toute la châtellenie; la taxe était à peu près d’un denier par setier pour les ventes en gros et de 1⁄16 ad valorem pour la vente au détail 2. Cette concession était accordée pour dix ans, mais elle fut constamment renouvelée dès lors 3.
Au début de 1362, il y avait eu une nouvelle alerte et l’on avait fait de très importantes levées de troupes dans le Pays de Vaud 4. Puis il y eut un répit de quelques mois 5. Mais, bientôt les menaces se renouvelèrent. /157/ Le comte de Savoie s’entendit alors avec les princes ses voisins et fit une campagne au delà du Jura en 1364 et 1365 1. En 1365 encore, le bailli de Vaud se rendit avec une escorte de gens de pied et de cheval aux Clées et à Jougne pour mettre en état de défense les passages du Jura, par lesquels on craignait de voir arriver de nouvelles bandes. Plusieurs Moudonnois l’accompagnaient 2. Les routiers s’écoulèrent ailleurs et le danger s’éloigna pour quelque temps.
Il reparut, plus redoutable que jamais, en octobre 1374 3. De nouveau il fallut surveiller les passages du Jura; les contingents des communes furent mis sur pied et se réunirent à Chambéry. Tout l’hiver de 1375, ainsi que le printemps, fut rempli de ces préoccupations; en face de l’ennemi commun, toutes les rivalités s’étaient apaisées : Savoyards, Fribourgeois /158/ et Bernois s’entendaient pour repousser une menace égale pour tous. Le danger ne venait pas seulement de l’ouest; les Bretons d’Enguerrand de Coucy envahissaient le plateau suisse et des bandes de pillards se glissaient jusque vers Morat.
Dès le printemps de 1376, les routiers disparurent, usés par les privations et les intempéries, et chassés par les paysans bernois 1. On restait sur ses gardes cependant et les fortifications de Moudon étaient complétées, aux frais de la ville et des villages de la châtellenie auxquels elle devait servir de refuge en cas de danger 2.
Les premières campagnes du Comte Vert avaient mis son nom en vedette en même temps qu’elles avaient éveillé son ambition; il se laissa entraîner dans la grande politique : avec l’appui du roi de France et de l’empereur Charles IV, il intervint dans les affaires d’Italie, ce qui le détourna de celles de notre pays.
Ni dans ses expéditions au delà des monts, ni dans sa croisade en Orient il n’emmena avec lui ses sujets des communes vaudoises, qui, on se le rappelle 3, ne lui devaient la chevauchée que dans les limites des trois évêchés romands, et qui ne paraissent pas avoir eu pour le service mercenaire le même goût que les Italiens ou les Suisses. /159/
Par contre, le comte se faisait accompagner par les chevaliers ses vassaux, qui lui devaient, semble-t-il, trois mois de service militaire 1; ils le suivaient volontiers 2 dans ces campagnes lointaines, pleines d’imprévu et de risques, mais aussi de chances heureuses. Aux fidèles et pacifiques habitants des villes, le prince se contentait de demander de l’argent, des subsides pour employer la langue du temps, ou impôts extraordinaires, que nous allons voir se répéter de plus en plus fréquemment, à mesure que s’accroîtront les ambitions savoyardes et les déficits du Trésor 3.
Amédée VI reçut de la ville de Moudon un premier subside en 1365 4; il s’élevait à 500 florins, qui vaudraient aujourd’hui près de 30 000 fr. 5. Il lui était accordé par les habitants à l’occasion du passage de l’empereur Charles IV, de la maison de Luxembourg. /160/ Au début de mai le comte s’était avancé à sa rencontre jusqu’à Morat 1; de là, il l’avait escorté à travers le Pays de Vaud, en passant par Moudon 2, jusqu’à Lausanne; il l’avait ensuite conduit à Chambéry et accompagné en Italie. Lorsque l’empereur revint au mois de juin, le comte lui tint compagnie au retour comme il l’avait fait à l’aller. Ce voyage donna lieu à des réceptions grandioses et à des fêtes splendides 3, car le comte Amédée VI aimait le luxe et la pompe et, de plus, il tenait à se faire bien voir du premier prince de la chrétienté.
En mai 1370, Moudon paya 300 fl. (environ 18 000fr.) à l’occasion d’une campagne en Bourgogne pour laquelle les communes avaient refusé leur concours militaire, au grand déplaisir du prince 4. En 1381 nouveau subside de 400 fl. 5. A ce moment le Comte Vert préparait une expédition dans le royaume de Naples; il faisait acheter des chevaux par son bailli de Vaud; cet officier traitait avec des capitaines /161/ et enrôlait des cavaliers; à Berne, à Soleure et à Fribourg, il se procurait des tentes et des barils cerclés de fer, destinés à contenir du vin et que des chevaux devaient porter à bâts. Hommes, bêtes et matériel étaient concentrés à Moudon 1.
Mais cette expédition, dont le prince attendait tant de gloire et de profit, se termina par un désastre : la peste ravagea l’armée; le comte lui-même succomba à la maladie le 1er mars 1383 2; il n’avait que 49 ans.
Ces campagnes lointaines donnaient satisfaction aux besoins guerriers de la noblesse et l’absence des plus turbulents d’entre les seigneurs féodaux était plutôt un bienfait, car il valait mieux que leurs instincts belliqueux se donnassent libre carrière ailleurs.
Au reste, il y avait dans le pays encore assez de personnages dangereux. Tel ce comte Pierre d’Aarberg, seigneur de Maconnens, qui, le 1er juillet 1366, fit dépouiller près de Romont, par ses gens d’Arconciel et d’Illens, trois marchands, un de Cologne, un autre de Bâle, le troisième d’Anvers. Si l’on en croit les plaintes des lésés, la valeur des marchandises et de l’argent dont ils avaient été dépouillés s’élevait à 2030 fl. (plus de 120 000 fr.); sur cette somme ils n’auraient pu se faire restituer que 30 fl. (1800 fr.). Cité à Moudon, devant une cour composée de chevaliers /162/ et de donzels, Pierre de Maconnens fut condamné à verser à ses victimes une indemnité de 4000 fl. (environ 240 000 fr.) 1. L’histoire ne dit pas si elle fut jamais payée.
D’autres brigands de grands chemins, mais de moindre envergure, sont condamnés à des amendes 2, ou à la prison 3; quand leurs crimes deviennent trop odieux, le bailli de Vaud prend des mesures plus énergiques. Ainsi, nous le voyons, le 6 décembre 1378, réunir 80 cavaliers, parmi lesquels il y a huit bourgeois de Moudon; il se rend avec eux à Morat, y arrête un brigand redoutable, l’emmène à Payerne où il le fait juger sommairement et pendre, malgré les protestations des bourgeois de Morat dont les franchises étaient violées 4.
Parfois, ces opérations de police intéressaient plus directement les gens de Moudon. Il y avait des troubles à Payerne depuis le milieu du siècle 5; à partir de 1367, le principal coupable semble avoir été un certain Pierre Charles, que l’on accusait de vols et de crimes nombreux; il avait des amis puissants qui le /163/ protégeaient, si bien que l’avoyer de Payerne n’osait pas le faire arrêter et juger. En mai 1370, sur l’ordre du comte, le bailli de Vaud rassembla 40 cavaliers et cent fantassins, levés dans la châtellenie de Moudon; avec cette solide escorte, il se rendit à Payerne; il y saisit le criminel qui fut amené à Moudon, où il fut jugé et noyé 1.
A la Toussaint de l’an 1371, même expédition, mais avec un nombre double de fantassins; il s’agissait cette fois d’arrêter, dans la même ville de Payerne, le donzel Jean Mestral qui passait pour un malfaiteur dangereux; il fut fait prisonnier, envoyé à Morges et noyé à son tour 2. /164/
Quelque intérêt, nous semble-t-il, que les Moudonnois aient eu à voir régner l’ordre et la tranquillité, il nous faut reconnaître qu’ils étaient les premiers à troubler la paix quand l’envie leur en prenait. Un jour de l’automne 1364, ou du début de l’hiver 1365, ils se rendirent en bande à Dommartin, qui appartenait au Chapitre; ils ravagèrent les villages de cette châtellenie 1, pillèrent les maisons, emmenèrent le bétail, maltraitèrent les habitants tant et si bien qu’un des blessés en mourut. Le Chapitre se plaignit au comte qui cita les gens de Moudon à comparaître devant lui à Morges, le 21 février 1365. Les accusés firent défaut et furent condamnés à payer au Chapitre une indemnité de 5000 fl. (environ 300 000 fr.) et à fonder une chapelle où l’on dirait la messe pour le repos de l’âme de leur victime 2.
La ville recourut en appel; l’année suivante, le premier jugement était cassé par le bailli de Vaud agissant au nom du comte, « parce que les nobles et bourgeois de la communauté de Moudon, en vertu de leurs franchises, ont le droit de ne point être cités hors de Moudon, sauf en appel » 3. Annulée pour vice de forme, la sentence de Morges ne fut cependant remplacée par aucune autre. Assurément /165/ le Chapitre n’avait guère envie de citer les gens de Moudon devant le seul tribunal compétent, la cour de Moudon, dont la partialité était certaine. L’affaire traîna donc; elle ne fut terminée que dix ans après par une transaction : Moudon payait 300 fl. (18 000 fr.) au Chapitre à titre d’indemnité, faisait une offrande de 100 liv. (10 000 fr.) sur l’autel de la Vierge Marie à Lausanne et versait 20 liv. (2000 fr.) à la veuve et aux enfants du malheureux qui avait été tué dans la bagarre 1.
On voit que le Chapitre avait dû rabattre passablement de ses prétentions, mais nous ne pouvons savoir si l’indemnité consentie correspondait aux torts subis par les gens de Dommartin. Cette histoire nous montre quel était l’état d’insécurité qui régnait alors dans ces contrées aujourd’hui si paisibles.

Sceau de Guillaume de Namur
sire de Vaud,
1359.
/166/
CHAPITRE XI
LE COMTE ROUGE
Amédée VII, le jeune prince qui succédait à son père, n’était pas un inconnu à Moudon où il avait passé au moins une fois, au début de l’été de 1382 1. Il faisait alors un de ces voyages qui sont destinés à initier un prince-héritier aux mystères de la politique et se rendait à Fribourg et à Berne; il s’était arrêté peu de temps à Moudon; il y avait écouté avec bienveillance les compliments que lui avaient débités un ménestrier et une ménestrelle; il les avait récompensés largement 2, puis avait continué sa route.
C’était un jeune homme de 23 ans 3, aimable et brillant, très populaire à cause de sa bravoure, de sa bonne grâce et de sa simplicité. Il avait hérité les goûts militaires de son père, mais non ses talents politiques; aussi, par son testament, celui-ci avait-il remis le gouvernement de ses états à sa veuve, Bonne de Bourbon. Le jeune comte ne fut nullement blessé /167/ d’être ainsi placé, quoique majeur, sous la tutelle de sa mère et il lui laissa volontiers porter le poids de soucis pour lesquels il ne se sentait guère fait.
Il séjournait sur les bords du lac Léman 1 quand lui parvint la nouvelle de la mort de son père; un des premiers actes de son gouvernement fut de prêter aide et secours aux Bernois, ses alliés, qui assiégeaient Berthoud. Les communautés vaudoises consentirent à payer pendant dix-huit jours les contingents nécessaires, que le comte retint à ses frais pendant une quinzaine de plus. Un premier corps, composé de 40 lances (environ 200 cavaliers) fut en campagne du 13 avril au 15 mai; un second, de 36 lances, du 7 au 17 mai. Plusieurs bourgeois de Moudon prirent part à cette expédition, qui aboutit du reste à un échec 2.
Amédée VII passa la plus grande partie de la première année de son règne à combattre en Flandre 3. A peine était-il de retour qu’il eut à guerroyer contre les Valaisans, qui s’étaient révoltés contre leur évêque, Edouard de Savoie. C’était le Comte Vert qui avait fait placer celui-ci sur le trône épiscopal, afin qu’il y fût un instrument de sa politique; l’honneur et l’intérêt de la maison de Savoie exigeait qu’il fût rétabli dans sa dignité.
Les préparatifs militaires commencent avec le /168/ printemps de 1384 1; le 31 mars, le comte ordonne à son bailli de Vaud, Humbert de Colombier, de se rendre de Moudon à Berne pour y renouveler l’alliance avec la république et demander son appui; les 8 et 12 avril, il fait convoquer bannerets et communautés en vue d’une campagne en Valais; il met ainsi de piquet les contingents nobles et bourgeois du Pays de Vaud. Dès le début de mai, il fait rassembler des armes : le châtelain des Clées achète 24 fers de lance; dans les provisions de sa maison 2, le bailli de Vaud prend une forge portative, six ballistes à deux pieds et deux canons; il achète du chanvre; il fait fabriquer à La Sarraz deux cents boulets de pierre 3. Ces armes et ces munitions, destinées à la défense du château de Montorge, sont transportées à Vevey sur des chars. Le 15 mai, la comtesse envoya de Ripaille l’ordre de se mettre en route; le bailli partit pour Conthey, accompagné de 29 hommes d’armes du Pays de Vaud avec leur suite; sa propre escorte se composait de dix chevaux; vingt chevaux de bât portaient ses provisions et ses armes. Cette compagnie ne resta que dix jours en campagne : le 2 juin 4, si ce n’est plus tôt, le bailli était de retour à Moudon.
A la fin du mois, une troupe d’officiers et de conseillers du comte se rendit, sur son ordre, à Thoune, « dans les montagnes de l’Allemagne », pour voir si /169/ une armée ne pourrait pas tomber dans le dos des Valaisans en passant par les Alpes. Mais le projet parut sans doute impraticable et fut abandonné, comme l’avait été, un mois auparavant, celui de passer par la Gruyère, c’est-à-dire par le Sanetsch.
Les Valaisans devenaient toujours plus hardis : ils avaient pénétré sur les terres savoyardes et portaient l’incendie et le pillage dans le voisinage de Conthey et de Saillon. Le 24 juin, le comte mandait de Ripaille au châtelain de Moudon 1, qui remplaçait le bailli malade, de se transporter à Fribourg et à Berne pour y requérir à nouveau l’aide de ses alliés. Lui-même, pour stimuler l’ardeur de ses sujets vaudois, passait le lac et venait s’installer à Moudon.
Le 2 juillet, il y confirmait les franchises de la ville 2, ce qu’il n’avait pas encore fait depuis son avènement. Le comte resta plusieurs jours à Moudon : le 6, il alla à Rue et à Romont pour y accomplir le même devoir 3; il revint prendre ses quartiers à Moudon; le 7, après y avoir encore signé une pièce 4, il se rendit à Yverdon pour y confirmer également les franchises de cette ville 5. Il faut croire que sa présence était nécessaire et que, s’il voulait des soldats, il fallait qu’il donnât d’abord satisfaction à ses sujets en reconnaissant leurs droits. /170/
Ce début de l’été 1384 fut une période brillante pour la petite ville dont nous nous occupons : après les préparatifs militaires qui avaient animé ses rues, la présence du prince lui donnait les allures d’une résidence. De toutes parts, de nobles seigneurs accouraient auprès du souverain; celui-ci reçut entre autres la visite de l’évêque de Bamberg, chancelier impérial, qui venait en ambassade auprès de lui et qui voyageait en magnifique équipage, avec 61 chevaux.
De Moudon, le comte envoya messagers sur messagers à Berne pour établir avec les autorités de cette ville le plan de la campagne commune. Les Bernois, avec qui il venait de renouveler son alliance 1, lui prêtèrent le secours demandé : ils s’engagèrent à pénétrer dans le Lœtschenthal pendant que les Savoyards attaqueraient par la vallée du Bhône.
Le comte avait réussi dans ses négociations; il pouvait reprendre ses préparatifs militaires. Le bailli acheta à Payerne 1500 livres de chanvre, avec lequel on fabriqua à Moudon neuf cordes de 55 toises 2 chacune; elles étaient destinées à l’artillerie que l’on avait amenée devant Sion. De même, il se procura 300 pots ou pains 3 de poix noire pour faire les « phares » qui, la nuit, devaient éclairer l’armée savoyarde. Le tout fut mis sur un gros char ferré, et transporté à Conthey 4. /171/
Le 28 juillet, tout étant prêt, le comte convoqua les gens des communautés vaudoises avec ordre de le rejoindre devant Sion armés et bien munis de vivres. Les villes s’étaient engagées à lui fournir des soldats à leurs frais pour trois semaines 1.
Attaqués à la fois par les Bernois et les Savoyards, les Valaisans ne purent résister. Sion fut prise d’assaut et détruite vers le 20 août 1384. Le 21 août, les rebelles et le Chapitre venaient dans la tente du vainqueur signer la paix que celui-ci voulait bien leur accorder 2. Après cette éclatante victoire, Amédée VII put licencier son armée et les soldats rentrèrent chez eux, chargés de butin, suivant l’usage.
Les années qui suivirent ne furent guère plus calmes. Au cours de l’automne 1385 et de l’hiver 1386, on eut de nouveau quelques inquiétudes au sujet des Grandes Compagnies; le bailli alla inspecter les défenses d’Yverdon; il se concerta avec Guillaume de Grandson, seigneur d’Aubonne, pour faire garder les passages du Jura 3. Le danger s’éloigna cependant sans que l’on ait eu à prendre des mesures plus sérieuses. /172/
A ce moment la guerre éclatait entre les Confédérés et l’Autriche; au lendemain de la bataille de Sempach (9 juillet 1386), les hostilités commencèrent entre les Bernois, alliés des Suisses, et les Fribourgeois, sujets des Habsbourg. Les deux adversaires se firent le plus de mal possible en se ravageant réciproquement leurs terres 1. Après un armistice de quelques mois, la guerre reprit de plus belle au printemps 1388.
Cette lutte entre des voisins, qui tous les deux étaient ses alliés, inquiétait le Savoyard; il avait cherché à s’entremettre en avril, pendant le siège de Nidau par les Bernois; il avait chargé son bailli de Vaud d’accompagner à Berne l’évêque de Lausanne, qui allait offrir sa médiation 2, inutilement du reste.
En juillet, la situation s’aggrava; on signala en Franche-Comté des bandes de soldats qui menaçaient de pénétrer dans le pays. Le bailli, en toute hâte, alla visiter les passes du Jura vers Jougne; il était accompagné d’Othon de Grandson et de quelques cavaliers; il fit creuser un fossé aux Clées et plaça des garnisons à Payerne, Morat et Romont, par mesure de prudence 3. Quelques jours après, il envoyait à la comtesse, à Chambéry, un exprès chargé de l’informer des événements qui venaient de se produire.
Les nouvelles qu’il portait étaient, en effet, d’importance : malgré la surveillance des passes du Jura, /173/ deux lieutenants d’Enguerrand de Coucy, accompagnés de 1500 chevaux, avaient pénétré dans le pays et, le 16 juillet, ils étaient entrés à Fribourg où on les attendait impatiemment 1. Ils se préparaient à reprendre les châteaux que les Bernois avaient enlevés aux Fribourgeois. Le 22 juillet 2, Bonne de Bourbon envoyait au bailli des instructions sur cet incident qui pouvait avoir des suites graves.
Notre pays échappa cette fois encore aux ravages des bandes du sire de Coucy; au bout de trois semaines 3, elles quittèrent Fribourg sans avoir rien obtenu; mais on restait sous la menace d’une nouvelle invasion et, le 29 août, les milices vaudoises furent mises de piquet. Six mois plus tard, en janvier ou février 1389, le bailli de Vaud allait à Pontarlier; on prêtait aux principaux lieutenants du célèbre chef de bandes, Jean de Ray et Girard de Cusances, l’intention d’entrer dans le pays avec 1000 chevaux. Le bailli leur notifia qu’ils n’eussent pas à passer par les terres du comte, comme l’été précédent 4. En mai encore, le bailli faisait surveiller la frontière.
Mais entre temps la guerre avait repris en Valais. En septembre 1387, Moudon avait fourni au comte /174/ un contingent qui avait servi pendant une quinzaine 1. Au mois d’août de l’année suivante, Amédée VII fit annoncer la levée d’un nouveau contingent. Les communautés, fatiguées de ces mises sur pied continuelles, ne mirent aucun empressement à répondre à son appel. Leurs députés, réunis à Moudon, refusèrent leur concours, malgré toutes les insistances du souverain 2.
Celui-ci en fut réduit à convoquer ses vassaux seulement (4 oct.). Au milieu du mois de décembre, du 13 au 29, le bailli se rendit en Valais avec 20 hommes d’armes, parmi lesquels se trouvaient le vidomne de Moudon et Rodolphe Cerjat. Au cours de cette expédition, les troupes savoyardes subirent un effroyable désastre près de Viège, le 23 décembre 3; surprise par les Haut-Valaisans, l’armée du comte fut mise en déroute et taillée en pièces; si l’on en croit les vieilles chroniques, 4000 hommes seraient restés sur le carreau. Il semble que personne de Moudon n’ait succombé dans cette bataille, tandis qu’un contingent de Nyon paraît avoir pris part au combat 4.
L’honneur du comte exigeait une revanche. Le 13 janvier 1389, il rappelait ses sujets sous les drapeaux /175/ et le bailli de Vaud adressait aux seigneurs vassaux 140 lettres de convocation; en même temps, il invitait les députés des bonnes villes à se réunir à Morges, malgré la saison et la neige qui obstruait les chemins. Nous ne connaissons pas le résultat de leurs délibérations. Le fait est que, contremandée de mois en mois, l’expédition projetée n’eut pas lieu. Le comte se borna à interdire l’exportation des vivres, afin d’avoir des provisions en cas de besoin 1.
L’année 1390 se passa encore presque tout entière sans nouvelle levée de troupes, mais non sans nouvelles exigences de la part d’Amédée VII. Il avait besoin d’argent tout autant, si ce n’est plus, que de soldats. Il en obtint après de longues négociations avec les communes vaudoises 2 : Moudon lui accorda un subside de 700 florins (plus de 40 000 fr.), mais « de grâce spéciale » et à condition que le comte reconnût formellement que cela ne pouvait porter préjudice aux franchises de la ville. Amédée VII s’exécuta, mais dans le même acte il ordonnait la perception immédiate du subside; le bailli devait choisir quatre bourgeois probes et les charger de répartir équitablement la somme votée, suivant les moyens de chacun; après quoi il devait forcer chacun à payer son dû, en employant, si besoin était, la saisie et la vente forcée « dans de telles conditions que nous touchions bientôt cette somme intégralement 3 ».
Vers la fin de l’année, l’inquiétude reprit : le comte /176/ d’Armagnac emmenait des routiers combattre en Italie et on pouvait craindre qu’ils ne cherchassent à passer sur les terres savoyardes. Dès le mois d’octobre, le comte de Savoie prit des mesures militaires; un peu plus tard, le sire Louis de Cossonay, son lieutenant-général en deçà des monts, fit proclamer à Moudon la chevauchée pour les gens de Vaud 1. Le 29 janvier 1391, sur son ordre, le bailli de Vaud se rend à Morat pour y rencontrer des ambassadeurs bernois auxquels il voulait demander du secours; le 30 et le 31, il discute à Moudon avec les députés des villes vaudoises qui y étaient réunis pour délibérer sur l’appel du comte; il soupe le premier soir et dîne le lendemain avec eux, puis il va à Lausanne traiter avec l’évêque; le 2 février, il était à Genève où il faisait rapport au lieutenant-général 2. Au début d’avril, la chevauchée était convoquée à Genève, sans que les bourgeois des villes vaudoises eussent, semble-t-il, élevé de protestation. Au reste, les Armagnacs passèrent par le sud et les états savoyards échappèrent aux dévastations dont ils étaient menacés.
Mais le Comte Rouge n’avait pas oublié son échec en Valais; il comptait bien se venger et cela d’autant plus que les Valaisans devenaient arrogants 3. Le 1er juin, il défendait à ses vassaux de quitter le pays et, le 6, il convoquait les Etats de Vaud 4 à Moudon; /177/ cette séance ayant été renvoyée, ceux-ci ne se tinrent qu’en septembre. Lorsque le comte se rendit à Berne pour demander aux Bernois un appui, qui lui était indispensable pour sa campagne du Valais, il trouva, le 5 septembre, les Etats réunis à Moudon 1.
Si les communes vaudoises avaient été disposées à fournir des soldats quand il s’agissait de défendre la patrie contre des pillards étrangers, elles ne l’étaient plus du tout quand il était question des affaires du Valais. Les députés ne voulaient pas donner leur appui à une politique de conquêtes. Toutefois, pour ne pas faire preuve de mauvaise volonté, ils offrirent un service de trois semaines 2. Le comte reçut cette réponse à Romont, où il passa le 9 septembre, en revenant de Berne 3. Il ne cacha pas son mécontentement : une si courte durée ne permettait pas une campagne sérieuse. Les Etats se réunirent alors de nouveau, le 17 septembre, à Moudon; ils consentirent à un service d’un mois en plus des huit jours qui étaient dus 4.
Cette fois, le comte se déclara satisfait. Il le reconnut à Lausanne, le 23 septembre, par un acte dans lequel il affirmait que cette concession de leur part ne pourrait porter préjudice aux franchises des communautés qui ne comportaient qu’un service de huit jours. Il ajoutait que dorénavant tous les actes officiels /178/ émanant de lui ou de ses officiers porteraient la réserve suivante : « les coutumes de notre Pays de Vaud étant observées ». Enfin, c’était aux bourgeois eux-mêmes qu’était réservé le droit de choisir les hommes destinés à participer à la chevauchée 1.
Ainsi, Amédée VII était arrivé à ses fins, mais non sans peines, ni sans quelques sacrifices d’amour-propre. Le 4 octobre, il faisait acheter des vivres qu’il ordonnait de transporter en Valais, où se trouvait déjà le maréchal de Savoie, Jean de Vernet. D’autres ordres, les 8 et 21 octobre, complétaient ces mesures préparatoires; puis, le 25, il donnait des contre-ordres et renvoyait au 1er décembre l’expédition projetée 2.
Sans aucun doute, c’était sa santé qui l’y avait obligé, car, huit jours après, le 2 novembre, il expirait, vers une heure du matin, dans son château de Ripaille 3.

Sceau de Catherine de Savoie
Dame de Vaud, comtesse de Namur, 1359.
CHAPITRE XII
LE DRAME DE RIPAILLE. AMEDEE VIII
Le drame qui a coûté la vie à Amédée VII a fait l’objet de bien des études 1 et nous n’y reviendrions pas si ses contre-coups ne s’étaient étendus jusqu’à Moudon.
Le comte était mort empoisonné, pense-t-on, par son médecin Grandville. Mais qui était l’instigateur du meurtre ? On a supposé que la mère d’Amédée, Madame la Grant, Bonne de Bourbon, craignant de voir le pouvoir lui échapper, n’avait pas craint d’attenter, sinon à la vie, tout au moins à la santé de son fils; on a accusé des seigneurs de l’entourage du prince, en particulier Othon de Grandson; il pouvait avoir quelque ressentiment contre le comte qui ne l’avait pas soutenu dans un procès récent. L’explication la plus simple et la plus plausible est que le malheureux prince fut une victime de l’ignorance de son médecin; sans avoir d’intentions criminelles, celui-ci lui fit subir un traitement tel que le patient en mourut 2. /180/
La protection dont jouit Grandville au lendemain du drame, les rivalités d’une cour où deux femmes, la grand’mère et sa bru, représentaient l’autorité souveraine au nom d’un enfant de huit ans, le goût général du public de tous les temps pour le mystérieux et le tragique ne purent manquer d’exciter les passions et de faire travailler les imaginations : d’un simple accident, on fit un sombre complot.
La nouvelle de la mort du comte fut communiquée au bailli de Vaud par un message de Madame la Grant 1, à laquelle son fils avait remis la régence en mourant. Elle ordonnait de faire bonne garde; il ne fallait pas que la disparition du souverain devînt une occasion de troubles. Quelques jours après, la régente convoquait les députés de toute la Savoie en un conseil général à Chambéry. Avant Noël, les communautés du Pays de Vaud envoyèrent de leur côté leurs délégués à Moudon 2.
Malgré les discussions un peu vives qu’il avait eues avec les Etats de Vaud, Amédée VII était resté populaire dans notre pays; on considéra sa mort comme un deuil national; on jugea que c’était un devoir de venger un crime dont on ne doutait déjà plus.
A Moudon, en effet, l’opinion publique s’était /181/ prononcée dès le premier jour. Il y vivait depuis 1387 un ancien chirurgien du comte; retiré dans cette ville, dont il était peut-être originaire, Jean de Moudon y jouissait d’une pension que son maître lui avait allouée en récompense de ses services 1. Lorsque Amédée sentit son état s’aggraver, il manda à Ripaille son ancien serviteur; mais les remèdes de celui-ci furent impuissants. Toutefois Jean de Moudon avait examiné les ordonnances de Grandville et il avait déclaré à haute voix et devant témoins que le malheureux prince avait été empoisonné. Cette accusation avait exaspéré le médecin, qui eut une querelle avec le chirurgien. Les assistants s’interposèrent et on les réconcilia; Grandville invita Jean de Moudon à souper. Ce dernier eut l’impression d’avoir été empoisonné à son tour au cours de ce repas; le fait est qu’il mourut peu après son retour à Moudon 2. /182/
Jean de Moudon semble être rentré chez lui avant la mort du comte; dès son arrivée, il avait été interrogé par ses compatriotes; à leurs questions sur la santé du prince, il avait répondu que, si celui-ci en réchappait, ce serait pour rester infirme, mais qu’il était plus probable qu’il succomberait, à moins que Dieu lui-même n’y portât remède; il ne cacha pas que ce malheur était dû au traitement absurde, et même criminel, d’un médecin étranger 1. Pendant sa propre maladie, Jean de Moudon avait clairement exprimé devant ceux qui le visitaient quels étaient ses soupçons sur les causes de la mort de son maître 2.
On comprend que l’opinion surexcitée ait vu dans la mort du chirurgien 3 la confirmation de toutes ses accusations. Lorsqu’en avril 1392 les délégués des communes vaudoises se réunirent à nouveau, la mort mystérieuse du Comte Rouge était l’objet de toutes les préoccupations, et cela d’autant plus /183/ qu’un fait nouveau s’était produit : on venait d’apprendre l’arrestation de Grandville.
Au lendemain du drame de Ripaille, le médecin coupable avait échappé à la colère vengeresse des serviteurs du comte; jouissant d’une protection inexplicable, il avait passé le lac, puis, grâce aux bons offices d’Othon de Grandson 1, il avait pu se réfugier en France. C’est là que, quelques mois plus tard, il était tombé, bien malheureusement pour lui, entre les mains du duc de Berry, le beau-père du prince défunt 2.
Celui-ci prit en main la vengeance de son gendre, moins par affection pour lui que par désir de s’ingérer dans les affaires de la Savoie. Il somma Amédée de Savoie, prince d’Achaïe, le plus proche parent mâle et majeur du petit Amédée VIII, d’avoir à ouvrir une enquête sur la mort du Comte Rouge 3. Comme il se méfiait de lui, il avisa la noblesse de la Savoie 4, ainsi que les communautés 5, des mesures qu’il avait prises; il annonçait qu’il allait envoyer de ses gens pour constater sur place que l’on faisait vraiment une enquête sérieuse, car il était décidé à découvrir la vérité. Ces trois lettres étaient datées du 10 août 1392.
Les Etats de Vaud prirent connaissance de cette /184/ missive 1 en même temps que d’un message du prince d’Achaïe, qui avait entrepris loyalement 2 la tâche qu’on exigeait de lui. Il avait envoyé Antoine de la Tour, seigneur d’Arconciel et d’Illens, pour le représenter devant les députés des communautés; ceux-ci entendirent ses explications et, dans la réponse qu’ils le chargèrent de rapporter au prince, ils encourageaient ce dernier à poursuivre son enquête et l’invitaient à se faire livrer Grandville (27 août) 3.
Comme on peut bien penser, le duc de Berry se garda d’extrader son prisonnier, malgré toutes les démarches que l’on fit auprès de lui 4. C’était une arme dont il ne voulait pas se dessaisir. Mis à la torture, suivant l’usage, le médecin avoua tout ce qu’on voulut : il accusa la comtesse Bonne de Bourbon, ainsi qu’Othon de Grandson 5; ces imputations, habilement répandues dans les pays savoyards par les ennemis de la princesse et du chevalier, y provoquèrent la plus grande agitation : les Etats généraux de Savoie furent convoqués à deux reprises au début de 1393 6. /185/
Les accusations qui visaient la comtesse mère furent étouffées, mais son influence politique fut irrémédiablement compromise. La situation d’Othon de Grandson fut plus terrible encore : le sénat de Savoie confisqua ses biens 1 et les députés des villes vaudoises, réunis à Moudon le 3 août 1393, approuvèrent toutes les mesures que le prince d’Achaïe leur proposa 2; l’opinion publique condamnait sans appel le malheureux chevalier.
Cédant devant l’orage, Othon avait quitté le pays et cherché un refuge en France; il abandonnait ses biens à ses ennemis. Les communes vaudoises, acharnées après lui, firent plus d’une expédition, sans succès du reste, contre le château de Sainte-Croix, qu’un des membres de sa famille avait réussi à conserver 3. A cette occasion, leurs députés se réunirent fréquemment à Moudon 4.
Une circonstance dut y surexciter les passions : /186/ dans les derniers jours de juillet ou dans les premiers jours d’août 1393, on y avait reçu un tonneau qui contenait, conservé au sel, un quartier du corps du malheureux Pierre de Lompnes, l’apothicaire du Comte Rouge, qui, bien qu’innocent, avait été condamné et exécuté à Chambéry 1. En sa qualité de résidence du bailli de Vaud, Moudon avait eu le sinistre privilège de voir ces tristes restes suspendus à son gibet.
Deux ans se passèrent; au printemps 1395, la mémoire de Pierre de Lompnes fut réhabilitée 2; quelques mois plus tard, Grandville mourait, après avoir rétracté toutes ses accusations 3; Othon de Grandson put croire que l’affaire était oubliée : en 1396, il rentra au pays.
Mais les colères, qui n’étaient qu’assoupies, se réveillèrent; un seigneur vaudois, Gérard d’Estavayer, se présenta devant le bailli de Vaud, Louis de Joinville, et lui adressa ces paroles : « Sire bailli, je, Girard d’Estavayer, me clame en votre main, comme lieutenant, pour faire raison de mon très cher et redouté seigneur de Savoie, de messire Othe de Granson; si vous requiers comment le veuillez assigner à un jour, selon raison et coutume du pays, et lui veuillez notifier que, à celui jour, je lui maintiendrai et dirai que il, faussement et mauvaisement, /187/ a été consentant de la mort de mon redouté seigneur, monseigneur de Savoie, dernièrement mort … et je lui dis et dirai et maintiendrai, mon corps encontre le sien, à Moudon, où raison se doit faire de toutes causes touchant les bannerets, par devant vous, comme bailli et commis pour faire raison et justice 1. »
Le bailli le renvoya devant le comte et son Conseil. Mais les communautés vaudoises avaient pris parti pour l’accusateur; elles avaient envoyé leurs délégués à Moudon et à Rue et s’étaient engagées à supporter les frais du procès 2. Aussi Gérard insistait-il pour que la cause fût tranchée à Moudon, selon l’usage et la coutume du Pays de Vaud 3. Dans la procédure, il déclare que, s’il consentait à ce que le procès se plaidât hors du Pays de Vaud, il encourrait le mécontentement et l’inimitié des gens de ce pays.
Le comte passa outre et évoqua l’affaire à lui, quoique, d’après les franchises, il ne pût juger qu’en appel; il se crut donc obligé d’affirmer solennellement que ce cas particulier ne pouvait porter préjudice aux coutumes du pays qu’il entendait respecter 4.
Sur ce point aussi, Gérard d’Estavayer apparaît comme le champion du pays de Vaud 5 et l’on peut /188/ se demander si, aux yeux des bourgeois des villes vaudoises, la question de procédure n’importait pas tout autant que la vengeance du Comte Rouge.
On sait que le duel eut lieu à Bourg en Bresse le 7 août 1397 : Othon de Grandson succomba, condamné par ce que l’on considérait alors comme le jugement de Dieu. Cette nouvelle fut accueillie dans notre pays avec des cris de joie : justice était faite ! En septembre, Gérard d’Estavayer traversa le pays; il fut reçu partout comme un héros et les communes vaudoises ne se firent pas tirer l’oreille pour solder les comptes de cette affaire qui avait fini comme elles le désiraient 1.
*
* *
Au cours des années 1395 et 1396, le Pays de Vaud tout entier et Moudon en particulier avaient été agités par d’autres incidents : on avait pu craindre des soulèvements. Ces menaces étaient-elles en rapport avec l’affaire dont nous venons de parler ? étaient-elles dues à d’autres causes ? Nous ne le savons pas. Le fait est que le bailli en fut très vivement préoccupé et qu’à Moudon l’opinion publique ne resta pas indifférente. /189/
Au nom du souverain, le bailli interdit de faire des « ligues »; à partir du 1er octobre 1395 et jusqu’au 1er décembre 1396, le château d’Yverdon fut gardé par des soldats 1. En septembre 1396, le bailli réussit à faire signer une trêve aux plus agités; à la fin de novembre, il passa de château en château pour pacifier les seigneurs soulevés et put enfin établir une paix véritable.
Le bailli, Louis de Joinville, seigneur de Divonne, semble avoir été personnellement visé par certains perturbateurs de l’ordre public, si bien qu’il ne voyageait qu’avec une solide escorte 2. Un jour, — c’était le 9 septembre 1396 — il fut assailli dans le château de Moudon par Pierre de Cuchet, un Payernois qui était venu dans cette ville pour y vider, par un combat judiciaire, un différend qu’il avait avec un moine de Payerne, Jaques Mallet. Le bailli faillit périr dans la bagarre. Le lendemain, il envoyait en toute hâte un exprès au comte, à Bourg en Bresse, pour le mettre au courant des événements. Louis de Joinville trouva du reste de l’appui dans le pays même : les Etats de Vaud, qui se réunirent le 14 septembre, puis le 27 octobre, se prononcèrent en faveur du moine et condamnèrent son adversaire, l’agresseur du bailli; satisfait, celui-ci invita les représentants de la noblesse et des bourgeoisies à dîner au château; le 31 octobre, /190/ Pierre de Cuchet avait la tête tranchée, par grâce spéciale; cent soldats assuraient l’ordre et protégeaient le bailli contre toute attaque de la part des gens du condamné 1.
Une cérémonie d’un tout autre genre eut lieu à Moudon le 20 décembre 1398 : le comte Amédée VIII, qui venait d’atteindre sa majorité, — il avait 15 ans — faisait son entrée dans sa bonne ville. Il confirmait ses franchises qu’il jurait d’observer comme ses prédécesseurs. A leur tour, les habitants nobles et bourgeois, levant les doigts au ciel, jurèrent d’être de bons et loyaux sujets et ils crièrent à maintes reprises : « Vive Savoie ! » 2 L’évêque de Lausanne était présent à cette cérémonie solennelle qui se déroula devant le château et devant l’église de Notre-Dame 3.
L’éclat des fêtes ne faisait pas oublier les affaires. Ce n’était pas pour témoigner son amour à ses féaux sujets que le comte était venu à Moudon : il désirait un subside que les Etats, réunis en novembre, puis le 12 décembre, n’avaient pas voulu lui accorder. /191/ Il les convoqua à nouveau à Yverdon, le 12 janvier 1399 et chercha, sans y parvenir, à faire pression sur eux. Les Etats se réunirent encore à Moudon le 25 et envoyèrent le 28 une réponse qui ne donnait pas satisfaction au prince. Il y eut une nouvelle séance le 10 février à Moudon et le 15 à Morges. Finalement on tomba d’accord pour un subside de deux francs d’or par feu 1.
*
* *
Le jeune prince qui commençait ainsi son règne effectif allait être le plus grand des souverains que la Savoie ait eus au moyen âge. Il ne brillait pas, comme son père ou son grand-père, par les dons extérieurs : délicat de santé, disgrâcié par la nature qui lui avait donné une taille peu avantageuse et un visage déparé par le strabisme, Amédée VIII ne fut pas un chevalier fringant, passionné pour la chasse et les tournois. La mort tragique de son père, les soupçons qu’elle avait fait naître, la rivalité de sa mère et de sa grand’mère, les intrigues des princes étrangers avaient entouré sa jeunesse d’une tristesse qui ne se dissipa jamais; il eut toute sa vie une humeur un peu sauvage, qui le poussait à fuir le monde.
Mais, sous cet aspect morose, se cachaient une vive intelligence et une volonté ferme. Prévoyant et calculateur, connaissant les hommes, Amédée VIII était un fin diplomate; il savait prendre l’avis des gens avertis, laisser mûrir ses projets, attendre patiemment le moment favorable 2. /192/
Sans renoncer par principe à l’emploi de la force, il était assez sage pour n’y recourir qu’à bon escient et en vue de fins très précises; les quelques campagnes qu’il fit furent courtes et conduites de telle sorte qu’elles amenèrent rapidement la conclusion de traités avantageux 1.
Il réussit à agrandir ses états : en 1401, il acquit le comté de Genevois, à prix d’argent et en se servant habilement de ses droits de suzerain; il fit de même, en 1402, avec les domaines des sires de Thoire et Villars, situés dans la Bresse et le Bugey 2; dans les années qui suivent 1406, l’extinction de la maison de Cossonay permet au comte de Savoie l’annexion des terres qu’elle avait possédées au Pays de Vaud 3; plus tard, il retire à lui le Piémont, apanage d’une branche de sa maison qui venait de s’éteindre (1418) 4; en 1421, il étend ses terres de la Bresse en acquérant les domaines du duc de Bourbon; en 1427, à la suite de deux courtes campagnes, le duc de Milan lui abandonna Verceil 5. Ainsi, il accroissait son autorité en faisant disparaître les enclaves possédées par des étrangers et il agrandissait ses territoires en leur réunissant des terres voisines. /193/
D’autre part, il savait renoncer aux possessions excentriques qui ne pouvaient que lui causer des difficultés, sans autre profit que des satisfactions d’amour-propre. Ainsi, en 1410, il abandonna aux Bernois la seigneurie d’Oltingen près d’Aarberg, qui était de son fief et à propos de laquelle une guerre avait failli éclater entre lui et la ville de Berne 1; de même, en 1423, il vendit aux Bernois et aux Fribourgeois la châtellenie de Grasbourg 2. C’était d’une sage politique qui lui assurait l’alliance de deux villes, dont l’une tout au moins était déjà une puissance redoutable.
On sait qu’il obtint de l’empereur Sigismond de Luxembourg le titre ducal (1416) qui donnait à sa maison un rang égal à celui des plus considérables.
C’était là, en quelque sorte, le sceau mis à la considération que l’on avait pour lui. Les princes étrangers, en effet, avaient de bonne heure remarqué sa sagesse; il n’avait pas trente ans que son arbitrage était demandé par Venise et par la cour de France 3. Il chercha à intervenir, à plusieurs reprises, pour mettre fin au schisme qui désolait la chrétienté 4. Pendant le règne malheureux de Charles VI, il fut appelé plus d’une fois à s’interposer entre les princes de la famille royale dont les rivalités déchiraient la France et un de ses /194/ derniers actes politiques fut de ménager entre Charles VII et le duc de Bourgogne le traité d’Arras (1435) qui devait amener bientôt la fin de la guerre de Cent Ans 1.
Amédée VIII fut un administrateur exact et soigneux 2, économe de ses deniers et soucieux de son autorité. Il fit régner l’ordre dans ses états qui jouirent d’une paix et d’une prospérité rares à cette époque 3. Pendant sa minorité, profitant d’une situation troublée, les Etats généraux de Savoie avaient joué un rôle grandissant 4. Sans cesser de les consulter, Amédée s’efforça de réduire leur importance; au lieu de les rassembler pour leur demander des subsides, il préféra souvent obtenir ceux-ci en s’adressant directement aux communautés qu’il était plus facile de gagner individuellement (1402) 5. Malgré les oppositions qu’il rencontra, il affirma son droit à promulguer des lois générales (Vetera Statuta Sabaudiae 1430) 6. /195/
Amédée VIII cherchait à instaurer dans ses états de Savoie, et probablement aussi en Chablais, un système de gouvernement plus moderne; il tenta aussi d’accroître son autorité dans le Pays de Vaud. Mais là, il se heurtait aux franchises de ce pays qui étaient plus étendues et plus précises que celles des autres terres de sa couronne. En 1403, lors d’un des conflits qui mirent aux prises les gens de Gessenay et le comte de Gruyère, Amédée VIII interdit d’envoyer des vivres aux montagnards soulevés contre son vassal 1; vers la même époque, il ordonna l’emploi exclusif de la monnaie savoyarde, en lieu et place de la monnaie lausannoise, qui avait eu cours jusqu’alors; l’amende menaçait ceux qui contreviendraient à ces mesures. Les villes du pays protestèrent que cela était contraire à leurs franchises, car, d’après celles-ci, le seigneur ne pouvait infliger des amendes que dans trois cas nettement spécifiés 2; or, la défense du prince ne pouvait rentrer dans aucun d’eux. Celui-ci reconnut leur droit et déclara que ses ordonnances ne pourraient porter préjudice à leurs franchises 3. Mais il ne rapporta pas les actes incriminés; /196/ il persista à imposer l’emploi de sa monnaie 1 et à percevoir des amendes de ceux qui se soustrayaient à cette obligation 2. Nous le voyons aussi faire incarcérer un individu et le maintenir en prison malgré toutes les protestations des communes 3. Amédée VIII entendait être obéi.
Quoique pacifique par tempérament autant que par politique, Amédée VIII dut parfois faire des préparatifs belliqueux. En novembre 1403, sur son ordre, le bailli se rend à Moudon où les députés des villes avaient été convoqués et il leur expose la nécessité de se fortifier; par une lettre datée de Saint-Germain, le 31 décembre de la même année, le comte ordonnait de proclamer la chevauchée dans les villes et d’inviter les seigneurs vassaux à le rejoindre dans la Bresse; il semble que les milices urbaines aient été mises de piquet seulement; seuls les nobles, avec 200 chevaux, se rassemblèrent à Morges 4.
En automne 1405, le comte ordonnait de nouveau /197/ à son bailli de faire fortifier le pays et de réparer les fortifications insuffisantes; nous voyons ce fonctionnaire faire en 1406 une tournée d’inspection dans les principales forteresses du pays 1. Peu après, Amédée VIII faisait mettre de piquet les contingents vaudois à cause des menaces des Bernois et des Fribourgeois 2; il s’agissait toujours du conflit gruyérien, qui se termina par un arrangement.
En mai 1409, il y eut une nouvelle alerte; les troupes furent mises de piquet; la chevauchée fut convoquée en Bresse; seuls, les nobles s’y rendirent effectivement et parmi eux plusieurs seigneurs qui habitaient Moudon et plusieurs bourgeois qui possédaient des fiefs nobles 3. En 1413, on prit des précautions contre une troupe de 8000 routiers qui menaçaient, venant du côté de Mâcon et de Lyon 4.
Cinq ans plus tard, en 1418, c’est à deux reprises que le duc fit mettre les hommes de piquet et crier la chevauchée; mais le danger, dont nous ignorons la nature, s’éloigna et les deux fois les ordres donnés purent être révoqués 5. Quand, en juillet 1426, Amédée /198/ VIII fit la guerre au duc de Milan, il ne convoqua que les seigneurs vassaux 1.
Ses exigences en matière d’impôts furent plus grandes. Quoique peu dépensier pour lui-même et de goûts simples, Amédée VIII avait besoin de beaucoup d’argent. Ses acquisitions de terres, son habile diplomatie exigeaient d’abondantes ressources; puis, à une époque où, plus que jamais, le faste était tenu pour un signe de la puissance, il lui fallait bien tenir son rang; enfin, il eut une nombreuse famille à élever et des filles à marier, ce qui n’allait pas sans de grandes dépenses. Il avait peine à équilibrer son budget 2.
Il eut donc fréquemment recours à l’impôt, quoi qu’en ait dit Aeneas Silvius Piccolomini, le futur Pie II 3, et quoi qu’aient répété après lui plus d’un historien. Dans la province du Chablais, il perçut quinze fois des subsides au cours des trente-cinq premières années du XVe siècle 4, ce qui fait, à peu près, un an sur deux.
Pour autant que nous sommes renseignés, le Pays /199/ de Vaud fut moins lourdement frappé; les communautés surent mieux se défendre contre les exigences du prince. Le premier subside que nous trouvions mentionné — après celui de 1399 1 — est celui de 1406; il s’agissait de doter Bonne de Savoie, sœur du comte, qui épousait le prince d’Achaïe. La ville de Moudon versa pour sa part 500 florins (à 14 sous) 2, soit environ 35 000 fr. de notre monnaie.
L’année suivante, après de nombreuses séances des Etats, soit à Moudon, soit à Lausanne, « la patrie de Vaud » fit au prince un don de 1200 florins (près de 72 000 fr.) pour l’entretien de gens d’armes « dans la patrie, contre ceux de Fribourg qui voulaient faire une incursion dans ladite patrie » 3. Les Fribourgeois, qui avaient cautionné le comte, avaient dû payer pour lui certaines sommes à des banquiers bâlois et, pour se récupérer, ils avaient opéré quelques coups de main en terre savoyarde 4. Le compte de la commune de Moudon de 1407 à 1410 porte un versement de 200 écus, ou 220 livres (22 000 fr.), fait au comte pour la dot de sa sœur Jeanne.
En 1413, les villes de Morges et de Cossonay payèrent 100 florins chacune pour le voyage d’outremont d’Amédée VIII 5 et, l’année suivante, la première de /200/ celles-ci lui en versa encore 250 à l’occasion du passage de l’empereur Sigismond 1.
Nous ne savons pas si Moudon paya aussi quelque chose en 1413; en 1414, la ville fit au prince un don de 700 fl. (à 13 sous), environ 45 000 fr. 2. A la même occasion, Payerne faisait un don de 400 fl. 3. Ces chiffres nous indiquent approximativement l’importance respective de ces quatre villes.
Quand, en 1420, Amédée VIII négocia avec le duc de Bourbon l’achat des terres que ce dernier possédait dans la Bresse, il demanda aux communautés vaudoises de l’aider de leurs deniers. Convoqués à Moudon, puis à Thonon, les députés refusèrent 4. Finalement, comme cette acquisition avait été faite quand même, pour le prix de 100 000 écus d’or (1421) 5, les villes vaudoises se résignèrent et payèrent ce que le duc leur demandait 6. Nous ignorons à combien s’élevait cette somme.
Une discussion semblable se renouvela l’année suivante, lorsque le duc acheta le Diois et le /201/ Valentinois 1. Après un premier refus 2, les communes vinrent à composition. Nous savons ce que Nyon paya 3, mais non quelle fut la part de Moudon.
Il y eut, en 1425, une nouvelle demande du prince; mais nous ne sommes pas renseignés sur son résultat 4.
Au cours de l’automne 1427, Philippe-Marie Visconti, duc de Milan, fut vaincu par une coalition dont Amédée VIII faisait partie; il abandonna alors à ce prince la ville de Verceil et épousa sa fille Marie 5. Il s’agissait de doter cette jeune princesse et de payer les frais considérables du splendide trousseau que son père lui donnait 6. Le duc s’adressa, entre autres, aux villes vaudoises dont il avait convoqué les députés à Chambéry 7. Ce ne fut pas sans difficulté que les communautés consentirent au « don gratuit » que l’on exigeait d’elles. Après de longues négociations, au travers desquelles on sent percer l’impatience du prince 8, elles finirent par s’engager à verser un franc d’or (16 sous, soit 80 fr.) par feu; Moudon paya 247 francs d’or (près de 20 000 fr.) 9.
Le 31 août 1432, était célébré en grande pompe, /202/ à Thonon, le mariage d’une autre fille du duc, Marguerite de Savoie, avec Louis d’Anjou, roi in partibus de Sicile et de Jérusalem 1; par contrat, son père lui avait constitué une dot de 120 000 ducats d’or de Gênes (environ 12 000 000 fr.). Il s’agissait pour lui de se procurer cette somme respectable. Il paraît en avoir eu assez des marchandages avec les communautés vaudoises; il essaya de faire acte d’autorité.
Le 21 octobre, les députés du Pays de Vaud qu’il avait mandés auprès de lui comparaissaient devant le duc assisté de son Conseil; là, le prince leur notifiait une ordonnance, datée du 16, qui leur enjoignait de payer, à l’occasion de ce mariage, un subside de deux francs d’or (32 sous ou 160 fr. de notre monnaie) par feu, dans un délai assez rapproché. Les députés des villes voulurent se réserver d’en parler à leurs commettants; ils demandèrent en tous cas une diminution. Le duc leur opposa un refus catégorique : il s’agissait d’un des quatre cas où l’aide féodale était due et les ressources financières ne leur manquaient pas 2. Puis, il prit des mesures pour la perception du subside et menaça de saisie les récalcitrants 3. Cependant, à la suite de circonstances que /203/ nous ignorons, les villes probablement, et Moudon en tout cas, obtinrent un traitement plus favorable; au lieu de deux francs par feu, cette dernière ville n’eut à verser qu’une somme forfaitaire de 360 francs d’or (28 800 fr.); elle obtint en outre une déclaration portant que ce versement était fait « de grâce spéciale » et non comme un dû (16 mars 1433) 1; il importait beaucoup aux bourgeois de faire constater par le prince qu’ils n’étaient pas tenus à l’aide féodale comme les seigneurs vassaux.
A peine cette affaire était-elle finie qu’une nouvelle se présentait, sur laquelle nous sommes mal informés : le duc demandait aux Etats réunis à Moudon en faveur de son fils le comte de Genevois, le futur duc Louis, « des soldats pour le servir » 2. A ce moment les Savoyards firent une campagne en Italie et prirent Chivasso 3; mais les communes vaudoises ne devaient aucun service au delà des Alpes; il semble qu’il s’agisse plutôt d’une forme de l’aide féodale en faveur du jeune prince qui allait être créé chevalier 4. Le fait est que les communes vaudoises s’engagèrent, après de longues discussions, à lui payer l’entretien de deux cents fantassins pendant deux mois. Plus /204/ tard, elles composèrent pour la somme globale de deux mille florins (120 000 fr.) 1.
On le voit, même aux temps prospères d’Amédée VIII, les besoins d’argent de la monarchie savoyarde devenaient si pressants qu’ils forçaient le prince à avoir recours à l’impôt, au mépris des chartes municipales; cela l’obligeait à de pénibles négociations où son amour-propre et son autorité n’avaient rien à gagner. J’ai montré ailleurs que, même quand il obtenait ce qu’il sollicitait, les sommes qui lui avaient été concédées avaient peine à entrer dans le trésor 2. Déjà alors la monarchie savoyarde était sourdement minée par des difficultés financières 3 que des événements imprévus allaient encore aggraver.

Sceau de Bonne de Bourbon
comtesse de Savoie, 1384.
CHAPITRE XIII
L’ADMINISTRATION SAVOYARDE
Nous avons vu que, lorsque Thomas de Savoie se fut emparé de Moudon, il y installa un châtelain 1 et que, plus tard, le comte Pierre fit de ce fonctionnaire un bailli de Vaud 2. Ni son successeur, ni les barons de Vaud ne modifièrent cette organisation, qu’Amédée VI conserva également lorsqu’il rentra en possession de notre pays. Il confia cette charge à un de ses conseillers habituels, François de La Sarra, un des plus grands seigneurs du pays vaudois, qui avait déjà rempli les mêmes fonctions du temps des dames de Vaud et était alors bailli du Chablais 3.
A sa mort, qui survint au bout d’une année, celui-ci fut remplacé par Jean de Blonay 4; quand il mourut à son tour, il eut pour successeur Humbert de Colombier, le plus brillant des seigneurs vaudois de son temps 5, qui fut bailli de Vaud pendant près de seize ans. /206/
Ceux qui vinrent après eux gouvernèrent pendant des périodes plus courtes, mais quelques-uns à plus d’une reprise; ils appartenaient pour la plupart à la noblesse du pays; c’étaient des Blonay, des Estavayer, des seigneurs de la Molière.
Au début du XVe siècle, nous trouvons Louis de Joinville, seigneur de Divonne, qui possédait une partie du Pays de Gex; Gaspard de Montmayeur, fils d’un compagnon d’armes du Comte Vert, lui-même membre du Conseil d’Amédée VII et dévoué à la cause de Bonne de Bourbon; comme son père, il devint maréchal de Savoie 1; Jean de Clermont, familier de Ripaille au temps du Comte Rouge et partisan de sa veuve 2; Amédée de Viry, le plus illustre représentant de cette famille du Genevois qui posséda, entre autres, dans notre pays le seigneurie de Mont-le-Vieux et la ville de Rolle 3; Henri de Menthon, de la plus noble des maisons de la Savoie 4; Jean de Blonay, qui avait ajouté aux terres patrimoniales de sa maison les seigneuries de Carrouge et Mézières qu’il tenait de sa mère, Catherine de Vulliens 5; dans la liste de ces baillis il n’y a qu’un seul personnage de second ordre 6. /207/
Le bailli est à la fois le commandant militaire de la province 1 et l’intendant général du comte 2.
C’est en cette première qualité que nous l’avons vu prendre des mesures militaires lors des menaces des Grandes Compagnies ou veiller à la tranquillité intérieure du pays 3.
Le Comte Vert et son fils, qui avaient donné cette charge à des hommes de premier rang et investis de toute leur confiance, les employèrent très fréquemment dans des missions diplomatiques. Nous voyons chaque année François de La Sarra, Jean de Blonay ou Humbert de Colombier se rendre fréquemment à Payerne, à Morat, à Neuchâtel ou à Berne, ou ailleurs encore, pour traiter d’affaires importantes 4. A cette époque, où la politique savoyarde s’appuyait sur Berne dans sa lutte contre les Habsbourg, c’est le bailli de Vaud qui est, en quelque sorte, l’agent diplomatique ordinaire de la Savoie auprès de la république des bords de l’Aar.
Au XVe siècle, la situation change; nous voyons encore Henri de Menthon envoyé deux fois en de semblables missions 5, ainsi que Gaspard de Montmayeur /208/ et Jean de Clermont 1; Jean de Blonay père, Louis de Joinville 2 et Jean de Blonay fils 3, une fois chacun. Ce n’est pas le cas des autres. Quoique nous ne possédions pas tous les comptes, une chose est claire : quand le bailli n’est pas un personnage de tout premier plan, il n’est pas chargé de missions diplomatiques; celles-ci sont réservées aux Montmayeur et aux Menthon, parce qu’ils sont, en plus, les conseillers ordinaires du prince 4.
Au reste, tandis qu’Amédée VI et Amédée VII, soldats avant tout, laissaient beaucoup d’initiative à leurs gens, Amédée VIII, diplomate par goût, aimait à concentrer entre ses mains tous les fils de la politique savoyarde, qu’il dirigeait lui-même, de son cabinet, et par l’intermédiaire d’un personnel spécial. Il est juste d’ajouter que, sans rompre avec Berne, la Savoie se détachait cependant d’une ville qui devenait trop puissante pour pouvoir servir encore d’instrument à sa politique.
Comme, d’autre part, le pays est paisible, le maintien de l’ordre occupe peu le bailli; c’est à peine si nous le voyons intervenir deux ou trois fois pour surveiller l’état des forteresses ou rétablir la paix publique 5. La charge, visiblement, perd de son lustre. /209/
Aussi entendons-nous, en 1421, le bailli Henri de Menthon se plaindre vivement 1 : que les habitants du pays refusent de l’entretenir, quand il le parcourt pour visiter les forteresses, que la châtellenie de Moudon manque de ressources plus qu’aucune autre, que les revenus dont il dispose ne suffisent pas à payer les dépenses qui lui incombent, que la somme qui lui est allouée pour ses « frais de représentation » est insuffisante, que les fonctionnaires qui dépendent de lui sont désobéissants et négligent leur devoir 2, enfin qu’il n’est pas remboursé de ses avances. C’est là, croyons-nous, la raison essentielle de la mauvaise humeur d’Henri de Menthon. Les princes de Savoie, en effet, avaient la fâcheuse habitude, non seulement de ne pas payer leurs fonctionnaires, mais encore de laisser ceux-ci avancer des sommes parfois considérables et accumuler ainsi entre leurs mains des créances redoutables contre le Trésor 3. /210/
Le duc, qui appréciait les services de son bailli de Vaud, lui promit tout ce qu’il voulut : le paiement de ses gages « le plus tôt que bonnement se pourra » et, pour le moment, une assignation de 200 fl. (environ 12000 fr.) 1, un équipage digne de lui, « comme il faisait à messire Gaspard (de Montmayeur) », en particulier l’entretien de ses sept chevaux quand il viendrait à la cour 2. Il faut croire qu’Henri de Menthon fut satisfait, puisqu’il resta en charge encore sept ans.
A côté de ses fonctions politiques et militaires, le bailli joue le rôle d’intendant du souverain : il est son receveur général et doit lui rendre fidèle compte de toutes les sommes reçues ou dépensées; il doit maintenir en bon état et aux moindres frais les châteaux et les autres bâtiments qui appartiennent au prince; enfin, au 15 mars de chaque année, il doit venir rendre ses comptes devant la Chambre des Comptes à Chambéry 3.
Il est enfin un juge, ou plus exactement, le président de la cour d’appel du bailliage. C’est devant sa cour, /211/ c’est-à-dire devant le grand jury de notables qu’il préside, que sont portées en appel les causes civiles jugées par les cours de justice des châtellenies, et probablement celles jugées par les justices seigneuriales 1. Il semble qu’il ait jugé de même, mais en première instance, les causes dans lesquelles les seigneurs féodaux étaient parties.
Sa juridiction s’étendait sur tout le Pays de Vaud savoyard, soit sur la plus grande partie des cantons de Vaud et de Fribourg.
En outre, le bailli de Vaud était en même temps châtelain de Moudon, c’est-à-dire receveur du prince et président du tribunal de première instance 2. Cette châtellenie comprenait les villages suivants : Denezy, Brenles, Combremont-le-Petit, Rueyres, Combremont-le-Grand, Treytorrens, Champtauroz, Démoret, Villars-Mendraz, Peney-le-Jorat, Carrouge, Servion, Ferlens, Boulens, Corcelles-le-Jorat, Vulliens, Ropraz, Mézières, Montet et Les Cullayes, Syens, Montpreveyres, Martherenges, Essertes, auxquels il faut ajouter : Bussy, Chapelle-Vaudanne, Sottens, Hermenches, Vucherens et la Rappaz, Chavannes, Neyruz, Forel et Thierrens, qui formaient, à proprement parler, le ressort de la cour du châtelain 3. Dans ces derniers villages, en effet, les droits de justice étaient encore entre les mains du /212/ prince 1; dans les autres, ils avaient passé dans celles des propriétaires de fiefs.
Toute cette besogne administrative et judiciaire avait peu d’attrait, on le comprend, pour le bailli, quand celui-ci était un grand seigneur, accoutumé à la vie des camps où à celle des cours. Aussi le bailli se fait-il d’ordinaire remplacer; il a un substitut que l’on appelle lieutenant, ou plus fréquemment châtelain. C’est ce fonctionnaire qui préside la cour de Moudon, qui rend les jugements en son nom, qui tient les comptes, si compliqués alors, et vient les présenter à Chambéry 2.
Parfois, ce lieutenant est un seigneur de l’entourage du bailli 3; c’est plus fréquemment, un bourgeois de Moudon et, de préférence, un notaire 4. C’est, en effet, /213/ une situation qui convient mieux à un homme de loi qu’à un seigneur et cela d’autant plus qu’à mesure que l’on avance, la vie moderne, avec ses préoccupations juridiques, remplace la vie féodale au caractère plutôt militaire.
Nous ne savons pas comment ces fonctions étaient rétribuées; les comptes ne portent aucune indication à cet égard. Il est probable qu’elles permettaient à celui qui en était revêtu de s’enrichir; il est certain qu’elles lui donnaient de la considération; elles le mettaient en rapport avec de grands personnages; elles le rapprochaient du prince; le bourgeois, devenu châtelain, s’introduisait ainsi dans une société plus brillante et, bientôt, il prenait rang dans la noblesse 1.
Nous avons montré ailleurs 2 quels étaient les revenus du bailliage; nous avons vu que le domaine seigneurial, très réduit, ne rapportait plus grand’chose et que les impôts divers, limités par la charte de Moudon, étaient peu productifs, si bien que les comptes soldaient en déficit. Partout en trouve les traces des difficultés financières de la monarchie savoyarde. /214/
Parmi les dépenses les plus régulières et les plus considérables, nous voyons figurer celles que nécessitent l’entretien ou la construction de bâtiments, appartenant au prince.
Nous voyons, par exemple, en 1367, Amédée VI faire faire un pont sur la Mérine; il demanda aux Bernois et aux Fribourgeois de participer aux frais de cette construction, qui facilitait à leurs marchands le transport de leurs ballots à destination de Genève 1. Cette même année et les suivantes, il fait d’importantes réparations à la halle du marché et aux entrepôts qui se trouvaient sur la place du Château 2, afin, sans doute, d’y attirer les marchands. Il charge son architecte de remettre en état les fortifications du lieu 3. On répare aussi les canalisations qui amènent l’eau aux moulins qu’actionnait un bief de la Mérine, ainsi que les fours du comte 4.
Mais, de tous les bâtiments, celui qui coûta le plus fut le château.
Il se trouvait, avons-nous vu 5, aux abords immédiats de la grosse tour; il était composé de plusieurs corps de logis juxtaposés, d’un étage chacun en général, semble-t-il 6; il y avait une chambre réservée au /215/ comte, une grande salle, deux pièces chauffables, deux autres chambres, deux cuisines; dans la cour, où les différences de niveau étaient rachetées par des escaliers, une tribune couverte, aux parois de bois; c’était la salle d’audience où siégeait la cour du bailli de Vaud; au rez-de-chaussée des divers corps de bâtiment, des celliers et des écuries; dans les combles, des greniers et des fenils; dans la cour, un puits; la porte d’entrée était précédée d’un pont-levis; une poterne donnait sur la Mérine et permettait aux habitants du château de sortir sans passer par la ville.
Nous ignorons son emplacement exact que seule une exploration méthodique du sol pourrait nous indiquer; il est très probable qu’il était à l’ouest de la Tour à laquelle il n’était pas immédiatement attenant; les appartements, semble-t-il, donnaient sur la Mérine.
Si nous en jugeons par les réparations que durent faire les comtes de Savoie, le château devait être bien délabré quand ils le reçurent du comte de Namur; la remise en état des toits paraît avoir été particulièrement coûteuse. Ils étaient couverts en bardeaux; c’était une lutte incessante contre les gouttières; chaque année, pour ainsi dire, on était obligé de boucher des trous ou de refaire des pans entiers et l’on employait des milliers de tavillons et des milliers de clous 1.
Il fallut reconstruire entièrement quelques pièces, le puits, le pont-levis, des escaliers; on plaça des chéneaux au bord des toits; sur les créneaux, on mit /216/ des girouettes aux armes de Savoie; on refit une bonne partie de la menuiserie : armoires et portes, les poêles, les serrures et les verrous. La Tour servait de prison : en 1375, des détenus réussirent à démonter la porte et à s’enfuir; on fit alors d’assez sérieuses réparations; plus tard, on compléta la couverture du toit de celle-ci par des tuiles que l’on fit venir de Soleure. Vers la fin du siècle, on refit l’installation des latrines et on créa un poulailler.
Le bâtiment paraît avoir été alors à peu près complet : les clefs étaient aux serrures et le garde-manger 1 était prêt à recevoir des provisions de viande salée. Mais, ne nous faisons pas d’illusions, le château de Moudon était de modestes dimensions comme de modeste apparence; les pièces étaient boisées, ou même séparées par de simples cloisons de planches; les planchers étaient faits de terre battue, même celui de la grande salle de réception. Les comptes portent l’indication des salaires payés aux charpentiers et aux maçons, aux premiers surtout; aucun tailleur de pierre, aucun peintre n’y figure. Le mobilier se composait simplement de bois de lits, de tables et de bancs. Moudon n’était pas Chillon.
Voici, du reste, un document qui nous renseignera : l’inventaire dressé le 11 septembre 1408 2, au moment /217/ où Jean de Clermont entrait en charge comme bailli de Vaud; au nom de son prédécesseur, Louis de Divonne, Girard d’Illens, son lieutenant, lui remettait les meubles suivants : sur le pont, à l’entrée du château, une grosse bombarde ferrée 1, dans la cuisine, deux mortiers en une seule pierre, un pizon 2; dans la grande salle, deux grandes tables, un buffet, des bancs tout autour 3; dans la petite chambre chauffée, deux petites tables 4; dans la chambre du comte, un bois de lit 5; dans la petite chambre à côté, un bois de lit 6; dans la grande chambre des écuyers, une table, un bois de lit et quelques bancs 7; dans la grande chambre chauffée, un dressoir 8.
Un inventaire subséquent nous apprend qu’à côté de la grande salle il y avait une dépense 9 et, à côté de la grande chambre chauffée, une autre chambre 10. Ajoutons des latrines, des écuries avec deux mangeoires et deux râteliers et, dans un coffre, deux mesures d’avoine. La porte du château était à deux battants /218/ et solidement ferrée; une sorte de chemin de ronde défendait le pont-levis; sur le toit de la grande cuisine, on pouvait voir une guérite, destinée au guet. Avec la grosse tour, beaucoup plus élevée alors qu’aujourd’hui, c’était tout ce qui dépassait le niveau des toits.
On avait dépensé beaucoup d’argent dans le château au cours des quarante dernières années du XIVe siècle. Frais inutiles, semble-t-il, car dès le début du XVe, il fallut tout recommencer.
Bâtis, comme on le faisait alors, en cailloux roulés, boulets et têtes de chats, de résistance inégale aux intempéries, liés avec des mortiers insuffisants, les murs ne duraient guère; bientôt, ils se désagrégeaient, « pourrissaient et tombaient en ruine », disent les comptes. Les toits en bardeaux ne résistaient pas longtemps au vent et à la neige; les poutraisons étaient attaquées par l’humidité provenant des gouttières ou entraînées par l’effondrement des murs.
Malgré les inspections régulières des architectes savoyards 1, malgré les réparations quasi-annuelles, l’état du château était lamentable. Le 6 mai 1413, le bailli Jean de Pitigny faisait constater par devant témoins que tous les toits tombaient en ruine, sauf celui de la petite chambre.
Le bâtiment était en si piteux état qu’il semble qu’Amédée VIII s’en soit ému. Dès l’année suivante, son fidèle architecte Aymonet Corviaux 2 vient à Moudon; il fait un examen sérieux du château et /219/ ordonne des réparations que l’on commence aussitôt; elles vont se continuer, année après année, pendant vingt ans.
L’architecte ordonna la démolition de deux pièces qui étaient trop délabrées 1; il fit étayer les parties menacées; on refit entièrement le plancher et le plafond de la chambre du comte 2; dans les années qui suivirent on reconstruisit le mur de la grande cave, qui menaçait ruine au grand préjudice du bâtiment.
Puis, on éleva un mur de trois pieds et demi (un mètre env.) d’épaisseur à la place des chambres que l’on avait démolies 3. En 1417, on entreprit des travaux plus importants : la construction, du côté du nord, d’un gros mur de soutènement de dix pieds (3 m.) de largeur à la base, ramené peu à peu à une épaisseur de cinq pieds à la hauteur des appartements; ce mur est fondé sur le roc; les assises inférieures sont faites de quartiers de tuf ou de molasse taillés. Il est soutenu par un contrefort massif, en blocs de même matière 4.
Ce gros ouvrage se fait très lentement, tant à cause des difficultés qu’il présente que de son coût; chaque année, on en construit un morceau, pendant la bonne saison; quand vient l’hiver, ou quand les crédits /220/ sont épuisés, on recouvre le tout de planches pour le protéger contre le gel.
En attendant, le château conserve un air fort délabré. Le 21 mai 1418, le bailli Henri de Menthon fait constater qu’il manque des planches au pont, qui est quasi tout découvert; que, si quelques pièces ont des poutraisons neuves, la grande salle est dans un état lamentable : le mur du côté d’en bas s’effondre, ainsi que le plafond et le plancher; dans la Tour, qui a trois étages, il manque des planches aux planchers et des poutres sont brûlées.
On poursuivit les réparations 1, mais d’une façon insuffisante, sans doute, car, en 1421, Henri de Menthon écrivait au duc : « Pour ce que la lettre de constitution 2 dudit bailliage faite audit Sr de Menthon contient que il doive rendre le châtel de Moudon à Monseigneur ou à ses successeurs sous l’obligation de tous ses biens, et [que] le dit châtel est déroché et est impossible à lui de le pouvoir garder, s’il venait guerre ou rumeur 3 du peuple, [c’est] pourquoi il demande à mon dit seigneur lui être pourvu en ladite constitution que, si le cas advenait que ledit châtel se perdît — que Dieu ne veuille — que ledit seigneur de Menthon ne fût point dommage 4 de ce qui lui serait impossible pour le garder ». 5 /221/
A ce moment, une partie du gros mur commencé s’effondrait; le pont de l’entrée du château tombait en ruine et devait être refait entièrement et il fallait garder à vue les prisonniers si l’on voulait qu’ils ne pussent s’enfuir 1.
Lors de son inspection, le 9 juin 1427, Aymonet Corviaux constatait que des réparations urgentes s’imposaient encore : il fallait mettre une porte à la poterne neuve « pour que les gens ne pussent pénétrer dans le château », canceler une poterne et munir l’autre d’une solide porte « afin que les prisonniers soient mieux gardés », etc. 2 Mais, quelque nécessaires que fussent ces travaux, rien ne fut fait cette année-là, faute d’argent 3.
L’année suivante, le duc mit à la disposition de son architecte les fonds nécessaires 4 et, dès l’été, les travaux reprirent. On commença par des démolitions et l’on employa les matériaux pour remblayer derrière le mur neuf. Entreprise malheureuse, car ce gros mur, qui avait coûté tant de peines et tant d’argent s’effondra en partie sous le poids, entraînant avec lui des masses de terre; il fallut 377 journées de manœuvres pour déblayer le terrain. Travail dangereux du reste, /222/ car un pan du mur restait suspendu sur le vide et l’on avait toujours à craindre un nouvel accident. Aussi bien, découragé, renonça-t-on à l’ancien projet. L’automne était là; on se hâta de reconstruire un mur de trois pieds et demi seulement. A peine s’était-on mis au travail, que, par deux fois, sous l’effet de pluies abondantes, de nouveaux glissements de terrain se produisirent; il fallut tout recommencer, et cela coûta fort cher 1; la peste et la famine avaient ravagé le pays et provoqué une raréfaction de la main-d’œuvre, si bien que les paysans, que l’on chargea de ce travail, purent exiger le salaire qu’ils voulurent 2.
Les comptes des années suivantes manquent; quand nous les retrouvons, en 1432/3 et 1433/4, on est toujours en train de construire le gros mur de soutènement, sans parler de l’entretien des toits. Le travail ne fut terminé qu’en 1436 : nous voyons alors que l’architecte fait couvrir d’un chemin de ronde et d’un toit en bardeaux tout le mur neuf. Cette mesure n’est pas dictée, comme on pourrait le croire, par des préoccupations militaires seulement; elle a essentiellement pour but de mettre à l’abri des intempéries le résultat de travaux si longs et si coûteux : plus de 180 000 fr. de notre monnaie 3, en effet, avaient été engloutis dans les réparations de ce château, qui n’était ni bien grand, ni bien luxueux. /223/
A partir de 1436, il n’y a plus de gros travaux, soit que, après tant de sacrifices, il n’y ait eu plus rien à faire, soit plutôt que le manque de ressources financières ait tout arrêté, sauf les petites réparations d’entretien les plus urgentes.
En 1445-1446, ce sont les parois de la salle d’audience que l’on refait, travail inutile puisque, en juin 1459, un incendie l’anéantit 1; on la reconstruisit l’année suivante; nous apprenons par les comptes qu’elle avait 16 pieds sur 25 (environ 4 m. 80 sur 7 m. 50); elle était adossée à un autre corps de bâtiment, car son toit n’avait que trois pans. Elle était placée à l’entrée du château, près de la porte; celle-ci était précédée d’un pont couvert, comme à Chillon aujourd’hui, supporté au milieu par un chevalet; il avait environ 12 m. de long; ce n’était plus un pont-levis. Deux ans plus tard, le toit de la Tour, vieux de près de cent ans, fut recouvert à nouveau; au sommet on plaça deux hampes portant des girouettes en fer blanc aux armes de Savoie.
Ce sont les derniers renseignements un peu précis que nous possédions : en 1464, on rencontre la mention des appartements du château; c’est la dernière fois; en 1481-1482, les comptes nous parlent encore de la salle d’audience. Dès 1485, il n’est plus question que de la Tour; le château a complètement disparu, nous ne savons ni quand ni comment 2.
Au début du XVe siècle, le château servait d’arsenal : /224/ dans une des chambres, chauffable mais inhabitable 1, on trouvait en 1413 2, onze balistes, dont une cassée, trois rouleaux 3, deux caisses de virotons 4 sans fers, 63 fers de lances, 192 fers de virotons 5; une petite bombarde dans la cour 6 complétait les ressources défensives du château; elles étaient bien modestes 7.
*
* *
Vers la fin du XVe siècle, quand l’administration savoyarde eut renoncé aux constructions coûteuses, les comptes de la châtellenie se présentèrent sous un jour plus favorable. Celui de 1482/3 boucle par une redevance du bailli de 370 fl. 5 sous et une fraction (22 200 fr.); ce fonctionnaire a versé en outre au Trésor 529 fl. 11 sous (31 800 fr.) 8. Le compte de l’année précédente se terminait aussi par un boni 9; certaines dettes ont été amorties en partie. Cependant, /225/ malgré les observations de la Chambre des Comptes, le bailli, ou ses sous-ordres, semblent assez négligents dans la perception des redevances 1; ils laissent mourir les débiteurs sans exiger d’eux ce qu’ils doivent; ils affirment ensuite que ceux-ci n’ont pas laissé d’héritiers 2.
Plus tard, lorsque Marguerite d’Autriche reçut le Pays de Vaud comme douaire 3, elle en afferma les revenus 4. C’était, pour elle, la manière la plus pratique d’échapper à la mauvaise volonté des fonctionnaires ducaux. Son premier fermier, Antoine Voudan, lui payait 5000 fl. (250 000 fr.), à charge par lui d’entretenir les bâtiments 5. Ce chiffre peut être considéré comme celui du revenu net du domaine savoyard dans notre pays à la veille de la conquête 6.
CHAPITRE XIV
LES HABITANTS DE MOUDON
Nous avons vu 1 le rôle important joué aux siècles précédents par la famille de Vulliens; il diminue à mesure que l’on avance : la famille se partage en plusieurs branches et tombe en quenouille au début du XVe siècle 2; ses biens passent en diverses mains : à Rod. de Langin 3, à Jean de Blonay, à qui sa femme, Catherine, héritière d’Antoine Cornu, apporte les rentes assignées sur la châtellenie 4 et la seigneurie de Carrouge; à Othonin et Girard de Bonvillars qui ont Ropraz et quelques biens à Moudon /227/ même 1; enfin à la maison de Fernex-Lullin. C’est elle qui a la plus grosse part. Isabelle de Vulliens, fille d’Antoine l’aîné, veuve de Pierre de Fernex, laissa en mourant 2 au mari de sa petite-fille, Rod. de Chastonay, des droits sur six maisons au Château 3 et à son fils, François de Fernex-Lullin, sa grande maison de pierre au dit lieu, côté Broye 4, des droits très nombreux sur des maisons en ville et hors de ville, la seigneurie de Vulliens, Sépey, Willenjaux, etc. 5, ainsi qu’une part de la seigneurie de Chapelle sur Moudon.
Dès lors nous rencontrons fréquemment le nom de François de Fernex dans les documents moudonnois 6 et, après lui, celui de son héritier, Thomas de Genève, mari de sa sœur Guillemette de Fernex. Celui-ci, d’une branche bâtarde de la famille des comtes de Genève, est l’ancêtre de la maison de Genève-Lullin 7, dont nous retrouverons le nom au cours de cette étude. /228/
A côté d’eux et des donzels de Servion, déjà mentionnés plus haut 1, la noblesse est représentée encore par les vidomnes, de la famille de Donneloye, puis Provana 2, et par les Daillens, qui sont aussi coseigneurs de la Molière. Ils possèdent une maison à la Bâtie et des biens aux alentours 3, nous ne savons à quel titre. L’un d’eux, Guyonnet de Daillens, résidait volontiers à Moudon 4, où il exerçait une certaine influence 5, que ses héritiers 6 ne conservèrent pas.
Au début du XVe siècle, un bâtard joua un rôle important à Moudon, tout autant que bien des représentants authentiques de la noblesse broyarde. C’est /229/ Nicod d’Illens, donzel, fils de Jean d’Illens, de Cugy (Fribourg) 1. Nous ne savons pas pourquoi il vint à Moudon; avant la fin de l’année 1414 2, il y épousa la fille unique d’un des plus riches bourgeois de la ville, Jeannet Serragin 3; sa femme mourut de bonne heure en lui laissant toute sa fortune 4. Il est dès lors un gros personnage : il habite la maison des Serragin au Coude; il est propriétaire de la moitié du village de Chapelle 5; il devient conseiller de l’hôpital et syndic de Moudon 6; il fut châtelain de Bercher de 1426 à 1440 7, soit pendant tout le temps où cette seigneurie fut entre les mains du duc de Savoie.
Tout près de la noblesse, nous retrouvons ces familles de grands bourgeois, dont nous avons vu naître la fortune 8. Et tout d’abord, les Glane. Thomas mourut peu après février 1360 9; le seul fils qu’il laissât, /230/ Henri, hérita de la seigneurie de Villardin; son mariage avec Isabelle de St-Martin lui apporta celle de Brenles 1. En mai 1370, nous le voyons accompagner le bailli de Vaud à Payerne 2; dès lors, il fait partie de son escorte, en temps de paix comme en temps de guerre 3. Depuis le début du XVe siècle, son nom apparaît plus rarement et, quoiqu’il ait vécu jusqu’en 1416 au moins 4, il semble ne plus jouer de rôle 5; c’était un vieillard, sans doute, et son âge ou sa santé l’avaient obligé à laisser la place à son fils unique, Jaques de Glane. Celui-ci est un personnage de premier plan; son nom revient constamment dans les documents de cette époque. Il est châtelain d’Estavayer 6; il fonctionne comme arbitre entre les gens de Bulle et de Vuadens 7; il vit dans l’entourage du bailli de Vaud ou de son lieutenant, qu’il accompagne /231/ dans leurs ambassades 1; il va même seul en mission à Berne, en l’absence du bailli et de son lieutenant 2. A plus d’une reprise, le comte le mande auprès de lui pour prendre son avis 3; dès 1413 4, il est qualifié de donzel et, en 1428, il porte le titre d’écuyer du duc de Savoie 5. C’est lui qui eut l’honneur de recevoir chez lui l’empereur Sigismond de Luxembourg, lorsqu’il passa à Moudon, le 25 juillet 1415 6. Il était aussi bien vu des communes que des princes, puisqu’il représenta celles-ci fréquemment et, en particulier, à Chambéry en 1434 7. En 1425, il était commissaire et juge en appel dans les terres vaudoises de Louis de Chalon, prince d’Orange 8. Il siégeait régulièrement au Conseil de Moudon 9 et il était fort riche 10, ce qui ne gâte rien. /232/
Les Cerjat 1 grandissent aussi, mais sans arriver toutefois à ce degré d’importance. A la fin du XIVe siècle, la famille est représentée par deux frères, Nicod et Rodolphe 2. Le second est, dès le début du XVe siècle, un des bourgeois marquants de Moudon; il possède plusieurs maisons au Château 3; il fait partie du Conseil de la ville 4; il est métral 5, arbitre dans des procès importants 6, lieutenant du bailli de Vaud 7, qu’il accompagne, lui aussi, dans ses voyages diplomatiques 8, écuyer et exécuteur testamentaire de l’évêque Guillaume de Menthonay 9. A cette occasion, il est appelé donzel; cependant, il ne porte le /233/ qualificatif de noble que dans la lettre d’armes, accordée à sa famille par l’empereur Sigismond, le 9 octobre 1415 1. Depuis 1420, ses descendants portent régulièrement ce prédicat 2. L’un de ses fils, Antoine, fut syndic de Moudon dès 1432 3.
D’autres familles s’éteignent; celle des Girard, par exemple, dont l’unique héritière apporte les biens à Jeannet Serragin 4. Boucher 5, entrepreneur 6, meunier 7, aubergiste 8, gros propriétaire, il est un des exemples les plus caractéristiques de l’enrichissement des bourgeois. Il achète à Perronet Vionnet son domaine de Chapelle 9, alors que la fortune de ce dernier subit quelques échecs 10, sans cependant aller jusqu’à la ruine; Perronet Vionnet reste un homme /234/ considéré ainsi que son fils, Rodolphe, après lui 1. Déjà riches, les Arma 2 accroissent leurs ressources par des héritages 3 et leur situation par des mariages avantageux. Pierre Arma 4, qui est au début du XVe siècle le chef de la famille, occupe à Moudon une des premières places 5.
*
* *
Au nombre des gens importants figurent les notaires; ils créent de véritables dynasties : tel Perrod de Syens, dans la seconde moitié du XIVe siècle; fermier des revenus judiciaires de la châtellenie dès 1355 au moins 6, lieutenant du bailli 7, il laisse un fils, /235/ Guillaume Chartreir, qui lui succède dans ses offices et dignités 1; Antoine Chartreir, son petit-fils, est notaire à son tour et prend rang dans la noblesse 2.
Le notaire Jean Serragin 3 tient la plume auprès de plusieurs baillis de Vaud 4 qu’il accompagne dans leurs missions, comme un véritable secrétaire de légation 5, et qu’il remplace à l’occasion avec le titre de châtelain 6; il siège au conseil de Moudon 7.
A la même profession appartiennent, pour ne citer que quelques noms : Jean et Jaques Valacrêt 8, Uldriod /236/ Ysabel 1, Jean Jolivet 2, qui fut aussi châtelain de Moudon, Jean Landry, qui devint procureur de Vaud 3, Antoine Bruyvaud 4, Antoine de l’Etang 5, Pierre de Sarandin, François Champagniod, qui était originaire d’Yverdon, Jean de Treytorrens 6, l’ancêtre d’une famille qui s’est illustrée par la suite et qui vient de /237/ s’éteindre, d’autres encore, plus obscurs et qui ne nous sont plus connus que par les actes qu’ils ont rédigés.
On le voit, tous ces hommes gravitent autour du bailli et l’on saisit l’importance de sa présence pour Moudon, qui devient une ville d’hommes de loi. Juge et magistrat suprême, le bailli ne peut se passer de leur expérience et de leur plume. Ils en profitent; ils prennent à ferme les fonctions publiques 1 et la rentrée des impôts 2, dans la châtellenie et au dehors 3. Ils y trouvent honneurs et profits. Ce n’est pas que le métier soit sans risques : il arrive à ces fermiers généraux au petit pied de s’être trop engagés; mais le seigneur est équitable et, de plus, ses besoins d’argent le mettent à leur merci; nous le voyons rembourser aux héritiers de l’un d’eux les pertes qu’il avait subies au cours des six années de son bail 4. Nous n’en avons rencontré aucun qui se soit ruiné; la plupart ont fait fortune et plusieurs sont arrivés par là à prendre rang dans la noblesse.
Les bourgeois les plus notables, nobles et roturiers, notaires ou artisans, forment la cour de Moudon. /238/ Le bailli ou le châtelain qui la préside a le droit, semblet-il, de la composer à son gré; mais un usage auquel il ne peut se soustraire et le souci d’une bonne justice l’obligent à convoquer les bourgeois dont l’opinion a quelque poids, même quand les plaideurs sont nobles. C’est ainsi qu’en 1366-7, le comte d’Aarberg ayant été cité devant la cour du bailli de Vaud, Ant. Thorein, ainsi que le notaire Rod. Pallière, qui fonctionne comme greffier, assistent le châtelain et le bailli et siègent aux côtés des nobles seigneurs, pairs de l’accusé 1.
Souvent, le bailli emmène avec lui les jurés de la cour, ou coutumiers, pour prononcer dans des cas graves ou embarrassants : ainsi, en mars 1378, quinze d’entre eux l’accompagnent à Yverdon où il s’agit de juger un homicide; d’autres vont à Rue 2; en janvier 1389, quelques-uns vont à Morges à propos d’un procès entre les seigneurs d’Orbe et de Grandson 3. Ce ne sont là que quelques exemples.
En ces temps où le droit n’est pas écrit, ce sont ces hommes d’expérience qui établissent la coutume ou, si l’on veut, qui déclarent quelle est la loi applicable au cas litigieux. Tous s’inclinent devant leur prononcé. Survient-il quelque part dans le pays une affaire délicate ou compliquée, le bailli a recours à leur science, les parties s’en remettent à leur arbitrage 4, le souverain lui-même leur demande leur avis. Ce fut /239/ le cas lorsque s’ouvrit, en 1406, la succession de Jeanne de Cossonay 1 ou, en 1433, celle du comte Antoine de Gruyère 2. Amédée VIII les mande alors, et à plus d’une reprise 3, auprès de lui pour avoir leur opinion, et les documents n’hésitent pas à appeler deux d’entre eux ses conseillers et coutumiers ordinaires 4.
Ne nous étonnons donc point de voir ces hommes riches et considérés convoqués avec les vassaux du comte qu’ils servent à cheval, comme les seigneurs féodaux 5.
Il y avait encore à Moudon des officiers de justice de rang inférieur : le métral, à la fois juge et fonctionnaire 6, le sautier, qui était une sorte d’agent de police 7, et, depuis 1362 8, un forestier, chargé de défendre les bois du seigneur, et qui semble avoir eu /240/ fort à faire, au début surtout 1. A cette liste, il faut encore ajouter l’huissier de la châtellenie; ces fonctions étaient confiées à d’honnêtes bourgeois, parfois aubergistes de leur métier 2, qui, outre les devoirs ordinaires de leur charge, remplissaient celui de messager officiel du bailli 3; à un moment donné, ce rôle fut dévolu à un musicien allemand, que les comptes appellent Henseli Minestre, Jean le ménétrier; ce personnage, sans métier bien défini, semble avoir été, un temps, l’homme à tout faire des gouverneurs du pays de Vaud 4.
Les comptes de la châtellenie nous donnent aussi les noms de quelques personnages qui n’appartiennent pas à la magistrature, mais servent le seigneur de leur art : le premier est cet habile mécanicien, dont j’ai déjà parlé 5, constructeur de machines de guerres, /241/ charpentier, ingénieur 1, comme on l’appelle parfois; il est établi à Moudon où il exploite, avec ses fils 2, des moulins que le comte lui loue. Entre temps il surveille l’état de ses châteaux, préside aux réparations 3, sans cesser de diriger son artillerie 4. Il sert fidèlement, à Moudon comme à Ripaille 5, un maître qui le paie irrégulièrement 6.
Le second est un chirurgien, qui semble avoir joui d’une certaine réputation 7; il accompagne l’armée, lorsqu’elle est mise sur pied 8, ce qui lui valut sur ses /242/ vieux jours une pension du comte. Le troisième est un artisan, un maître de forges, Perrod Apparellie, auquel le comte avait permis d’établir une usine, au pied de la colline du Château, en ville, sur le bief de la Mérine 1. Il y fabriquait des armes : dans l’inventaire du château on parle de fers de lance « au signe de Perrod Apparellie 2 »; il vendit même, pour la somme considérable de 120 écus d’or, une bombarde de fer au comte de Savoie 3. C’était un personnage de marque : nous le voyons accompagner, avec deux chevaux, le procureur de Vaud et le bailli dans une ambassade solennelle à Morat, où ce dernier va renouveler l’alliance avec Berne 4; il est un des hommes de confiance de la ville 5. Un autre bourgeois, qui, un peu plus tard, installa un martinet pour battre le fer et le cuivre, ne paraît pas être parvenu à une égale fortune 6.
*
* *
On continue à rencontrer à Moudon des banquiers italiens 7 qui paient une redevance au comte; en 1353, ce sont : un citoyen d’Asti, Aymonet Asinier, et trois /243/ ressortissants de la ville de Carignan : François de Medicis, Georges et Boniface de Bonaceriis 1. Bourgeois de Fribourg et de Genève, où ils étaient propriétaires d’une maison de banque, les deux premiers n’ont pas résidé à Moudon; leurs deux autres associés, inconnus par ailleurs, y tenaient sans doute une succursale. En 1364, dans des circonstances que nous ignorons 2, le prêt à intérêt leur fut interdit et ils durent fermer leur maison à la Noël; pendant plus de quinze ans la banque de Moudon fut inoccupée; elle se rouvrit en décembre 1380 3 et Dominique Bonacerii 4 l’exploita de nouveau, avec des associés qui ne sont pas nommés. Dix ans après, comme son bail arrivait à échéance, il mourut et personne ne lui succéda 5; la redevance qu’il payait au comte n’était cependant que des trois cinquièmes de celle de ses prédécesseurs 6. /244/
Faudrait-il en conclure qu’il y eut à ce moment-là une dépression économique ? que Moudon passa par une crise financière ? C’est une possibilité; d’autres indices encouragent cette supposition 1. On pourrait en trouver la cause dans la peste de 1349, qui, avec une récidive vers 1360 2, avait décimé la population du pays. On pourrait supposer aussi que le progrès économique rendait inutile le genre d’affaire des prêteurs lombards; les banquiers florentins et génois les remplaçaient dans les places importantes 3, tandis que, dans les localités plus modestes, des bourgeois faisaient la petite banque.
Comme, en vertu de la charte, les boulangers et les bouchers payaient une redevance au comte, nous savons exactement, année par année, quel était leur nombre : il varie d’une manière très brusque d’une année à l’autre, sans que nous sachions bien pourquoi. En 1358, il y a 27 boulangeries et 12 boucheries; il y en a 34 et 16 en 1360; entre 1388 et 1399, le nombre des boulangeries varie entre 10 et 15, il est de 9 en 1402 et descend à 6 en 1416 et années suivantes; pour les boucheries, le chiffre varie d’abord entre 6 et 2, pour rester définitivement à ce dernier point dès 1409 4. /245/
Cette diminution progressive est-elle due, elle aussi, à une crise économique ? Faut-il en conclure que l’effort de quelques individus réussit à concentrer entre quelques mains l’exercice de ces professions ? Nous ne savons 1.
Nous ne trouvons, à cette époque à Moudon, aucune trace de corporations. La ville est trop petite pour cela. Le métier qui semble grouper le plus de personnes est celui de tisserand 2. Ces artisans, particulièrement nombreux, habitent pour la plupart la même rue; dès la fin du XIVe siècle, elle prend le nom de rue ou, dans la langue de l’époque, rang des Tissots 3, qu’elle a conservé jusqu’à aujourd’hui. A côté d’eux travaillent les tondeurs de drap 4.
A la même époque, l’industrie de la laine enrichissait Fribourg 5. Il ne semble pas cependant que des influences fribourgeoises se soient exercées à Moudon. Aucun tisserand n’y est venu de cette première ville, à notre connaissance du moins; sans doute /246/ interdisait-elle toute émigration qui aurait pu profiter à une cité concurrente. Les tisserands de Moudon paraissent être de pauvres gens, venus des villages des alentours 1. Ils habitent un quartier retiré; leurs maisons sont très modestes, des masures parfois 2; et, pour se procurer le petit capital qui leur est nécessaire, ils doivent recourir à l’emprunt 3. La plupart ne sortent pas d’une situation très précaire. Rares sont ceux qui arrivent à une modeste aisance; ils peuvent, alors, prendre à ferme la perception de quelque impôt 4 et leurs enfants deviennent des gens importants 5.
La commune de Moudon s’intéressa à cette industrie qui pouvait faire la prospérité d’une ville : nous la voyons conclure avec l’évêque un accord sur les droits que devront payer à Lausanne les marchands de Moudon qui y vendront des toiles de fil ou de chanvre 6; de son côté, suivant la coutume du temps et poussé /247/ par des préoccupations fiscales, le comte de Savoie était intervenu, pour contrôler la fabrication des étoffes 1. Malgré cela, Moudon ne devint jamais une ville industrielle comme Fribourg 2.
Il y avait, sur la place du Château, une halle, destinée à servir d’entrepôt aux marchandises 3; elle appartenait au seigneur, qui l’entretenait; nous le voyons la faire recouvrir de bardeaux et y réparer les dégâts causés par la neige 4. Désireux de favoriser le commerce dans ses états, Amédée VIII la fit reconstruire en 1416 : on y plaça 14 colonnes de bois, dont les plus courtes avaient 3 m. 60 et les plus longues 7 m. 50; elles reposaient sur des bases de pierre; il fallut 50 000 bardeaux pour couvrir le toit 5. Une dizaine d’années plus tard, on y fit placer des bancs, /248/ sur lesquels les marchandises pouvaient être étalées 1. Le duc, du reste, protégeait les marchands qui étaient ses sujets, jusque dans les pays voisins : ayant appris qu’un individu du Montbéliard a prononcé des menaces contre eux, il envoie aussitôt demander des explications aux autorités de ce pays 2.
Mais tous ces soins ne réussirent pas à faire de Moudon une ville riche. Si quelques individus purent y faire une jolie fortune, la masse des habitants restait dans une situation très médiocre et l’argent y était rare en comparaison de la ville voisine de Fribourg; aussi était-ce là que l’on allait en emprunter en cas de nécessité 3.
*
* *
A côté des laïques, les ecclésiastiques : Moudon possède de nombreux prêtres : en 1391, ils sont 17 au moins 4; en 1421, nous en trouvons au moins 14 5, sans compter le recteur de l’hôpital St-Jean et le curé, qui réside, semble-t-il 6. L’accroissement du clergé s’explique par les fondations religieuses que /249/ nous avons signalées plus haut 1. Chaque autel a son chapelain, qui souvent est en même temps curé d’une paroisse voisine 2; cela lui permet d’habiter Moudon, dont beaucoup d’entre eux sont bourgeois 3.
Mais, à part une collection de noms propres, nous savons peu de chose de la paroisse de Moudon. Comme dans le reste du diocèse, la visite de l’église fut faite en janvier 1417, mais le procès-verbal n’est que commencé, le reste de la page est resté blanc 4 et nous ignorerons toujours l’impression des visiteurs. /250/
Il semble qu’entre le clergé et la ville il y ait eu quelques difficultés. En 1416-7, le Conseil avait à se plaindre du curé, nous ne savons pourquoi 1; en 1421 la ville se plaignait de ce que le curé refusât de donner aux grandes fêtes un repas aux clercs, aux notaires et aux chapelains, — ce qui devait faire une nombreuse assistance — qu’il n’entretînt qu’une lampe au lieu de trois dans l’église St-Etienne et ne fît pas sonner les cloches chaque matin 2. Ce conflit d’ordre purement matériel, fut remis à l’arbitrage de l’évêque; nous ignorons son prononcé.
D’autres documents nous apprennent que la générosité des fidèles continuait à enrichir l’Eglise. C’était la ville elle-même qui pourvoyait à l’entretien des édifices dédiés au culte et à leur embellissement, ainsi qu’à celui du mobilier 3. Les particuliers continuaient à doter des autels 4, à fonder des messes et des /251/ anniversaires 1. Toutefois, il nous paraît que la valeur des dons est moindre qu’auparavant 2, ce qui pourrait être le signe d’une moindre ferveur; nous ne rencontrons pas moins de gens qui se vouent à l’Eglise 3, mais on peut se demander parfois si le souci de faire carrière ne l’emporte pas sur la vocation, tel ce Pierre Montauz qui, quoique mineur encore, est recteur de l’hôpital du Mont-Joux dont les biens sont administrés par son père 4. Durant le premier tiers du XVe /252/ siècle, nous ne trouvons aucun Moudonnois qui soit entré dans un couvent 1, ce qui vient à l’appui de notre affirmation de tout à l’heure.
Les églises de Moudon étaient-elles riches ? Nous ne le savons pas. Nous avons bien un registre qui contient l’inventaire des biens de St-Etienne au début du XVe siècle 2, biens dont le revenu ascende à 10 liv. et 12 sous (un peu plus de mille francs), plus des redevances en nature 3, mais il est manifestement incomplet 4 et il ne concerne pas les chapelles, qui avaient chacune leur fortune propre 5.
*
* *
Par ailleurs, nous savons peu de chose des gens de Moudon. Comment se faire une idée un peu nette d’une société que nous ne connaissons que par des actes /253/ notariés ? Faut-il s’étonner que les préoccupations d’intérêts mesquins et le goût des procès semblent y dominer ?
Les comptes de la châtellenie, qui nous donnent parfois la liste des amendes perçues, nous les montrent portés aux injures et aux voies de fait. Ils se traitent volontiers de punais (puant) ou de mésel (lépreux) 1; ni les femmes 2, ni l’huissier 3, ni même le bailli et son lieutenant 4 ne sont à l’abri d’imputations venimeuses. Dans ce dernier cas, cela coûta fort cher au délinquant : plutôt que de laisser l’affaire suivre son cours, il préféra composer pour 50 florins (3000 fr.).
Les amendes pour coups et blessures sont plus nombreuses; on ne respectait ni les femmes 5, ni les prêtres 6, ni les étrangers, des marchands sans doute, qui étaient sous la sauvegarde du seigneur 7, ni même certains officiers de justice 8, et les femmes ne sont pas de complexion moins rude que les hommes 9.
Généralement, les amendes infligées — fixées du reste par la charte dans la plupart des cas — restent dans les limites des condamnations de nos tribunaux /254/ de police et vont de 2 à 60 sous (10 à 300 fr.) 1. Voici le cas le plus grave que nous ayons rencontré : il peint les mœurs du temps. Jean d’Allemagne, c’est-à-dire un domestique suisse allemand, au service de Fr. de Bussy, avait menacé son maître de voies de fait; celui-ci porta plainte; le coupable fut incarcéré à Romont; son maître demandait qu’on lui coupât la langue pour le punir; mais comme les menaces ne pouvaient être absolument prouvées, le malheureux fut relâché moyennant un versement de 100 florins (6000 fr.) 2. De quoi faut-il nous étonner le plus ? de la cruauté du plaignant ou de la justice du bailli ? Le fait que celui-ci touchait le quart des « compositions » peut expliquer son attitude; ce qu’il y a de plus surprenant, c’est que l’accusé ait pu se procurer cette somme.
Ajoutons encore les petits délits contre la propriété et les contraventions administratives : violations de domicile 3, prise injustifiée de gage ou distraction d’objets saisis 4, menus larcins 5, parjure 6, délits forestiers ou ruraux 7, contraventions aux prescriptions /255/ relatives à la boucherie 1, aux poids et mesures 2, à des règlements que nous ignorons et qui interdisaient l’exportation du blé 3, refus de prendre part à la chevauchée 4, etc.
Au demeurant, ces vieux Moudonnois n’étaient pas méchants et les documents qui nous sont parvenus nous ont transmis le souvenir d’un seul crime, commis en 1368, contre un Etienne Roberti 5.
Mais le fait que Moudon était le siège de la cour suprême du bailliage lui valut parfois de voir incarcérer dans la Tour des criminels de marque, voleurs de grands chemins, rebelles notoires 6 ou fonctionnaires accusés de prévarications 7. Plus d’une fois même, les bourgeois purent assister à des exécutions capitales, spectacles qui leur répugnaient moins qu’à nous. Nous en avons déjà signalé quelques exemples 8; en voici un autre : En 1422-3, Richard Day fut pendu aux fourches de Moudon pour ses démérites dont nous ne connaissons pas la nature. Lors de son arrestation, il avait affirmé être un clerc et s’était fait réclamer par le procureur de l’évêque, qui avait menacé Moudon de l’interdit, si /256/ l’on poursuivait le procès. Mais le juge avait pris l’avis du Conseil ducal; il avait été établi que le prévenu avait bien porté l’habit ecclésiastique, mais qu’il n’avait jamais reçu ni tonsure ni lettres de cléricature. La justice civile avait donc pu procéder contre lui 1. Quelques années auparavant, un détenu, régulièrement condamné par la cour de Moudon, se pendit dans sa prison. Le lieutenant baillival fit constater le fait par des témoins, puis comparaître le cadavre devant la cour, où il fut condamné, le lundi 7 octobre 1415, à être traîné aux fourches et pendu au gibet, ce qui fut fait le lendemain par les soins du bourreau de Lausanne 2.
C’est au même titre que Moudon reçut un des quartiers du corps de Pierre de Lompnes 3, et, en octobre 1434, lorsque l’aventurier bressan, Antoine de Sure, qui avait voulu attenter, sinon à la vie, tout au moins à la liberté d’Amédée VIII, eut été exécuté par la hache à Thonon, les bourreaux d’Aubonne et de Genève, qui avaient officié en cette circonstance, clouèrent sa tête au gibet, puis découpèrent son corps en quatre quartiers qu’ils salèrent et introduisirent dans des barils, dont l’un, transporté par le lac, puis à dos de cheval, parvint à Moudon, où il fut exposé en lieu apparent, afin d’inspirer l’horreur du crime et la crainte du châtiment 4. /257/
*
* *
Dans sa lettre du 6 juin 1421 au duc de Savoie 1, le bailli de Vaud Henri de Menthon écrivait que « les novellites qui viennent au pays viennent plus tous assavoir à Moudon que aultre part… » et qu’il ne pourrait garder le château « sil vennoit guerre ou rumeur du peuple ». Devons-nous en conclure qu’il y avait alors dans cette ville un esprit quelque peu révolutionnaire ?
Dans l’ignorance où nous sommes de tout ce qui touche à l’opinion des hommes de ce temps lointain, nous devons laisser cette question sans réponse.
*
* *
Comme aujourd’hui, Moudon avait des foires qui attiraient marchands et acheteurs; c’est là, par exemple, qu’en 1412 le Conseil de Lausanne fit acheter cinq bœufs qu’il comptait offrir à l’évêque Guillaume de Challant 2. Placée sur la route qui conduisait « des Allemagnes » à Genève, le trafic des marchandises amenait quelque animation et quelque argent dans la petite ville. Les plaideurs 3 et leurs avocats y venaient pour débattre leurs procès devant la cour du bailli de Vaud, et leur séjour n’était pas de nature à déplaire aux aubergistes. /258/
Nous avons déjà parlé des cérémonies que provoquèrent la réception du comte de Namur 1, celle du Comte Vert 2 et celles des autres princes de la maison de Savoie 3. La présence du bailli y amenait souvent des seigneurs qui venaient prêter hommage 4, de hauts fonctionnaires savoyards, des officiers et des ambassadeurs, qui passaient avec leur escorte et parfois séjournaient dans la ville 5. Il y avait là tout un mouvement de gens et de chevaux, et même de voitures 6.
D’autres fois, c’étaient les députés des villes vaudoises qui venaient traiter d’affaires avec le gouverneur du pays, qui se rendaient aux séances, de plus en plus nombreuses, des assemblées des communautés vaudoises ou Etats de Vaud 7, ou enfin qui venaient consulter les coutumiers de Moudon et se renseigner sur les privilèges existants ou les usages établis, afin de pouvoir exiger de leurs châtelains les mêmes faveurs 8. /259/
De tout cela Moudon tirait avantage, matériellement et moralement. D’autres villes vaudoises en étaient jalouses, Morges en particulier, où les princes de Savoie séjournaient volontiers, et qui refusait de comparaître à Moudon quand elle y était citée 1. Petites rivalités qui sont de tous les temps, si leurs manifestations diffèrent avec les siècles.
Située sur la route qui, d’Allemagne, conduisait en Savoie, la ville de Moudon vit passer des voyageurs illustres. En 1384, c’était le cortège du chancelier impérial qui se rendait à la cour de Savoie : il se composait de 61 chevaux 2.
Nous ne savons pas si Henri VII de Luxembourg la traversa lors de ses deux voyages dans la Suisse occidentale 3, mais il est fort possible que, lorsqu’au printemps 1365 l’empereur Charles IV se rendit en Italie, avec une escorte de 2000 cavaliers, sa route l’ait conduit par Moudon 4. /260/
Il est certain que, au siècle suivant, l’empereur Sigismond s’y est arrêté et le compte de la châtellenie nous donne des indications précieuses sur la réception qui lui fut préparée 1. L’empereur passa une première fois dans notre pays en juin 1414; il venait d’Italie et avait pris la route du Grand St-Bernard; le comte l’accompagna à Fribourg et à Berne 2; cette fois le cortège impérial ne toucha pas Moudon. Il n’en fut pas de même l’année suivante; le souverain revenait par Bâle; le comte alla à sa rencontre jusqu’à Aarberg, d’où il l’escorta à Berne 3.
Vers la fin de juillet, on annonça sa prochaine arrivée à Moudon. On ne pouvait songer à le recevoir dans le château dont nous avons dit l’état lamentable 4. A l’entrée de la ville, sur la route de Lucens par où les princes arrivaient, sur l’emplacement où fut plus tard la maison de Cerjat, aujourd’hui agence de la Banque cantonale, se trouvait la maison d’Henri de Glane, le plus riche des bourgeois 5. On la choisit pour y faire descendre le chef de l’Empire, qui, n’étant pas couronné encore, ne portait que le titre de roi des Romains. On peut croire que Jaques de Glane, qui remplissait le rôle de chef de la famille à la place de son père, fit réparer sa demeure 6. L’architecte du comte se borna /261/ à l’aménagement des pièces : une salle pour le roi, munie d’un trône sur une estrade; une table était réservée à Sa Majesté; il y en avait quatre autres; autour des tables et le long des murs, des bancs, le tout en planches de sapin; la salle à côté contenait deux tables, des bancs et un bois de lit; une chambre tout auprès, un bois de lit; une cuisine avait été préparée pour le roi, avec deux buffets, une autre pour le comte, avec un buffet; il y avait une chambre pour les pannetiers et quelques autres salles, dont le mobilier se composait de bancs et de tabourets. Pendant que s’accomplissaient ces travaux, qui rappellent ceux de nos cantines de fêtes villageoises, le châtelain Jean Serragin, exécutant les instructions d’Amédée VIII, envoyait des hommes parcourir les villages voisins pour y recueillir de la volaille, des oies, des œufs et du beurre; des bourgeois considérés allaient à Yverdon et à Grandson, à Romont et à Rue chercher de la vaisselle d’étain et de bois; d’autres amenaient le bois nécessaire à la cuisine; on se procurait du sel et du charbon. Les paysans amenaient gratuitement 1 du bois vert, du feuillage sans doute, destiné à orner les salles; d’autres voituraient deux chars de foin pour les chevaux et l’on achetait encore 50 assiettes de bois pour compléter la provision de vaisselle 2.
Le jeudi 25 juillet 1415, jour de la St-Jaques, /262/ l’empereur arriva; il entra dans la ville par une brèche que l’on avait faite exprès à la muraille 1; on peut admettre, quoique le compte de la châtellenie soit muet à cet égard 2, qu’il s’arrêta à Moudon et goûta au repas qui lui avait été préparé dans ce décor et avec ce service, qui nous paraissent bien rustiques. Il n’y coucha pas et continua sa route sur Lausanne; seul, le chancelier de l’Empire passa la nuit à Moudon, chez le châtelain, Jean Serragin 3.
On peut croire que l’empereur avait été satisfait de sa réception; il récompensa ses hôtes : le comte de Savoie y gagna le titre de duc et, plus modestement, les Cerjat obtinrent de lui une lettre d’armes qui les fit entrer dans la noblesse vaudoise 4.

Sceau de Jean, vidomne de Moudon
chevalier, 1302.
CHAPITRE XV
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Nous ne sommes guère renseignés sur l’administration de la commune pour la fin du XIVe siècle; les procès-verbaux, s’il y en a eu, et les comptes ont disparu depuis longtemps 1. Mais, dès le début du XVe, les documents deviennent plus abondants; nous avons, en particulier, deux comptes communaux 2 qui, s’ils ne nous disent pas tout ce que nous voudrions savoir, nous donnent au moins des indications utiles.
Il n’y a pas à ce moment une grande différence entre les bourgeois et les simples habitants qui forment ensemble la communauté; la bourgeoisie s’acquiert par le fait du domicile et par l’acquittement d’un droit qui s’élève à une ou deux livres (100 à 200 fr.), mais, comme l’argent est rare, le nouveau bourgeois est autorisé à ne payer que l’intérêt annuel de ce modeste capital 3. /264/
L’autorité suprême appartient à l’assemblée générale des prud’hommes de la ville. Convoquée par le crieur public et au son de la grosse cloche, elle se tient dans l’église Notre-Dame 1 ou dans la Halle 2; ses compétences principales sont le vote des dépenses importantes, les autorisations d’emprunt, achats ou ventes, l’approbation des comptes, l’élection du procureur ou syndic. Elle ressemble au Conseil général de nos communes rurales actuelles. Les jours d’élections, la séance est suivie d’une collation, chez l’un des taverniers de la ville, où l’on offre du vin, du pain et du fromage, des bricelets et des merveilles 3.
Les deux seuls procès-verbaux qui nous restent nous indiquent la présence de 87 4 et de 53 5 bourgeois. C’est un chiffre plutôt bas, si l’on admet que Moudon compte alors 300 feux ou ménages 6; cela ne fait pas un homme pour trois ménages, dans le cas le plus favorable. Nous pensons que cette abstention s’explique par l’indifférence pour une bonne part /265/ et que, d’autre part, le souci du pain quotidien éloignait bien des hommes des séances du Conseil général.
Le gouvernement proprement dit de la commune appartenait au Conseil, que l’on appelle parfois Conseil étroit 1, ou restreint, par opposition au Conseil général. Le nombre de ses membres est si variable 2 que nous devons en conclure qu’il n’était pas limité par des dispositions précises. Nous ignorons aussi comment il se recrutait 3. On peut supposer que c’était une délégation du Conseil général et qu’elle se composait des personnages les plus marquants, laïques et ecclésiastiques, qui, suivant l’occurrence, s’adjoignaient d’autres personnes dont l’avis ou l’influence pouvaient être utiles.
En tête de la liste des membres du Conseil, on trouve les noms des nobles établis à Moudon 4, les Vulliens, puis les Blonay et les Fernex leurs héritiers, les vidomnes, les Daillens, puis les grands bourgeois, les Glane et les Cerjat, les Arma, les Serragin, les Apparellie, /266/ les Valacrêt, etc. Pendant la première moitié du XVe siècle, c’est Jaques de Glane qui, de toute évidence, est le véritable chef de la communauté; on ne fait rien d’important en son absence et, s’il le faut, on le fait chercher par un messager; c’est lui que l’on envoie auprès du duc lorsqu’il y a des négociations difficiles 1; c’est lui qui est le premier magistrat de la ville, bien plus que le syndic.
Le syndic, ou gouverneur, en effet, n’est pas un magistrat, mais un fonctionnaire; il est l’administrateur-délégué de la communauté, dont il a en quelque sorte la procuration, d’où le nom de procureur qu’il porte encore parfois 2. Il surveille les travaux et paie les dépenses ordonnées par le Conseil ou les bourgeois; il perçoit les redevances dues à la commune et il en rend compte au bout de l’exercice. C’est un boursier; il est salarié, tandis que les fonctions des conseillers sont gratuites. Il est nommé pour une année, mais rééligible; nous en connaissons qui ont fonctionné plusieurs années de suite et à plus d’une reprise 3. En général, ces fonctions sont confiées à un notaire, ce qui est assez naturel, puisqu’elles nécessitaient des écritures; il fallait, en outre, qu’elles fussent remises à des hommes qui présentassent des garanties de solvabilité, et même fussent capables, le cas échéant, d’avancer de l’argent.
Ainsi, l’organisation municipale ne rappelle guère /267/ celle de Berne ou de Fribourg : c’est l’administration d’une petite ville, et non le gouvernement d’un petit Etat. Elle a, d’autre part, plus d’analogie avec celle d’une société financière moderne qu’avec celle de nos communes politiques.
*
* *
Quelles sont les charges financières qui incombent à la commune ? Les comptes vont nous l’apprendre :
En ces temps ce ne sont pas les traitements des fonctionnaires qui grèvent le budget; outre le syndic à 14 livres l’an 1, la ville a un forestier qui touche 2 livres, des fonteniers que l’on paie 10 livres et des mimes ou ménétriers; ce sont des musiciens, des fifres probablement; ils sont habillés aux couleurs de la ville et portent son chiffre, un M, sur leur vêtement; ils servent d’huissiers et de courriers; ils sont, pour la plupart, des Suisses allemands 2; ils sont payés 7 florins (à 14 s.) par an. Cette fonction semble avoir été supprimée en 1417, date à laquelle apparaissent les guets, à 11 livres l’an.
La commune a la charge de l’école 3; on sait que dans notre pays, les écoles communales datent de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe 4; à Moudon, /268/ elles avaient été créées sous le règne d’un des barons de Vaud, de Louis II probablement, à une date que nous ignorons 1. En retour de l’autorisation à bien plaire qu’il avait donnée, le prince avait exigé une redevance de deux livres de gingembre, mais que les receveurs savoyards préféraient toucher en argent 2.
Les régents dont les noms nous ont été conservés sont des laïques 3. Il semble que l’Eglise se soit désintéressée de l’école, ce qui provoqua des difficultés avec les autorités communales; malgré les réclamations, fondées ou non, de celles-ci, le curé refusait d’offrir aux élèves un repas les jours de grandes fêtes 4 et c’est sur les fonds de l’hôpital que l’on paya la vaisselle d’étain nécessaire à cette institution 5, qui était un internat; l’instruction ne paraît pas avoir /269/ dépassé le cycle du trivium 1. C’est là qu’apprenaient à lire et à écrire les jeunes bourgeois qui devenaient ensuite notaires ou ecclésiastiques.
Le métier était médiocrement payé : de 7 à 10 livres l’an, plus le logement, et l’on avait de la peine à trouver des titulaires; nous voyons le Conseil envoyer un de ses membres en chercher, inutilement du reste, jusqu’à Salins; à certains moments, la place est inoccupée pendant de longs mois.
Quand la ville n’est pas entraînée dans des procès ruineux qui étaient une plaie de ce temps, les frais de l’administration municipale proprement dits sont insignifiants. Par contre, l’obligation où l’on est d’envoyer un courrier ou une délégation, dès qu’il s’agit de traiter une affaire, finit par coûter assez cher. Dans ces cas les conseillers allaient en général deux ensemble, à cheval, avec un domestique; l’indemnité de voyage était de 6 sous (30 fr.) par jour et par homme.
Nos aïeux avaient le sens de l’hospitalité; ils offraient un verre de vin aux visiteurs ou aux hôtes qui survenaient. Lors des séances des députés des bonnes villes, qui se réunissaient assez souvent à Moudon pour se concerter et se défendre contre les exigences du fisc savoyard, la ville offrait aux délégués une modeste réception. Passait-il à Moudon, qui était sur une route de grand passage, quelque officier savoyard, quelque ambassadeur en mission, quelque dignitaire ecclésiastique, il était l’objet des attentions du Conseil. A l’entrée en fonction d’un bailli, d’un /270/ châtelain, d’un curé ou même d’un simple maître d’école, un dîner réunissait autour de lui les notables de l’endroit.
Suivant les cas, on ne recule pas devant le pourboire en argent, quand il s’agit de personnages de rang inférieur comme des huissiers, et ces pourboires deviennent de véritables pots de vin, au sens figuré, quand ils s’adressent à des hommes puissants. Le bailli ne dédaigne pas de toucher des cadeaux intéressés, pour la récompense de ses bons offices, et les comptes notent naïvement ceux faits aux châtelains, « afin qu’ils soient favorables à la ville » 1.
Mais les deux chapitres les plus chargés sont ceux des travaux publics et des mesures de défense militaire. C’est à la ville qu’incombe l’entretien des églises; nous la voyons recouvrir de bardeaux le toit de Notre-Dame 2, mettre une croix de fer sur le clocher et réparer les cloches; à St-Etienne, on place des verrières : on fait relier un bréviaire et un psautier et redorer un calice; car on tient au luxe du culte.
Moudon a une horloge, introduite depuis peu 3; un prêtre, habile en mécanique, la surveille et le Conseil paie l’huile avec laquelle on la graisse.
Dans le chapitre de la voirie, nous trouvons les /271/ dépenses que nécessite l’entretien des rues et des places; celles-ci sont pavées, du moins dans le voisinage des fontaines. Ces dernières sont au nombre de six, trois dans la ville haute, trois dans la ville basse; l’eau, captée sur les collines voisines 1, est amenée par des tuyaux en bois, qui ont besoin de réparations continuelles, surtout pour les fontaines du haut : la moindre fuite enlève toute la pression et les fontaines ne fonctionnent plus. Les bassins sont creusés dans un tronc de chêne; les chèvres sont en bois avec un goulot de métal. La ville veille à maintenir en bon état les chemins qui conduisent aux champs et les ponts qui franchissent les ruisseaux qui se jettent dans la Broye. Elle fait réparer, quand besoin est, le pont St-Eloi, le seul, semble-t-il, de la région qui soit en pierre.
Enfin la ville possède des bâtiments, deux maisons 2 que l’on transforme pour en faire un Hôtel de Ville. Ce travail que l’on commence vers 1410 n’est pas entièrement terminé en 1416. Le plus gros de l’ouvrage, accompli au début de cette période, coûte plus de 130 livres; les soubassements sont en pierre; le reste de l’édifice est en bois, avec planchers de terre battue.
Les dépenses d’ordre militaire sont beaucoup plus importantes. L’artillerie avait fait de grands progrès à la fin du XIVe siècle, non les bouches à feu, mais /272/ bien ces machines de guerre, déjà connues des anciens et dont la force de propulsion provenait de la détente brusque de cordes tordues. Il fallut remettre au point tout le système de défense des villes.
Moudon s’y appliqua. Dans les toutes dernières années du siècle 1, on refit les fossés de la ville, même au pied de la colline du Bourg, côté nord, qui nous paraît pourtant assez bien défendu par la nature, et l’on travailla aux fortifications.
Nous avons vu 2 qu’Amédée VIII insista pour que les villes du pays se fortifiassent. On prit ses ordres au sérieux à Moudon : les murs furent refaits en blocs de tuf et munis de coursières et de bretèches (galeries de bois en encorbellement, intérieures et extérieures 3); les portes et les tours furent reconstruites, les ponts-levis réparés. De 1407 à 1411 on dépensa pour cela 323 livres, soit 82 livres par an, en 1416-7 83 livres. Faut-il voir dans ce chiffre une pure coïncidence ? ou bien est-ce là la somme que l’on affectait annuellement à ces travaux ? Pour peu qu’il en ait été de même pendant chacune des quinze premières années du XVe siècle, cela ferait une somme de 125 000 francs, consacrée à ces travaux. La ville y mit, en tous cas, plus de 40 000 francs.
En 1424 encore 4, ses représentants s’arrangeaient /273/ avec la dame de Fernex-Lullin pour qu’elle leur accordât l’autorisation de prendre à la tuffière, située sous le village de Vulliens qui lui appartenait, autant de quartiers de tuf qu’il leur serait nécessaire pour la construction des murailles et des églises de la ville. Nous ne savons pas s’il faut en conclure que les travaux n’étaient pas terminés, ou bien que la ville prenait tout simplement des précautions en vue de l’avenir.
Après les fortifications, les armes et les projectiles : entre 1407 et 1411 la commune fait provision des unes et des autres. Outre les balistes fournies par les bourgeois extérieurs, dont nous ignorons le nombre, la ville en acquiert 13 autres 1, que le forgeron Perrod Apparellie, un spécialiste en la matière 2, s’en va chercher à Morges et à Thonon. Le compte ne dit pas s’il s’agit d’arbalètes à main ou d’arbalètes de remparts; avec ces armes, il faut des cordes, des treuils et des crochets pour les tendre et d’autres instruments dont les noms n’ont plus aucun sens pour nous.
Le même Perrod fournit encore 12 canons; ce sont des couleuvrines légères, puisque entre toutes elles ne pèsent que 220 livres, soit 9 kg. en moyenne chacune 3; elles ne doivent pas être très dangereuses. L’importance restreinte de cette arme nouvelle se montre aussi par ce fait que l’on se procure 250 boulets (en pierre) seulement, tandis que l’on achète des milliers /274/ de carreaux (virotons) pour les balistes. On dépense pour cela 133 livres en quatre ans.
Enfin, après les armes, les hommes. A Moudon, comme dans le reste du pays, les exercices militaires dominicaux étaient la seule école où se formaient les milices. La ville les encourageait en donnant chaque dimanche un gros tournois (un peu plus d’un sou) aux arbalétriers.
Comme aujourd’hui, il y avait de temps en temps des tirs à prix; on appelait cela jouer la fleur (ludere florem), parce que le premier prix était déjà une couronne 1. La ville offre alors une collation, composée de pain, de fromage et de vin; quand on invite les tireurs des villes voisines à une fête qui rappelle nos tirs régionaux, sinon cantonaux, outre la collation, le Conseil offre un don d’honneur de 10 s. (50 fr.).
Lorsque la guerre menace, — et cela se produit plus d’une fois au cours de la période dont nous nous occupons 2 — on passe à des préparatifs plus immédiatement utiles : le bailli et les officiers inspectent les murailles; on place des guets sur les tours des églises; on fait acheter à Lausanne ou à Fribourg le drap nécessaire à l’équipement des soldats et l’on fait venir un spécialiste pour fabriquer 27 ½ livres de salpêtre.
La ville a sa bannière que porte un banneret quand le contingent est mis sur pied 3. /275/
*
* *
Le chiffre total des dépenses est de plus de 500 livres par an entre 1407 et 1411 1 et de 326 livres en 1416-7. Comment la ville peut-elle faire face à ses obligations ? Ses ressources essentielles sont les impôts indirects et, en particulier, ce droit de consommation sur la vente au détail du vin dans la châtellenie (longuel), que le comte Amédée VI lui avait concédé en 1362 2. La perception en est donnée à ferme chaque année, à des notaires d’ordinaire, et rapporte de 230 à 280 livres par an 3. Ajoutons la corde 4 impôt sur la vente du vin en gros, qui ne vaut que 8 s. l’an, et le pontenage, sur le taux duquel nous manquons de renseignements, et qui donne une quinzaine de livres 5. A partir de 1416, nous trouvons encore la mesure du blé, sans doute une redevance sur la vente de cette denrée, qui fait 42 livres 6 s. 8 d. 6.
Les redevances annuelles des nouveaux bourgeois s’élèvent à 55 ou 57 s.
Ces sommes sont tout juste suffisantes pour payer les dépenses ordinaires. Dès que survient une dépense exceptionnelle, telle que la construction de fortifications, /276/ la bâtisse d’une maison ou un impôt à payer au prince, les ressources sont insuffisantes. La ville se trouve, à la fin de l’exercice, redevoir d’assez fortes sommes au syndic : plusieurs centaines de livres à celui de 1401, un peu moins à un de ses successeurs 1, 92 au syndic sortant de charge en 1411, 77 à celui qui lui succéda, etc. Comme on ne peut les leur rembourser, cela constitue des dettes, dont les intérêts au 6 1⁄4 ou au 7 1⁄2 % viennent grever les budgets ultérieurs.
Mais cela même est insuffisant et il faut recourir à l’emprunt; les riches bourgeois 2, les fondations religieuses 3, l’hôpital 4 font des avances de fonds, et, lorsque les besoins sont particulièrement pressants, on a recours aux banquiers de Fribourg. Ainsi, le syndic se trouvant embarrassé pour payer 200 écus d’or, part de la ville à la dot de Jeanne de Savoie, il fallut aller emprunter cette somme à Petermann Velga, longtemps avoyer de Fribourg; comme il s’agissait d’un emprunt à court terme, celui-ci ne semble pas avoir demandé d’intérêt, mais il exigea /277/ qu’on lui achetât fort cher un cheval qui ne valait rien et que la ville dut revendre à perte, si bien qu’avec les frais d’acte et de voyage, la commission du secrétaire de Velga et les autres menus frais, elle paya plus du 10 % pour quelques semaines. Ottonin de Saliceto, un banquier italien 1, était aussi créancier de Moudon pour une très grosse somme : on lui devait 50 écus d’or, soit 55 livres, d’intérêts par an 2.
Bref, de 1407 à 1411, la commune consacre plus de 620 livres au service de sa dette; cela fait environ 15 000 francs de notre monnaie par an. Comme le taux, qui n’est pas toujours indiqué, oscille entre le 5 % et le 7 1⁄2 %, cela représente un capital de 250 000 fr. environ.
Mais Moudon amortit ses dettes. Dès 1398, elle perçoit un giète, ou impôt extraordinaire sur la fortune; elle l’exige aussi des habitants des villages de la châtellenie 3, ce qui s’explique par le fait, qu’en cas de guerre, ils avaient le droit de se réfugier derrière les murailles de la ville; il était naturel qu’ils contribuassent à sa défense. Ces travaux ayant continué, on exigea un nouveau giète en 1407, en 1408 et en 1409 4, non sans quelques difficultés de la part de certains villages, comme Poliez-le-Grand 5, et même /278/ du clergé 1; en 1408 et 1409, les habitants de la ville payèrent deux annuités de 142 et 146 livres; la somme versée entre 1407 et 1411 s’élève, au total, à 792 livres 2 s. Nous trouvons de nombreuses allusions aux versements des années suivantes, mais nous n’en connaissons pas le montant.
Ils semblent avoir été assez considérables, car les dettes diminuent rapidement. Dans le compte de 1407-1411, les amortissements figurent pour la somme de 40 livres; en 1413, la plus grande partie de la dette due à Ottonin de Saliceto était amortie; il ne restait dû que 150 écus au 5 % (165 livres); le syndic et les membres du Conseil s’engageaient par serment à la façon des nobles, par la foi de leur corps et en levant un doigt, à en payer les intérêts régulièrement; s’ils omettaient de le faire, ils seraient tenus, dans les huit jours après la première réquisition, d’envoyer à Fribourg six personnes avec six chevaux, qui y vivraient à l’hôtellerie à leurs dépens jusqu’au paiement de l’arriéré 2. Cette créance est entièrement éteinte en 1416-7, ainsi que deux autres des plus fortes. En six ans la commune a amorti la moitié de ses dettes. Il semble que l’on avait compté pouvoir le faire entièrement, mais il avait fallu payer au trésor savoyard la régale du giète 3, sans doute une sorte de commission /279/ pour l’autorisation de lever le giète accordée par le comte, et, d’autre part, le giète avait peine à rentrer.
C’est qu’aussi l’effort fiscal était grand; nous ne connaissons ni le total des impôts prélevés ainsi au cours de ces années, ni le nombre des habitants sur lesquels la charge retombait, ni l’état de leur fortune; mais une chose est certaine : la population était peu nombreuse, l’argent était rare, les sommes payées furent considérables 1. Les particuliers firent de lourds sacrifices pour la défense de leur ville. Si les bourgeois qui la gouvernaient ne nous paraissent pas avoir toujours été très soigneux des deniers publics quand il s’agissait de boire un verre dans les auberges, ils eurent, dans les grandes affaires, une saine politique financière et une administration clairvoyante.
*
* *
Il est légitime de considérer l’hôpital comme dépendant de l’administration municipale 2.
Nous possédons encore quelques-uns de ses comptes du début du XVe siècle 3; ils sont très mal tenus, inexacts et incomplets; ils ne sont pas bouclés, si bien qu’il est très difficile de se rendre compte de la fortune et des charges de cette maison. /280/
L’hôpital possède des biens dans une vingtaine de villages de la vallée de la Broye, plus des dîmes, qui donnent, pour l’année 1405-6, en froment : 20 muids 2 coupes; en orge : deux coupes; en avoine : 7 muids 10 coupes et un bichet; en cire : 2 ½ livres; en huile : 4 pots; et un bichet de graines de chanvre 1. Les revenus en argent sont les suivants : les rentes foncières : 116 liv. 18 s. 3 d. 1 ob.; les loyers : 2 liv. 4 s.; les dons : 10 liv. 18 s.; les ventes de bétail, froment, avoine, foin : 9 liv. 19 s.; recettes diverses : 4 liv. 6 s.; au total : 144 liv. 5 s. 3 d. 1 ob. Pour l’année suivante, ce chiffre est de 160 liv. 14 s. 2 d. 1 ob., et, pour 1407-8, 174 liv. 10 s. 1 d. 1 ob., la vente des denrées agricoles ayant produit une somme élevée 2. Si, pour l’année 1405/6 3, on fait entrer en compte la valeur de celles-ci, qui est de 67 liv. 4 s. 11 d. 1 ob., cela donne un total de 211 liv. 10 s. 3 d., plus de 21 000 francs de notre monnaie 4.
Passons au chapitre des dépenses : l’hôpital consomme plus des deux tiers de ses revenus en froment, /281/ soit 8 muids 1 (4505 lit. 856) pour le ménage proprement dit et un peu moins pour les distributions 2. En 1405-6, l’entretien du cheval de l’hospitalier absorbe au delà de ce qu’on a récolté d’avoine; les années suivantes, il n’est plus question de ce coûteux animal; la plus grande partie de l’avoine est vendue, le reste sert aux semailles et à l’engraissement des porcs de la maison 3. On utilise aussi la cire et l’huile provenant du domaine.
Les frais du ménage s’élèvent à 80 liv. et 17 s. pour l’année 1405-6 et ne varient pas beaucoup les années suivantes. Chaque année, à la St-Martin, on achète six porcs et on fait boucherie; on achète aussi un bœuf, parfois même un bœuf et une vache, que l’on met au sel; c’est une dépense de 15 à 17 liv., plus de 2 à 3 liv. (2 à 300 fr.) pour le sel. On vit donc de salé; on n’achète que pour 2 liv. 19 s. de viande fraîche; une centaine de harengs pour 16 s., du poisson pour 10 s., des œufs pour 12 s. suffisent pour les jours maigres; on consomme pour plus de 3 liv. de fromage et pour plus de 2 liv. de beurre; on achète 10 coupes (469 lit. 36) de pois pour la soupe et une coupe de lentilles; ajoutons du séré, 17 pots d’huile, 2 livres de gingembre, des champignons et de l’ail 4; tout /282/ cela nous laisse supposer une cuisine qui n’était ni trop fade ni trop maigre.
Le vin est une des grosses dépenses de la maison : en 1405-6, on en achète 5 muids et 8 setters (3055 lit. 104), pour 42 liv. 14 s.; c’est plus de la moitié des frais du ménage. L’année suivante, il est vrai, on se contente de 3 muids et 5 setters (1842 lit. 048), pour 27 livres.
L’entretien du jardin coûté 1 liv. 8 s.; la majeure partie de cette somme sert à payer le fossoyage; le compte ne parle que de la culture du chanvre et des raves.
L’hôpital achète pour plus de 7 livres de bois et paie 6 s. pour le couper; nous le voyons dépenser 11 s. et 4 d. pour la façon de 16 aunes de drap et de 3 pièces de toile; nous apprenons aussi qu’il a sa vache, pour laquelle on achète de la paille et du foin.
Le recteur ne touche pas de salaire en 1405-6, mais il s’alloue 8 livres pour achat de vêtements et de souliers à sa femme et à lui-même; l’année suivante il porte en compte un salaire de 3 livres; celui de la servante est de 2 livres.
Il y a encore toute une série de petites dépenses d’administration : menues réparations, frais causés par la rentrée des récoltes, inventaires, actes notariés, procès, etc., enfin, une somme d’une livre (100 fr.) pour vin bu lors de la conclusion d’une affaire. Les rentrées qui n’ont pas pu être opérées font une somme de 6 liv. et 6 d. Le total de ce second chapitre est de 38 liv. 12 s., ce qui fait avec les dépenses de ménage /283/ 118 liv. et 9 s. Les mêmes calculs donnent pour l’année suivante 110 liv. 7 s. 5 d. et, pour 1407-08, 85 liv. 14 s. 7 d.
Viennent ensuite ce que l’on pourrait appeler les frais de culte : le traitement du prêtre qui dessert la chapelle de l’hôpital, 13 liv., celui des prêtres « qui ont aidé à chanter avec des notes » les jours de fête, 10 s.; on donne au sonneur des Ave Maria 5 s., à l’ecclésiastique 1 chargé de diriger l’horloge 3 liv.; enfin, la cire des cierges coûte 15 s., les deux livres et demie, perçues en nature, n’ayant pas suffi à cet effet.
Nous trouvons encore toute une série de versements faits au curé de Moudon et à celui de Morlens, aux recteurs de plusieurs autels, à la léproserie de Lucens, etc., sans qu’il soit très clairement indiqué si ce sont des rentes foncières ou des aumônes dont l’hôpital était le débiteur en tant qu’héritier des donateurs 2; il y a sans doute des unes et des autres; pour terminer, mentionnons les censes foncières proprement dites, dues à divers seigneurs, et l’impôt (theyse) dû au comte de Savoie. Le total de ces derniers articles s’élève à 33 livres et quelques deniers.
Le compte n’étant pas bouclé, la somme totale des dépenses n’y figure pas; elle s’élève, si mes calculs sont exacts, à près de 153 livres 3 et dépasse de /284/ 8 livres environ celle des recettes. Ce résultat fâcheux déplut au Conseil qui condamna le recteur à une amende de 30 livres (3000 fr.) à cause des trop grandes dépenses qu’il avait faites.
Cette mesure rigoureuse, même si elle resta à l’état de menace 1, fit quelque effet. L’année suivante, les recettes augmentèrent 2, tandis que les dépenses diminuaient : elles étaient réduites à 144 livres et quelques sous, ce qui laissait un boni de 16 livres environ 3; en 1407-8 on pouvait faire des placements nouveaux pour une valeur de 10 livres; la fortune de l’hôpital recommençait à s’accroître; plus tard, nous constatons encore des placements pour des sommes assez élevées 4, mais il est très probable qu’une partie de ces capitaux provenait de remboursements.
Les comptes nous apprennent que la chapelle avait des verrières, mais que les fenêtres de l’hôpital lui-même étaient faites de papier huilé, qu’on s’y éclairait avec des chandelles de suif, placées dans des chandeliers de fer et qu’on y mangeait dans de la vaisselle de bois 5. L’institution possédait du linge en assez grande quantité; le Conseil en prenait inventaire et le recteur en était responsable. Il semble que les femmes hospitalisées y filaient; on donnait la toile à fabriquer à un tisserand.
Les pensionnaires de l’hôpital étaient en 1406-7 /285/ au nombre de 5 seulement : un couple, Rolet Marchiant et sa femme Boucharde, deux autres femmes, l’une appelée la Tachete, l’autre Marguerite Rica, une fillette, la petite Marguerite. Ce n’étaient point des miséreux; la Tachete avait du bois et du blé dont l’hôpital profitait; Rolet Marchiant y entretenait sa propre vache; l’année suivante, une bonne femme aveugle vint s’y installer; elle amenait aussi sa vache avec elle. Nous connaissons plusieurs autres exemples de ces gens, âgés et sans famille, qui abandonnaient leurs biens à l’hôpital, à condition d’y être entretenus jusqu’à la fin de leurs jours 1; ils y étaient même vêtus; le recteur achetait l’étoffe nécessaire et leur faisait faire des vêtements; ceux-ci étaient très simples : quelques aunes de drap gris, un capuchon pers et une paire de souliers pour les femmes, un bonnet noir pour Rolet Marchiant; cela suffisait 2.
L’hôpital nous apparaît donc plutôt comme un asile de vieillards; il secourait cependant bien des misères, par ses distributions d’abord, puis par des secours occasionnels : nous le voyons envoyer deux fois la semaine de la nourriture à une pauvre femme et vêtir un enfant trouvé, donner du blé à un indigent et des coussins à une malade; mais, à en juger par les comptes que nous avons eus entre les mains, ce n’était pas là son utilité principale.
CHAPITRE XVI
LE DECLIN DE LA PUISSANCE SAVOYARDE
(1434-1465)
Le 7 novembre 1434, Amédée VIII remettait solennellement à son fils Louis le gouvernement de ses Etats, avec le titre de lieutenant-général. Depuis trois semaines, il s’était retiré à Ripaille; il se faisait ermite et entrait dans cet ordre religieux des chevaliers de Saint-Maurice qu’il venait de créer pour lui-même et pour cinq ou six compagnons, veufs comme lui; il quittait le monde pour passer la fin de ses jours dans la solitude et la contemplation.
C’est dans une disposition naturelle à la piété, dans la tristesse provoquée par un veuvage prématuré, dans la lassitude causée par un règne de 43 ans qu’il faut rechercher les motifs de cette résolution. Ripaille était d’ailleurs une retraite confortable et la solitude n’y était que relative; le prince conservait une cour de 200 personnes et c’était parmi ses conseillers et ses amis qu’il avait choisi les compagnons appelés à partager sa vie de méditation et de prière; la politique n’en était pas exclue; les ermites formaient avec Amédée VIII un vrai Conseil d’Etat, car celui-ci /287/ s’était réservé la décision suprême dans toutes les affaires importantes 1.
Précaution bien nécessaire, car son successeur, qui venait d’avoir vingt ans, était incapable de gouverner; léger, inconstant, il n’aimait que le luxe et les fêtes, et sa femme, la belle Anne de Chypre, de la famille des Lusignan, exerçait sur lui une influence fâcheuse; dépensière à l’excès, elle était d’une générosité démesurée vis-à-vis des courtisans, disposition dangereuse dans une maison déjà menacée de graves difficultés financières 2.
Mais le père, lui aussi, tout expérimenté qu’il était, allait, en écoutant les mauvais conseils de l’ambition, contribuer au déclin de sa propre maison : le doyen de Ripaille, en voulant être pape, cessait d’être sage 3. En effet, comme le dit la chronique de Bonivard, « au contraire des autres qui sont cardinaux devant que papes, il fut pape devant que cardinal ».
Le concile, qui s’était réuni à Bâle, en 1431, pour procéder à la réforme de l’Eglise, s’était proclamé supérieur au pape et était ainsi entré en conflit avec Eugène IV; il finit par le déposer, le 25 juin 1439. Un conclave irrégulier se réunit à Bâle le 30 octobre. Dès le premier scrutin, Amédée VIII eut un grand nombre de voix; le 5 novembre, il obtenait la majorité et était élu.
La nouvelle en parvint le 8 à Ripaille 4 et, le 15 /288/ décembre, une ambassade, composée de 374 personnes, parmi lesquelles il y avait de nombreux, prélats, venait auprès du duc pour lui offrir la tiare; deux jours après, celui-ci acceptait, non sans avoir manifesté sa surprise, son effroi même, et fait mine de refuser. Mais c’était pour la forme seulement que le duc avait obligé les envoyés du concile à insister; depuis longtemps il préparait sa candidature et son élection ne le surprenait pas.
Elle entraînait son abdication : le 6 janvier 1440, Louis était proclamé duc de Savoie et le nouveau pape, Félix V, assumait à Thonon la direction de l’Eglise; quelques mois plus tard (24 juillet), il était couronné à Bâle.
C’était une couronne d’épines que venait de ceindre Félix V. Ni sa réputation de piété, ni son habileté diplomatique ne pouvaient lui tenir lieu de ces ressources financières qui lui eussent été indispensables; les princes de la chrétienté, en effet, avaient pris, pendant le premier schisme, l’habitude de se faire acheter leur obédience. Le roi de France, sur lequel le nouveau pape comptait, refusa de le reconnaître; l’empereur resta neutre; même son propre gendre, le duc de Milan, après s’être fait payer largement, passa à Eugène IV. Félix V ne fut reconnu guère que dans ses Etats et dans les cantons suisses.
En 1448, avec les débris du concile, il se retira à Lausanne; le 7 avril 1449, il y signa son abdication; il ne survécut à cet acte que peu de mois et mourut à Genève le 7 janvier 1451. /289/
*
* *
Ces douze premières années du règne du duc Louis sont une période de réaction féodale; les grands seigneurs agissent à leur guise; ils se font justice eux-mêmes. Le jeune prince est trop faible pour pouvoir réprimer leurs violences; il laisse massacrer ou condamner ses propres officiers; son père est trop absorbé par les difficultés de son pontificat pour pouvoir lui être d’un grand secours.
« Povero di moneta e di prudenza », le duc manque l’occasion de s’emparer du Milanais à la mort du dernier Visconti 1.
Il fut plus heureux dans sa politique vis-à-vis de Fribourg. Cette ville était à la fois l’alliée de la Savoie et de Berne et la vassale de l’Autriche, ce qui la plaça dans une situation fausse pendant la crise que l’on appelle l’ancienne guerre de Zurich. Sollicitée en même temps par l’empereur et par Berne, elle était aussi en proie à des discordes intestines, dues à la lutte des partis savoyard et autrichien et à des troubles sociaux 2. La faction autrichienne finit par l’emporter et les rapports avec la Savoie s’envenimèrent : l’année 1447 est remplie d’actes de violence de part et d’autre. On voit le duc envoyer messages sur messages à Berne, sa fidèle alliée; une coalition se forme dans laquelle entrent les comtes de Neuchâtel et de Gruyère; on fait des préparatifs militaires; les châteaux /290/ savoyards sont mis sur pied de guerre et munis d’artillerie et le duc mande, à plus d’une reprise, les représentants de ses sujets à Lausanne pour les inviter à lui fournir des soldats. Il bénéficie de l’appui de son père qui frappe de l’excommunication tous ses adversaires 1.
En décembre 1447, les Fribourgeois déclarèrent la guerre à leurs ennemis; il en résulta une campagne qui consista surtout en razzias réciproques et en atrocités de toute nature. Les milices vaudoises furent mises sur pied 2. Mais le bailli de Vaud, qui avait reçu l’ordre de lever vingt lances de cavaliers et de marcher sur Fribourg, dès les premiers jours de janvier 1448, ne put trouver que dix lances à trois chevaux, ce qui n’empêcha pas le maréchal de Savoie de lui donner le 28 janvier à Payerne le témoignage suivant : « Il a soutenu grands frais et a bien servi; l’on y doit avoir bon regard 3. »
Le territoire vaudois fut épargné; les ravages des Fribourgeois ne dépassèrent pas Montagny, Villarsel-le-Gibloux ou les environs de Romont 4. Moudon ne semble pas avoir joué grand rôle dans cette campagne; nous ne savons pas si la ville fournit des soldats ni combien; sans doute y fut-on fort inquiet : Moudon était si près du théâtre des hostilités et, aux précautions que l’on prit à Yverdon 5, on peut juger ce que l’on fit sur les bords de la Broye. /291/
C’est Romont, Payerne, Morat surtout, qui furent les places d’armes principales, les bases d’opérations savoyardes; c’est Lausanne qui fut le quartier général; c’est là que séjournent le pape et le duc, c’est là que siègent les Etats, sauf une fois; c’est là que nous voyons le bailli de Vaud demeurer avec la cour de Savoie du 7 mars au 30 juin 1448 1.
Le premier juillet, il passe le lac avec elle et reste jusqu’au 12 à Evian. C’est que la campagne est terminée et qu’on démobilise. Attaqués de toutes parts, les Fribourgeois avaient dû céder; le 16, ils signaient à Morat une paix humiliante; ils renonçaient à toutes leurs prétentions, faisaient amende honorable et s’engageaient à payer une lourde indemnité de guerre 2.
Le duc comptait bien par là ruiner Fribourg qu’il convoitait; mais Berne ne voulait pas que cette ville tombât entre les mains de son allié. Il fallut laisser le temps faire son œuvre. La détresse financière et les revers militaires avaient surexcité les esprits à Fribourg, qui passa par trois ans de troubles continuels, on pourrait presque dire : de révolutions. Profitant de la situation, le duc de Savoie réussit, le 10 juin 1452, à obliger les Fribourgeois à reconnaître sa suzeraineté, malgré la mauvaise humeur de Berne 3.
C’était un succès, le seul de la politique du duc Louis, mais celui-ci ne sut pas profiter de son avantage; ses dettes l’accablaient; il ne put remplir les /292/ obligations qu’il avait contractées envers Fribourg 1; peu à peu, il devint non le maître, mais l’instrument de la politique fribourgeoise. Les Fribourgeois se rapprochèrent toujours plus des Bernois et des Suisses; bientôt, ils furent quasi-indépendants.
La mort de Félix V avait laissé son faible fils privé de conseils et d’appuis. Dès lors, il subit fortement des influences étrangères, en particulier celle de Charles VII; ainsi commence une période de cinquante ans pendant laquelle « la Savoie fut pour ainsi dire toujours à la merci de la France 2 ». En 1455, devant le désordre croissant des finances et la désobéissance des grands, le roi intervenait et, dans une lettre à la ville de Chambéry, il invitait les Etats de Savoie à remettre de l’ordre dans le duché pour éviter sa ruine 3; il exigea que Louis changeât de conseillers 4. Le duc fut entraîné à prendre parti pour le roi dans sa lutte contre son fils, le futur Louis XI; il fut amené à conclure avec la maison de Valois des alliances de famille honorables, mais onéreuses. Le duc de Savoie donna sa fille Charlotte au dauphin avec une dot de 200 000 écus d’or, qui ruina son Trésor; son fils, le prince de Piémont qui fut plus tard Amédée IX, épousa Yolande, fille de Charles VII. Le duc avait promis de donner à son fils en apanage quatre châteaux, dont Cossonay; sur les instances de Charles VII, ce cadeau fut porté à 30 000 florins /293/ (environ 180 000 fr.). Le roi, qui connaissait la situation financière du duc, exigea que cette somme fût assignée sur des terres; le 13 décembre 1455, Louis donnait à son fils le Pays de Vaud et la Bresse, avec cette réserve que le jeune prince ne pourrait ni aliéner des terres ni lever des impôts et que les comptes passeraient toujours devant la Chambre des Comptes de Chambéry 1; le roi prit de plus sérieuses précautions encore : les fonctionnaires du duc durent remettre ces terres entre les mains de commissaires royaux, qui étaient censés agir au nom du prince de Piémont.
C’est ainsi que, le 8 mars 1456, trois conseillers du roi et un secrétaire se présentèrent à Moudon, escortés de deux commissaires savoyards; introduits dans la salle où la cour de Moudon tenait ses séances, ils trouvèrent le bailli de Vaud, Bertrand de Duin, occupant le siège présidentiel; il était assisté de Mermet Christine, procureur de Vaud, des nobles et bourgeois de Moudon qui formaient la cour, des seigneurs du pays vassaux de Savoie et des magistrats des communautés, qui y avaient été convoqués; le sieur André Porte, un des légistes de Charles VII, produisit les lettres de cession du duc, qu’on lut à haute voix, et requit la remise solennelle entre ses mains de la souveraineté du Pays de Vaud; le premier des commissaires ducaux, Jaques de la Baume, remit /294/ alors au premier commissaire royal un poignard nu; il fit descendre de leur siège le bailli et le procureur de Vaud et y installa à leur place les commissaires français et releva de leurs charges tous les fonctionnaires savoyards jusqu’alors en fonctions. Le premier acte des commissaires ainsi mis en possession du pays fut, « pour marque qu’outre ce qui en a été dit dans les prémisses ils avaient de plus fort obtenu et embrassé une telle possession », d’interdire à tous ces fonctionnaires remerciés d’exercer leurs charges plus outre; puis, « pleinement informés de la prudence et bonne discrétion et de la loyauté et prud’homie » du bailli et du procureur de Vaud, comme aussi des châtelains des diverses châtellenies du Pays de Vaud, ils les confirmèrent tous à nouveau dans leurs fonctions pour le compte du nouveau prince.
Cette formalité accomplie, « les prénommés seigneurs commissaires … ont demandé qu’il fût prêté serment de fidélité… par les syndics, les habitants, les députés de toutes les villes, les bourgs, soit châteaux, et des communautés dudit Pays de Vaud … et qu’hommage leur fût fait par les barons, les bannerets et par tous les autres nobles et vassaux dudit Pays de Vaud… » 1. Mais, au nom des nobles et des bourgeois, Humbert Cerjat déclara qu’en vertu des coutumes, que les princes de Savoie avaient juré d’observer, c’était le nouveau souverain qui devait jurer le premier, et personnellement, qu’il respecterait les coutumes du pays; les commissaires répondirent que le prince, retenu auprès du roi de France, les avait /295/ expressément chargés de prêter ce serment en son nom et lecture fut donnée de la lettre qui les y autorisait 1. Noble Humbert Cerjat reprit la parole : « Il n’a jamais été l’usage, dit-il, que les seigneurs du Pays de Vaud prêtassent le serment usuel d’observer les libertés et coutumes par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir…, mais…, par respect pour le roi de France, et parce que dans sa lettre le prince, notre seigneur, promet de prêter serment lui-même dès qu’il pourra venir en personne dans ce pays…, » les communautés et les nobles se déclarent satisfaits, « mais, de grâce spéciale, et pour cette fois seulement » 2.
Alors, posant leurs mains sur les Evangiles, que tenait Humbert Cerjat, les commissaires du prince de Piémont jurèrent en son nom d’observer les privilèges, droits et coutumes du Pays de Vaud; à leur tour, les barons et seigneurs bannerets et les représentants des communautés prêtèrent serment de fidélité au prince, « chacun d’eux levant pour cet effet la main et le doigt au ciel » 3. Mais, lorsque les premiers furent requis de faire encore hommage pour leurs fiefs, ils refusèrent, par la bouche d’Humbert Cerjat, et déclarèrent qu’ils ne le feraient qu’à la personne même du prince; les commissaires royaux y consentirent. Puis, pour marquer encore son entrée en possession du château et de la ville de Moudon, les représentants /296/ du duc les firent entrer dans la Tour, dont ils leur remirent les clefs.
A cette cérémonie assistaient 34 seigneurs vassaux de Savoie, à la tête desquels on voyait le comte François de Gruyère, « le plus beau chevalier du pays roman 1 », et 26 députés des communes de Moudon, Romont, Yverdon, Cossonay, Morges, Nyon, Rue, Estavayer, Payerne, Morat et Cudrefin.
Dès cette date, tous les actes concernant le pays sont censés émanés du prince de Piémont. En 1460, le duc Louis donna en apanage à son troisième fils, Jaques, la baronnie de Vaud avec le titre de comte de Romont; mais celui-ci n’en devait jouir qu’à la mort de son père, lorsque son frère aîné, devenu duc, pourrait la lui céder 2. Par faiblesse ou par imprévoyance, le souverain, revenant à une tradition féodale, morcelait à nouveau la monarchie savoyarde que son père et son bisaïeul s’étaient efforcés de grouper tout entière entre leurs mains pour la rendre plus puissante.
*
* *
Louis de Savoie était faible, mais bienveillant; ses rapports avec ses sujets du Pays de Vaud ne furent pas difficiles. A la requête des gens de Moudon, il confirma les franchises de la ville, par un acte daté /297/ de Genève, le 31 mars 1444 1. En 1455, sur des plaintes qui lui étaient parvenues, il ordonna à ses baillis et à ses châtelains de respecter sous peine d’amende les libertés et coutumes du pays 2 et il fit faire une enquête sur les excès dont on accusait ses officiers 3. Le degré d’efficacité de ces mesures nous échappe; /298/ il est probable qu’elles étaient destinées à procurer un meilleur accueil à ses demandes d’hommes et d’argent.
Il n’abusa pas des levées de troupes. Il demanda, et obtint, en 1438, des bonnes villes de la patrie de Vaud, 300 soldats pour deux mois 1. Il s’agissait déjà probablement de protéger le pays contre les Ecorcheurs, ces bandes connues aussi sous le nom d’Armagnacs, qui, la guerre de Cent Ans touchant à sa fin, se déversaient sur les pays voisins 2. Dès l’année suivante, et, pendant plus de dix ans, ce fut un souci constant. La menace était grave; aussi quand le prince demanda des mesures militaires en 1438, trouva-t-il beaucoup de bonne volonté parmi ses sujets; chaque ville prépara des machines de guerre et se tint prête à fournir des hommes 3. Nous ne savons pas s’ils durent marcher. En 1441, les milices furent mises sur pied; les soldats d’Yverdon tout au moins allèrent en Bresse 4. Au printemps de l’année 1443, les Ecorcheurs reparurent plus menaçants que jamais; la Savoie prit peur et appela à son secours ses alliés bernois. La république mit à sa disposition une grande armée qui partit le 25 avril 5 et à laquelle se joignirent 400 Fribourgeois 6; le procureur de Vaud vint à leur rencontre et les conduisit en Bresse où se trouvait /299/ déjà l’armée du duc. Devant un pareil déploiement de forces, les Armagnacs s’éloignèrent; au bout de peu de jours, les Bernois purent prendre le chemin du retour; par Genève ils gagnèrent Lausanne, où le procureur de Vaud les quitta 1; le 9 mai, l’armée était rentrée à Berne 2. Les gens des villes vaudoises, convoqués entre le 31 mars et 23 avril, se concentrèrent à Morges, d’où ils furent transportés à Genève; on ne sait pas si, eux aussi, allèrent en Bresse 3.
En 1444, ou plus probablement en 1445, il y eut une nouvelle expédition; entre le 8 et le 11 mars, le procureur de Vaud conduisait de Morges à Genève les contingents de Morat, Payerne, Yverdon, Moudon et Cossonay 4; quelques jours plus tard, 23 soldats d’Estavayer, habillés de drap rouge et blanc, venaient à Morges d’où, après quelques jours d’attente, on les renvoya dans leurs foyers 5. Du 4 au 14 janvier 1445, le bailli et le procureur de Vaud visitèrent les passages du Jura et les châteaux voisins, qu’ils firent garder nuit et jour; entre le 19 et le 24 du même mois, ils allèrent à Moudon, puis à Lausanne pour discuter avec les Etats de Vaud des mesures à prendre pour protéger le pays contre les Armagnacs 6; à une date /300/ que nous ne connaissons pas, le bailli de Vaud manda aux milices des villes que chacun vînt à Yverdon auprès « du capitaine pour obvier que les escorchieux ne entrassent au pays de Vuaud ». Dans le courant d’avril, il les convoqua à une revue, qu’il passa lui-même à Yverdon, et il y revint trois jours après pour s’occuper de fortifications 1.
En 1446, le duc avait des hommes d’armes tout prêts en Bresse, à Genève, en Savoie et dans le Pays de Vaud; il les offrait aux Bernois avant de les congédier 2. Il s’agissait sans doute de mercenaires, et non de soldats vaudois.
En 1447, on dut de nouveau fortifier les passages du Jura et les milices vaudoises se relayèrent pour les garder; mais il semble ressortir des indications qui nous sont parvenues que les communautés n’étaient plus animées d’un grand zèle militaire; lasses du service ou ne croyant plus au danger, elles se font tirer l’oreille; ce n’est que sur les réquisitions réitérées des capitaines savoyards qu’elles envoient leurs contingents; elles préfèrent payer des subsides pour l’entretien des mercenaires 3. On cite encore une campagne en 1449 4 et une en juillet 1452 5, mais cette /301/ dernière, probablement, n’était pas dirigée contre les Armagnacs; il s’agit de la guerre que le dauphin, le futur Louis XI, et le duc de Savoie menaçaient d’entreprendre contre Charles VII 1.
Nous avons vu plus haut 2 que les milices vaudoises prirent part à la guerre contre Fribourg; leurs soldats se succédèrent de huit en huit jours 3, s’en tenant ainsi strictement aux obligations que leur imposaient leurs chartes.
En 1452, lorsque le duc s’empara de Fribourg, le mécontentement fut tel à Berne que l’on craignit une guerre; on prit des mesures militaires dans le Pays de Vaud, mais les choses s’arrangèrent avant que l’on eût mis les troupes sur pied 4. Deux ans plus tard, le dauphin fit mine d’attaquer son beau-père, le duc de Savoie, parce que celui-ci refusait, cette fois, de marcher avec lui contre le roi, son père. A plus d’une reprise au cours des mois de juillet, août et septembre, les villes vaudoises fournirent des contingents; mais les exigences du prince provoquèrent dans le pays une vive résistance 5. La campagne se termina sans effusion de sang, lorsque les Bernois eurent envoyé une armée de 3000 hommes au secours du duc, leur allié 6. Une dernière fois, en juillet 1457, le duc Louis, par l’intermédiaire de son fils, le prince de Piémont, /302/ réclama l’aide militaire des Vaudois : il voulait réduire à l’obéissance le duc de Bourbon, son vassal en Bresse, qui lui refusait hommage; les villes lui accordèrent chacune vingt-cinq hommes, qui ne semblent pas avoir été levés 1. Nous ignorons la part que prit Moudon à ces diverses campagnes.
*
* *
Louis de Savoie fut plus exigeant en matière d’impôts. Nous avons déjà signalé 2 que, au moment où son père lui remit l’administration du duché, il était en conflit avec les communes vaudoises à propos d’un subside sous forme de soldats mercenaires; une autre difficulté était pendante, dont voici l’objet, si nous comprenons bien les textes qui sont parvenus jusqu’à nous : la cour suprême de Chambéry avait interdit aux juges du Pays de Vaud d’exécuter les jugements prononcés par eux quand il y avait appel devant elle; les villes vaudoises protestaient que cela était contraire à leurs franchises, soit qu’elles voulussent sauvegarder leur autonomie judiciaire en s’opposant à tout appel, soit qu’elle craignissent qu’un appel suspensif, avec les complications de la procédure d’alors, n’empêchât les procès de jamais finir 3. Les communes avaient voulu lier les deux questions; cela avait déplu à Amédée VIII qui brusqua les choses : il exigea que les soldats demandés fussent à Morges le 10 août 1434 4. /303/
Les villes s’y refusant, il fit saisir les biens des communautés récalcitrantes; elles cédèrent et, vers le 25 janvier 1435, les Etats de Vaud, réunis à Moudon composaient pour 2000 florins (120 000 fr.); Moudon en payait 200 1; Payerne 250 2; moyennant quoi toutes les saisies étaient levées et tous les procès intentés à ce propos annulés. Le premier acte officiel du prince de Piémont envers ces nouveaux sujets fut de leur donner quittance de cette somme, le 16 février 1435.
Un an ne s’était pas écoulé que le jeune prince réclamait de nouveau de l’argent : il s’agissait de marquer par là son joyeux avènement et de fournir quelques soldats à son frère Philippe devenu comte de Genevois; il demandait un florin par feu. Les gens de Moudon préférèrent s’arranger pour une somme globale et versèrent une seconde fois 200 florins, dont quittance leur fut donnée le 25 janvier 1436 3.
En 1437, nouvelle exigence : le duc avait obtenu, assurait-il, la révocation de certains induits pontificaux 4; il demandait qu’on le récompensât de ce service par un don d’une livre (100 fr.) par feu. Cette fois les communes regimbèrent; on discuta tout l’été; finalement le 21 août, à Thonon, le duc ayant promis de réprimer les abus de pouvoir de ses officiers, les villes /304/ consentirent à payer, Moudon 240 livres (24 000 fr.), Nyon 100 1. Cela faisait, pour Moudon seulement, 800 florins (48 000 fr.) en moins de trois ans.
L’élection de Félix V fut un prétexte pour une nouvelle demande de subside; Yverdon paya 16 deniers gros (80 fr.) par feu 2; nous n’avons aucune indication d’un paiement fait à ce sujet par Moudon, mais il serait bien étrange que cette ville y eût échappé.
Pendant trois ans le duc Louis évita de recourir à l’impôt 3. Au cours de l’automne 1442, l’empereur Frédéric III, qui ne portait encore que le titre de roi des Romains, vint en Suisse; il séjourna à Fribourg du 8 au 18 octobre 4; le 19, il était à Lausanne, d’où il passa à Ripaille, puis à Genève (22 octobre) 5. Il fut partout magnifiquement reçu. Comme une trentaine d’années plus tôt 6, les sujets de Savoie furent invités à payer les frais des fêtes données en l’honneur du monarque. Mais cela n’alla pas tout seul; le 4 janvier 1444, les députés des villes refusèrent le subside /305/ de deux florins (120 fr.) par feu qui leur était demandé; l’empereur, disaient-ils, n’était pas venu pour le fait de l’Empire 1; ils ajoutaient que, en 1443, le passage des armées bernoises et fribourgeoises 2, ainsi que des autres troupes savoyardes, avait été une telle charge qu’ils n’en pouvaient plus. Une nouvelle conférence, le 24 janvier, resta sans résultat; en mars toutefois les communautés se résignèrent 3, mais nous ignorons quelles conditions elles mirent à l’octroi d’un subside dont nous ne connaissons pas même le montant 4.
En 1447, les villes versèrent des sommes importantes, pour payer la solde des troupes qui défendaient le pays contre les Ecorcheurs, mais il ne semble pas qu’il y ait eu de subside proprement dit 5. L’année suivante, à l’occasion de la guerre contre Fribourg, le Pays de Vaud accorda au duc un subside de 1200 florins (72 000 fr.) 6; il le fit d’assez bonne grâce, paraît-il 7, cette campagne ayant soulevé pas mal d’inquiétude dans les esprits.
En 1449, au plus mauvais moment de la guerre désastreuse qu’il faisait à François Sforza pour la /306/ possession de Milan, le duc eut recours aux ressources de ses sujets; les provinces au nord des Alpes fournirent un florin (60 fr.) par feu 1. Nous ne savons pas comment le Pays de Vaud et Moudon en particulier se comportèrent en face des nouvelles exigences du prince 2.
Lorsque, en 1451, il donna sa fille Charlotte au dauphin de France, Louis demanda 6 francs 3 par feu; les Etats de Vaud, réunis à Moudon le jeudi après Pâques (29 avril), ne purent se soustraire à un paiement que la coutume féodale leur imposait, mais ils réduisirent cette somme à deux florins, à 13 sous chacun, par feu (130 fr.) 4; le 14 mai, le prince reconnaissait que ce versement était fait de pure grâce et ne pouvait constituer un précédent 5.
L’année suivante, quand le duc faillit être entraîné dans une guerre avec le roi de France 6, il fit de nouveau appel à la bourse de ses sujets; il demanda 16 sous (80 fr.) par feu. Les communes transigèrent en lui versant 2000 florins en une seule fois 7, mais /307/ le duc, mécontent, leur refusa l’acte de non-préjudice qu’il était d’usage de leur accorder en pareil cas.
Cela l’obligea à user par la suite de quelques ménagements; chose rare, cinq ans s’écoulèrent sans nouvelle demande. Néanmoins, quand, en 1457, il maria sa fille Marguerite au marquis de Montferrat et qu’il réclama un subside de 29 sous (145 fr.) par feu, il éprouva une résistance inaccoutumée 1. En 1459, le second fils de Louis, qui portait le même prénom que son père, épousait sa cousine germaine, Charlotte de Lusignan, reine de Chypre, et acquérait ainsi ce titre de roi de Chypre et de Jérusalem, que, tout récemment encore, on pouvait lire sur les monnaies des rois de Sardaigne, titre glorieux sans doute, mais qui devait être pour lui une source de malheurs sans fin 2. L’avènement du jeune prince fut l’occasion d’une nouvelle demande de subside; mais les communautés ne payèrent pas la somme qu’on leur réclamait 3 : les villes ne voulurent accorder que 3000 florins pour toutes choses 4 et les /308/ seigneurs bannerets ne versèrent que mille florins entre eux tous 1.
Son fils aîné, le prince de Piémont, n’avait pas encore tenu la promesse faite jadis par ses mandataires de venir à Moudon, dès son retour au pays, prêter serment de respecter les franchises de ses sujets 2; pour l’y contraindre, les villes lui firent un don de 300 écus 3; mais nous ne savons pas si cela l’amena à s’exécuter.
Enfin, en 1465, comme le roi de Chypre, chassé de son royaume et depuis cinq ans en exil, implorait des secours en hommes et en argent, son père, à bout de ressources lui-même, tenta d’obtenir de ses sujets un nouveau subside de 16 sous; il lui fut refusé 4.
En attendant que l’aventure de Chypre vînt le ruiner complètement, la situation financière du duc empirait de jour en jour; le pontificat de Félix V avait coûté très cher; la cour ducale menait une vie de luxe hors de proportion avec ses ressources; la guerre de Milan /309/ avait absorbé les dernières disponibilités du Trésor; le duc avait dû avoir recours à des emprunts à des taux élevés, au 7 % et au 10 %; il avait été obligé de mettre sa vaisselle en gage ainsi que les bijoux, de la duchesse 1; il commençait à altérer sa monnaie 2. Il était hors d’état de verser aux Fribourgeois les sommes qu’il s’était engagé à leur payer lors de leur soumission; il ne pouvait pas davantage s’acquitter envers les Bernois des 15 000 florins du Rhin qu’il leur avait promis en compensation de l’acquisition de Fribourg 3. Aussi, Fribourgeois et Bernois, las d’attendre et désireux déjà de mettre la main sur le Pays de Vaud, profitèrent-ils de l’occasion. En 1459, ils firent mine de prendre des gages et de s’emparer de quelques châtellenies : Morat, Yverdon, Romont. L’opinion s’émut dans le pays, qui ne tenait pas à changer de maîtres; les Etats de Vaud se réunirent à Moudon 4. Le roi de France intervint; une sentence arbitrale du marquis de Hochberg et des cantons suisses obligea le duc à payer aux Fribourgeois 25 600 florins, plus 7960 d’intérêts arriérés et 1280 d’intérêts annuels; Vevey et la Tour étaient donnés en gage de ces versements (14 février 1460). Seule l’intervention de Berne, qui ne voulait pas voir Fribourg installer sa domination sur les rives du lac, empêcha /310/ ces deux villes du Chablais de tomber entre les mains des Fribourgeois. Au printemps de l’année suivante, ceux-ci, qui n’étaient pas payés, s’emparèrent de la châtellenie de Châtel-St-Denis, pour être couverts de leurs créances 1. Le morcellement de la monarchie savoyarde commençait.
La détresse financière de la cour n’était pas sans influence sur la politique intérieure; le duc avait peine à rembourser ses fonctionnaires de leurs avances; il était obligé de leur passer reconnaissance pour de fortes sommes 2. Il devait abandonner des terres ou des droits aux créanciers du Trésor; c’est dans ces conditions que les Cerjat acquirent la seigneurie de Combremont-le-Petit 3. Mais quelle autorité conservait le prince sur des fonctionnaires ou des vassaux dont il était le débiteur insolvable ?
Autre conséquence : les demandes réitérées de subsides multiplient les séances des Etats de Vaud. Nous n’en avons pas une liste complète; le peu que nous savons 4 nous montre les députés des villes se /311/ réunissant plusieurs fois par an pour discuter avec le duc ou ses agents, pour protester contre les procédés de ses officiers, pour traiter « aucuns affayrez tochan tôt le pais 1 ». Quand la guerre menace de la part des Ecorcheurs ou du côté de Berne ou de Fribourg, les Etats délibèrent sur le salut de la patrie et prennent des mesures militaires pour la défense du pays 2. Ainsi les délégués des communes s’habituent à venir discuter à Moudon de la situation politique; peu à peu les Etats de Vaud prennent figure de représentation nationale; leur importance croit avec le dénuement du Trésor 3.
Sous un autre rapport aussi, la part des Vaudois au gouvernement du pays tend à s’accroître : à peu près tous les baillis de Vaud sont des seigneurs autochtones 4. Ceux qui exercèrent le plus longtemps ces fonctions, Jean de Blonay et Guillaume de Genève, ont des propriétés dans la vallée de la Broye et des maisons à Moudon; s’ils n’y séjournent pas en permanence, leurs intérêts, à défaut des devoirs de leur charge, les y ramènent fréquemment et les mettent en contact avec la population dont ils sont les représentants naturels.
Quand ils sont absents, ce qui est fréquent 5, ils y sont remplacés par leur lieutenant qui est, dans la /312/ règle, un notaire de Moudon 1. Là encore, nous voyons une part de l’autorité détenue par des hommes du pays.
Il serait imprudent d’en conclure que celui-ci tendait à l’autonomie; il est permis de penser qu’il avait le sentiment de n’être pas gouverné par des étrangers.

Signature d’Amédée, prince de Piémont.
Voir Note 1 p. 295
CHAPITRE XVII
LES GUERRES DE BOURGOGNE
La faiblesse de la Savoie suscita les ambitions bernoises. Tant qu’Amédée VIII avait vécu, tant que sa maison avait été florissante, l’idée qu’ils pourraient un jour s’installer dans le Pays de Vaud ne semble pas avoir abordé l’esprit des Bernois. Mais lorsqu’ils virent l’Etat savoyard en pleine décadence, lorsqu’ils sentirent menacé à la fois de l’anarchie et de la conquête française ce beau pays, où le climat était plus doux, le soleil plus chaud et le ciel plus riant que chez eux, cette terre privilégiée d’où ils tiraient leur vin et une partie de leur blé 1, alors leur appétit s’éveilla. Genève était la porte par laquelle passait tout leur commerce avec Lyon et la vallée du Rhône; ne convenait-il pas qu’ils s’assurassent la possession du pays qui les séparait de cette ville ? Le duc était leur débiteur; n’était-il pas sage de se réserver des gages qui couvrissent leur créance ? Ainsi, tout concourait à attirer leurs regards sur cette proie que la nature et la Providence paraissaient avoir placée à portée de leurs mains. /314/
Sans doute, la conquête proprement dite ne se présenta pas à eux comme un but immédiat; la politique bernoise visa d’abord à une sorte de pénétration pacifique et songea pour commencer à prévenir toute extension dangereuse de l’emprise française. La discorde qui régnait au sein de la famille ducale leur fournit une occasion d’intervenir.
Déjà du vivant du duc Louis, lorsque son cinquième fils, Philippe, s’était révolté contre lui 1, ils avaient témoigné au rebelle une discrète sympathie. Le jeune prince affirmait, en effet, n’avoir pris les armes que pour s’opposer aux desseins ambitieux du roi de France; cette attitude ne pouvait déplaire aux Bernois; aussi des personnages importants de la république ne dédaignèrent-ils pas de l’accompagner à Genève quand il y parut devant son faible père et ils y jouèrent en quelque sorte le rôle d’arbitres.
Les Bernois le prirent dès lors sous leur protection, si bien que Louis XI en vint à redouter une entente entre les Suisses et lui. Cela permit à la diplomatie bernoise d’obtenir l’assurance que le roi ne songeait pas à s’emparer de la Savoie 2 et, en même temps, de s’immiscer dans les affaires intérieures de ce pays.
Ils continuèrent après la mort du duc Louis. Il laissait une quinzaine d’enfants, dont huit fils; cinq étaient laïques; il leur avait donné des apanages /315/ au détriment des ressources de sa maison 1; les trois autres étaient ecclésiastiques 2 sans avoir ni la vocation, ni les mœurs qui conviennent à cet état; tous étaient ambitieux et agités et ont troublé de leurs prétentions et de leurs querelles la monarchie savoyarde, à la ruine de laquelle ils ont puissamment contribué.
Le nouveau duc, Amédée IX, était un prince plein de vertus et de bonnes intentions; d’une piété monacale, il a mérité le nom de Bienheureux que l’Eglise lui a donné; mais il était faible et usé par une maladie redoutable, l’épilepsie; il ne régnait qu’à regret et il abandonna bientôt le gouvernement de ses états à sa femme, Yolande de France, la sœur de Louis XI.
C’était, disent les historiens savoyards 3, une belle princesse, intelligente et cultivée, qui goûtait les fêtes et les représentations théâtrales et que l’esprit de la Renaissance avait déjà touchée. D’une vertu indiscutée comme femme, elle comprenait la politique comme les princes italiens de son temps; fausse et sans scrupules, elle ressemblait beaucoup à son frère : dévoté comme lui, elle était, comme lui, d’esprit souple et de conscience élastique.
Il faut reconnaître que sa situation était bien difficile : elle avait un mari incapable, un Etat ruiné, des voisins redoutables; Louis XI, Charles-le-Téméraire, /316/ le duc de Milan, les Suisses cherchaient, les uns et les autres, à exercer sur la Savoie un protectorat, qui n’était autre chose qu’une annexion déguisée.
En Savoie, tout un parti aurait voulu profiter de la guerre de la Ligue du Bien Public, qui menaçait Louis XI, pour soustraire l’Etat à la tutelle française, mais le duc resta fidèle à l’alliance qu’il avait héritée de son père 1. Louis XI, qui connaissait sa faiblesse et qui semble n’avoir eu en sa sœur qu’une médiocre confiance, n’était pas tranquille cependant; il imagina de s’assurer la dépendance de la Savoie en se servant de Philippe de Bresse, que l’on appelait alors Philippe-Monseigneur. Il s’était emparé de lui traîtreusement et l’avait fait enfermer; il lui rendit sa liberté et l’envoya dans sa patrie où il devait être un des instruments de sa politique. Mais le comte de Bresse ne pardonnait pas à Louis XI de l’avoir emprisonné; d’accord avec ses frères, il tournait ses regards du côté de la Bourgogne et, bientôt, il s’engageait avec le duc Charles 2; il ne revint que plus tard à l’alliance française.
Philippe était au mieux avec les Bernois. Quoique Yolande eût renouvelé en 1467 son alliance avec Berne et que, en 1469, elle eût fait avec son mari un voyage dans cette ville et à Fribourg 3, où elle avait trouvé bon accueil, elle n’avait pu rompre cet accord.
Sûr de ce côté, Philippe de Bresse s’enhardit et, au mois de juin 1471, à la tête d’une troupe d’hommes /317/ d’armes, il pénétra dans Chambéry, d’où la cour venait de s’enfuir, puis il alla mettre le siège devant le château de Montmélian, où elle s’était réfugiée. Pour ne pas tomber entre les mains de son beau-frère, Yolande s’enfuit à Grenoble; le pauvre Amédée, abandonné par elle, passa de la tutelle de sa femme sous celle de ses frères et la Savoie eut deux gouvernements rivaux 1.
Alors les Bernois et les Fribourgeois intervinrent; l’avoyer de Berne et celui de Fribourg se rendirent à Chambéry et imposèrent leur médiation; la sœur du roi de France plaida devant eux, devant Pétermann de Wabern et Nicolas de Diesbach, devant un Vuippens et un Praroman; les princes leur remirent Chambéry; la duchesse congédia l’armée française qu’elle avait levée; le gouvernement du duché fut reconstitué par les soins des députés suisses; les frères du duc y avaient leur place; le comte de Bresse obtenait peu après la lieutenance générale 2.
Ainsi, vingt ans après la mort d’Amédée VIII, la Savoie était à la merci des Suisses et les Bernois s’y comportaient en maîtres.
Quelques mois après, le 30 mars 1472, Amédée IX mourait; il laissait le trône à son fils Philibert, un enfant de sept ans 3. Les Etats de Savoie remirent la régence à la duchesse Yolande 4. Mais ses beaux-frères, Philippe-Monseigneur en particulier, /318/ réclamaient une part du pouvoir et la pauvre duchesse craignait à tout instant une nouvelle révolte de ce dernier. Brouillée avec son frère, parce qu’elle ne voulait pas lui sacrifier la Savoie, redoutant les Bernois qu’en 1472 déjà on représentait comme tout prêts à s’emparer du Pays de Vaud 1, elle chercha d’abord un appui auprès du duc de Milan; pendant près de deux ans, elle resta dans le Piémont 2 pour être plus à portée de ses secours; puis, quand elle commença à craindre que ce protecteur ne devînt un maître, elle se jeta dans les bras de Charles-le-Téméraire (juin 1473) 3.
C’était le moment, en effet, où le monde occidental était appelé à prendre parti dans le conflit qui séparait le roi de France du duc de Bourgogne. Mal inspirée ou mal conseillée, la duchesse de Savoie s’attacha à celui des deux adversaires qui devait être vaincu et l’entraîner dans son infortune.
*
* *
A ce moment notre pays ne dépendait pas directement du duc de Savoie; comme nous l’avons vu plus haut 4, il était devenu l’apanage de Jaques de Savoie, comte de Romont. Pour des raisons que nous ignorons 5, ce ne fut qu’en 1467 qu’il entra en /319/ possession de son domaine. Encore ne reçut-il que huit des châtellenies qui le composaient, soit celles de Romont, Rue, Moudon, Estavayer, Yverdon, Cossonay, Morges et Nyon; les autres continuaient à former le douaire de la duchesse Yolande 1.
Le 25 juin, à Annecy, le nouveau baron de Vaud confirma les franchises du pays; les représentants de ses sujets firent inscrire dans cet acte que ce serment ne dispensait pas le prince de venir les confirmer en personne la première fois qu’il irait dans le Pays de Vaud 2; aussi, le 15 janvier de l’année suivante, le comte était-il à Romont et, le surlendemain, le samedi 17 janvier 1468, à Moudon, dans l’église St-Etienne, il prêtait serment d’observer les franchises de la ville; la cérémonie se déroula devant le grand autel, en présence d’une noble assistance où l’on remarquait l’évêque de Genève et le comte de Bresse, ses frères, le comte de Gruyère et beaucoup de seigneurs vaudois; au nom de la communauté, Guy Cerjat prêta serment à son tour, la main sur les Saints Livres, pendant que tous les habitants levaient au ciel l’index de la main droite 3.
En juin 1471, profitant de la faiblesse de la duchesse attaquée par Philippe-Monseigneur, Jaques de Romont s’empara des châtellenies de Morat, Payerne, Grandcour, Sainte-Croix, Montagny-les-Monts, les Clées et /320/ Corbières; Yolande ne conserva que Belmont sur Yverdon 1. Ainsi, le comte de Romont était maître de tout le pays et son apanage formait un véritable Etat.
Quand il avait donné le Pays de Vaud à son fils aîné, le duc Louis avait mis quelques limites à l’autorité de celui-ci 2; Jaques de Romont eut les coudées plus franches; non seulement, il put installer à Moudon un bailli de Vaud et son lieutenant 3 ainsi que des châtelains dans le reste du pays, mais il leur adjoignit un lieutenant d’armes et un gouverneur de Vaud, dépositaires, en l’absence du prince, du pouvoir suprême, au militaire et au civil 4; il eut sa propre Chambre des Comptes, qui siégeait tantôt à Cossonay, tantôt à Morges 5; il convoquait les Etats de Vaud et discutait avec eux 6; comme son frère le duc, il avait un Conseil qui s’occupait des questions politiques 7.
Le chef de la maison de Savoie n’avait plus que le droit de juger en appel et celui de lever des subsides. Le gouvernement d’Amédée IX n’en abusa pas; en 1465, les communautés vaudoises lui accordèrent un don de 1200 florins petit poids à l’occasion de son avènement, en lieu et place d’un impôt de 16 s. /321/ par feu; elles le firent d’autant plus volontiers qu’elles espéraient voir le duc se dégager par là de ses dettes vis-à-vis de Berne 1; elles redoutaient évidemment que les Confédérés ne saisissent ce prétexte pour envahir le pays. En 1469, au printemps, elles consentirent à un nouveau subside, mais après de longues négociations 2.
Ainsi, Jaques de Romont put se conduire en prince indépendant; il se permit même de lever un subside en 1471 3; satisfait de son lot à partir de cette date, il n’importuna plus la régente qui fut amenée à se confier en lui et à lui demander une protection contre les ambitions inassouvies de ses autres frères, du comte de Bresse en particulier.
Comme beaucoup de jeunes seigneurs de notre pays, le comte de Romont était allé chercher fortune à la cour de Bourgogne; il y épousa une petite-fille du connétable de St-Pol, de la maison de Luxembourg 4; il était lié, en outre, à Charles-le-Téméraire /322/ par des rapports d’attachement personnel. Il est probable que son influence n’a pas été étrangère au parti que prit la duchesse.
Pour des raisons que nous ignorons, le comte de Romont ne jouissait pas à Berne de la même faveur que son frère Philippe. Peut-être les Bernois craignaient-ils que sa vassalité bourguignonne ne l’entraînât à faire passer sous l’autorité de Charles le Pays de Vaud qu’ils convoitaient déjà 1.
*
* *
Quoi qu’il en soit, ni cette inimitié, ni même la crainte de voir le duc de Bourgogne étendre sur la Savoie un protectorat que Berne entendait se réserver pour elle-même ne furent les causes déterminantes de la guerre. Il fallut, pour engager les Suisses dans une campagne contre celui-ci, une force plus puissante : l’intervention de Louis XI. C’est lui qui, pour ruiner son redoutable adversaire, excita les Suisses; c’est lui qui, par ses flatteries, ses promesses et ses cadeaux, gagna Nicolas de Diesbach et réussit, par son intermédiaire, à créer à Berne un parti français dont l’influence devint prépondérante 2. /323/
A la fin d’août 1474, des ambassadeurs français arrivaient en Suisse; ils promettaient au nom du roi une pension annuelle de 2000 fr. à chaque canton, une gratification annuelle de 20 000 fr. et une solde de 80 000 fr. en temps de guerre 1. Les Confédérés ne résistèrent pas à des promesses si alléchantes; le traité d’alliance fut signé le 26 octobre; la veille déjà 2, ils avaient déclaré la guerre au duc de Bourgogne en prenant pour prétexte un appel de l’empereur et de l’archiduc Sigismond; le 27, les troupes de Berne occupaient Cerlier, dont le seigneur était vassal de la Savoie, mais servait Charles-le-Téméraire 3; en novembre les Suisses faisaient leur première expédition en Franche-Comté et, le 2 janvier 1475, les Bernois et les Fribourgeois s’emparaient d’Illens, fief d’un seigneur savoyard au service de Bourgogne 4. C’était la guerre et la Savoie était directement menacée.
Elle était cependant au bénéfice d’un traité d’alliance avec Berne qui n’avait pas été rompu; mais, depuis quelques mois, les rapports s’étaient gâtés. Il ne nous /324/ est pas possible de suivre mois par mois les progrès de la rupture 1; nous en sommes réduits aux hypothèses. On peut penser que la régente avait gardé un mauvais souvenir de l’intervention bernoise de 1471 et qu’elle préférait voir ses liens se distendre avec la république; il est probable d’autre part que les magistrats les plus influents de cette ville avaient lié partie avec Philippe-Monseigneur, comme eux instrument de la politique de Louis XI; ils auraient voulu voir ce prince assumer la régence à la place de sa belle-sœur qui ne leur inspirait pas confiance 2; ce fut, peut-être, pour engager celle-ci à appeler ce prince à son Conseil que Berne fit plusieurs démarches auprès de la cour savoyarde au cours de l’été 1473, sous prétexte des affaires du Valais 3.
Un fait est certain : en septembre 1474, Philippe de Bresse tenta une troisième rébellion; assisté de son frère Janus, comte de Genève, il se jeta dans Annecy avec 150 lances françaises 4; au même moment, une bande de soldats bernois cherchait à s’emparer du château de Sainte-Croix. L’évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie, réussit à mettre fin à la tentative de son frère et les officiers du comte de Romont mirent le Pays de Vaud en état de défense 5. /325/ Mais la duchesse, qui avait cru pouvoir maintenir sa neutralité, qui même venait d’offrir sa médiation à la diète de Lucerne 1, dut revenir de ses illusions et prendre des mesures militaires 2.
Entre temps, la diplomatie agissait. A l’instigation de Philippe de Bresse, qui comptait bien pêcher en eau trouble 3, et du comte de Gruyère, que ses titres de bourgeois de Berne et de maréchal de Savoie plaçaient dans une position délicate 4, une conférence eut lieu à Lausanne, le 21 janvier 1475 et les jours suivants, en présence des députés du Pays de Vaud; sous la forme d’un ultimatum et en exigeant une réponse dans les quinze jours, les Bernois présentaient des demandes inadmissibles, entre autres le droit de passer avec leurs troupes au travers des pays savoyards et d’en occuper les citadelles 5. Grâce à l’intervention du duc de Milan, et probablement de Louis XI lui-même, qui fit comprendre aux Bernois que, s’il permettait que l’on donnât une « correction » à sa soeur, il ne tolérerait pas qu’on lui prît ses états 6, la duchesse obtint que la chose fût portée devant la Diète, où la situation semblait plus favorable, les cantons du centre, déjà jaloux du rôle joué par Berne, /326/ ne paraissant pas disposés à entreprendre une guerre qui ne profiterait qu’à cette ville.
Mais ce ne fut qu’un court répit; pendant que les négociations traînaient 1, au début de mars, des bandes de soldats, que Berne désavouait, mais laissait faire, ravageaient la contrée de Grandson 2, et, en avril et mai, une armée confédérée, commandée par Nicolas de Diesbach, s’emparait de Grandson, Montagny et Orbe 3, qui dépendaient de la maison de Chalon, sous la suzeraineté de la Savoie.
La duchesse, qui ne pouvait ignorer qu’à Berne et à Fribourg on parlait ouvertement d’occuper Yverdon et les terres du comte de Romont 4, n’avait ni argent ni soldats pour résister à ces attaques et Charles-le-Téméraire était encore retenu au siège de Neuss; elle se contenta de protester et de réclamer, sans aucun résultat, la restitution des places qui étaient tombées entre les mains des Suisses 5.
Un moment, on put croire que l’orage s’éloignerait : en septembre, Berne et Fribourg faisaient dire à la duchesse qu’on ne songeait pas à l’attaquer 6; Charles-le-Téméraire faisait des propositions de paix et /327/ Louis XI s’arrangeait avec lui, en abandonnant les Suisses 1.
Mais, à Berne, le parti de la guerre, décontenancé un instant par la mort de Nicolas de Diesbach, avait bientôt repris le dessus; cette fois, on y était bien décidé à occuper enfin ce Pays de Vaud, où le soleil de l’automne mûrissait les raisins et qui, depuis une dizaine d’années, semblait une terre promise à la valeur comme à l’ambition bernoises.
Au milieu du mois d’août déjà, le passage de mercenaires italiens leur fournissant une occasion opportune d’intervenir, les Bernois avaient passé les Alpes et s’étaient emparés d’Aigle 2. Bientôt, entraînant les Fribourgeois en les assurant qu’on n’attaquerait pas la duchesse leur suzeraine, mais le comte de Romont seulement, qui venait de rentrer dans ses états et s’y préparait à la lutte, ils déclarèrent la guerre à ce prince et à l’évêque de Genève; c’était le 14 octobre 1475 3.
*
* *
Depuis plusieurs mois, en effet, le comte de Romont avait pris des précautions militaires. Les premières mesures que nous connaissions datent de l’année /328/ 1474 : au mois d’avril, six mois avant la première campagne des Confédérés, il avait fait mettre en état de défense le château de Sainte-Croix; en mai, nous y trouvons des coulevreniers de Moudon, de Romont, de Rue, de Cudrefin; à partir de septembre date de la tentative d’attaque des Bernois, une garnison permanente y est installée 1.
A peu près au même moment, Cossonay avait réparé ses murailles 2 et, à Yverdon, on avait refait les ponts-levis, construit des boulevards et acheté de la poudre; au printemps 1475, on y avait mis une garnison 3 en même temps qu’on renforçait celle de Sainte-Croix 4.
A Moudon aussi, on prit des mesures de défense 5, sur l’initiative de l’autorité municipale. Depuis 1469 au moins, la ville songeait à se munir d’artillerie 6; dès l’automne 1474, on acheta du métal, fer et cuivre, avec lequel on fabriqua des serpentines et des coulevrines et l’on travailla aux fortifications : les portes furent remises en état; en janvier 1475, sous l’effet de l’émotion que causa la prise d’Illens, on construisit des braies, c’est-à-dire des retranchements, surmontés de palissades, qui formaient devant les /329/ murs une première enceinte; en février, sur le modèle de ce qui avait été fait à Payerne, un charpentier dressa, au milieu des fossés, de petites redoutes basses et crénelées, destinées à battre de flanc les assaillants et que l’on appelait des moineaux; devant les principales portes, on fit des boulevards, soutenus par des madriers.
Dès que la bonne saison fut arrivée, on se mit aux travaux de terrassement et de maçonnerie; les fossés furent creusés à nouveau; les murs regarnis et, par endroits, reconstruits; au nord de la ville, une tour fut démolie et rebâtie; d’autres furent munies d’archères; les boulevards furent renforcés de parapets en pierre.
Ces travaux furent terminés en septembre; ils étaient considérables, si l’on en juge par le nombre des journées des maîtres d’état et par la quantité des matériaux qui y furent employés 1, ainsi que par leur coût qui atteignit 500 livres (environ 50 000 fr.). De même, la ville semble munie alors d’une artillerie suffisante : outre les pièces qu’elle possédait auparavant, et dont nous ignorons le nombre, elle dispose de trois serpentines et de plus de trente coulevrines; les premières, qui sont lourdes, ont été mises sur des affûts; les secondes, qui sont très légères 2, ont été placées sur des chevalets. La réserve de munitions se compose de quelque deux cents livres de poudre, de 180 boulets de pierre et d’un lot de balles de plomb, à quoi il faudrait ajouter les provisions que la ville /330/ pouvait avoir faites antérieurement. Le tout avait coûté 300 livres.
Les autorités de Moudon semblent avoir compté davantage sur les murailles de leur ville et les canons qui les garnissaient que sur les hommes qui l’habitaient. Sans doute, ils avaient encouragé le tir de leurs arbalétriers et fourni des chausses à leurs coulevriniers, au nombre de 28; en janvier 1475, ils avaient envoyé six compagnons tenir garnison pendant un mois, à Montagny près Payerne; en diverses circonstances, lorsqu’un danger subit avait semblé menacer leur ville, les bourgeois s’étaient armés pour garder leurs murs et leurs portes; mais leurs capacités, comme leurs goûts militaires, paraissent avoir été médiocres. Quand, au lendemain de la prise de Grandson, on put craindre que le Pays de Vaud entier ne fût envahi, on ne songea pas à se défendre avec les milices locales : on fit venir Jean de Genève-Lullin, que l’on nomma capitaine de la ville; celui-ci amena de Savoie vingt-sept soldats qui tinrent garnison à Moudon pendant quelques jours.
On n’en fit pas même autant en octobre, quand l’armée des Confédérés s’approcha.
Le jour de la déclaration de guerre, le 14 octobre, tard dans la soirée, elle avait pris Morat; le dimanche, elle occupait Payerne; le mardi 17, elle prenait d’assaut et mettait à sac la ville d’Estavayer; le vendredi 20, elle se présentait devant Yverdon, qui capitulait le lendemain; elle prenait ses quartiers à Orbe le dimanche 22, s’emparait des Clées le 23, couchait à Cossonay le 25 et entrait à Morges le vendredi 27. /331/
Aucune volonté supérieure n’avait présidé à la défense du pays; si le comte de Romont était présent, comme le croyaient les Confédérés 1, son action fut nulle et il ne tenta aucun effort sérieux pour leur résister 2. Laissées à elle-mêmes, les châtellenies agirent au hasard. Tandis qu’à Cossonay, par exemple, tout le contingent était mis sur pied et combattait vaillamment 3, dans la vallée de la Broye on était prêt à se soumettre sans essayer de se défendre.
Le 16 octobre déjà, n’ayant plus d’illusion sur le secours que l’on pouvait attendre des officiers du comte, le Conseil de Moudon entama des pourparlers avec les Confédérés. Pourquoi ces négociations n’aboutirent-elles pas le jour même ? Nous ne le savons pas; peut-être les délégués moudonnois prétendaient-ils obtenir un traitement particulièrement favorable. La nouvelle du sac d’Estavayer leur fit comprendre qu’il n’était plus temps de discuter; après s’être assuré l’appui des Fribourgeois, moyennant un cadeau de soixante écus 4, ils se préparèrent à capituler.
Le jeudi 19 au matin, un détachement de l’armée victorieuse remontait la vallée de la Broye pour y recevoir la soumission des villes et des châteaux; /332/ à Lucens, il rencontra une députation de conseillers et de bourgeois de Moudon; elle était composée de 17 personnes; par leur organe, la ville se soumit sans conditions; en retour, les habitants obtinrent des garanties pour leurs vies et leurs biens, ainsi que la confirmation de leurs franchises; ils s’engageaient à obéir dorénavant aux deux villes de Berne et de Fribourg et à ne plus en appeler à un tribunal étranger laïque ou ecclésiastique 1; les vainqueurs se réservaient de pouvoir démanteler la ville, ils n’exigeaient pas de rançon. Une escouade de 28 cavaliers vint aussitôt prendre possession de Moudon, où on les traita largement.
Cette prompte soumission épargna à la ville une occupation militaire et les horreurs de la guerre; elle ne la mit pas à l’abri des inquiétudes et des difficultés. Sans parler des pillards, contre lesquels elle dut prendre des précautions, ou des soldats égrenés qu’elle dut héberger, elle reçut, la semaine suivante, de Fribourg, la nouvelle qu’une troupe de 500 Suisses arrivait; c’était le contingent de Lucerne, de Glaris et des petits cantons 2 qui allait rejoindre l’armée devant Morges. Il fallut faire provision de victuailles pour les recevoir; on se procura 10 000 kg. de blé, 35 000 kg. d’avoine, 17 000 litres de vin de Lavaux, 225 têtes de bétail, essentiellement des moutons. Les distributions /333/ de vivres faites aux soldats, les cadeaux offerts aux capitaines évitèrent à Moudon tout mauvais traitement, mais coûtèrent plus de 500 livres à la bourse communale.
Lorsque, peu de jours après, on apprit que les Suisses s’apprêtaient à rentrer dans leurs foyers, on eut peur que toute l’armée ne passât par la ville qui était sur la route directe de Morges à Fribourg. Moudon échappa cependant à cette menace; partis de Morges le 29 ou le 30 1. les Confédérés firent route par Lausanne et Romont; le 2 novembre, ils étaient de retour à Berne 2. Pour le moment, tout danger était écarté.
*
* *
La mise en état de défense de la ville, l’acquisition d’une artillerie, le passage des soldats suisses avaient coûté plus de 1300 livres, ce qui est beaucoup pour une cité dont les recettes ordinaires ne dépassaient guère 250 livres 3. Elle dut trouver des ressources extraordinaires : elle exigea le remboursement des créances qu’elle possédait; elle vendit des terrains dont elle avait hérité; elle emprunta 400 livres, en deux fois, à un riche bourgeois, le forgeron Pierre de Bulo 4; /334/ enfin, elle eut recours à l’impôt, sous toutes ses formes.
A une dizaine de nouveaux bourgeois on demanda une contribution supplémentaire pour acheter des coulevrines. On obtint du clergé de la ville, en deux fois, un don de 60 livres et, de celui des environs, 44 livres et 7 sous. On imposa, à deux reprises, les fermiers des domaines qui se trouvaient aux portes de la ville et les paysans des villages qui formaient le ressort de Moudon 1. On se procura par là, en février, 127 livres 10 sous et, en octobre, 111 livres 6 sous, et plus de 26 muids d’avoine 2.
La première fois, la perception de cet impôt souleva pas mal de difficultés : le village de Servion refusa de payer; Démoret fit de même; tous deux alléguaient qu’ils ne faisaient pas partie du ressort de Moudon; et il semble bien qu’ils avaient raison 3. /335/
Le refus de Démoret entraîna Moudon dans une vilaine affaire avec le Chapitre de Lausanne dont ce village dépendait. Par trois fois, la ville envoya une troupe de bourgeois saisir les bestiaux des villageois; le Chapitre répondit en excommuniant les gens de Moudon. Ce conflit 1 semble avoir occupé les esprits tout autant, si ce n’est plus, que la menace de la conquête bernoise : une de ces expéditions contre Démoret tombe précisément sur le jour de la prise de Grandson par les Suisses. L’affaire finit par s’arranger, grâce à l’intervention du gouverneur de Vaud et de Claude d’Estavayer 2; le Chapitre renonça à ses prétentions et promit de payer les frais 3. Cet incident nous montre toute l’importance des querelles locales; le Pays de Vaud d’alors était bien loin de constituer une patrie dont les intérêts vitaux eussent pu primer toute autre considération.
La seconde fois, pour éviter de nouvelles difficultés, pressés de plus par l’urgente nécessité, les bourgeois s’imposèrent eux-mêmes aussi; chaque ménage aisé ou riche paya une contribution proportionnelle à sa fortune, mais suivant un taux qui ne nous est pas indiqué; il y eut 152 contribuables, sur 191 ménages, et cet « impôt de guerre » produisit 302 livres et 4 sous, plus de 30 000 fr. de notre monnaie. /336/
*
* *
Les Confédérés étaient maîtres de la plus grande partie du Pays de Vaud; ils en abandonnèrent l’administration à Fribourg et à Berne. Ces deux villes se hâtèrent d’organiser leur conquête.
Le bailli de Vaud était alors François de Billens, semble-t-il 1; il fut destitué. A sa place, on désigna, le 7 novembre 2, Humbert de Glane, seigneur de Cugy. C’était un bourgeois de Moudon des plus notables et fort riche 3. Sa nomination était motivée par les bons services que lui et ses aïeux avaient rendus aux deux villes et par le dommage qu’il avait subi du fait de leurs troupes. Nous ne savons pas à quel fait précis se rapporte ce second considérant 4; quant au premier, il ressort des comptes de Moudon qu’Humbert de Glane avait eu une conduite très prudente : quoiqu’il occupât une place en vue dans le Conseil, il n’avait pris aucune part aux préparatifs militaires; il avait laissé agir Humbert Cerjat et les autres membres de cette famille. Toutefois, il n’avait fait partie /337/ d’aucune des délégations qui eurent à traiter de la reddition de la ville 1; son rôle s’était borné à accueilir le détachement suisse qui en vint prendre possession et à lui tenir compagnie. Cette attitude réservée, peut-être des relations de famille lui avaient assuré la faveur des Confédérés. Il devint donc bailli de Vaud pour le compte des Bernois et des Fribourgeois avec mission d’administrer leurs terres et d’en toucher les revenus; comme son prédécesseur savoyard, il présidait la cour de Moudon.
Son premier acte officiel fut de convoquer à Moudon les Etats de Vaud pour les 8 et 9 novembre 2. Les maîtres de l’heure demandaient à leurs nouveaux sujets de leur fournir de l’argent pour payer les garnisons chargées de défendre le pays. Ces exigences étaient cruelles pour les Vaudois; les députés demandèrent un délai pour répondre; on les ajourna au 24 3.
La séance eut lieu à Fribourg cette fois, sous les yeux mêmes des vainqueurs; Nicolas de Scharnachtal et Péterman de Wabern y représentaient les Bernois. Les trois Etats n’étaient pas au complet; /338/ les ecclésiastiques avaient refusé de s’y rendre 1; il y avait des absents, parmi les nobles probablement.
Dès l’abord, les députés des villes réclamèrent la confirmation de leurs franchises, comme les officiers le leur avaient promis lorsqu’on avait capitulé; les vainqueurs s’y refusèrent : la situation était tout autre, déclaraient-ils, que du temps du comte de Romont; votre pays, « nous l’avons gagné à l’épée et le graf l’a obtenu par pasche 2 »; de plus, nous avons reçu votre soumission en nous réservant le droit de démolir les murs et les portes de vos villes.
Ils prétendaient mettre des garnisons dans le pays et en faire payer l’entretien par les habitants; les députés les remercièrent de leurs bonnes intentions, mais ajoutèrent « qu’il ne leur semblait pas que ce fût nécessité de le faire »; il suffisait de leur donner un « officier diligent, sage et prudent » qui pût diriger la défense du pays, avec l’aide des milices locales; quant à un impôt, il n’y fallait pas songer : « le pays est pauvre et pillé et ne le pourrait soutenir 3 ».
Ces objections furent mal accueillies : « [Cela] ne se peut faire, leur dit-on, car il y faut avoir garnison et ne nous suffit de la réponse 4; car la garde [du Pays] s’étend 5 plus ou autant pour eux que pour nous… nous les voulons armer et soutenir, comme bons seigneurs. Nous voulons que la sûreté 6 se fasse et [c’] est /339/ notre intention d’y mettre gouverneur et officier à tous gens d’armes 1 pour conserver le pays et non pas [le] laisser ainsi et requérons plus honnête réponse, ainsi que leur devoir [le ] requiert. »
Enfin, les vainqueurs exigèrent la prestation du serment de fidélité et la reconnaissance en leur faveur de tous les droits que le comte avait possédés jadis; ce fut en vain que les députés affirmèrent que les titres 2 étaient restés entre les mains du prince; cette excuse ne fut pas admise et les Fribourgeois reçurent mission de présider à ces reconnaissances; pour cette fois, les sujets devraient se présenter à Fribourg même.
Parlant au nom des nobles probablement 3, Humbert Cerjat insista sur l’état de dénuement où se trouvait le Pays de Vaud : si on y imposait un subside de 5 sous (25 fr.) par feu seulement, il ne le pourrait payer; il demanda, lui aussi, que les franchises fussent respectées, conformément aux promesses faites; enfin, il protesta contre la suppression des appels à Chambéry; par là, on portait atteinte, non plus seulement aux droits du comte de Romont, mais bien à ceux du duc de Savoie et de la régente sa mère et à sa souveraineté 4.
Ces protestations n’eurent qu’un médiocre succès : les Bernois et les Fribourgeois cédèrent sur le fait /340/ des garnisons; ils se contentèrent d’exiger que, lorsque l’ennemi menacerait et que l’on sonnerait le tocsin, les habitants se rassemblassent et se missent à la disposition du gouverneur que Berne devait désigner 1. Il semble aussi qu’ils n’aient plus fait de difficultés pour confirmer les franchises 2.
Mais ils persistèrent à réclamer un subside, même des ecclésiastiques, et à interdire que les appels soient adressés autre part qu’à Berne et à Fribourg 3. Ils congédièrent les députés en leur ordonnant de faire rapport à leurs commettants, puis de leur apporter une meilleure réponse. Nul doute qu’ils ne fussent parvenus à leurs fins, en matière d’impôt spécialement, si le pays était resté plus longtemps entre leurs mains.
Mais, on le sait, cette première occupation du Pays de Vaud par les Confédérés fut de courte durée. Dès le milieu de décembre, quoiqu’on eût négocié une trêve avec le duc de Bourgogne 4, quoique des pourparlers eussent été engagés avec la duchesse de Savoie qui réclamait la restitution des terres conquises à son détriment 5, la guerre se préparait. La duchesse elle-même rassemblait des soldats 6 et Charles-le-Téméraire approchait 7. Le 21 décembre, le bailli /341/ de Vaud, Humbert de Glane 1, mandait que le comte de Romont avait fait une apparition dans le pays, que des hommes allaient rejoindre l’armée bourguignonne qui recevait des renforts de toutes parts, que les dispositions des esprits étaient mauvaises dès Lausanne et au delà; « mais, de ce côté-ci du Jorat, ajoutait-il, chacun est de bon vouloir », sauf Humbert Cerjat sur lequel on ne pouvait plus compter 2.
Les premiers jours de janvier 1476, Jaques de Romont rentrait dans le pays avec une avant-garde et tentait, inutilement, de s’emparer d’Yverdon; cinq semaines plus tard, dans la nuit du 11 au 12 février, il occupait Romont; le lendemain, Charles s’installait à Orbe 3. On 4 n’avait pas eu le temps d’organiser la défense du pays conquis et les garnisons suisses avaient dû se retirer à la hâte; en quelques jours, tout le territoire vaudois, des bords du lac jusqu’à Payerne et bientôt jusqu’à Morat, /342/ était rentré en possession du comte de Romont, dont la cavalerie battait la campagne jusque devant Fribourg 1.
*
* *
Que se passait-il alors à Moudon ? Nous l’ignorons complètement. Nous ne savons pas si la population y partageait l’opinion d’Humbert Cerjat ou se rangeait à celle d’Humbert de Glane. Aucun document ne nous renseigne sur la date où la ville redevint savoyarde, ni sur l’impression qu’y fit cet événement.
Aucun chroniqueur, aucune lettre ne nous apprend non plus l’effet que fit sur nos lointains aïeux la nouvelle de la bataille de Grandson qui dut leur parvenir dans la matinée du dimanche 3 mars. Nous pouvons penser qu’ils en furent bouleversés et s’attendirent à voir revenir incessamment les bandes redoutables qu’ils avaient vu passer six mois auparavant. A Genève, qui était pourtant moins exposée, l’émotion fut très vive; on y prévoyait le pire et la populace, doutant déjà de l’autorité savoyarde, pillait les bagages du prince de Tarente, fils du roi de Naples 2.
La régente, qui y était arrivée le 1er mars avec deux mille cavaliers 3, pensa, pendant quelques heures, à quitter la ville et à se réfugier au château de Gex dont la défense était plus facile; mais bientôt elle se /343/ reprit et, avec une fermeté toute virile, elle fit face aux difficultés du moment 1.
Elle eut raison : méprisant les conseils des Bernois qui auraient voulu qu’on profitât de la victoire pour reconquérir le Pays de Vaud, — ce que l’on pouvait faire sans coup férir 2 — les Suisses avaient disloqué leur armée; les soldats, gorgés de butin, ne songeaient qu’à rentrer dans leurs foyers 3.
De son côté, Charles-le-Téméraire ne s’était pas laissé abattre par sa défaite. Avec une énergie admirable, il avait, dès le lendemain, préparé sa revanche : le 7 mars déjà, il annonçait au comte de Romont son prochain retour au Pays de Vaud 4; le 8, sur l’avis, erroné semble-t-il, d’un coup de main contre Romont, il se décida à partir le jour suivant 5; le 11, il était à Orbe avec sa garnison et, le 14, il arrivait à Lausanne; le soir même, son camp était dressé sur les Plaines du Loup et il couchait dans une baraque de bois, dressée à la hâte 6.
Lausanne étant devenue la base d’opérations du duc, on pouvait craindre que la vallée de la Broye ne servît de champ de bataille 7. Le 28 mars, une armée bernoise et fribourgeoise tentait de s’emparer de Romont, /344/ que défendait le comte en personne. Elle échoua 1. Charles-le-Téméraire fut sur le point de marcher sur Fribourg et sur Berne. Pour assurer sa route, il envoya 200 lances — un millier d’hommes environ — occuper Moudon, le 29 mars 2. La ville refusa cette garnison et déclara qu’elle était capable de se défendre toute seule; Ce n’était pas que les bourgeois fussent acquis aux Confédérés 3; c’est qu’ils avaient peur de ces soldats italiens qui, au dire du bâtard de Bourgogne lui-même, n’étaient que des brigands 4.
Moudon échappa ainsi à l’occupation par ces bandes indisciplinées, mais tout le pays fut abominablement ravagé : les Suisses brûlaient les villages pour faire le vide devant l’armée du duc et les troupes de celui-ci pillaient pour se ravitailler 5.
Cependant, avec le mois d’avril, les opérations militaires furent suspendues 6. L’armée bourguignonne était hors d’état de se mesurer avec les Suisses 7. /345/ De grosses affaires diplomatiques, puis une maladie grave retinrent le duc pendant deux mois; ce ne fut que le 27 mai qu’il quitta Lausanne 1. Il campa une dizaine de jours près de Morrens, puis, longeant le sommet des collines, pour éviter toute surprise, ou plus probablement pour trouver des régions non encore épuisées par le passage des soldats, il vint camper dans le voisinage de Thierrens et de Lucens, puis dans les environs de Payerne; le 9 juin au soir, il mettait le siège devant Morat 2.
*
* *
On peut se figurer les émotions diverses par lesquelles passèrent les habitants de Moudon pendant les premiers mois de cette année terrible. Ils n’étaient pas au bout de leurs peines et ils n’avaient pas encore vu le pire.
Dans la soirée du samedi 22 juin, le bruit de la défaite du duc se répandit dans la ville 3; on vit les fuyards errant par la campagne, peut-être Charles-le-Téméraire lui-même courant à bride abattue sur la route de Morges 4. Dès le lendemain, on ne put plus douter de l’étendue du désastre. /346/
Les vainqueurs allaient-ils s’arrêter et rentrer chez eux, comme au printemps, après la bataille de Grandson ? allaient-ils s’avancer en conquérants dans ce Pays de Vaud qui s’ouvrait devant eux sans défense ? On fut bientôt fixé à cet égard. Les Suisses restèrent trois jours sur le champ de bataille pour se reposer et se partager le butin; puis, tandis que la moitié de l’armée prenait le chemin du retour, l’autre moitié, essentiellement composée de Fribourgeois et de Bernois, marchait pour la seconde fois à la conquête du pays savoyard 1.

Arrivée des Bernois à Moudon,
le 25 juin 1476.
Pl. VIII : Miniature ornant la p. 677 du manuscrit de la chronique de Diebold Schilling déposé à la Bibliothèque centrale de Zurich.
Elle se mit en route le mardi 25 juin, au matin, et remonta la vallée de la Broye, pillant et brûlant « beaucoup de jolis châteaux et de villes 2 ». Vers la fin de l’après-midi, laissant derrière elle un contingent confédéré occupé à piller Lucens, l’avant-garde s’approchait de Moudon 3. « Là, ils rencontrèrent tout le clergé, les clercs et les laïques, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes qui venaient à leur rencontre en procession avec toutes les reliques et qui leur demandaient grâce. On la leur accorda et on laissa à chacun sa vie, mais on fit le sac de la ville et on leur prit tout ce qu’ils avaient et on y trouva un gros butin 4. »

Pl. IX : Arrivée des Bernois à Moudon,
le 25 juin 1476.
Dessin provenant du t. III de la chronique de Werner Schodoler déposée à la Bibliothèque cantonale d’Aarau.
Un autre chroniqueur dit, dans des termes analogues : « Alors vinrent au-devant d’eux les gens de Moudon, marchant en procession, avec des reliques, /347/ prêtres, femmes et hommes. Ils se rendirent, demandant en grâce qu’on leur accordât seulement la vie. On la leur accorda donc, quoiqu’ils eussent mérité qu’on les punît dans leurs corps et dans leurs biens, car ils avaient mal agi avec ceux de Berne 1. Aussi les gens de Berne pillèrent-ils la ville et la mirent-ils à sac 2. »
Ce cortège lamentable qui implorait leur pitié frappa les vainqueurs; le soir même, à 9 heures, le capitaine fribourgeois, écrivant au Conseil de cette ville pour demander des instructions, insistait sur les prières des femmes de Moudon qui avaient obtenu qu’on ne brûlât pas la ville aussitôt 3 et les manuscrits de Berne et de Zurich de la chronique de Diebold Schilling, au nombre de leurs illustrations, en contiennent une où l’on voit les Confédérés marchant sur Moudon et le cortège des bourgeois et des prêtres venant à leur rencontre 4.

Pl. VII : Arrivée des Bernois à Moudon,
le 25 juin 1476.
Miniature ornant la p. 387 du manuscrit de la chronique de Diebold Schilling déposé à la Bibliothèque de la ville de Berne.
Cédant aux supplications des femmes moudonnoises, les officiers renoncèrent à incendier la ville le soir même, comme ils l’avaient fait ailleurs. La décision fut renvoyée au lendemain; ce délai sauva Moudon qui ne fut pas livré aux flammes 5, mais n’échappa pas aux horreurs du pillage.
Les Bernois partirent le mercredi 26 déjà, à la nouvelle que les bandes du comte de Gruyère les /348/ avaient précédés à Lausanne 1. Mais ils avaient été remplacés à Moudon par d’autres contingents, non moins avides de butin; certains d’entre eux y restèrent jusqu’au vendredi 28 2.
Nous ignorons l’étendue des pertes que le pillage causa aux habitants de la ville. Un chroniqueur affirme que personne ne fut tué 3 et aucun document ne vient infirmer cette déclaration. Mais, si les personnes échappèrent, il n’en fut pas de même des biens; tout ce qui avait quelque valeur fut emporté : bijoux, étoffes, vêtements, ustensiles 4; des titres furent détruits 5. Le butin fait à Moudon et à Lausanne fut vendu à Bienne 6; nous ignorons la valeur de la part qui provenait de Moudon. Il ne semble pas, cependant, que le désastre y ait été aussi grand qu’à Lausanne et sur les rives du Léman 7.
*
* *
En octobre 1475, les vainqueurs s’étaient réservé le droit de démanteler la ville 8; soit qu’ils n’en aient pas eu le temps, soit qu’ils aient eu d’autres projets, /349/ ils n’en avaient rien fait. En juillet 1476, on en reparla; le 8, Adrien de Bubenberg se présenta devant le Conseil de Fribourg pour y exposer les projets de Berne; nous admettons, dit-il entre autres, qu’on ne brûle ni Romont, ni Moudon, ni Rue, ni Estavayer, mais nous proposons qu’on en fasse des villes ouvertes; les Fribourgeois approuvèrent et, le 10, ils en avisèrent les gens de Moudon, en donnant comme motif de cette décision la probabilité d’une nouvelle attaque de la part de Charles-le-Téméraire 1.
Espérant gagner du temps, les bourgeois de Moudon répondirent qu’ils n’avaient ni pioches, ni leviers, ni forgerons, que le fer même leur manquait, mais qu’ils étaient prêts néanmoins à obéir à tous les ordres qu’on leur donnerait, lorsqu’on leur aurait fourni les moyens matériels. On leur accorda huit jours de répit.
Mais à Berne, on s’impatienta et l’on se décida à prendre des mesures énergiques; on se prépara à envoyer dans le Pays de Vaud un corps de troupes, composé essentiellement de maçons, qui aurait pour mission de démanteler Estavayer, Yverdon, Romont et Moudon; des Fribourgeois devaient les accompagner 2. En même temps, une lettre impérieuse était envoyée aux communes vaudoises récalcitrantes; nous connaissons les termes de celle qui fut adressée à Moudon, à la date du 15 juillet : « A ceux de Moudon, au nom de MM. (de Berne) et de ceux de Fribourg. /350/ Ils connaissent la décision prise à leur sujet, par laquelle ils sont astreints à démanteler leurs tours et leurs murs. Cela n’a pas encore été fait et rien n’est préparé à ce sujet, de sorte que MM. des deux villes en sont fâchés et ne comprennent pas ce qui se passe. Ils leur font connaître immédiatement leur volonté que cela se fasse, s’ils veulent éviter leur mécontentement plus grave, car MM. des deux villes ne laisseront pas passer cela, mais ils veulent que cela soit fait 1. »
Les Moudonnois se résignèrent-ils à démolir de leurs propres mains ces murailles qui leur avaient coûté si cher ? Nous ne le savons pas. Il semble plutôt que ce travail ait été entrepris par une escouade d’ouvriers fribourgeois, dirigés par un maçon bernois 2. Quoi qu’il en soit, les travaux de démolition se bornèrent à peu de chose, car Moudon resta une ville enclose de murs et garnie de tours. On se contenta sans doute de pratiquer quelques brèches qui rendaient la défense impossible et marquaient bien nettement la volonté des vainqueurs 3.
*
* *
Pendant ce temps, le sort du Pays de Vaud se réglait à Fribourg où un congrès s’était réuni pour traiter de la paix, le 25 juillet 4. /351/
Tout nous autorise à penser que, vainqueurs, les Bernois et les Fribourgeois espéraient bien s’emparer du Pays de Vaud. Mais ils avaient compté sans le roi de France. Le lendemain de la bataille, les chefs suisses avaient reçu une lettre de Louis XI 1. Que contenait-elle ? On ne le sait. Quoique écrite avant la défaite du duc, elle invitait, sans doute, les Suisses à ménager la sœur et les neveux du roi et leur laissait clairement entendre que celui-ci ne permettrait pas qu’ils conquissent la Savoie. A Lausanne, les officiers bernois reçurent une ambassade savoyarde qui venait demander un armistice 2; ils l’accordèrent assez facilement. Elle leur apportait, en effet, une grave nouvelle : le 27 juin au soir, dans le voisinage de Genève, Charles-le-Téméraire avait fait enlever la régente de la fidélité de laquelle il commençait à douter; le jeune duc lui avait échappé; conduit à Genève, il avait été remis à la garde de son oncle, l’évêque, qui rompait avec la Bourgogne et se jetait dans les bras de Louis XI 3. Mal soutenus par leurs Confédérés, les Bernois ne pouvaient pas envahir les terres d’un protégé du roi 4. /352/
Le congrès de Fribourg fut une brillante assemblée où, à côté des capitaines suisses les plus illustres, on voyait les députés des cantons, des villes alliées jusqu’à Bâle, Strasbourg et St-Gall, les représentants de l’archiduc Sigismond, le duc René de Lorraine, et, à la tête de la députation française, Louis de Bourbon, amiral de France, le propre gendre du roi. En face d’eux, les représentants des vaincus : l’évêque de Genève, les députés des Etats de Vaud, le bailli François de Billens 1, Humbert Cerjat 2, Humbert de la Molière, Jaques de Glane 3 et le procureur de Vaud.
Les députés suisses parlaient avec le ton impérieux du vainqueur. Après avoir une fois de plus énuméré leurs griefs contre la duchesse et contre Jaques de Romont, les Bernois et les Fribourgeois réclamèrent la cession du Pays de Vaud, de Genève et d’une partie du Chablais, plus une indemnité de guerre. En réponse à ces exigences, les représentants du duc n’eurent d’autre ressources que de rejeter la faute sur la /353/ régente et d’en appeler aux bons offices des ambassadeurs du roi 1.
Celui-ci s’était emparé de la personne de son neveu; il avait confié le gouvernement de la Savoie à l’évêque de Genève et celui du Piémont au comte de Bresse 2; il ne voulait pas laisser les Suisses démembrer l’Etat savoyard 3. Ses ambassadeurs avaient donc pour mission d’arracher aux Confédérés les bénéfices de leur victoire; ils se posèrent en médiateurs. Un des députés bernois ou fribourgeois eut beau déclarer fièrement que le roi était libre de donner à ses agents les instructions qu’il voulait, mais qu’eux étaient libres aussi d’en tenir compte ou non et d’agir à leur guise 4; ils furent obligés de céder : ils avaient contre eux, non seulement Louis XI, mais encore les autres cantons, jaloux de leur agrandissement territorial.
Les préliminaires de la paix furent signés à Fribourg, le 13 août. Moyennant le paiement d’une rançon de 50 000 florins du Rhin 5, la Savoie recouvrait le Pays de Vaud, qui restait cependant entre les mains des Confédérés à titre de gage jusqu’au paiement de cette somme; cette restitution serait faite au duc /354/ à condition qu’il s’engageât à ne pas le rendre au comte de Romont et à ne plus jamais le distraire de sa couronne; les Confédérés gardaient Morat et quelques seigneuries voisines; les Etats de Vaud devaient donner leur garantie au traité 1.
Quand, dans l’arrière-automne, la duchesse Yolande, arrachée à la prison par les cavaliers de son frère, dans des circonstances aussi romanesques qu’en juin, fut rentrée dans les états de son fils et eut assumé à nouveau le gouvernement de la Savoie 2, un de ses premiers soucis fut de chercher à s’arranger définitivement avec les Bernois et leurs alliés; une expédition comme celle des Compagnons de la Folle vie 3 était une manifestation inquiétante de l’humeur batailleuse des Suisses.
Genève n’avait pas payé à Noël 1476 les 8000 florins du Rhin qu’elle devait aux Confédérés. Si, pour des raisons diverses, politiques et économiques, Berne semblait disposée à ménager Genève, il n’en était pas de même des cantons de la Suisse centrale.
Mis en goût par les campagnes des années précédentes, qui, deux fois par an, leur avaient procuré un riche butin, les jeunes gens des Waldstætten et de Zoug rêvaient de recommencer ces fructueuses opérations. Une bande s’organisa au début de février 1477; elle était décidée à aller piller Genève, tout en y exigeant le versement de la rançon promise. /355/ Un premier contingent arriva le 23 février 1 à Berne, qui n’osa pas lui fermer ses portes; le 26, il se dirigea sur Fribourg, où il fut rejoint par d’autres et finit par faire une troupe de 1800 hommes. Les députés de la Diète les y atteignirent et, après des pourparlers difficiles, réussirent à les persuader de rentrer chez eux; mais il fallut pour cela que Genève payât comptant 2 florins 2 à chaque compagnon, et leur offrît le coup de l’étrier sous la forme de quatre tonneaux de vin (4 mars).
Entre temps, une partie de la troupe avait déjà quitté Fribourg; le 2 mars, elle était venue coucher à Payerne 3. Les Fribourgeois envoyèrent des messagers pour la rappeler; l’un d’eux dut aller jusqu’à Moudon; un autre courut à Lausanne, où il put enfin atteindre l’avant-garde de ces aventureux compagnons 4.
Nous n’avons pas les comptes de la commune de Moudon pour cette année, mais nous pouvons sans peine nous figurer l’inquiétude que ne manqua pas de provoquer dans cette ville l’approche de ces bandes redoutables.
*
* *
Dès le mois de janvier 1477 5 la duchesse Yolande avait cherché à renouer avec les Confédérés; renvoyée à /356/ plus d’une reprise, la conférence eut lieu à Annecy du 18 au 25 avril 1; la régente aurait voulu obtenir la restitution immédiate du Pays de Vaud contre une obligation de 50 000 florins, à un an de terme, souscrite par elle et contresignée par les Etats; un projet fut élaboré sur cette base, mais il ne fut jamais ratifié par les cantons 2.
La duchesse tenait plus encore à renouveler son traité d’alliance avec Berne, l’expérience lui ayant appris qu’il valait mieux avoir les Bernois comme amis que comme ennemis. Les négociations, qui avaient échoué en avril, parce que la duchesse ne voulait pas admettre l’indépendance de Fribourg, furent reprises en juin 3; elles aboutirent, le 20 août, à un traité entre les deux villes et le duché 4; Fribourg était relevée complètement de la vassalité savoyarde 5.
Le plus difficile était fait; assurée de l’appui de Berne, Yolande put, dès le début d’octobre 6, demander qu’on lui restituât le Pays de Vaud à la Chandeleur, moyennant un premier paiement de 25 000 florins; elle l’obtint sans trop de peine, et, le 21 février 1478, l’acte de /357/ restitution était signé; les 25 000 florins qui restaient devaient être payés avant Pâques de l’année suivante 1.
C’est ainsi que le Pays de Vaud 2 fit retour à la Savoie. Pendant les dix-huit mois où il avait été entre les mains des Suisses, il avait continué à être administré par les fonctionnaires savoyards, en particulier par le bailli de Vaud, François de Billens, en vertu de ce « provisoire » qui dure souvent fort longtemps et parce que les cantons n’avaient pu s’entendre pour lui donner un autre régime 3.
Le premier mai 1477, François de Billens rendit compte de son administration aux députés confédérés réunis à Fribourg. Les revenus de la châtellenie de Moudon s’élevaient à 712 livres et 10 sous (un peu plus de 70 000 fr.), mais il avait dépensé 990 livres et 10 sous (près de 100 000 fr.) pour la solde de l’escorte des ambassadeurs suisses qui revenaient d’auprès du roi, pour les nombreux courriers qu’il avait reçu ordre d’expédier, etc. En outre, son traitement ne lui avait pas été payé; il réclamait 200 livres 4. Les Suisses reconnaissaient lui devoir l’excédent de ses débours, mais ils affirmaient n’avoir pas les pouvoirs suffisants pour régler son traitement. Les autres châtellenies ne donnaient pas un rendement beaucoup meilleur, en partie par le fait des ravages causés par la guerre 5. /358/ Financièrement, l’occupation du Pays de Vaud n’était pas une brillante affaire pour les Confédérés.
Le 21 février 1478, les plénipotentiaires 1 de la duchesse reçurent à Nyon, des mains des commissaires suisses, le Pays de Vaud qui leur était restitué; deux députés de Moudon, Georges de Glane, seigneur de Cugy, et Louis Cerjat, furent témoins de cet acte. Puis, les ambassadeurs savoyards traversèrent le pays, jurant dans chaque ville, au nom de leur maître, d’en maintenir les franchises; avec leur suite, ils formaient une troupe de 16 personnes. Quand ils arrivèrent à Moudon, la ville leur fit fête; on leur offrit des flambeaux de cire et on les défraya entièrement 2. Ils accordèrent à la ville une lettre confirmant ses franchises 3.
Tout nous autorise à penser que les villes vaudoises accueillaient avec joie le retour de leur ancien souverain. Nous savons, d’autre part, que ce n’était pas sans regret que les Bernois abandonnaient ce pays; /359/ ils eussent bien voulu le garder 1 et ce sentiment va jouer, dans leur politique, pendant soixante ans, un rôle considérable.

Sceau de Charles Ier
duc de Savoie (1482-1490)
CHAPITRE XVIII
LES DERNIERS PRINCES DE LA MAISON DE SAVOIE
La Savoie avait recouvré la plus grande partie de ses terres, mais le pays était appauvri et les habitants dispersés 1. Il fallait relever les ruines, reconstruire les moulins et les châteaux détruits 2, rétablir l’ordre et ramener la sécurité. Or les ressources faisaient défaut : la misère était telle en bien des endroits que l’Etat dut renoncer à percevoir les redevances qui lui étaient dues 3; surtout, l’autorité manquait : la guerre avait profondément ébranlé le prestige de la maison de Savoie; d’autres malheurs allaient l’atteindre encore.
Six mois après la restitution du Pays de Vaud, le 29 août 1478 4, la duchesse Yolande mourait /361/ prématurément. Le jeune duc Philibert venait d’avoir treize ans; son âge, et la faiblesse de son caractère, le mettaient à la merci de son entourage : Louis XI, qui avait placé auprès de lui un gouverneur à sa dévotion, dirigea dorénavant la politique extérieure de la Savoie, tandis que les grands seigneurs du pays et les oncles du prince se disputaient le gouvernement intérieur de l’Etat, pillaient le Trésor et se livraient à tous les excès 1. Pendant ce temps, Philibert voyageait, s’amusait, chassait, jouait; après quelques jours de maladie, il mourait à Lyon le 22 avril 1482; il n’avait pas dix-sept ans. Le trône revenait à son frère Charles, qui en avait quatorze.
Le nouveau duc avait une intelligence et une volonté précoces; il était d’une capacité supérieure à la moyenne; légalement majeur, il sut, malgré sa jeunesse, tenir en respect ses oncles et se soustraire à l’influence française. Il était en train de restaurer sa maison lorsqu’il mourut à son tour, dans sa vingt-deuxième année, le 14 mars 1490 2.
Charles Ier laissait un petit enfant de neuf mois, Charles-Jean-Amédée; sa veuve, Blanche de Montferrat, assuma la régence; elle n’avait que vingt ans et, sans être incapable, n’était cependant pas préparée à régner. On eut donc une nouvelle minorité avec tous les dangers qu’elle entraîne. Ce fut de nouveau la lutte des factions les unes contre les autres, le /362/ pillage des deniers publics, les révoltes des barons et leurs guerres privées, les intrigues des membres de la famille ducale, la faiblesse devant les influences étrangères. Si la Savoie ne tomba pas alors sous la dépendance complète de la France, c’est que Louis XI était mort.
Mais le petit Charles II n’atteignit pas la fin de sa septième année et, le 15 avril 1496, son grand-oncle Philippe de Bresse lui succédait 1.
Depuis trente ans, ce prince troublait l’Etat de ses intrigues et de son ambition; il avait de l’énergie et de l’habileté, une longue expérience de la politique; il semblait capable de rétablir l’ordre dans son duché : le sort voulut qu’il ne conservât que dix-huit mois ce trône auquel il avait rêvé toute sa vie; il mourut en novembre 1497 2.
Son fils Philibert II était un jeune homme de dix-huit ans, ami des plaisirs plus que des affaires, et qui laissa à des courtisans le soin de gouverner; ce fut alors le retour des mêmes désordres qui avaient troublé les règnes précédents 3. Ce régime dura sept ans; puis, le 10 septembre 1504, le duc mourut; il n’y a qu’un seul monument qui rappelle son nom à la postérité : c’est le magnifique tombeau que, dans l’église de Brou, lui éleva sa veuve inconsolable. Il laissait le trône à son frère cadet Charles III 4, dont nous aurons à reparler. /363/
Ce dernier quart du XVe siècle avait été désastreux pour la Savoie : elle avait eu cinq princes, dont trois étaient des enfants, et deux régences. Les rivalités au sein de la famille régnante, les luttes des factions avaient ruiné l’autorité ducale; l’Etat savoyard se décomposait.
Il nous reste à examiner quelles en étaient les conséquences pour notre pays 1.
*
* *
Lorsqu’une puissance militaire voit tout près d’elle un Etat en proie à l’anarchie, il lui arrive toujours d’intervenir. Berne n’agit pas autrement vis-à-vis de la Savoie.
La faiblesse du gouvernement ducal ne lui permettait pas d’assurer la sécurité des marchands qui traversaient le Pays de Vaud pour se rendre à Genève. Or, les cantons avaient intérêt à ce que se rétablît le trafic d’Allemagne en France au travers du plateau suisse 2. Il suffisait qu’un de ces marchands fût molesté sur les terres savoyardes pour que Berne ou Fribourg se plaignissent à Chambéry et exigeassent impérieusement des indemnités, même quand le bien-fondé de leur réclamation semblait contestable 3. /364/
A chaque deuil qui frappait la maison de Savoie, les cantons ne manquaient pas d’envoyer une ambassade à la cour. Mais ce n’était pas là une simple démarche de courtoisie : à plus d’une reprise les magistrats bernois profitèrent des circonstances pour offrir leurs bons offices en vue de remettre de l’ordre dans les affaires de l’Etat 1. Visiblement la république tendait à établir son protectorat sur les terres septentrionales du duché; si elle n’y réussit point, c’est que, la France et Milan ayant une politique analogue, les ambitions des trois puissances se contre-balançaient 2.
Quand la mort de Louis XI sembla laisser à Berne /365/ le champ libre, le moment favorable était passé. La génération des grands politiques, vainqueurs de Charles-le-Téméraire, avait disparu et leurs successeurs n’avaient pas hérité de leur hardiesse. Le duc Charles Ier, d’autre part, offrait une résistance inattendue 1. Il se hâta, du reste, de renouveler le traité qui liait la Savoie avec les Bernois et lui assurait l’appui militaire de ces redoutables voisins 2.
Lorsque Charles VIII intervint en Italie, les Bernois craignirent que la France n’établît son protectorat sur la Savoie; Bernois et Fribourgeois furent alors heureux à leur tour de confirmer, d’abord avec Philippe 3, puis avec Philibert 4, leur traité traditionnel /366/ qui, en les obligeant à porter secours au duc, leur allié, leur permettait d’exercer un certain contrôle sur les affaires de son pays. Mais, il faut voir, dans les instructions que donnait alors à ses ambassadeurs l’ancien comte de Bresse, les égards qu’il leur recommandait vis-à-vis des Confédérés : « …leur remontrant le plus doucement qu’ils pourront,… (ils) leur répondront le plus doucement et amiablement… 1 ».
Dans le Pays de Vaud, où Jaques de Romont chercha en vain à se réinstaller 2, l’autorité ducale se faisait peu sentir. Les communautés urbaines et les seigneuries rurales vivaient chacune pour soi, souffrant de la cherté du temps 3, cherchant à se remettre peu à peu des blessures de la guerre et craignant toujours quelque nouvelle invasion des Suisses 4.
Laissé à lui-même, le pays prenait l’habitude de se passer du gouvernement savoyard; il essayait de s’administrer sans lui. Nous voyons les Etats de Vaud se réunir assez fréquemment et de préférence à Moudon.
A chaque changement de règne, ils exigèrent du prince la confirmation des franchises du pays. Ainsi, /367/ le 18 mars 1480, à la requête d’Amédée de Gingins qui lui avait été député à cet effet, Philibert Ier confirma les franchises du Pays de Vaud par un acte général dont les Etats prirent connaissance, le 20 avril suivant, dans une séance où les députés de la noblesse étaient réunis avec ceux des villes, à Moudon, dans la maison de François de la Rapaz 1.
Après la mort du jeune duc, les Etats envoyèrent auprès de son frère à Pignerol trois seigneurs, dont le même Amédée de Gingins, et quatre bourgeois, dont Antoine Bridel de Moudon; là, le 18 juin 1483, Charles Ier leur accorda la confirmation demandée 2. Suivant la coutume, il vint en personne dans le Pays de Vaud, l’année suivante. Le jeune duc de seize ans tint sa cour à Lausanne, dans le château épiscopal; entouré de plusieurs princes de sa maison, de grands seigneurs savoyards et d’ambassadeurs bernois et fribourgeois, il reçut le serment de ses sujets; Louis Cerjat, syndic de Moudon, le prêta au nom de cette ville 3. /368/
Lorsque ce prince eut disparu prématurément, les Etats se hâtèrent de requérir de sa veuve une nouvelle confirmation, qu’elle leur accorda le 12 avril 1490, moins d’un mois après la mort de son mari 1.
Il n’existe pas d’acte analogue émanant du duc Philippe, ce qui s’explique par la courte durée de son règne. Son fils Philibert confirma les franchises du Pays de Vaud, à Genève, le 7 avril 1498 2.
L’activité des Etats de Vaud ne se borna pas à cet objet. Au cours de l’été 1480, ils se plaignirent des abus de la justice ecclésiastique; trop souvent les officiers de l’évêque de Lausanne poursuivaient des sujets savoyards pour des causes qui n’avaient rien à voir avec la justice spirituelle; trop souvent des laïques citaient devant ces cours leurs parties adverses et obtenaient contre elles des sentences d’excommunication. Notre pays n’était pas seul à connaître ces abus, qui scandalisaient les âmes pieuses et qui portaient préjudice à tous ceux qui vivaient de la justice séculière. Pour y mettre fin, les Etats de Savoie avaient pris des mesures l’année précédente 3. Le 31 août 1480, le duc Philibert donna satisfaction sur ce point à ses sujets vaudois; il interdisait aux particuliers /369/ tout appel à la juridiction ecclésiastique pour des causes profanes et aux juges de l’Eglise toute intervention dans des procès du même ordre 1.
Cette défense dut être renouvelée plus d’une fois. Quoiqu’elle eût été provoquée par les représentants des villes vaudoises elles-mêmes, elle suscita à Moudon l’incident que voici : Le lundi 23 novembre 1489, le bailli de Vaud la faisait proclamer, en patois, par son huissier et menaçait les contrevenants d’une amende de soixante sous. Sur-le-champ et sur la place même, le syndic Louis Cerjat fit dresser par un notaire une protestation au nom de la ville comme au nom de tout le pays : en vertu de la charte, en effet, et des privilèges confirmés si souvent par le prince, les officiers de celui-ci n’avaient pas le droit de fixer des amendes sans l’assentiment du Conseil des bourgeois 2.
Il est rare de voir les Etats discuter des impôts; il semble que, contrairement aux habitudes de leurs prédécesseurs, les ducs de Savoie n’en aient, à cette époque, réclamé que rarement. Ce n’est pas que leurs besoins d’argent fussent moins grands, au contraire; ce n’est pas non plus, je le crains, que ces princes aient /370/ voulu ménager un pays ruiné par la guerre 1; c’est qu’ils n’avaient plus une autorité suffisante pour obtenir ce qu’ils demandaient. Seul Charles Ier y réussit 2. En 1485 et 1487, il avait obtenu de ses autres sujets deux « subsides », l’un pour lui permettre de marier ses sœurs, l’autre pour subvenir aux frais de sa guerre contre le marquis de Saluces; en vertu de ses franchises, le Pays de Vaud en était exempt. Mais les nobles et les villes de ce pays vinrent lui offrir, spontanément, si l’on en croit le texte du document, un don gracieux de 5500 florins, que le duc accepta en reconnaissant son caractère volontaire 3.
C’est aussi son autorité incontestée qui permit au même prince d’obtenir, sans trop de difficulté, l’appui /371/ militaire des communes vaudoises à l’occasion de la même campagne; elles n’y étaient cependant pas tenues puisque leurs obligations militaires ne dépassaient pas les limites des évêchés de Lausanne, Genève et Sion, ni une durée de huit jours 1. Charles Ier les garda un mois sous ses drapeaux, en Italie; il le reconnut loyalement 2.
Mais, quand il eut disparu, c’est en vain que sa veuve s’adressa à ses sujets vaudois pour obtenir d’eux de l’argent. En automne 1492, les Etats généraux de Savoie ayant été réunis à Annecy, le délégué vaudois en rapporta une demande de subside, à laquelle les Etats de Vaud opposèrent une invincible résistance 3; la discussion avec le gouvernement savoyard traîna /372/ tout le long de l’année suivante, et même au delà 1; la duchesse eut beau envoyer à Moudon les plus considérables de ses conseillers; elle n’obtint rien 2.
Etait-ce encore pour le même objet que les Etats étaient rassemblés à Moudon, le 5 février 1495, dans la grande salle du château 3 de Jean d’Estavayer, bailli de Vaud ? Nous ne savons. Ce jour-là se présenta devant eux frère Henri Riondi, le carme que l’évêque venait d’établir dans l’hôpital abandonné de Sainte-Catherine; il demandait, et obtenait, l’appui moral des représentants du pays 4.
Vers la fin du siècle, un nouveau subside d’un florin (60 fr.) par feu fut voté par les Etats, non sans résistance; le duc dut envoyer à Moudon son meilleur diplomate, l’évêque Aymon de Montfalcon 5. /373/
On peut supposer que c’est à cette occasion que Philibert II, qui était venu à Lausanne prêter hommage à l’évêque pour les fiefs qu’il tenait de lui, confirma à ses sujets vaudois leur privilège de ne pouvoir être soustraits à leurs juges naturels et interdit une fois de plus à sa cour de Chambéry de statuer sur des procès venant de notre pays, à moins que ce ne fût en appel 1. Comme leurs aïeux du XIIIe siècle 2, les Vaudois du XVe tenaient à être jugés par leurs compatriotes et ils s’opposaient aux moindres tentatives de centralisation savoyarde qui pouvaient porter atteinte à leur autonomie judiciaire.
La faiblesse du gouvernement savoyard favorisait cette tendance à l’autonomie, qui n’était pas spéciale au Pays de Vaud 3; elle y était certainement plus accentuée qu’ailleurs 4 et, là, l’exemple de Fribourg, qui s’était petit à petit dégagée de la Savoie, celui des cantons suisses n’étaient pas sans influence. Peu à peu, les Etats de Vaud prenaient figure d’autorité régulière : ils traitaient même avec les puissances étrangères. Au printemps de l’année 1492, en effet, ils avaient envoyé une ambassade discuter avec « Messieurs des Ligues », c’est-à-dire avec les Confédérés /374/ sur un sujet qui nous échappe, mais qui devait avoir quelque importance, puisqu’il motiva plusieurs séances des Etats 1.
Au reste, nous aurions tort de croire que, dans notre pays, on eût conservé jusqu’à ce moment, à l’égard des Suisses, un très profond ressentiment à cause de leur rôle pendant les guerres de Bourgogne. Au contraire, on respectait leur puissance et l’on admirait leur force; la grandeur bernoise contrastait avec la décadence savoyarde; on sait que le soleil levant trouve toujours beaucoup d’adorateurs. Plusieurs familles féodales, vaudoises ou savoyardes, ne craignaient pas d’acquérir la bourgeoisie de Berne, tel est le cas des Viry 2, des la Molière et même des Cerjat 3.
*
* *
Charles III n’avait que dix-huit ans lorsqu’il succéda à son frère Philibert. Les chroniqueurs savoyards, qui l’ont appelé le Bon, lui attribuent de la culture, de la perspicacité et de l’application; ils signalent son goût, son affabilité et sa piété; mais ils ne peuvent dissimuler ce manque d’énergie et de résolution qui l’entraîna dans les pires malheurs 4.
La situation intérieure de la Savoie était moins difficile : la mort avait fait le vide dans la maison /375/ ducale et le nouveau prince n’avait plus à craindre, comme ses prédécesseurs, les intrigues de ses proches 1.
Il restait assez de difficultés extérieures. Louis XII avait conquis Milan et les guerres d’Italie étaient entrées dans une période d’accalmie; malgré cela, la France était un danger pour la Savoie, qui se trouvait sur la route de la Lombardie. Pour se couvrir contre la menace française, le duc recherchait l’appui de Berne et des cantons suisses. Un de ses premiers actes fut de renouveler son alliance avec cette ville et avec Fribourg 2, puis avec Soleure 3.
Il en tira grand profit dans ses difficultés avec les Valaisans 4 et put, grâce à elle, échapper à une guerre que, faute de ressources militaires, il aurait été incapable de repousser. La médiation des Bernois, des Fribourgeois et des Soleurois lui permit d’obtenir de ses adversaires, aux conférences de Bex (12-18 mai 1506), un arrangement provisoire, qui ne tarda pas à devenir définitif.
Cette affaire n’était pas réglée que d’autres incidents venaient montrer combien le duc était dans la dépendance de ses alliés helvétiques.
Ce furent d’abord les difficultés que provoqua le règlement de la succession de La Sarraz 5. Le chef /376/ de cette maison n’avait pas d’enfant; comme il était en conflit avec le gouvernement ducal et menacé d’une saisie, il s’avisa de tester en faveur de ses cousins, les Gingins, qui étaient en faveur à la cour; cela lui valut l’abandon de la procédure engagée contre lui. Mais, quelques mois après, étant à la veille de mourir, il fit un second testament en faveur de son neveu, le jeune Michel Mangerot. Quand les Gingins voulurent s’emparer de la baronnie, ils en furent empêchés par les Mangerot qui l’avaient occupée avant eux et d’où ils ne purent les déloger. Les Mangerot s’étaient fait recevoir bourgeois de Berne; Adrien de Bubenberg était le tuteur du jeune baron et son héritier substitué; l’avoyer de Scharnachthal était son cousin; Berne les avait pris sous sa protection; elle envoya des soldats pour défendre La Sarraz et obligea le duc à accorder l’inféodation à leur protégé (18 mars 1508).
Cette affaire n’était pas finie qu’une autre éclatait, aussi désastreuse pour les finances du duc que pour l’honneur des cantons : en mars 1508 1, un ancien secrétaire d’Etat, Jean Dufour, remit aux magistrats des deux villes de Berne et de Fribourg un testament du duc Charles Ier, daté de mars 1489 2, par lequel, prévoyant sa mort et celle de son jeune fils, ce prince léguait aux Bernois et aux Fribourgeois 350 000 florins du Rhin (environ 35 000 000 fr.), à condition que ces /377/ villes fissent dire des messes pour le repos de son âme.
Quoique cet acte fût établi en due forme et qu’il eût toutes les apparences extérieures de l’authenticité, on aurait dû comprendre que la position de Dufour à la cour de Savoie lui rendait la fabrication d’un faux la chose la plus aisée du monde; de plus, l’invraisemblance du legs aurait dû éclater aux yeux de tous 1. Il est évident que l’on avait affaire à un escroc de haut vol. Ni à Fribourg, ni à Berne, on ne se laissa arrêter par ces scrupules; on récompensa largement le faussaire et l’on s’empressa d’envoyer une ambassade à Turin pour faire valoir ce titre et exiger des gages. C’est en vain que le duc protesta et prouva la fausseté du testament 2, c’est en vain que le roi de France 3 et l’empereur intervinrent en sa faveur; les cantons furent impitoyables et le duc dut composer avec eux 4, ce pourquoi il hypothéqua en leur faveur le Chablais, le Pays de Vaud et d’autres terres encore (9 juin 1508). Ce sacrifice valait mieux que la guerre ou la saisie dont il était menacé 5. /378/
Le coup avait trop bien réussi pour qu’on ne tentât pas de le renouveler. Deux ans après, Dufour, qui avait juré pourtant n’avoir plus de pièces entre les mains, s’aboucha avec un aventurier à court d’argent, Louis d’Erlach, et parla d’une autre donation du même duc; encouragé par lui, il produisit une seconde pièce; il s’agissait cette fois de 100 000 florins, légués à chacun des huit cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug, Glaris et Soleure, ce qui représentait 800 000 florins du Rhin, ou environ 80 millions de notre monnaie 1.
Les protestations du duc furent inutiles, comme les interventions étrangères; menacé de la guerre, Charles III prit peur et céda; il s’engagea à payer aux Suisses 300 000 florins, sans parler des frais 2. Pour pouvoir effectuer les premiers versements, il dut emprunter aux banquiers bâlois, tailler le clergé de son pays, exiger des dons de ses villes 3 et sacrifier sa vaisselle d’argent. /379/
Quelques semaines après, l’affaire de La Sarraz recommençait. Les Gingins, qui n’avaient pas admis d’avoir été évincés, étaient allés chercher de l’appui en Suisse; ils étaient devenus bourgeois de Fribourg, de Lucerne, de Schwyz et de Zoug, ce qui leur permit de rassembler quelques soldats et de s’emparer par surprise du château de La Sarraz, le 9 février 1512. Il parut un instant que les Confédérés allaient entrer en guerre les uns contre les autres pour la défense de leurs combourgeois réciproques et le duc les y poussait. Mais ils s’en aperçurent et se réconcilièrent sur son dos : il dut payer une lourde indemnité aux Mangerot et aux Gingins, à Berne et à Soleure 1.
Ces deux affaires se terminaient aux dépens du Trésor savoyard et de l’autorité du prince, qui n’était plus maître chez lui. La hâte avec laquelle il met les Suisses au courant de ses projets matrimoniaux 2 est un autre signe de cette dépendance et rappelle le jeu de ces fils de familles ruinés qui cherchent à se donner quelque crédit en faisant luire aux yeux de leurs créanciers l’espoir d’une dot prochaine.
*
* *
Bien loin de rompre avec des voisins aussi redoutables, Charles III aimait mieux les avoir comme alliés que comme ennemis. Dès la fin de 1507, quoique ses traités avec Berne, Fribourg et Soleure n’arrivassent /380/ à échéance qu’en 1514, il chercha à les renouveler et même à obtenir de meilleures conditions; c’est à cela que s’employa, pendant dix-huit mois, l’évêque de Lausanne 1; grâce à l’habileté de ce prélat, grâce à l’appui du parti français 2, grâce aux opportunes largesses de ses agents 3, le duc obtint, le 19 mars 1509, le renouvellement de son alliance avec Berne et Fribourg; le 22, le renouvellement de celle avec Soleure 4.
C’était un succès; mais bientôt les guerres d’Italie allaient compliquer encore la situation, si difficile déjà, du duc de Savoie. Dès le début, les prétentions de Louis XII sur le Milanais avaient menacé le Piémont d’un double danger : celui d’être ruiné par le passage continuel des armées françaises, et celui, /381/ si elles étaient victorieuses, de tomber dans la vassalité du roi, devenu maître de Milan. Trop faible pour pouvoir résister à celui-ci, trop éloigné de l’empereur pour pouvoir compter sur son secours, Charles III avait dû faire bonne mine à mauvais jeu : sans rompre avec Maximilien 1, il avait su flatter Louis XII et même se faire pensionner par lui 2.
Sa position s’aggrava lorsque les Bernois rompirent avec la France. Pendant les premières années, ceux-ci, dont tous les intérêts se portaient vers la Suisse occidentale 3, n’avaient pris qu’une part insignifiante à la politique italienne des cantons du centre et ils étaient restés attachés à l’alliance française 4. Mais, dès 1509, les manœuvres des recruteurs au service du roi commencèrent à indisposer les esprits à Berne 5; la lésinerie et la mauvaise foi de Louis XII, qui ne payait ni les soldes ni les pensions, accentua ces dispositions hostiles, si bien qu’en 1510 on écouta les propositions de Matthieu Schiner 6. Toutefois, c’est sans grand enthousiasme, et plutôt par loyauté confédérale, que le gouvernement bernois s’engagea dans l’alliance pontificale et prit part aux campagnes de 1510, 1511 et 1512 7. /382/
Cette rupture de Berne avec le roi plaçait le duc de Savoie dans la position la plus délicate : Entre ses deux alliés, également redoutables, comment pourrait-il sauvegarder son indépendance ? Au moindre incident, ne risquait-il pas d’être attaqué par celui qui s’estimerait offensé ? A force d’habileté et de souplesse, Charles III réussit à se tirer d’affaire, interposant ses bons offices entre les belligérants, quand cela paraissait utile 1, et mettant tous ses efforts à observer une stricte neutralité, que lui dictait la peur 2.
Mais l’horizon s’assombrissait encore : Tandis que les armées des Confédérés se gorgeaient de butin et se couvraient de gloire en Italie, Berne et Fribourg reprenaient leur politique d’expansion vers l’ouest.
Un des premiers symptômes fut une expédition des Fribourgeois qui envoyèrent une troupe de 326 hommes, bannière déployée, à Neuchâtel, pour y arrêter deux prisonniers politiques qui leur avaient échappé (16 janvier 1511) 3.
En décembre de la même année 4, on proposa en diète une expédition en Bourgogne, qui fut froidement accueillie; les Bernois alors se décidèrent à agir de leur côté, et, entraînant avec eux les Soleurois, ils se mirent en marche pour occuper Neuchâtel, dont le prince, Louis d’Orléans-Longueville, était un des agents les plus actifs de Louis XII. Sur de /383/ mauvaises nouvelles reçues d’Italie, les troupes furent rappelées avant d’avoir pu exécuter leur mission 1. Mais, l’année suivante, lorsque la conquête de la Lombardie fut assurée, Berne reprit son projet : Dans le courant de juin, au moment où Milan et Pavie tombaient aux mains des Suisses, Bernois, Fribourgeois, Soleurois et Lucernois occupaient Neuchâtel sans coup férir et s’emparaient de la principauté qui commandait un des principaux passages du Jura 2.
En juillet, Berne reprenait son projet d’expédition en Bourgogne 3, tandis que l’empereur et le roi d’Aragon cherchaient à entraîner les Confédérés dans une expédition contre Lyon 4, à l’occasion de laquelle les terres savoyardes n’eussent guère pu être épargnées.
Le duc se sentait directement menacé; au cours du même mois de juillet 1512, comme un ambassadeur français était arrivé à sa cour avec mission de renouer avec les Suisses, ceux-ci exigèrent qu’il fût congédié sur-le-champ; peu s’en fallut qu’une bande de soldats bernois n’allât s’emparer de sa personne à Gex, en plein pays savoyard 5. Quelques jours après, un capitaine bernois pénétrait en Savoie à la tête d’un corps franc, sous prétexte d’empêcher le passage des /384/ Français 1; les Fribourgeois menaçaient d’envahir le Pays de Vaud pour être payés de leurs créances 2 et les troupes de Schiner ravageaient le Piémont 3.
Charles III dut donner des gages aux vainqueurs; il renseigna les Bernois sur les marches des armées françaises 4; il sollicita une alliance avec tous les cantons. Il réussit à l’obtenir, le 27 août, des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Zoug, Bâle, Fribourg, Soleure et Schaffhouse 5; les Waldstætten et Claris refusèrent de se lier avec un prince en qui Schiner, qui les inspirait, voyait un agent de la France 6. Les conditions qui étaient faites au duc par les huit cantons étaient onéreuses : Si les Confédérés appelaient le duc à leur secours, il devait leur fournir de la cavalerie, mais à ses frais; si c’était lui qui appelait les Confédérés, ceux-ci lui enverraient de l’infanterie, à ses frais également. Il s’engageait encore à payer à chaque canton une pension annuelle de 200 florins du Rhin (environ 20 000 francs). Le duc, sans doute, estimait que ce n’était pas payer trop cher l’alliance de gens si redoutables.
L’année 1513 fut pire. Lorsqu’au printemps l’armée française passa en Italie pour reprendre la Lombardie, la situation de Charles III fut inextricable; il se crut obligé de renseigner ses alliés Bernois sur la /385/ marche des armées françaises, mais, en même temps, il laissait passer celles-ci, envoyait cent lances au service du roi et lui fournissait de l’artillerie 1. Quelques semaines après, les Suisses étaient victorieux à Novarre (6 juin 1513) et le duc expiait cruellement ses complaisances pour Louis XII : ses états piémontais furent pillés et il dut payer aux vainqueurs une contribution de guerre de 50 000 couronnes 2. Il fut même question d’une expédition en Savoie pour le punir de sa déloyauté; seule, l’intervention de Berne la lui évita 3.
Peu de jours après, quand éclata à Berne la révolte des paysans, c’est à grand’peine que le gouvernement put empêcher les gens du Simmenthal de fondre sur Vevey 4. Et, dans la nuit du 26 juin, une bande de Bernois et de Fribourgeois s’emparait du château du Châtelard, sous prétexte que le baron du lieu avait renseigné les Français et recruté des soldats pour eux; en ouvrant généreusement ses caves aux assaillants, le baron s’en tira sain et sauf; mais son frère, qui se rendait à la diète de Lucerne comme ambassadeur savoyard, fut arrêté par des paysans soleurois et jeté en prison; malgré ses prières, le duc ne put obtenir que beaucoup plus tard sa libération, et encore sans indemnité 5. /386/
Chose plus grave : au même moment, on se remettait à parler d’une expédition en Bourgogne et, des trois routes que l’empereur proposait aux Suisses, deux passaient au travers du Pays de Vaud savoyard. Cette fois encore, la fortune favorisa Charles III, qui en fut quitte pour la peur. L’armée suisse qui marchait sur Dijon vers la fin d’août passa au nord des terres du duc; les contingents bernois et fribourgeois seuls empruntèrent le territoire vaudois et se dirigèrent sur Jougne par Morat, Payerne et Yverdon. A Payerne, les Fribourgeois exigèrent une rançon de 200 couronnes, bien que les Payernois les eussent bien reçus et fussent leurs combourgeois 1.
L’échec final de cette campagne ne calma pas les Suisses et le duc de Savoie dut laisser, en novembre, Berne et Fribourg faire arrêter à Genève l’ambassadeur français, qui fut conduit à Berne et incarcéré 2.
C’est en vain que Charles III essaya de ménager un arrangement entre les Suisses et Louis XII 3; l’année 1514 s’écoula et le roi mourut, sans que sa médiation eût réussi. L’avènement de François Ier accentuait la fausse position du duc : le nouveau roi était son oncle et l’on savait que Louise de Savoie, sa sœur, exerçait sur son fils une très grande influence. C’était une raison de plus pour rendre le duc suspect aux Confédérés. Les tentatives que fit celui-ci, au printemps 1515, pour ramener les Suisses à l’alliance française rendirent cette opinion plus plausible, si bien qu’à Berne même /387/ on se méfiait de lui et que l’on prenait des précautions contre lui 1. Comme on craignait une attaque par le Pays de Vaud, la Diète chargea, en juin, les villes de l’ouest d’occuper Yverdon, en plein pays savoyard. Le duc n’osa pas s’opposer à cette mesure 2.
Il n’osa pas non plus empêcher les troupes suisses et les contingents bernois en particulier d’entrer en Piémont et de venir occuper les cols des Alpes, pour barrer la route aux Français; il dut supporter que cette armée, mal ravitaillée, pillât abominablement le pays 3.
Ce spectacle, comme le souvenir de toutes les humiliations qu’il avait dû subir, le poussa à jouer double jeu. Tandis qu’il se donnait l’air de chercher à accommoder le roi et les Suisses, il encourageait les dissensions au sein de l’armée fédérale, il fournissait à François Ier des guides qui le conduisaient par un passage que les Suisses ne gardaient pas et il l’avisait de la discorde qui régnait dans leur camp 4. C’est enfin par son intermédiaire que furent faites les ouvertures de paix qui aboutirent au traité de Gallarate (8 septembre) 5. L’armée suisse était coupée en deux tronçons et, tandis que les contingents des cantons occidentaux rentraient dans leurs foyers, les autres se faisaient battre à Marignan (13 septembre). /388/
*
* *
A la nouvelle de la victoire française, Charles III se hâta d’offrir sa médiation, que les belligérants étaient, de leur côté, prêts à solliciter de lui 1. Il comptait bien y retrouver le prestige qu’il avait perdu et, des Suisses dont la défaite venait de briser l’orgueil, il espérait obtenir quelque témoignage de reconnaissance : la restitution du Chablais valaisan, par exemple, ou la remise des contributions qu’ils lui avaient imposées 2. Il présida en personne aux négociations qui eurent lieu à Genève à la fin d’octobre. Mais ses complaisances pour les Français, devenues trop visibles depuis que ceux-ci étaient victorieux, lui avaient enlevé tout crédit, sinon aux yeux des magistrats pensionnés par lui ou par le roi, tout au moins auprès des gens un peu informés et même auprès du peuple des cantons 3.
Les pourparlers de Genève n’aboutirent qu’à un projet; c’est un an après seulement, le 29 novembre 1516, au congrès de Fribourg, qu’il fut transformé en une paix définitive 4.
Le duc de Savoie put alors s’apprêter à recueillir la récompense de ses services. En novembre 1517, Charles III vint à Berne 5. L’avoyer et les conseillers /389/ reçurent avec les plus grands égards ce prince que, peu d’années auparavant, ils traitaient avec tant de mépris. Le duc ne se contenta pas de ces satisfactions d’amour-propre. La Diète, qui s’était réunie dans cette ville, sur sa demande, lui accorda, sans difficulté cette fois, le renouvellement de son alliance avec les cantons; Berne, Fribourg et Soleure confirmèrent, à de meilleures conditions, leur alliance avec lui; enfin, les créances provenant des faux Dufour lui furent remises 1. Charles III avait sa revanche.
Il semblait donc que des jours plus heureux allaient luire pour la Savoie; les Suisses, affaiblis par leur défaite, ne paraissaient plus redoutables. Le duc voulut profiter de ces circonstances qui paraissaient favorables; il entreprit de restaurer son autorité dans ses états et même de l’asseoir dans les villes épiscopales de Lausanne et de Genève, qui formaient des enclaves au sein de son pays.
On connaît l’échec 2 lamentable de ces tentatives maladroites et inopportunes. Après quelques années de recueillement, Berne et Fribourg reprenaient justement alors leur politique de pénétration du côté de l’occident; elle se justifiait d’autant mieux que la défaite de Marignan avait mis fin à la politique italienne de la Confédération. Les ambitions des deux villes se heurtaient donc directement à celles du Savoyard.
En 1519, Charles III réussit encore à faire rompre le traité de combourgeoisie conclu entre Genève et /390/ Fribourg 1; il put encore arrêter à Morges une expédition militaire des Fribourgeois 2. Ce dernier succès, qui lui coûtait fort cher 3, il le devait à l’appui de la diplomatie française. Mais, lorsque, au lendemain de Pavie 4, il eut, comme jadis au lendemain de Marignan, volé au secours de la victoire et passé au parti de l’empereur 5, rien ne retint plus les Bernois et les Fribourgeois : ils s’allièrent avec Lausanne 6 et Genève 7, qui échappèrent définitivement à la Savoie.
Tout devait engager le duc à la prudence : privé de ressources, sans argent et sans soldats, avec un pays ravagé par le passage des armées françaises et impériales 8, il n’était pas de taille à tenir tête à de si redoutables voisins. Au début de son règne, il avait subi de leur part de plus graves humiliations 9 sans prendre une attitude hostile. Maintenant, l’âge l’avait rendu moins souple et l’alliance de son beau-frère Charles-Quint lui donnait /391/ de fallacieux espoirs; il croyait son prestige engagé dans cette affaire et pensait que ses états au nord des Alpes seraient irrémédiablement perdus si le protectorat des Confédérés s’étendait sur Lausanne et sur Genève 1. Il n’abandonna donc pas la partie et poursuivit, par tous les moyens, l’annulation des combourgeoisies, de celle de Genève en particulier.
Les trois années qui suivent sont remplies des incidents qui naissaient presque journellement de la situation de cette ville : Exilés par les Eidguenots vainqueurs, les Mammelus invoquaient l’aide du duc qui se vengeait en saisissant les biens des Genevois et en bloquant leur ville pour l’affamer. Les soldats en garnison dans ses châteaux, les gentilshommes vaudois et savoyards faisaient la petite guerre à Genève qui appelait à son secours ses combourgeois de Berne et de Fribourg. Et cela donnait lieu à des négociations sans fin : les deux villes confédérées se plaignaient au duc des mauvais procédés dont il usait vis-à-vis de Genève, Charles III se plaignait auprès des autres cantons que Berne et Fribourg violassent le traité de 1512. Suivant les circonstances politiques, suivant l’ampleur des largesses du duc, suivant l’état des rapports des Confédérés entre eux, la décision des diètes ou la sentence des arbitres favorisaient l’une ou l’autre des parties et celle qui avait perdu en appelait toujours à une autre diète ou à des surarbitres 2. /392/
A ce régime, les rapports entre la Savoie et les cantons occidentaux se gâtaient de plus en plus. Dès 1529, ils sont tout à fait mauvais, si bien que la guerre faillit éclater 1, le bruit ayant couru que le duc envoyait des troupes à Romont. Devant les menaces de Berne et de Fribourg, il jugea prudent de les licencier 2. De nouveaux incidents, qui se produisirent en automne, amenèrent la rupture : le 6 octobre, en présence de l’ambassadeur savoyard, Berne faisait lacérer le traité qui liait la république avec son maître 3.
D’opportunes largesses, diverses conjonctures, dont la principale fut la crise religieuse, retardèrent l’ouverture des hostilités. Mais, lorsque, à la fin de septembre 1530, on apprit à Berne et à Fribourg qu’une armée, venant de Bourgogne, marchait sur Genève, on se décida à agir; dans les premiers jours d’octobre, 5000 Bernois, 3500 Fribourgeois, 500 Soleurois et un millier d’hommes des villes alliées se mettaient en route pour délivrer Genève 4. Ils traversèrent le Pays de Vaud, qu’ils ravagèrent affreusement 5, et débloquèrent Genève. Le 19 octobre, les représentants du duc durent signer des préliminaires de paix /393/ à St-Julien; ce traité imposait au duc l’obligation de cesser toute violence contre Genève; s’il violait ses engagements, les villes de Berne et Fribourg étaient autorisées à se saisir du Pays de Vaud 1. Quelques semaines après, une nouvelle conférence s’ouvrait à Payerne, où les cantons neutres devaient régler définitivement les rapports du duc, de Genève et des deux villes. Malgré tous les espoirs que Charles III nourrissait, malgré tous les efforts de ses agents, la sentence de Payerne (31 décembre 1530) confirma le traité de St-Julien et condamna le duc à payer aux deux cantons une indemnité de 21 000 couronnes 2.
Le traité de St-Julien et la sentence de Payerne sont des actes très importants pour l’histoire de notre pays : ils ont créé, en faveur de Fribourg et de Berne, un titre juridique contre la Savoie; les deux villes étaient décidées à le faire valoir; le duc, de son côté était tout aussi déterminé à ne pas renoncer à Genève; la conquête du Pays de Vaud par les Suisses en était donc la conséquence inévitable. Si elle tarda encore cinq ans, cela est dû essentiellement aux troubles que la Réforme provoqua au sein de la Confédération.
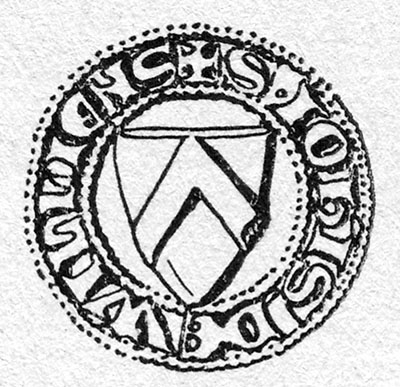
Sceau de Jean de Vulliens
donzel, 1316.
CHAPITRE XIX
LA FIN DU REGIME SAVOYARD
Il nous reste à étudier la politique de Charles III vis-à-vis de ses sujets vaudois. A bien des égards, ce prince nous apparaît comme plus moderne que la plupart de ses contemporains : il ne veut plus être un seigneur féodal; il aspire à devenir le souverain dont la volonté fait loi. Aussi ne pouvait-il voir de bon œil les tendances autonomistes que nous avons signalées plus haut 1.
Le jeudi 25 août 1513, le nouveau bailli de Vaud, Pierre de Beaufort, entrait en fonctions à Moudon; suivant l’usage, il se présenta devant le Conseil de cette ville et, dans l’église Notre-Dame, il prêta serment, à genoux, entre les mains du notaire Rodolphe Demierre et jura d’observer les franchises du pays qu’il allait administrer 2. Cette cérémonie n’était pas nouvelle, mais ce qui frappe c’est le soin avec lequel le secrétaire de la ville a noté le fait dans son registre et celui avec lequel, en particulier, il a relevé l’attitude humble que l’antique coutume imposait au représentant du prince. /395/
Charles III, sans doute, ignorait cet incident; mais d’autre part, quoiqu’il régnât depuis neuf ans, il n’avait pas encore confirmé les franchises du Pays de Vaud, comme il y était tenu. Cette abstention ne peut être l’effet du hasard, et cela d’autant plus qu’elle se prolongea encore quatre ans.
Enfin, lorsque, en 1517, il traversa le Pays de Vaud pour se rendre à Berne 1, il ne put plus se soustraire à ce devoir traditionnel; les succès de sa politique lui donnaient, pensait-il, un prestige qui lui permettrait de tirer quelque avantage de cette obligation.
Au début de septembre, on apprit dans le pays la nouvelle de la venue prochaine du prince; les Etats de Vaud se réunirent à Moudon, à trois reprises 2. Dans ces séances, il fut question du don en argent que les loyaux sujets du duc avaient l’habitude de lui présenter pour son joyeux avènement et qu’ils avaient différé tant que celui-ci n’avait pas reconnu les franchises; on y parla aussi d’une requête, dont nous avons encore le texte 3; on y demandait à Charles III, entre autres, de confirmer ces franchises et de prendre femme, car il avait trente et un ans. A la dernière séance, on discuta certains « points de coutume » sur lesquels le duc voulait avoir l’avis des Etats 4. /396/
Il y a tout lieu de supposer que cette demande suscita quelques difficultés entre le prince et ses sujets. Le duc, qui était parti de Genève dans les derniers jours d’octobre 1, annonçait qu’il serait à Moudon le mardi 10 novembre pour y recevoir l’hommage des Etats 2. On l’y attendait plus tôt, car, le samedi 7, on y avait fait venir des musiciens et des tambours 3. Le jour choisi par le prince tombait assez mal : c’était la veille de la foire de la Saint-Martin; on en avertit le seigneur de Lullin 4 qui était arrivé à Lausanne le 5 avec le duc 5, et le 7, Charles III convoqua les Etats dans cette cité pour le 9 6, au grand chagrin des Moudonnois qui paraissent s’être attendus à ce qu’on modifiât le jour, et non le lieu, de la séance; ils envoyèrent une députation au duc pour lui demander de passer au moins dans leur ville au cours de son voyage 7. Les députés aux Etats se réunirent donc à Lausanne, mais ni le 9, ni le 10, Charles III ne put, ou ne voulut, trouver le temps de leur donner audience. Ce n’est que le mercredi 11, à Romont où il les avait entraînés à sa suite, qu’il accepta leur cadeau 8; le lendemain, 12 novembre, /397/ il consentait enfin à confirmer les franchises du pays 1.
Il y a là des signes évidents de sa mauvaise humeur. De plus, en recevant le don gracieux de ses sujets vaudois, le duc leur demanda d’admettre un certain nombre d’articles qu’il proposait et qui tendaient tous à accroître son autorité ou ses revenus; il exigeait une réponse pour le jour, prochain, de son retour de Berne 2.
Le Conseil de Moudon convoqua les Etats pour le 19, mais il n’y vint presque personne, les convocations /398/ n’étant pas parvenues à temps, et l’on ne put rien faire 1. En quittant Berne le 25, Charles III donna au bailli l’ordre de les convoquer à nouveau pour le dimanche 29, à Moudon 2, où il se trouverait en personne pour recevoir leur réponse.
Dans cette ville, on se préparait fiévreusement à recevoir le souverain du pays. Les syndics avaient parcouru les villages et les fermes des environs pour y trouver de la paille, du foin, du blé, de l’avoine et du bois de chauffage; on aménageait la maison de l’ancien bailli Jean d’Estavayer, où le duc devait descendre; on mettait du papier aux fenêtres et on y dressait des lits; à des chasseurs, on achetait un chevreuil après lequel ils avaient couru quatre jours; dans la nuit du vendredi au samedi, on invita les habitants des villages à venir à la rencontre de leur prince et l’on rappela les musiciens 3.
Le duc arriva le dimanche 29 novembre comme il l’avait promis; il fut reçu par un cortège où l’on voyait huit musiciens 4 et des enfants qui portaient des croix blanches 5. Pour l’occasion, on avait fait faire un fanion de taffetas rouge et vert et l’on avait mis des franges au dais que l’on portait lors des fêtes religieuses 6. Il semble que l’entrée du prince eut lieu /399/ le soir; on alluma un grand feu de joie 1 et des décharges de poudre éclatèrent en son honneur. On lui offrit six flambeaux de cire et dix pots d’hypocras, dans la composition duquel entraient deux livres de sucre 2. Pendant la nuit, douze bourgeois, et non des moindres, montèrent la garde et firent le guet. La ville de Moudon avait tenu à bien faire les choses 3; on n’avait pas oublié l’entourage du prince; ses huissiers avaient reçu un cadeau de 7 livres 4.
Mais, si la réception fut brillante, l’accord ne se fit pas entre le prince et ses sujets vaudois. Nos ancêtres considéraient toute innovation comme dangereuse en principe; cette raison, à elle seule, leur eût déjà fait repousser les suggestions de Charles III. Celui-ci quitta le pays sans avoir obtenu ce qu’il désirait. /400/
*
* *
Le don de joyeux avènement que le trésorier de Savoie avait touché à Romont quelques jours auparavant n’était pas le premier que le Pays de Vaud eût fait à son prince. Lorsque le duc avait été obligé de payer de fortes sommes aux Confédérés à la suite des faux Dufour 1, il avait déjà eu recours à la bourse de ses sujets qui lui avaient accordé un subside, dont nous ignorons le chiffre 2.
Lorsque, en 1521, Charles III se décida à se marier et épousa Béatrice de Portugal 3, les nobles et les bonnes villes saluèrent la joyeuse arrivée de la duchesse par un don d’un florin par feu. Mais, Pierre Cerjat, seigneur de Combremont, qui était chargé de le percevoir, se heurta à une résistance inattendue; il ne put pas même faire rentrer la moitié de la /401/ somme escomptée et ne versa au trésorier savoyard que 542 florins (environ 25 000 fr.) 1.
En 1527 encore, le duc obtint des Etats de Vaud un subside qui devait lui permettre de réparer les forteresses et de préparer la défense du pays 2. Nous ne savons pas à quelle somme il s’élevait.
Les communes vaudoises profitèrent de l’occasion pour se faire accorder une faveur : Pour que la jeunesse pût s’exercer aux armes de trait, arc, arbalète ou coulevrine, et jouir d’un passe-temps honnête tout en se préparant à la guerre, elles demandèrent le droit de tirer au papegai aussi souvent qu’elles le voudraient, moyennant que ce fût en présence des fonctionnaires savoyards 3. Il n’y avait là, semble-t-il, rien de nouveau; depuis plus d’un siècle les fêtes de tir existaient dans notre pays 4. Les privilèges nouveaux /402/ que l’on sollicitait étaient les suivants : le droit, pour les tireurs, d’être à l’abri de toute poursuite ou saisie, les jours de tir; celui, pour leur confrérie, de faire sa propre police; enfin, pour le meilleur tireur, le roi, celui d’être exempt de tout impôt pendant l’année de sa « royauté ».
Le duc accueillit cette demande et accorda, le 19 novembre 1527, une faveur qui ne lui coûtait pas très cher 1. Cet acte a servi de base à la constitution de toutes nos abbayes de tir et les privilèges accordés en 1527 aux arbalétriers ont passé aux arquebusiers, aux mousquetaires et aux carabiniers au fur et à mesure des progrès des armes à feu; ils ont subsisté jusqu’à la fin de l’époque bernoise 2.
En 1529, les bourgeois de Moudon, craignant que leurs foires et leurs marchés ne perdissent leur clientèle de marchands, demandèrent et obtinrent du duc que l’on ne saisît plus les marchandises de ceux-ci; ils obtinrent aussi l’autorisation formelle d’avoir cinq foires annuelles de trois jours chacune le 21 février, le 30 avril, le 24 juin, le 23 août et le 10 novembre 3. Sauf sur ce dernier point, l’acte du 10 juin /403/ 1529 ne faisait que confirmer les premiers articles de la charte 1. Il était d’usage que ces confirmations fussent payées au prince qui les accordait; il ne semble pas que, cette fois, la ville ait dû l’acquérir par un cadeau 2.
Si le duc n’eut recours à l’impôt que quatre ou cinq fois pendant un règne de plus de trente ans, et encore pour des sommes relativement faibles, ce n’est pas qu’il n’eût pas besoin d’argent. Au contraire, car à la traditionnelle misère du Trésor savoyard de nouvelles et lourdes charges étaient venues s’ajouter : il y avait trois duchesses douairières : Blanche de Montferrat, la veuve de Charles Ier, avait pour douaire le Piémont; Claude de Bretagne, veuve de Philippe II, avait le Bugey; Marguerite d’Autriche, veuve de Philibert II, la Bresse, le Faucigny et le Pays de Vaud 3; une cousine du prince avait en apanage le Chablais 4 /404/ et son frère, le comté de Genevois 1. C’était tout autant de provinces dont le duc ne tirait plus de revenus 2.
Ajoutons à cela les lourdes sommes qu’il avait dû promettre aux Suisses, les pensions qu’il faisait aux cantons et à leurs magistrats 3, les pertes causées par le passage continuel des armées 4. Ne nous étonnons pas que Charles III ait été réduit aux pires expédients : il ne payait pas ce qu’il devait et passait pour avare 5; il aliénait les terres de la couronne 6, vendait des offices, remettait les peines aux coupables moyennant un versement en argent 7; il altérait les monnaies 8, il empruntait dans des conditions désastreuses 9.
Si donc Charles III a prélevé si rarement des impôts sur ses sujets vaudois, c’est que la nécessité l’y a /405/ forcé : il aurait dû, pour les obtenir, consentir à des sacrifices qui eussent ruiné son autorité et coûté trop cher à son amour-propre. Il osa encore moins leur demander des soldats 1, que, du reste, il aurait été trop pauvre pour entretenir.
La vérité est que, malgré les velléités d’absolutisme de ce prince, l’autorité ducale allait s’affaiblissant dans notre pays; les Etats de Vaud, dont les assemblées sont de plus en plus fréquentes, tendent à substituer leur influence à la puissance légale du duc et de ses fonctionnaires. Tantôt composés des délégués des trois ordres, tantôt formés des députés des bonnes villes seulement, ils se réunissent à Moudon, le plus souvent 2; ils s’occupent non seulement de l’administration, mais de législation et même de politique. Nous connaissons plus de cent de ces séances en trente ans 3. Presque toutes 4 sont convoquées par le Conseil /406/ de Moudon, soit qu’il agisse de son plein chef, soit qu’il en ait reçu mission du gouverneur de Vaud 1 ou d’un officier savoyard 2, soit qu’il en ait été chargé par le prince lui-même 3, soit enfin qu’il ait été prié par un seigneur ou une ville du pays 4. On s’explique sans peine le rôle que ce corps jouait dans cette circonstance. La ville de Moudon était le siège du bailliage de Vaud; c’était au bailli qu’était envoyée la lettre de convocation quand elle émanait du duc; c’était à ce haut fonctionnaire qu’était présentée la requête, issue des délibérations; c’était avec lui qu’étaient discutées les questions litigieuses. Souvent, il ne résidait pas dans le pays 5 et ses fonctions étaient remplies par le châtelain qui, lorsqu’il était de Moudon, siégeait au Conseil de la ville; nouvelle raison pour que l’importance de celui-ci s’accrût.
Nous sommes plus mal renseignés sur les objets qui furent portés à l’ordre du jour de ces assemblées; la plupart du temps les lettres de convocation ne les mentionnent pas ou se contentent d’allusions et de formules générales qui avaient un sens très précis pour les contemporains, mais que nous saisissons mal aujourd’hui : « Pour les occurens de présent bien dangereux 6 … », ou « Pour aucunes affaires touchant très expressément la préservation des libertés et /407/ franchises du pays et pour éviter l’infraction d’icelles 1 … »
Il semble bien que ce rôle défensif soit fondamental; empêcher que les fonctionnaires ducaux ne dépassent les limites de leur compétence, recueillir les plaintes de ceux qui auraient souffert d’un abus de pouvoir 2, les transmettre au prince, s’opposer à ce que ce dernier prélève un impôt ou viole la coutume, voilà la tâche principale des Etats. Mais, cela même les amène à faire œuvre plus positive, à fixer la coutume et à établir de nouvelles règles quand celle-ci ne répond plus aux circonstances. Nous avons vu un peu plus haut 3 que les Etats n’approuvaient guère les innovations que proposait le duc; ils aimaient que l’initiative partît d’eux-mêmes; lorsqu’ils avaient rédigé les formules nouvelles, ils les soumettaient respectueusement à l’approbation du prince 4; quand celui-ci les avait fait suivre de la formule : « Monseigneur le veut », elles prenaient force de loi. Ainsi les Etats partageaient avec le duc, en fait sinon en droit, le pouvoir de faire des lois.
Dans cet ordre d’idées, nous pouvons citer les mesures prises pour lutter contre les empiétements de la juridiction ecclésiastique 5 et celles dirigées /408/ contre la propagation des doctrines luthériennes 1.
Tout naturellement, quand les députés du Pays de Vaud étaient réunis, ils parlaient des intérêts communs de la patrie, de son approvisionnement, en sel 2, par exemple, qui était, pour lors, une difficulté toujours renaissante. Si les circonstances étaient plus graves, ils ne craignaient pas d’intervenir dans la politique proprement dite : ainsi, en 1506, quand la guerre menaça à propos des affaires du Valais; en 1525, 1526 et 1528, quand le conflit entre Charles III et Genève devint inquiétant; en 1530, quand les Confédérés eurent marché au secours de cette ville 3. Dans ces occasions, et dans d’autres encore 4, les Etats envoyèrent des ambassadeurs à Berne, Fribourg et Soleure pour solliciter des conseils ou des ménagements 5, à Genève pour offrir leurs bons offices 6. Le duc de Savoie ne semble pas avoir vu de mauvais œil ces démarches qu’un Etat moderne considérerait comme bien dangereuses pour sa souveraineté. Il était accablé de tant d’autres soucis, bien plus graves. /409/
Au reste, les Etats de Vaud ne paraissent pas avoir jamais songé à abuser de la situation; s’ils ont toujours défendu avec âpreté leurs privilèges municipaux, ils n’ont pas cherché à se soustraire effectivement à la domination savoyarde. A plus d’une reprise, les séances des Etats furent si peu fréquentées qu’aucune décision ne put être prise 1. Plus que toute autre chose, la nonchalance de ses sujets mettait l’autorité du duc à l’abri de tout attentat grave.
Nous ne trouvons dans le Pays de Vaud aucune trace 2 de cette hostilité contre lui que l’on rencontre à Lausanne ou à Genève. Quand il vint le visiter en 1532, — pour la dernière fois — il y fut accueilli tout aussi bien qu’en 1517. Dès le mois de septembre 1531 3 et plus particulièrement en décembre, on y avait annoncé sa venue, car il se rapprochait des bords du lac, pour être mieux à même d’y surveiller les Bernois et tâcher de les brouiller avec les Fribourgeois 4. En janvier 1532, il était à Gex, où il mandait les députés des bonnes villes 5. Ce n’est que quelques mois plus tard cependant qu’il pénétra dans le pays. Le 4 juin, il vint coucher à Chillon 6. Le lendemain, il fut admirablement reçu /410/ à Vevey, où les députés du Pays de Vaud, entre autres deux conseillers de Moudon, étaient venus lui présenter leurs hommages 1; il tint les Etats le 6; on y parla de la réparation des places fortes qui devaient défendre le pays 2, mais il ne semble pas qu’aucune mesure utile soit sortie de ces délibérations. Puis, le duc alla à Oron, où il était le 13; le 14, il passait à Romont, le 16 à Payerne, le 18 à Cudrefin, le 19 à Estavayer, d’où il venait le 20 à Lucens 3, chez l’évêque, chez qui il soupa.
Depuis plusieurs jours, on l’attendait à Moudon. Le dimanche 2 juin déjà, on avait passé en revue les milices de la ville et des villages d’alentour, placées sous le commandement de trois capitaines, Pierre Cerjat, François et Claude de Glane, le premier, seigneur de Ropraz, le second, seigneur de Villardin; ils étaient assistés de deux adjudants et de six sous-officiers; quatre tambours les accompagnaient; après la revue, tous soupèrent aux frais de la communauté 4. Le 6, deux conseillers et l’huissier du bailli visitèrent une première fois les logements prévus pour le prince, sa suite et ses chevaux; une nouvelle inspection eut lieu le lendemain; elle porta sur les chambres, meubles et lits que l’on avait préparés. Entre temps, /411/ le Conseil avait fait venir de Fribourg 14 livres de myrrhe 1, qui fut incorporée à dix flambeaux, de cire, afin de leur donner un bon parfum. On y acheta aussi 25 livres de poudre « vomipetre » et on en commanda 12 autres à un meunier de Cossonay 2. Un bourgeois, expert en ces matières, fut chargé de préparer huit pots d’hypocras, dans lequel entraient de la cannelle et du sucre, achetés à Genève; on s’y était procuré aussi quatre boîtes de dragées. D’autres conseillers allaient à Chavannes faire provision de foin et de paille.
Quatre tambours, c’était trop peu pour faire « loz rencontroz » du duc. On chercha à constituer une fanfare; mais les Moudonnois de l’époque avaient peu de goût pour la musique 3; on alla quérir des fifres à Grandvaux, à Lutry et à Vevey; on espérait en trouver quatre dans cette ville; on dut se contenter d’un seul, qui fut accompagné d’un tambour; Grandvaux et Epesses fournirent trois fifres; on en découvrit un cinquième, nous ne savons où; un sixième tambour, venu d’un village voisin 4, compléta ce petit corps de musique.
Le mercredi 19 juin fut un jour d’agitation; on attendait le duc et les fifres n’étaient pas arrivés… Heureusement, le prince retarda son passage d’un jour et l’on eut le temps de finir les préparatifs; les conseillers, /412/ les maîtres d’état qui mettaient la dernière main à l’ouvrage, les terrassiers qui comblaient un fossé qui aurait pu gêner le cortège, les dix-neuf hommes du guet furent sur pied toute la journée et la ville les restaura. Le jeudi 20 au matin, les fifres arrivèrent et la ville leur offrit à boire; les miliciens étaient sous les armes. Tout était prêt.
Le duc arriva vers le soir; sur la route de Lucens, il rencontra une troupe d’enfants qui l’attendaient depuis longtemps et auxquels on avait fait porter quatre pots de vin pour leur faire prendre patience. Ils étaient précédés d’un drapeau que l’on avait fait pour la circonstance 1 et ils tenaient dans leurs mains 74 croix blanches. Ils étaient accompagnés de sybilles, pour lesquelles on avait fabriqué des loges; sans doute des jeunes femmes, qui, d’une niche de bois recouverte de branchages, prédisaient au prince un heureux avenir et auxquelles les Bernois allaient, bientôt, donner un éclatant démenti. Le duc entra dans sa bonne ville au bruit des coulevrines. Il y reçut dragées et hypocras et y passa la nuit; le lendemain matin, de bonne heure, il partait pour Lausanne 2. /413/
Le 27, il était de retour à Morges 1; il passa de là à Thonon, où il reçut encore les députés des bonnes villes 2. Il ne devait plus revoir ce Pays de Vaud, où il avait été reçu si chaleureusement 3.
*
* *
Et pourtant, ses sujets vaudois auraient eu le droit de se plaindre, car la faiblesse du duc les exposait à des dangers continuels. Au moindre bruit de guerre, officiers et soldats suisses se mettaient à traverser le pays pour se rendre aux places de rassemblement où les attendaient les recruteurs, Genève 4, Lausanne 5, Vevey 6 ou Aigle 7. Isolés ou groupés, ces aventuriers étaient toujours à redouter. Quand les gentilshommes de la Cuiller commencèrent leur campagne, ce fut bien pis; leurs bandes se mirent à sillonner le pays, pour son plus grand dam et dommage 8. Un des chefs /414/ du mouvement, Henri de Cojonay, seigneur de St-Martin, avait chargé un certain Nicolas Bize de lui recruter des soldats; ils ne s’entendirent pas pour le règlement de leurs comptes et le capitaine Bize assigna Henri de Cojonay devant la justice de Moudon. Trouvant la procédure trop lente, Bize se saisit du seigneur de St-Martin, en pleine ville un jour d’audience 1, le mit sur un cheval et l’emmena à Yverdon, où il le retint quinze jours prisonnier; sur quoi, le noble seigneur jugea plus sage de s’entendre avec le capitaine Bize et ses lieutenants. « Et est à sçavoir que quand ledit Nicolas Bize alloit comparaistre à la justice de Moudon, il alloit tousjours accompagné de sa bande avec enseigne desployée et taborins sonans 2. »
Cet incident, et d’autres du même genre, montraient que le prince avait peine à faire régner l’ordre public 3. Les Etats de Vaud cherchèrent à remédier à cet état de choses : réunis le 25 mars 1525 à Moudon, ils firent une ordonnance, pour une durée de trois ans, frappant d’une amende de 100 livres (6000 fr.) tous ceux qui se présenteraient en justice avec une /415/ escorte armée plus considérable que leur condition ne le comportait, ainsi que ceux qui, par leurs paroles ou leurs actes, outrageraient les juges « ou pres des banches des courts 1 », pour « contrarier » la justice à l’occasion d’un procès. Si les coupables ne pouvaient payer l’amende, ils devaient être emprisonnés aussi longtemps qu’il plairait au duc 2. La même peine menaçait ceux qui formeraient des « congregacions et abbayes … a maulvaise intencion ou il y a sermant de soy porter l’ung laultre 3 »; ils déclaraient abolies ces sociétés de gens qui cherchaient à s’entr’aider et à se faire justice privément, en dehors des tribunaux réguliers 4.
Car, l’insécurité étant générale, les voyageurs hésitaient à traverser notre pays où leurs personnes et leurs biens couraient un égal danger 5. /416/
Il est un fait plus caractéristique encore de l’état de décomposition politique dans lequel le Pays de Vaud était tombé : c’est le conflit qui, en 1534, mit aux prises Yverdon et Moudon.
Vers la fin de mars, le châtelain d’Yverdon faisait incarcérer un homme de Démoret, accusé de sorcellerie. Le Conseil de Moudon, qui considérait Démoret comme étant de son ressort 1, exigea la libération de son ressortissant; le châtelain refusa. Cité devant le bailli de Vaud à Moudon, il fut incarcéré à son tour et n’obtint d’être relaxé que moyennant la promesse qu’il livrerait le prisonnier. Les bourgeois d’Yverdon s’y opposèrent. Alors, le fils du détenu assigna le châtelain devant la cour de Moudon, où il fut condamné par défaut.
Le châtelain condamné interjeta appel à Chambéry; néanmoins, le châtelain de Moudon, agissant comme lieutenant du bailli absent 2, se décida à faire exécuter le jugement; il voulut faire saisir à Pomy des vaches qui appartenaient à son collègue d’Yverdon 3.
Le vendredi 22 mai, des députés du Conseil de Moudon inspectaient secrètement les bâtons, /417/ c’est à-dire les armes des bourgeois de la ville; le lendemain, Pierre et Jaques Cerjat, ainsi que Claude de Glane, se rendaient à Romont et à Rue pour requérir l’appui de ces villes voisines et, le 24 mai, dimanche de Pentecôte, l’huissier du bailliage se mettait en route accompagné de douze bourgeois armés. Le secret avait été mal gardé; à Thierrens, la petite troupe tomba sur un contingent d’Yverdonnois qui l’attendait; l’huissier fut injurié et malmené; trois Moudonnois furent emmenés en captivité 1; les autres s’enfuirent précipitamment, ramenant avec eux l’huissier en fort piteux état.
A cette nouvelle, on battit la générale à Moudon; les bourgeois s’armèrent; le seigneur de Ropraz accourut avec ses gens; 4 hommes de Montpreveyres, 19 de Mézières, 16 de Carrouge, 19 de Ropraz se joignirent à eux. La colonne marcha sur Thierrens, mais n’y trouva plus « l’ennemi » qui s’était retiré prudemment; on en fut réduit à boire 146 pots de vin chez l’aubergiste du lieu, Antoine Forestier. Puis on rentra en ville, où, par mesure de prudence, on garda à disposition les soldats des villages; on ne les congédia que le lendemain après le dîner.
Au bruit de cette guerre civile, les voisins s’émurent. Le mardi 26, on vit arriver deux députés du Conseil de Payerne qui « étaient bien marris » de ce qui venait de se passer et offraient « de se vouloir aider de pacifier de tout leur pouvoir le dit /418/ différend 1 »; on les accueillit fort bien et on leur offrit le verre de l’amitié, ainsi qu’à certains seigneurs des environs, tels que le seigneur de Bonvillars-Mézières et ceux de Villarzel et de Correvon, qui arrivaient d’Yverdon, où ils étaient allés faire des propositions de paix. Ils séjournèrent le lendemain chez Alexie Martin, qui tenait la meilleure auberge de la ville, et les conseillers leur tinrent compagnie 2. Leurs efforts conciliants furent appuyés, dès le jeudi 28, par le sire Antoine Pavillard, chevalier, et un des bannerets de Fribourg, envoyés par les magnifiques seigneurs de cette ville 3 auxquels l’événement fournissait une excellente occasion pour intervenir. Ils passèrent à Moudon toute la journée du vendredi.
La veille déjà, le secrétaire avait convoqué pour le dimanche 7 juin les Etats de Vaud, afin de soumettre à ce corps les nombreuses questions que l’incident avait soulevées 4. Dans deux conférences qui eurent lieu à Rue, les mercredis 3 et 10 juin, les délégués des conseils de Moudon et d’Yverdon réussirent à s’entendre et, dans une nouvelle séance, à Moudon, le 5 juillet, les Etats n’eurent plus qu’à prendre acte de la réconciliation des deux villes 5. Ainsi se terminait amiablement ce conflit qui, pour avoir parfois des allures d’opérette 6, n’en était pas moins grave en /419/ lui-même. Pierrefleur en fait la remarque 1 : « Et ne se faut estonner si soubs un tel prince (Charles III) si bon, si patient, si souffrant d’avoir des subjets si desreiglez et s’il luy advient beaucoup de maux et inconveniens, comme il luy advint depuis. »
*
* *
Plus dangereux encore était le risque que l’on courait de voir le pays envahi par les Suisses; sauf entre 1515 et 1519 2, les craintes à cet égard furent ininterrompues. Quelques témoignages nous en sont parvenus : au mois de juin d’une année que nous ne pouvons préciser, le Conseil de Moudon convoquait en hâte les Etats à la nouvelle que « MM. des Ligues sont sur le département pour marcher par ce pays de Vaud 3 »; ce n’était qu’une alerte. En 1513, quand les cantons préparèrent leur expédition de Dijon 4, l’inquiétude fut grande dans notre pays. Les Etats, réunis à Moudon envoyèrent une ambassade à Berne et à Fribourg pour supplier ces deux villes de le ménager 5. Nous ignorons les sentiments avec lesquels les Vaudois apprirent l’occupation d’Yverdon en 1515 6. /420/
Après quatre années seulement de répit, le danger reparut en 1519. Nous ne sommes pas renseignés sur l’itinéraire que suivit l’armée fribourgeoise dans sa marche sur Morges 1.
C’était le 6 février que les Genevois avaient conclu un traité de combourgeoisie avec Fribourg. Le 5 avril, Charles III entrait à Genève avec des troupes, bien décidé à le faire annuler. A cette nouvelle, les Fribourgeois marchèrent au secours de leurs alliés 2.
Le Conseil de Moudon avait vu venir la guerre : il avait pris ses précautions et envoyé, le dimanche 3 avril, un messager à Morges pour déclarer au duc que c’étaient à ceux d’outre-Jorat d’aller à Genève, car ceux d’en deçà étaient trop près de Fribourg; ils le priaient donc de les excuser 3.
Le 5 avril, apprenant sans doute qu’un parti de Fribourgeois allait passer par Romont et Rue, le bailli de Vaud, Pierre de Beaufort, et Antoine Voudan, receveur général de la duchesse Marguerite, accompagnés de Jaques Cerjat, seigneur de Denezy, de Jean de Saint-Germain, de François de Bulo et de Boniface Bridel, se rendirent à Rue, puis se dirigèrent /421/ vers Romont au-devant des Fribourgeois; le bailli espérait les rencontrer et les amener à se retirer. Et effectivement, près de Romont, l’ambassade rencontra les soldats, mais les « Allemands » ne voulurent rien entendre et emmenèrent la petite troupe prisonnière à Romont; ils les relâchèrent le jour même d’ailleurs, sauf le bailli et le « général » de Vaud. Nos gens rentrèrent en hâte à Moudon apporter ces nouvelles, et déjeunèrent pour se remettre de leur émotion 1; dans l’après-midi, Boniface Bridel repartait avec Pierre Cerjat pour Payerne, où se trouvait le gros des troupes : au nom de leur ville, ils devaient offrir des vivres, au cas où l’expédition passerait par Moudon; de plus, ils annoncèrent aux chefs fribourgeois que leurs gens avaient arrêté le bailli de Vaud et le gardaient à Romont, et ils demandèrent quand leur intention était de le « relaxer » 2.
Le même jour (5 avril), passaient à Moudon quatre ambassadeurs de Berne qui allaient à Genève « faire la paix » 3. On sait en effet que les Fribourgeois seuls s’étaient jetés dans cette aventure et que les autres cantons, Berne en particulier, n’étaient pas contents de cette intervention militaire.
Les troupes ne passèrent à Moudon ni à l’aller, ni au retour. Ce qui n’empêcha pas le Conseil, dont /422/ une délégation siégeait en permanence 1, de charger à trois reprises quelques compagnons de faire le guet 2. Par contre, on voit passer les ambassadeurs de Berne, de Fribourg ou de Soleure, allant ou revenant de Morges ou de Genève 3. Presque chaque jour aussi, le Conseil dépêchait un messager pour savoir où en étaient les négociations, et connaître, « s’il était possible, les intentions des Fribourgeois … qui étaient à Morges en armes avec leur bannière 4 ». Le 14 avril enfin, Jean Durand rentra de Lausanne disant « que la paix, était faite »; la nouvelle fut transmise le lendemain à Romont 5. En fait, l’accord entre le duc et Fribourg porte la date du 16 avril seulement 6. Et, le 1er mai, le Conseil reçut une lettre du duc, dans laquelle il recommandait à ses sujets de Moudon d’être pacifiques avec les seigneurs de Fribourg 7.
Toute cette affaire avait coûté à la ville de Moudon, en messagers, vin offert à des ambassadeurs de passage et parties d’auberge, une somme qui équivaut environ à 1600 francs 8. /423/
On eut ensuite quelques années de tranquillité relative. Dès 1525 1, l’inquiétude reprit. Le 24 mai déjà, le Conseil envoyait un messager à Yverdon pour voir s’il n’y avait pas des hommes de guerre rassemblés près de Bevaix 2. En février 1526, à la nouvelle de la conclusion des traités de combourgeoisie entre Berne et Fribourg d’une part, et Lausanne, puis Genève d’autre part, les Etats furent convoqués à la hâte 3. On fit une inspection secrète des armes dans la ville et à Thierrens 4, et l’on envoya le seigneur de Saint-Martin, puis Pierre Cerjat auprès de Charles III 5. A la fin d’avril, le Conseil achetait 50 lances à un fabricant d’armes de Poliez-Pittet 6. Le 1er juin, un vendredi, les hommes des châtellenies de Romont et de Rue furent passés en revue à Moudon par le comte de Gruyère et le gouverneur de Vaud 7. La ville leur offrit à boire à leur arrivée et à leur départ 8.
Dès le milieu de l’été cependant, le danger parut s’écarter. En 1527 et 1528, nous voyons les Etats délibérer moins fiévreusement sur la situation créée par les « Eguynod » de Genève 9, et sur les /424/ négociations pendantes entre les Confédérés et le duc 1. Ils cherchèrent même à provoquer un accord entre les adversaires 2. Leurs députés allèrent pour cela en novembre 1528 auprès du duc à Chambéry, en décembre à Berne et à Fribourg.
Mais ces tentatives furent inutiles. Dès le début de janvier 1529, on croyait à Moudon que les Genevois allaient entrer en guerre 3; on acheta de la poudre 4; on vendit quelques lances à des bourgeois belliqueux ou désarmés 5; on fit quelques préparatifs militaires. Surtout, l’on eut très peur. Le 5 février, on envoyait un bourgeois à Payerne voir s’il y avait des soldats suisses dans cette ville 6. Les Etats, convoqués précipitamment, se réunirent le dimanche 21 7; Jean de Saint-Cierges y représentait la ville de Lausanne. N’y était-il pas un peu un observateur pour le compte de Berne ?
Le mois de mars ne fut guère plus paisible; les comptes nous indiquent l’envoi de messagers ou de conseillers à Berne, Romont et Rue 8. /425/ Le Vendredi-Saint, 26 mars, on envoyait à la hâte Jaques Besançon à Payerne pour voir si les soldats bernois y étaient arrivés 1. C’était un faux bruit; cette fois encore, l’orage s’éloigna. Ce n’était qu’un répit 2. Le 16 septembre 3, le bailli de Vaud écrivait au duc pour le rendre attentif aux dangers qui le menaçaient : « qui sont toutes chouses qui me font suer sang et eau, et attendu que je vous n’y puis faire service ne y obvier vous supplie très humblement qu’il vous plaise me oyter de ce lieu et office; car j’aime rois mieux estre mort que de veoir venir sur mes braz et charge a vous un tel dommaige ».
*
* *
Un an après, le 27 septembre 1530, un messager de Genève arrivait à Berne pour demander du secours contre les gentilshommes de la Cuiller 4. Les Bernois se contentèrent d’abord d’envoyer deux ambassadeurs : Jean-Jaques de Watteville et Gaspard de Mülinen. Leur passage, celui du « chevalier de Mellunes », tout au moins, est signalé à Moudon le 30 septembre; il se rendait auprès du duc 5.
Le 2 octobre, le Conseil et les bourgeois songent à prendre des mesures militaires : ils désignent huit /426/ conseillers pour inspecter les armes des habitants de la ville et du ressort. Le châtelain leur donne le pouvoir d’exiger des habitants qu’ils aient de « gros bâtons », c’est-à-dire des arquebuses, et l’équipement nécessaire. Ils seront en fonctions pour trois ans; ils se répartissent les quartiers de la ville et les villages deux par deux 1. Mais le 3 octobre déjà, Boniface Bridel et Pierre Riguet partaient pour Payerne, porteurs d’une lettre de créance pour les conseillers de cette ville, qui devaient les introduire auprès des chefs de l’armée : les deux députés demandèrent aux Suisses d’épargner la ville et la terre de Moudon 2; le lendemain, 4 octobre, ils envoyèrent à Moudon un héraut, qui avertit sans doute les conseillers qu’un arrangement était intervenu, puis continua sa route sur Lausanne 3.
On peut croire que les députés de Moudon avaient promis aux officiers bernois et fribourgeois de fournir des vivres à leurs hommes. Comme il n’y avait pas de provisions suffisantes dans la ville, le Conseil fit amener en hâte du blé, du pain, de l’avoine des villages et hameaux voisins : Chavannes, Vucherens, Hermenches, Rossenges, Chapelle, Thierrens, la Cerjaulaz, Neyruz, Forel. Ce ne fut pas sans peine : presque partout, les /427/ habitants se montrèrent « rebelles » aux ordres du Conseil, qui chargea alors des huissiers de lever des gages pour les contraindre à se soumettre (5-8 octobre) 1. Le Conseil fournit aussi du vin; comme il n’y en avait plus assez à Moudon, il se préoccupa, dès ce moment, de faire venir de Lutry le vin du clergé, en vue du retour des soldats; les gens de Lutry voulurent d’abord retenir ce vin chez eux; ils ne le laissèrent partir qu’au bout de huit jours après paiement de l’impôt sur le vin vendu en gros, la corde 2.
L’expédition, à l’aller, passa tout entière par Moudon, semble-t-il : le mercredi 5 octobre, c’était une première troupe, comprenant un contingent de Payernois sous la conduite de leur banneret 3; le 6 en arrivait une autre : parmi les chefs on voyait le noble seigneur Guillaume de Diesbach 4. Le gros de l’armée traversa la ville le 6, sans doute, puisque le 7, de très bonne heure 5, le Conseil jugea nécessaire d’en aviser les bourgeois de Rue et de Romont.
Le 8 octobre, le Conseil décidait d’envoyer Jaques Monnier pour rejoindre les chefs des Suisses à Morges ou à Rolle; il partit le 9 au matin; en route, il fut dévalisé par des soldats. Ayant obtenu un sauf-conduit pour que le Conseil pût faire charrier les vivres où il le faudrait, au retour de l’expédition, il rentra le 11 à Moudon. Là, il se plaignit de sa mésaventure aux /428/ conseillers : en allant, il s’était trouvé dans un endroit appelé « au bois de chênes sous Bussigny vers Echallens »; il y avait rencontré des soldats qui l’avaient dépouillé de son argent. Comme il n’avait pas de témoins, il prêta serment, et les conseillers, confiants en sa parole, lui firent rembourser les 17 sous 6 deniers (environ 50 fr.) qui lui avaient été enlevés 1.
Le dimanche 9 au matin, des retardataires passaient encore 2. Quelques heures après, c’était Girard Mestral, le frère de l’avoyer de Payerne 3, qui allait à Morges; le 10, des Bernois, et le 11, des Schaffhousois, qui se rendaient auprès du duc de Savoie 4.
Ce même jour, 11 octobre, le Conseil chargeait Jean Luysii, Jean Jolivet et Rodolphe Demont d’examiner et de lire toutes les libertés et franchises de la ville de Moudon 5. Ignorant si le Pays de Vaud resterait cette fois aux mains des Bernois, le Conseil se préparait à les accepter comme maîtres, en faisant simplement reconnaître ses franchises.
Le 14 octobre, le Conseil envoya Pierre Cerjat et Jean Philippon à Genève en ambassade au nom du Pays de Vaud avec le seigneur de Vuissens; ils recommandèrent aux Suisses le pays tout entier, et la ville de Moudon en particulier; ils s’informèrent de la /429/ date et de l’itinéraire du retour pour qu’on pût tout préparer 1.
Les Suisses, entrés à Genève le 10 octobre, avaient conclu avec le duc la paix de Saint-Julien, le 19 2; ils pouvaient songer à rentrer dans leurs foyers. Jaques Monnier alla aux renseignements auprès du bailli d’Echallens : les troupes passeraient-elles par Molondin ? fallait-il y mener les vivres ou les diriger sur Murist ? 3 La réponse fut qu’il en passerait et par Molondin et par Moudon.
Les vendredi 21 et samedi 22 octobre, le Conseil envoya à Molondin plusieurs chars de pain et de fromage, et des tonneaux de vin 4 sur lesquels un jeune ecclésiastique, dom Bernard Bridel avait fixé « les armes de Moudon », qu’il avait lui-même fabriquées 5. Le Conseil envoya avec les charretiers Claude Calley et Benoît Cherpilliod, qui sans doute savaient l’allemand, pour parler aux Suisses et leur distribuer les vivres. Il dut faire revenir une partie de ces provisions, parce que, contrairement aux prévisions, le gros de l’armée passait par Moudon : le 21, en particulier, ce fut l’artillerie de Fribourg; les hommes s’arrêtèrent pour « goûter » et fourrager leurs chevaux 6. Et le lendemain, /430/ une troupe nombreuse cantonna à Moudon. Toute la nuit du vendredi au samedi, le guet, renforcé pour la circonstance, fut sur pied à cause des « Germains » 1. Nous ne voyons pas qu’il y ait eu d’incidents.
Si, par de judicieuses prévenances, Moudon avait échappé alors au pillage dont tout le pays eut à souffrir 2, il n’en était pas de même des villages de la banlieue. Là, des soldats moins surveillés ou des maraudeurs avaient dépouillé les habitants de pain, de fromage et de poules. A la fin de 1532, ces malheureux essayaient de se faire indemniser par la ville, et le Conseil tentait de dresser l’état de ces dommages de guerre. Nous avons une liste d’une vingtaine de personnes de Vucherens, de Bressonnaz ou d’Hermenches qui réclament de 2 sous (5 à 6fr.) — pour une poule — à 11 florins (350 fr.), et parmi elles une pauvre veuve, un peu simple, qui refuse de prêter serment; elle affirme cependant qu’elle a été dépouillée, mais ne sait pas dire de quoi; sur le témoignage de ses voisins, on l’inscrit pour 8 s. 3.
Le 6 novembre 1530, les Etats, mandés en toute hâte, s’occupèrent des dégâts causés par les Allemands 4; le duc avait envoyé deux ambassadeurs pour /431/ la « consolation de ceux qui furent pillés et dévastés, surtout d’outre-Jorat ». Le bailli de Vaud était revenu d’Aoste exprès pour cette circonstance 1.
Malgré le retour des Suisses et la paix de SaintJulien, on n’était pas tranquille à Moudon; le 24 novembre, le bruit courait que les seigneurs de Berne et de Fribourg allaient repartir pour Genève. Le Conseil de Moudon en avisa celui de Romont; il envoya un messager à Payerne et un autre à Fribourg auprès de Jaques Fouguilly, neveu de François de Bulo, pour savoir ce qu’il y avait de vrai dans ces on-dit 2. Les Etats de Vaud avaient été convoqués pour le lendemain; ils l’étaient de nouveau pour le même motif pour le 4 décembre 3.
En février 1531, un officier du duc vint visiter Moudon, Thierrens et les autres places appartenant à son maître 4 : Charles III avait-il l’intention de mettre le Pays de Vaud en état de défense ?
A ce moment, le Conseil s’occupait de lever un giète dans la ville et châtellenie de Moudon pour subvenir aux frais du passage des troupes 5; il menaçait de 60 sous d’amende (150 fr.) et de trois jours /432/ de prison au pain et à l’eau 1 ceux qui se montreraient « rebelles », battraient les syndics et les huissiers, les injurieraient ou refuseraient de payer le giète. A la même époque, le Conseil faisait rentrer les sommes dues par ceux qui avaient profité indûment des livraisons de blé et réglait les derniers comptes de l’expédition de 1530 2.
Nous ne pouvons pas savoir exactement tout ce que cette affaire avait coûté à la ville de Moudon; dans le compte de 1529-30 ne figurent guère que des frais de messagers et de vins, ce pour un total de 43 livres 11 sous et 7 deniers. Dans le registre du Conseil, les indemnités qui sont indiquées, et elles ne le sont pas toutes, font une somme de 45 livres 12 sous. En tout, cela équivaut environ à 4500 francs; mais ce qui coûta le plus cher n’est pas indiqué dans les comptes : c’est le prix des fournitures de blé, de pain et de vin, couvert par le giète levé à cet effet 3.
*
* *
Pour cette fois, le Pays de Vaud avait échappé à la conquête, mais pour combien de temps ?
Comme toujours en pareil cas, les bruits les moins fondés circulaient et l’on s’accusait /433/ réciproquement de trahison 1. Les Soleurois cherchaient à s’insinuer dans le pays pour avoir leur part le jour de la curée 2. Les Etats de Vaud s’inquiétaient : le 25 mars 1532, à Moudon, ils suppliaient le duc de s’arranger à l’amiable avec les Genevois, « non obstant que les borgeoysies » conclues par « ceulx de Genefve » avec « messieurs les voysins 3… lui soyt mal aggreables et desobeyssantes », cela « en consideracion … des maulx que desia 4 sen sont ensuyvyt au tresgrant preiudice et frais de ce pouvre pays ». Et comme, malgré tout, ils ne se faisaient pas de grandes illusions, ils lui demandaient de l’argent pour réparer les fortifications des villes « pour [que] quant les gros affaires surviendront lon ayt moyen et de quoy se deffendre 5 ». L’année suivante comme les Suisses menaçaient d’occuper le pays pour recouvrer par là leurs créances contre le duc, ils envoyaient à Berne, Fribourg et Soleure une ambassade pour intercéder en sa faveur 6. /434/
L’émotion atteignit son comble au cours de l’été 1534. Fribourg ayant rompu sa combourgeoisie avec Genève, l’évêque, poussé par le duc, essaya de pénétrer de force dans la ville, le 30 juillet 1. A cette nouvelle, l’angoisse s’empara des habitants du Pays de Vaud : devant cette violation évidente de la paix de St-Julien, Berne allait-elle faire valoir son hypothèque ? Le 2 août déjà, deux députés de Rue se présentaient devant le Conseil de Moudon pour savoir qui celui-ci avait choisi pour aller à Berne implorer la clémence de ces puissants seigneurs 2. Il ne paraît pas que cette mission ait été envoyée. Le 4, les ambassadeurs bernois qui allaient à Genève passaient à Moudon, où on leur offrait une réception propitiatoire et, deux jours après, le Conseil expédiait de son côté un émissaire à Genève, afin d’être renseigné 3. Entre temps, il avait convoqué en toute hâte les Etats de Vaud pour le 9, afin qu’ils se déterminassent sur une lettre comminatoire qui leur avait été adressée, ainsi qu’au bailli de Vaud, par les autorités bernoises 4. La séance eut lieu dans la salle neuve du Conseil; elle ne donna aucun résultat utile. Que pouvaient bien faire les Etats de Vaud dans ces conjonctures ?
Quelques jours après, un secrétaire du duc, qui se /435/ rendait à Berne, apporta au bailli les ordres de son maître. Lullin eut, le 18 août, une conférence à Romont avec le comte de Gruyère, le seigneur de Bonvillars-Mézières, l’évêque de Belley et quelques autres nobles vaudois, fidèles à Charles III 1; tout en évitant les mesures militaires, qui eussent pu paraître une provocation, il commençait une tournée d’inspection dans les villes et les châteaux vaudois 2.
Du vendredi 28 au lundi 31 août, des ambassadeurs bernois séjournèrent à Moudon; ils étaient descendus chez la veuve Martin où les conseillers de la ville leur tinrent compagnie aux frais de la communauté; le dimanche 30, il y eut séance des Etats, sur la convocation du bailli; en présence des députés bernois, on discuta des affaires de Genève 3. La situation paraissait si grave que le notaire Michel Frossard mit à l’abri, du mieux qu’il put, les lettres de franchises de la ville et qu’un conseiller fut envoyé à Fribourg, dont on connaissait l’animosité contre Berne, « pour savoir si l’on y pourrait trouver une certaine quantité d’armures et de poudre … pour le cas où il serait nécessaire de lutter contre les Bernois à cause de ceux de Genève 4 ».
Sur ces entrefaites, Berne mettait des troupes sur /436/ pied 1; devant l’imminence du danger, les Etats furent convoqués une fois de plus pour le 24 septembre 2; on ne voit pas très bien quelles mesures ils pouvaient prendre. La guerre, cependant, n’éclata pas à ce moment et toutes les menaces des Bernois s’enlisèrent dans de longues et inutiles négociations 3.
Avec l’été de l’année 1535 le conflit réapparut, plus grave que jamais. Les Genevois partisans du duc, bannis de leur ville, s’étaient réfugiés au château de Peney d’où, soutenus par Charles III, ils harcelaient leurs anciens combourgeois; cela faillit amener une intervention de Berne 4. Les Etats et le bailli de Vaud négociaient et cherchaient à persuader les Bernois des intentions pacifiques du duc 5.
Les Etats se réunirent encore le 8 août, le 26 septembre et le 5 octobre 6. De jour en jour la situation s’aggravait; le 12 octobre, on dépêchait un conseiller auprès du bailli de Vaud qui était à Nyon, pour lui parler de la menace bernoise; le 15, au milieu de la nuit, arrivaient à Moudon des délégués du Conseil /437/ de Morges; on réveillait les membres du Conseil de la ville et, à la lumière des chandelles, l’on discutait de la guerre imminente; le lendemain, pour avoir des nouvelles, on envoyait à Berne Boniface Bridel et Jaques Cerjat le jeune. Le 28, les Etats s’assemblaient de nouveau 1.
Puis l’orage parut s’éloigner; un calme trompeur se rétablit. Toutefois, le dénouement approchait : des événements que les députés des bonnes villes ou de la noblesse vaudoise ne pouvaient ni prévoir ni empêcher 2 allaient déclencher cette invasion bernoise que l’on redoutait depuis dix ans.

Sceau de Philippe de Savoie,
comte de Bresse, 1467.
CHAPITRE XX
MOUDON A LA VEILLE DE LA CONQUÊTE BERNOISE.
1435-1536.
LES HABITANTS.
Pendant le dernier siècle de la domination savoyarde, la ville de Moudon continue à être habitée par toute une noblesse qui préfère résider dans cette cité plutôt que de séjourner sur ses terres, où elle ne paraît pas avoir de château habitable.
Mais ce ne sont plus exactement les mêmes familles : les héritiers des Vulliens 1 ont leurs intérêts ailleurs. Les Servion ne sont plus que des personnages insignifiants 2; les Provana 3 quittent Moudon et les Asinier 4 s’éteignent; ces derniers descendants de banquiers italiens laissaient une situation obérée.
Ce siècle est celui de la grandeur des Glane et des Cerjat. Le chef de la première de ces maisons est /439/ d’abord Jaques de Glane, dont nous avons vu le rôle important 1. De ses trois fils, un seul fit souche : c’est cet Humbert de Glane, seigneur de Cugy et de Villardin, qui prit parti pour les Bernois lors des guerres de Bourgogne et fut, dès novembre 1475, bailli de Vaud pour le compte des Confédérés 2. Il mourut peu de jours après la bataille de Morat 3.
Ses deux, fils, Georges, seigneur de Cugy, et Jaques, seigneur de Villardin, font grande figure au sein de la noblesse vaudoise; le second est député des Etats de Vaud au congrès de Fribourg; le premier est un des témoins de l’acte par lequel les commissaires de la duchesse Yolande reprennent possession du Pays de Vaud 4. Jaques de Glane laissa quatre fils; les trois aînés siègent au Conseil de Moudon; comme leur père et leurs aïeux, ils y occupent une place d’honneur 5. Le plus jeune d’entre eux, Claude, vidomne de Moudon et seigneur de Villardin, est aussi le plus connu. Comme son grand-père jadis, il n’hésita pas à se soumettre aux Bernois en janvier 1536; il en fut /440/ récompensé par la charge de bailli de Vaud, comme nous le verrons plus loin 1.
Le rôle des Cerjat n’est pas moins brillant; le syndic Antoine 2 meurt sans laisser d’enfants en 1439 3, mais ses deux frères cadets, Humbert et Guy, parviennent à un âge avancé et à une haute fortune. Destinés à l’origine à l’Eglise, ils y renoncent de bonne heure et rentrent dans le monde où ils se distinguent bientôt 4. Ils étaient fort riches; nous possédons d’eux un rentier de 1443, alors qu’ils étaient encore en indivision : le total des censes qu’ils percevaient à Moudon et dans la vallée de la Broye s’élève à plus de 150 livres en argent, 17 muids de froment, 8 d’avoine, etc. 5; à la même époque nous les voyons acquérir encore 24 liv. et 14 sous de rente 6; et cela est loin de constituer toute leur fortune 7. Ils purent se partager leurs biens sans que leur situation en fût ébranlée.
Ils avaient pour débiteur le duc de Savoie auquel ils avaient prêté 589 liv. pour ses guerres /441/ d’outre-monts 1; ils se firent rembourser par la cession de la coseigneurie de Combremont-le-Petit 2.
Humbert Cerjat possédait encore — nous ne savons comment — des droits seigneuriaux à Denezy 3 et à la Molière 4. C’est un homme qu’il vaudrait la peine de connaître mieux 5, car sa carrière politique ne fut pas moins brillante que sa fortune.
Humbert Cerjat était par droit héréditaire métral de Moudon 6, ce qui mettait entre ses mains une part de la justice inférieure dans cette ville 7; il la faisait, du reste, exercer par un lieutenant 8. De 1450 à 1452 au moins, et en février 1459, il fut châtelain de Moudon 9, ce qui lui donnait le droit de présider la cour de justice supérieure en l’absence du bailli de Vaud. C’est lui qui, en 1444, avait été délégué auprès du duc Louis pour requérir la confirmation des franchises de Moudon 10; c’est lui encore qui, en 1456, revendiqua les privilèges du Pays de Vaud en présence des commissaires /442/ français, dans cette séance solennelle qui eut lieu à Moudon et dont j’ai parlé plus haut 1.
Dès que le pays eut passé entre les mains du comte de Romont, il fut un de ses principaux conseillers 2; il mit à son service, puis à celui de la duchesse ses talents diplomatiques; il fut à maintes reprises leur ambassadeur auprès des Bernois ou des Fribourgeois 3. Nous avons vu ailleurs le rôle qu’il joua lors des guerres de Bourgogne 4. Est-ce à ce moment qu’il fut bailli de Vaud ? Il ne semble pas 5. C’est lui, en tous cas, qui présida à la mise en état de défense de la ville de Moudon et fut, jusqu’au dernier jour, le champion de la Savoie. Lorsque la partie parut perdue, il ne l’abandonna pas. Avec fermeté, mais sans bravade inutile, il demanda, à la séance des Etats à Fribourg, la confirmation des franchises du pays et le respect des droits de la duchesse et de son /443/ fils 1. Malgré les égards que les vainqueurs semblent lui avoir témoignés, il fut un des premiers à se compromettre lorsque l’approche du comte de Romont parut présager des jours meilleurs pour la maison de Savoie. Nous savons mal ce qu’il fit pendant les six premiers mois de l’année 1476; en juillet, il représentait de nouveau les Etats de Vaud au congrès de Fribourg 2. Dix-huit mois plus tard, il était un des plénipotentiaires chargés par la régente de prendre possession du pays que les Confédérés lui restituaient 3. Il fut le plus illustre des Vaudois de son temps.
Chargé d’ans et de jours, il testa le 27 août 1487 4; entre autres legs pies, il fondait quatre messes dans l’église de Notre Dame 5, où il fut sans doute enterré; sa veuve, qui lui survécut assez longtemps 6, gardait l’usufruit de ses biens; son héritier universel était son neveu Louis, fils de son frère Guy, qui l’avait précédé dans la tombe.
Louis Cerjat était déjà un homme à cette époque; il avait représenté les Etats de Vaud lors de la remise /444/ du pays aux représentants de la duchesse 1; comme syndic de Moudon, il prête serment de fidélité au duc Charles 2; il fait également partie de la délégation qui, en avril 1498, va à Genève requérir du nouveau duc Philibert II la confirmation des franchises du Pays de Vaud 3. Sans occuper une place aussi grande que son oncle, il était un personnage important; il habitait à Moudon, dans la rue du Château, une maison qui se trouvait sur l’emplacement de ce qu’on appelle aujourd’hui le château de Rochefort 4. Il était mort en 1508 5. Sa veuve, Jeanne d’Estavayer, lui survécut cinq ans; le dimanche 24 juillet 1513, à 4 heures du matin, elle testait, in articulo mortis; elle élisait sépulture dans l’église de Notre Dame, devant l’autel de saint Georges et de la sainte Croix, près de son mari; elle laissait au clergé de Moudon une cense d’un muids de froment, rachetable pour 100 florins 6, afin qu’il célébrât chaque année l’anniversaire de sa mort avec une grande messe de Requiem; on devait à cette occasion placer sur sa tombe un catafalque avec des cierges; sa bonne robe de velours était destinée à être transformée en chasuble 7, tandis que sa robe de camelot devait revenir à celle de ses quatre filles qui se marierait la première; celles-ci se partageraient /445/ également ses autres vêtements et joyaux; ses héritiers devaient consacrer à ses funérailles les sommes en numéraire qu’elle avait mises de côté dans ce but : 38 écus d’or au soleil, un écu d’or du roi, 9 florins d’or d’Allemagne, un écu d’or à l’aigle, 3 ducats d’or, un Alphonse d’or, 8 pièces de Gênes, 37 testons d’argent et 20 florins en monnaie 1.
Il est difficile d’évaluer ces pièces dont nous ne connaissons pas toujours le cours; leur valeur totale n’est pas loin d’atteindre 10 000 fr. de notre monnaie. Mais n’est-il pas curieux de voir cette vieille dame collectionnant dans sa maison de Moudon les pièces d’or en vue de ses funérailles et constituant ainsi un trésor en numéraire, comme on en trouverait peu à notre époque ?
Son fils aîné, Noble Pierre Cerjat, écuyer 2, seigneur de Combremont-le-Petit et de Syens, sans jouer un rôle aussi en vue que son père et son grand-oncle, est un des conseillers de Moudon les plus considérés; il fut de l’ambassade qui, le 25 janvier 1536, alla remettre aux officiers bernois la capitulation de la ville 3. Son cousin éloigné, Noble Jaques Cerjat, seigneur de Denezy, n’était pas un personnage moins important; il était châtelain de Moudon à la veille de la conquête bernoise 4. /446/
*
* *
A la fin du XIVe siècle, on voit arriver à Moudon une famille qui désormais y tiendra une grande place, celle des Estavayer. Le premier qui y vint, Jean, coseigneur d’Estavayer 1, n’était pas un étranger dans cette ville : d’une branche de la famille de Vulliens il avait hérité une partie de la seigneurie de Mézières et une maison à Moudon; par son testament, Humbert Cerjat lui en avait légué une autre, dans le quartier du Château 2.
En 1477, jeune écuyer, il était encore à l’étranger et se préparait à sa carrière future par un séjour à la cour de quelque prince 3. Dès 1489, il devenait bailli de Vaud; il devait le rester pendant 24 ans 4. Bien en cour à Chambéry 5, chargé de mainte mission /447/ diplomatique 1, Jean d’Estavayer, quand il n’est pas en voyage, réside à Moudon, ce que n’avait fait presque aucun de ses prédécesseurs. Comme le château ducal n’existe plus, il habite sa propre maison; c’est chez lui que se passent des actes importants 2; c’est dans sa grande salle que se réunissent les Etats de Vaud le 5 février 1495 3.
Sa longue présence à Moudon, en un temps où la monarchie savoyarde s’affaiblissait, a contribué à faire de cette ville le centre des affaires administratives, judiciaires et même politiques du pays et à lui donner un petit air de capitale 4.
Jean d’Estavayer s’acclimata bien à Moudon 5; il y installa ses neveux — il n’avait pas d’enfants —; l’un, Jaques, fut curé de la ville 6; sa nièce Jeanne épousa Louis Cerjat 7; Philippe, coseigneur /448/ d’Estavayer, seigneur de Bussy, hérita de ses biens et, à son tour, résida à Moudon 1.
Jean d’Estavayer eut pour successeur comme bailli de Vaud un grand seigneur savoyard, Pierre de Beaufort 2, qui n’avait aucune attache avec notre pays. Il ne séjourna que rarement à Moudon 3, où il était représenté par des châtelains, étrangers eux aussi à cette ville 4, et dont le dernier suscita les plaintes des habitants 5.
Le 5 mai 1526, Pierre de Beaufort mourut, assez subitement, semble-t-il 6; la nouvelle en parvint à Moudon entre le 14 et le 20 mai. Aussitôt le Conseil convoqua les Etats; ceux-ci, où les trois ordres étaient représentés, insistèrent pour que le nouveau bailli fût pris dans le pays 7. La chose n’alla pas sans difficultés : Antoine de Beaufort, le capitaine de Chillon, frère du défunt, qui expédiait les affaires courantes, comptait bien lui succéder; il avait un fort parti à /449/ la cour; il reçut même du duc ses lettres de nomination. Mais Marguerite d’Autriche, qui avait son mot à dire, puisque le bailli de Vaud était son receveur, et qui avait eu peine à admettre Pierre de Beaufort 1, désigna, le 6 juin déjà, Aymon de Genève-Lullin, qui entra en fonctions à la fin de l’été, quoique le conseil ducal, siégeant à Bourg en Bresse, ne dût reconnaître cette nomination que le 27 août 1528 2.
Lorsque Aymon de Genève vint à Moudon, le 2 septembre 1526 et prêta, à Notre-Dame, le serment accoutumé, il fut bien accueilli 3. Il était loin d’y être un inconnu. Son grand-père, Guillaume de Genève, fils de Guillemette de Fernex 4, avait possédé la seigneurie de Vulliens et des maisons à Moudon où il habitait à l’occasion 5; il avait été plusieurs fois bailli de Vaud 6. Son père, Jean de Genève-Lullin, l’avait été à son tour; on se rappelle que c’est lui que les Moudonnois avaient choisi pour défendre leur ville en 1475 7. /450/
Aymon de Genève était un grand seigneur; chevalier de l’Annonciade et homme de confiance de Charles III, il était en même temps propriétaire à Moudon où l’appelaient souvent et ses affaires de famille et les voyages qu’il faisait au service du prince. Quand il y passait, ou qu’il séjournait dans sa terre de Vulliens, le Conseil lui offrait volontiers une réception 1. Aucune nomination ne pouvait satisfaire davantage les habitants de la ville. Pendant les dix dernières années du régime savoyard, il fut, à Moudon, la personnalité la plus marquante; il y résidait souvent; il y présidait la cour en personne 2, ce qui ne s’était pas vu depuis longtemps; il ne dédaignait pas de s’asseoir à la table des bourgeois, les jours de fête 3, et d’y amener sa femme, Marie de Duin, quelque grande dame qu’elle fût. Elle était aussi populaire à Moudon que son mari et, lorsqu’elle mourut, à la fin de juillet 1532, deux conseillers se rendirent à Thonon pour ses funérailles 4.
La présence d’Aymon de Lullin à Moudon fit de cette ville le centre de bien des négociations diplomatiques 5, car il fut l’agent ordinaire du duc auprès /451/ des Bernois; ceux-ci l’ont même accusé d’avoir été le principal artisan de la rupture 1.
*
* *
Un peu plus bas dans l’échelle sociale, on voit des hommes nouveaux qui cherchent à s’élever comme l’ont fait au siècle précédent les Glane et les Cerjat. Ce sont des notaires auxquels la pratique de leur art et la connaissance des affaires ont donné une certaine aisance; ils achètent des terres et des droits seigneuriaux; ils remplissent des offices qui, un jour ou l’autre, les font entrer dans la noblesse par la grande ou par la petite porte; aucune barrière infranchissable ne sépare les bourgeois qui sont simplement qualifiés d’honorables de ceux qui portent le prédicat de nobles ou le titre de donzel 2.
Cette ascension ne réussit pas également à tous. Malgré leur titre, les Chartreir, dont nous avons parlé plus haut, s’éteignent dans l’obscurité, avant la fin du XVe siècle 3. Pierre Vionnet, fils de Rodolphe, quoique qualifié de noble lui aussi 4, est dans une /452/ situation financière peu brillante 1; le dernier des membres de sa famille, Humbert, est moine à Payerne et abandonne à la commune de Moudon le reste de ses biens 2.
Les Valacrêt 3 paraissent plus heureux au début. Jaques, fils de Jean, fait des affaires : il prend à ferme la dîme de Forel, appartenant au curé de Curtilles; il se fait aberger les moulins de l’hôpital à Moudon; il est gros propriétaire dans la châtellenie de Lucens; mais les documents ne lui donnent que le prédicat d’honorable 4. En 1481 cependant, il est qualifié de noble 5. A cette date pourtant, ses affaires vont mal : sous le coup de poursuites, il doit vendre ses moulins de Moudon 6. L’année suivante, Noble Jaques de Valacrêt, qui devait être un vieillard, tua d’un coup de serpe, en pleine rue de Moudon, un homme de Lucens; il réussit à s’enfuir et échappa à tout châtiment 7, mais nous perdons ses traces. /453/ Ce forfait, ou ce malheur, n’améliora pas la situation de sa famille; ses fils conservent leur titre de donzels; l’un d’eux, qui s’appelait Jaques comme son père, fut syndic de Moudon et délégué aux Etats 1; mais nous les voyons peu à peu liquider leurs biens 2. Le sort semble s’acharner sur cette famille; son dernier représentant, qui s’appelle également Jaques, vient habiter Lausanne, où il se fait encore poursuivre pour dettes 3.
Mais tous n’ont pas une histoire aussi tragique : Ainsi Claude de la Cour, un riche notaire, qui devient noble en 1461 déjà, nous ne savons comment 4; ses fils, qui possèdent des fiefs nobles dans la banlieue, se sont installés au Château dans la maison des Bonvillars et jouent un rôle en vue dans les affaires moudonnoises pendant près d’un demi-siècle 5. Ainsi encore les Mallé. Jaquet Mallé achète des terres, des dîmes, des droits seigneuriaux à Chavannes, à Neyruz, à Seigneux, à Ursy, etc., et devient seigneur de Chapelle s/Gillarens, Châtonnaye et Villariaz, dans le canton /454/ actuel de Fribourg 1. Quoiqu’il ait fondé deux autels dans l’église St-Etienne 2, il laisse en mourant une belle fortune à sa fille unique; elle a épousé le notaire Pierre Espaz qui latinise son nom et se fait appeler Ensis, l’épée 3. Ses descendants acquièrent par là à la fois richesse et noblesse; ils s’allient aux plus nobles familles du pays; ils n’en continuent pas moins à habiter Moudon et à siéger dans le Conseil de la ville.
De ces notaires, celui qui paraît avoir amassé le plus d’argent, c’est Jaquet Coquerel. Fils d’un bourgeois déjà aisé, il instrumente durant toute la première moitié du XVe siècle, tout en tenant auberge; il jouit de la confiance de ses concitoyens qui lui confient toutes les fonctions que l’on peut remplir dans leur ville; et il s’enrichit; il aimait, semble-t-il, à acheter des créances d’une rentrée difficile; il poursuivait impitoyablement les débiteurs et réussissait à se faire payer; après quoi, il acquérait de bonnes terres au soleil. Il mourut sans enfants et légua à l’hôpital une fortune considérable 4. /455/
C’est aussi le notariat qui amena de Combremont-le-Petit, vers le milieu du siècle, le premier Bridel, du prénom d’Antoine, ancêtre d’une famille qui devait donner à Moudon des notaires et des magistrats et au Pays de Vaud tout entier tant d’hommes distingués 1. D’autres de ces notaires fondent de véritables dynasties où les fils succèdent aux pères pendant plusieurs générations; il serait oiseux de les mentionner tous.
Ce qui nous frappe davantage, c’est leur nombre, qui semble dépasser les besoins d’une si petite ville. Il faut croire que les services de ces hommes de plume et de loi étaient indispensables en un temps où la plupart des gens ne savaient pas écrire et où la coutume, qui tenait lieu de code civil, offrait de multiples occasions à la chicane. Il faut ajouter qu’ils fonctionnaient comme juges dans les seigneuries d’alentour 2.
*
* *
Après le notariat, la profession qui compte le plus de représentants est celle des aubergistes; ils sont bien une quinzaine 3, encore qu’il soit difficile de distinguer ceux qui se contentent de vendre vin de ceux /456/ qui tiennent logis à pied et à cheval; c’est souvent, du reste, autrefois comme aujourd’hui, l’occupation secondaire d’un homme qui pratique déjà un autre métier : les membres du Conseil ou les gens de la petite noblesse locale ne le dédaignent pas 1, non plus que les ecclésiastiques 2.
On rencontre quelques tisserands, mais leur nombre ne paraît pas dépasser les nécessités d’un petit bourg, entouré d’une large banlieue agricole; le métier n’est pas déconsidéré; il demande une sérieuse préparation; l’apprenti doit travailler trois ans auprès du patron qui l’instruit et doit lui tisser quatre pièces de toile et deux de drap; le reste de son travail sera partagé par moitié entre eux deux; le patron doit à son apprenti la soupe seulement; celui-ci doit se procurer le pain et le fromage qui composent ses modestes repas; les chandelles se payent par moitié et le patron donne à son apprenti une paire de souliers par an 3.
Les plus entreprenants ou les plus riches de ces tisserands vendent le produit de leur art et deviennent « marchands », c’est-à-dire négociants en étoffes, et semblent par là acquérir une situation meilleure 4. /457/
Tailleurs, couturiers et chapeliers travaillent à l’habillement des bourgeois. Les cordonniers, parce qu’ils travaillent le cuir, qui est une denrée coûteuse, occupent dans l’échelle sociale une position supérieure 1. Ils sont les seuls à former une confrérie professionnelle, sous le patronage de saint Crépin, comme il convient, et de saint Crépinien. Elle se compose de 24 membres avec deux recteurs à leur tête; de ses statuts nous ne connaissons, malheureusement, que les articles ajoutés en 1525 : pour chaque ouvrier travaillant chez lui, le maître s’engage à payer à la confrérie un denier (environ 25 centimes) par semaine; si le maître s’en va, hors de ville, faire des souliers avec le cuir d’autrui, il paiera une obole (environ 12 ct.) par paire; chaque nouveau maître qui s’installera paiera 24 s. (72 fr.) et un dîner, à moins qu’il ne soit fils d’un cordonnier déjà établi; cet argent servira à dire des messes pour le repos de l’âme des confrères défunts 2. Visiblement, la confrérie tend à devenir une corporation. L’apprentissage est, là aussi, de trois ans; l’apprenti paie au patron une somme /458/ d’argent, ce qui indique que la profession est avantageuse 1.
Il y a une ou deux tanneries 2 et un particulier pratique le métier de peaucier 3.
Moudon a un apothicaire 4 et, tout au moins à la fin du XVe siècle, un médecin; il était assez célèbre pour qu’on vînt le consulter de Fribourg 5 et, lorsqu’il mourut, il laissa sa fortune au clergé 6; il semble n’avoir pas eu de famille; peut-être était-ce un étranger, de ces demi-savants errant par le monde, comme il y en avait alors.
Il y a une sage-femme, « la dignan Criblettaz »,7 et un bourreau, maître Jaques Vaudran (ou Baudran)8.
Au début de la période qui nous occupe, il n’y avait que deux bouchers 9; il n’y en eut plus qu’un dès 1444 10; à partir de 1480, ils sont de nouveau /459/ deux et ce chiffre se maintient pendant une quarantaine d’années 1. Il semble que les bouchers de Moudon aient abusé de cette sorte de monopole qu’ils possédaient et qu’ils se transmettaient de père en fils. Quoiqu’il y ait quatre boucheries en 1531, on se plaint beaucoup de la façon dont elles sont tenues et le Conseil met les bouchers à l’amende 2. A partir de ce moment, et pour exercer un meilleur contrôle sur cette profession, la ville donne à ferme l’exploitation des « bancs », soit étals, qu’elle possède, ce qui, du reste, n’empêche pas les abus 3.
En 1434 et les années suivantes, il n’y avait que 6 boulangeries 4. Il faut croire que ce chiffre parut trop bas aux magistrats qui, à Chambéry, formaient la Chambre des Comptes; en 1439, ils enjoignirent au bailli de Vaud de désigner nominativement les personnes qui tenaient boulangerie à Moudon 5. Ainsi fut fait dès 1440 et, aussitôt, le chiffre monta à 8, puis à 11 et même 12, pour redescendre, il est vrai, à 6 en 1463; il y en a régulièrement 14 dès 1480, mais en 1514 on retombe à 6. En 1520, il y a un pâtissier 6. /460/
Les listes de noms que nous donnent les comptes 1 présentent quelque intérêt : elles ne contiennent que des noms de femmes. La charte de Moudon, déjà parlait de boulangères 2. Comme les fours appartiennent au seigneur, le métier de boulanger consiste essentiellement à pétrir et à vendre; les boulangeries ne sont, au fond, que des débits de pain et il est tout naturel qu’ils soient tenus par des femmes.
Celles-ci ne sont pas les premières venues; ce sont les épouses de bons bourgeois, de l’apothicaire Pierre Quoquard, de Pierre Chappuis le maître charpentier, de Pétremand Burichet le notaire. Simplicité des mœurs de ce temps : tout le monde travaillait; cela nous explique pourquoi les bourgeois faisaient fortune.
Dans ce que nous appellerions aujourd’hui l’industrie du bâtiment, nous trouvons des forgerons, des maçons, mais surtout des charpentiers, la plupart des maisons étant en bois. Notons enfin que l’on appelle agricolae, paysans, les simples manœuvres 3; c’était à la campagne que se trouvait la main-d’œuvre ordinaire, le prolétariat, si l’on peut employer ce terme; en ville, il n’y avait que des artisans. /461/
*
* *
D’où viennent ces habitants de Moudon ? La plupart sont des descendants de gens déjà établis dans la ville, mais d’autres, en assez grand nombre, arrivent du dehors et comblent les vides que creusent les familles qui s’éloignent ou qui s’éteignent. Généralement ces nouveaux-venus se recrutent dans les villages avoisinants; ainsi les Bridel, que nous avons vus venir de Combremont 1; d’autres viennent de Démoret ou de Treytorrens, de Villars-le-Comte ou de Martherenges, de Brenles 2 ou de Bussy 3. Et de plus loin encore : un Pierre Philippon est originaire de Rivaz « près de Glérolles 4 »; la famille noble de St-Germain est de Gruyères 5; un autre personnage est Bourguignon, ce qui veut dire Franc-Comtois.
Enfin, il y a des Savoyards : tel le notaire Jean Luysii, un gros personnage, qui est de Chamonix 6; le dernier bailli de Vaud, Aymon de Genève-Lullin amena avec lui plusieurs familles de son pays, dont les Chatelanat 7. Signalons, pour terminer, un domestique qui s’appelle Georges Allemand; c’est très probablement un Confédéré 8. /462/
Il est vrai que l’on ne peut, comme par le passé, du nom d’un individu, conclure avec certitude à l’origine de celui-ci. Le nom de famille, en effet, s’est constitué. Parfois l’on hésite encore entre deux surnoms : Charmet alias Jayet, Favre alias de la Mérine, Fraschat alias Chatelan, Veyre alias Derussel (Durussel), etc. Parfois on trouve encore des noms qui ne sont autre chose que le prénom du père ou du grand-père mis au génitif : Meystre (Magistri = fils du maître) ou Roberti (= fils de Robert). Mais, dans la majorité des cas, nous avons affaire à de vrais noms de famille, héréditaires; plus d’un, qui date déjà de la fin du XVe siècle, subsiste encore aujourd’hui 1.
*
* *
Quelle était la fortune de ces gens de Moudon ? Un des seuls documents qui nous renseignent est le compte communal de 1474/5 : il nous donne la liste du « giète » ou impôt extraordinaire établi le 9 décembre 1475 « à cause du passage des Allemands lorsqu’ils conquirent le Pays de Vaud » 2. La ville compte alors 191 feux, il y a 152 contribuables, donc 39 familles trop pauvres pour payer l’impôt minimum qui est de 2 sous (10 fr.); trois contribuables seulement rentrent dans la catégorie inférieure; cinq paient 3 s.; sept 5 s., et ainsi de suite; cinq paient 4 livres, quatre 5 livres, cinq 6 livres, trois 7 livres; Pierre d’Estavayer paie 8 livres, Louis Cerjat et Claude de la Cour chacun 9, Rod. Asinier 10, /463/ Humbert Cerjat 12 et Humbert de Glane 13. Comme le taux n’est pas indiqué, nous ne pouvons savoir quelle était la fortune de chacun. Elle semble très inférieure à celle des Fribourgeois 1. Il vaut la peine de remarquer que, grâce à leurs domaines féodaux, ce sont encore les nobles qui occupent le premier rang; les autres habitants se succèdent assez régulièrement le long de l’échelle des imposables 2. En 1501, quand il s’agit de payer au duc le tiers d’un subside 3, la situation est un peu différente : Louis Cerjat et la dame de Villardin paient 40 s. chacun, Guil. Ensis 30, Jaques Cerjat 24, P. de St-Germain 18, Jaques Valacrêt 9; tous sont nobles; parmi les bourgeois, Jaques de Bulo paie 36 s., Etienne Cornaz 34, Claude Clavoz 28, Louis de Martherenges 24, Rod. Demierre 22, Jean Saly 20, Claude Porchet l’aîné, Guil. Cavin et Pierre de la Cour 18; avec plusieurs autres, Michel Frossard paie 16 s., Jean Crespy et Boniface Bridel 12, etc. Le dernier contribuable verse 9 deniers 4.
Nous ne connaissons aucun inventaire successoral qui puisse nous renseigner mieux; mais voici les chiffres de quelques dots : la fille d’un paysan de Bussy qui épouse un bourgeois de Moudon lui apporte 12 livres (1200 fr.) 5, la dot de Louise Monachon, de Martherenges, femme d’Etienne Fraschat, est de /464/ 36 livres (2100 fr.) 1; une somme à peu près équivalente suffit pour établir une jeune Fribourgeoise qui avait été en service chez les nobles de la Cour 2; une modeste bourgeoise de Moudon n’a que 24 livres (2400 francs) 3; un tailleur, qui épouse la fille d’un cordonnier de Romont, reçoit une dot de 30 livres, qui, à cette époque, valent quelque trois mille francs 4. La mère du notaire Jean Crespy, qui était de Lucens, avait eu une dot de 40 livres (4000 fr.) 5; un maréchal ferrant de Moudon, fils lui-même d’un maréchal, épouse une fille de Bercher avec une dot de 200 florins (12 000 fr.) 6; la fille d’un cordonnier de Moudon, mariée à Romont, cède à son frère sa part de l’héritage paternel pour une somme de 450 florins, plus 30 florins pour ses vêtements de noce (15 000 fr.) 7; Noble Pierre de la Cour prend femme à Genève; son épouse a une dot de 300 florins (15 000 fr.) 8; le vidomne Humbert Provana assure par testament à sa fille une dot de 300 fl. (18 000 fr.) plus ses vêtements 9; un gros notaire, François de Bulo, fils d’un forgeron de Moudon originaire de Villars-le-Comte, reconnaît à sa femme un apport de 1000 florins (36 000 fr.) 10; Jean de Glane, le frère d’Humbert, /465/ avait épousé une fille du seigneur de Bioley, un Gumoens; elle lui apporte une dot de 11 000 fl. (66 000 fr.); peu d’années après, il teste en faveur de son frère, sous réserve d’une dot de 1000 écus (120 000 fr.) en faveur de sa fille unique 1; plus tard, lorsque Claude de Glane épousa Anne Crostel, la fille d’un bourgeois de Lutry, celle-ci avait une dot de 1000 fl. (env. 40 000 fr.) 2; la seconde femme de Jaquet Coquerel lui avait apporté 2000 livres, soit près de 200 000 fr. 3; c’est le chiffre le plus fort que nous ayons trouvé. Notons que l’époux reconnaît généralement à sa femme un « augment de dot » de la moitié de ses apports.
Les mêmes documents nous donnent quelques détails sur les trousseaux des mariées : la jeune fille de Bussy, dont nous parlions tout à l’heure, a trois habits, comme Cadet Roussel, un de drap de couleur, un second de drap gris à carreaux, un troisième de drap blanc à carreaux 4; Louise Monachon a quatre vêtements de drap; une autre fille, mieux dotée, reçoit de son père deux « habits dits houppelandes de drap de chambre » et deux autres « dits robettes », ainsi qu’un trousseau « à dit d’experts » 5. Ailleurs nous voyons deux sœurs épouser deux frères; outre leurs vêtements de noce, elles apportent avec elles 15 draps, un lit complet, une pièce de nappes, /466/ une demi-pièce de serviettes et huit chemises chacune 1; la fille d’Ant. Bridel, Aude, femme du notaire Nicati, laisse à chacune de ses filles, pour son trousseau, 50 florins (2500 fr.) 2. François de Bulo, qui est riche, lègue à sa femme, outre la jouissance de toute sa fortune, la meilleure de ses coupes d’argent, un bon lit complet avec coître, oreiller, couverture, six draps, une couverture de serge avec figures, un ciel de lit de toile avec ses pendants et ses franges et deux draps autour, trois pièces de toile fine qu’elle a filée elle-même, une arche de sapin ferrée pour ses petits objets; pour porter son deuil, il charge ses héritiers de lui remettre sitôt après son décès un bon manteau, un habit, une jupe et un capuchon; le tout sera en bon drap noir de Dijon, valant au moins quatre florins et demi l’aune (plus de 150 fr.); enfin il lui lègue son petit cheval gris avec selle et train 3. Cela est bien modeste encore et pourtant il y a une pièce d’argenterie, ce qui est rare 4.
Jusqu’en 1512, Etienne Cornaz, le marchand de drap 5, avait vécu en indivision avec son fils Jaques, dont nous aurons à reparler 6. Le père était âgé et menacé d’infirmités; le fils en profitait; il lui disait /467/ des injures et ne lui donnait pas de quoi vivre; ce premier réclama le partage de l’indivision, qui lui fut accordé par des experts 1. Cet acte nous renseigne sur l’état des biens d’une maison cossue à Moudon au début du XVIe siècle. Jaques Cornaz, après avoir demandé pardon à son père, comme il se doit, et payé les frais du procès, lui abandonne des revenus fonciers en argent et en blé, des vignes à Lutry, un pré, une chenevière et un clos à Moudon; il lui laisse une tasse d’argent, 100 florins d’or en monnaie (5000 francs), deux lits complets; de la vaisselle d’étain : deux pots, deux plats, deux écuelles, deux dites à oreilles, deux gobelets; deux pots de métal, une poêle, une poêle à frire; les livres qui contiennent les créances à lui dues; deux porcs gras (on est en novembre), du blé et du vin; une arche ferrée; un costume suivant son état, etc., etc.
On le voit : lits mis à part, le mobilier proprement dit existe à peine chez ces bourgeois aisés; ils ne sont guère plus riches en vaisselle et en batterie de cuisine. D’autre part, cet inventaire porte un cachet rural qu’on ne trouverait plus aujourd’hui dans une de nos villes modernes. C’est qu’il n’y a pas alors de commerce de denrées alimentaires : si l’on veut être assuré d’avoir du lait ou des fruits, des œufs et de la charcuterie, il faut être producteur soi-même; chaque maison a son étable et sa basse-cour 2. /468/
Aussi la ville de Moudon avait-elle un aspect très villageois : les cochons « divaguaient » dans les rues, ainsi que le bétail et la volaille 1, ce que l’autorité cherchait à réprimer par des mesures de police et des amendes, celles-ci étant plus élevées quand il s’agit du gros bétail « à cause de sa très grande facilité à fuir 2 ». Lorsque la saison permettait le pâturage, des gardiens, désignés par le Conseil, rassemblaient chaque matin l’un les vaches, un autre les chèvres, un troisième les porcs et les menaient paître sur les pâquis communs; il était défendu de faire troupeau à part, sauf pour les moutons, par nature plus dociles.
Dès qu’ils étaient arrivés à quelque aisance, les bourgeois achetaient des redevances en blé, ou mieux encore des domaines, qu’ils donnaient à ferme à mi-fruit ou à tiers-fruit 3; ils recevaient ainsi en nature la moitié ou le tiers des produits du sol. Par là, ils ne s’assuraient pas seulement le pain de chaque jour. Le blé qu’ils entassaient dans leurs greniers était, pour beaucoup, l’objet d’une spéculation. Le prix des céréales variait avec la récolte; il pouvait passer du simple au quadruple en quelques mois; celui qui avait des réserves pouvait faire de très bonnes affaires dans les années de disette. Nous ne pouvons pas douter que plus d’un bourgeois de Moudon n’ait /469/ pratiqué cette forme primitive du jeu en Bourse. Ils confient du bétail à des paysans 1, ce qui est une façon de masquer le prêt à intérêts, condamné par l’Eglise.
Ils achetaient aussi des vignes, presque toujours à Lutry; leurs contrats de vignolage, leurs différends avec leurs vignerons, les préoccupations de la vendange, le prix de leur vin ont laissé d’abondantes traces dans les documents de cette époque.
Les maisons aussi donnent à Moudon l’aspect d’un grand village; elles sont en bois pour la plupart 2 et ne contiennent que quelques pièces; le plus souvent il n’y a, à côté de la cuisine, qu’une seule chambre; quand il y en a plus d’une, une seule est chauffable; les enfants se partagent encore ces modestes demeures si bien que certains d’entre eux n’ont plus qu’une cave et une pièce avec des corridors communs, le tout sous le même toit 3, ce qui devait être une source d’éternelles chicanes.
Malgré les interdictions répétées, les caves sont transformées en étables, et même en « buatons » 4. Il y a des latrines 5; notre climat l’exige; mais elles sont insuffisantes, si bien que les gens jettent sur les /470/ toits et dans les cours des voisins leurs « immondices » et la rue sert d’égout 1.
Les risques d’incendie sont, peut-être, plus graves encore que la saleté. Aux maisons d’habitation, couvertes de bardeaux, sont adossées des granges et des écuries; les provisions de paille, de foin et de bois sont un aliment tout préparé pour le feu. Et, sur le devant des maisons, on met rouir le chanvre; lorsque les fibres sont préparées, on commet l’imprudence de brûler les détritus dans la rue même 2.
Aussi, malgré toutes les précautions 3, les incendies n’étaient-ils pas rares. Nous en connaissons deux au moins. L’un éclata le mercredi 27 juin 1459 au matin; le feu s’attaqua aux deux rangées des maisons de la rue du Château, de l’église Notre-Dame jusqu’au pont-levis du château ducal, dont la porte d’entrée fut brûlée, ainsi que la salle d’audience de la Cour. Hommes et femmes à force de seaux d’eau réussirent à l’éteindre 4, mais le mal avait été grand, car, de Fribourg, et même de Berne, une députation vint offrir des condoléances et de l’aide 5. Les bourgeois d’Yverdon avaient fait de même 6. /471/
Le lendemain de l’accident, comme toujours, on prit des mesures : le syndic de Moudon visita les cheminées, pour voir si elles étaient en bon état, et les galetas, pour s’assurer qu’il n’y avait là ni paille ni fascines, qui pussent provoquer un nouveau malheur 1.
Le jeudi 26 juin 1516, à 11 heures du soir, le feu consuma 57 maisons à la rue Grenade, y compris la maison de Claude de Glane 2 et la porte de Lucens qui y était attenante. Ce fut un désastre et les villes voisines crurent devoir subvenir aux misères qu’il avait provoquées en donnant, Fribourg 100 fl. (5000 fr.), Yverdon et Romont 30 chacune 3.
*
* *
Les terriers et les rentiers assez nombreux, que nous avons conservés de cette époque nous permettent de nous rendre mieux compte de la topographie de la ville et de la répartition de la population entre ses divers quartiers.
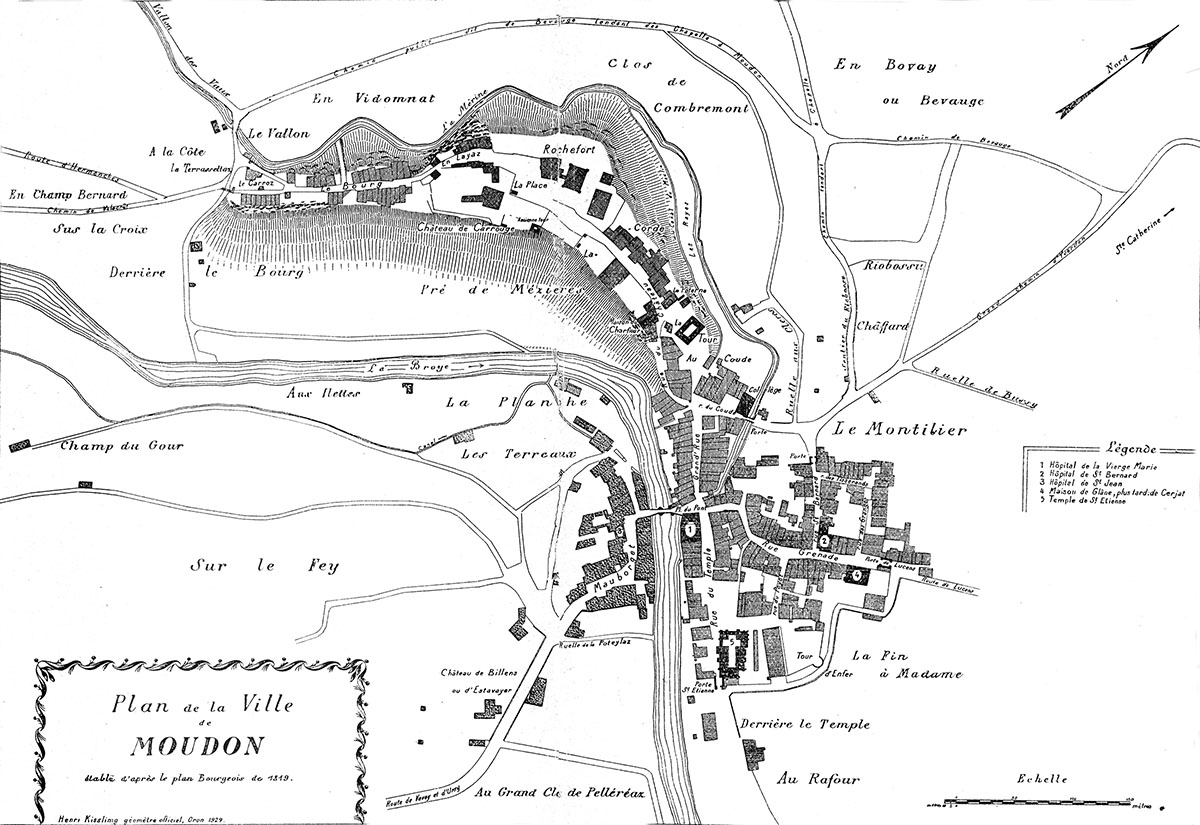
Pl. VI : Plan de la ville de Moudon
Cliquez 2X sur l’image pour une vue agrandie
Moudon a peu changé depuis le milieu du XIVe siècle 4. C’est toujours par Valacrêt et la Croix que la route de Lausanne aborde la ville 5. On y entre /472/ par une porte, que l’on refait en 1517; le toit en était couvert de tuiles; il était orné de girouettes de fer, portant des « pennons d’armes » aux couleurs de Savoie 1. Au Vieux-Bourg, quelques maisons ont été réunies en une; en Laya, la ville ayant hérité de quelques autres sous les murs du château de Jean de Blonay (aujourd’hui l’Institut des sourds-muets), elle les a transformées en une place 2.

Pl. X : Vieilles maisons savoyardes de la rue du Château. Vue prise des bords de la Broye. La troisième maison à partir de la gauche est celle dont la façade est reproduite ci-contre.
Ce quartier continue à être habité par des gens modestes; l’aristocratie demeure toujours à la rue du Château; c’est là qu’on trouve les Cerjat, les St-Germain, les de la Cour ou les Estavayer. Le château proprement dit a disparu 3; il ne subsiste plus qu’un corps de bâtiment, peut-être simplement une placette à ciel ouvert où siège parfois la cour de Moudon 4. Tout près, la maison et la porte du Charfiour — que l’on appelle aussi la porte du Château, — subsistent encore 5.

Pl. XI : Maison savoyarde de la rue du Château. C’est la maison que l’on appelle parfois, par erreur, la maison des Etats. Elle est ornée d’un écu martelé, entouré des lacs d’amour du collier de l’Annonciade. Si cette pierre est encore en place, — ce que nous n’avons pu vérifier — cela indiquerait que cette maison a appartenu à un prince de la maison de Savoie. Or, Amédée VI a possédé dans ce quartier une maison dite : la maison du Charfiour (voir p. 144 n1.)
Plus bas, au pied de la Tour et s’étendant jusqu’à la Mérine et à la porte qui conduit au Montellier, le quartier que l’on appelait autrefois les Borgeaux sous la Tour et auquel on donne maintenant le nom de Vieux-Mazel; des bancs de boucheries y sont toujours 6; il en est de même du four; mais /473/ l’établissement de bains chauds 1 n’existe plus; la ville, qui est devenue propriétaire de cet emplacement, l’a transformé en place et jardin 2; un bâtiment pour l’école a été construit tout auprès 3.
Le mot Borgeau n’est plus compris de la population et les quartiers qui portaient ce nom le perdent peu à peu. La rue qui au XVe siècle s’appelait encore les Plans Borgeaux se nomme au XVIe le Coude 4. C’est là qu’habitent les bons bourgeois, négociants et gens d’affaires : les Cornaz, les notaires Gaulé, Frossard et Moine, les nobles Espaz et Valacrêt; c’est là que se trouvent les boutiques des principaux artisans.
Il nous est moins facile de nous reconnaître dans le quartier du Pont, qui a beaucoup changé depuis ces temps lointains. La Mérine coule encore à ciel ouvert; un pont la franchit; c’est le pont de l’hôpital, ainsi nommé du fait que cette maison charitable était bâtie, en partie, sur ce pont et que la Mérine passait sous un de ses corps de bâtiments — la chapelle 5 — /474/ pour se jeter dans la Broye. Sur le pont, des boutiques occupées par des marchands et les étals de boucherie que la ville y a fait transporter de leur ancien emplacement au Vieux-Mazel 1.
Le pont St-Eloi n’est pas bien loin; c’est encore le seul qui soit en pierre 2, semble-t-il. Bordé de maisons qu’occupent des marchands, le trafic y est important 3. Sur le pont, il y a encore une fontaine; le bassin et la chèvre sont en bois de chêne; celle-ci est surmontée d’une hampe portant un pennon aux armes de Savoie 4.
Au début du XVIe siècle, la rue de la Bâtie prend le nom qu’elle porte encore aujourd’hui; c’est la rue Grenade 5. Là se trouve, entre autres, une des principales auberges de la ville, l’hôtel de l’Ange, que tient Jean l’Archange, sans que nous sachions si c’est l’hôte qui a donné son nom à sa maison ou si ce sont ses concitoyens qui en ont tiré pour lui un surnom 6. /475/
Sur la Broye, au Mauborget et sous le Fey, des scieries, foules et battoirs 1; hors la porte St-Etienne, une tannerie 2. Sur les pentes ensoleillées qui dominent la ville, au Montellier, sur la route de Thierrens, sous Charmet, en Bevouges, des chenevières et des jardins 3; dans les environs, des prés et des vergers.
Placée entre deux cours d’eau, la ville de Moudon n’était pas à l’abri des inondations. Dans la nuit du 25 au 26 juin 1527, à la suite d’un orage, la Mérine grossit démesurément; le pont de l’hôpital, engorgé, ne laissa plus passer les flots déchaînés; ceux-ci se répandirent sur la place et dans les rues voisines qu’ils couvrirent de sable et de gravats; l’eau entraîna bien loin dans la Broye les deux étals de la boucherie. Ce fut l’occasion de les refaire à neuf, en pièces de chêne, avec couvercles en bois montés sur des gonds et fermés par des serrures, en bois également; des catelles étaient placées à l’endroit où l’on suspendait les bœufs au moyen d’un treuil. Cette installation devait ressembler à celle de nos boucheries de village 4.
*
* *
Dans ces villes étroites et sales, avec l’hygiène déplorable de ces temps, les maladies sévissaient.
La lèpre d’abord. Il y avait alors une maladière à Moudon, mais elle n’était pas toujours occupée 5. A partir de 1525, on la nettoya, on y mit une porte, un /476/ fourneau et un lit; entendons : un simple cadre en bois avec une gerbe de paille; on recouvrit le toit de tuiles 1. C’est que, sans doute, il fallait y loger un malade. Précisément à cette date, par son testament, le notaire François de Bulo laissait une rente d’un demi-pot de vin à distribuer chaque dimanche au lépreux ou à la lépreuse de la maladière; il stipulait que, s’il y avait deux ladres, ils auraient un demi-pot chacun, mais que, s’il y en avait trois ou plus, ils n’auraient qu’un pot à se partager 2. Il semblait donc peu probable que ce cas pût se produire. Nous savons qu’au printemps de l’année 1526 un chirurgien fut chargé d’examiner trois femmes et un homme suspects d’être malades 3. Ils ne l’étaient pas tous, car, le 1er novembre de la même année, il n’y avait qu’une femme à la maladière 4; une seconde vint la rejoindre peu après 5; en novembre 1527, il y avait trois malades 6; un frère et une sœur durent être isolés en mars 1528 7. Le 1er novembre 1532, il y avait encore plus d’un lépreux 8. En septembre et en novembre 1534, quelques conseillers assistaient des chirurgiens et médecins étrangers qui les examinaient 9. Les femmes étaient plus fréquemment atteintes que les hommes. /477/
La peste était un mal bien plus dangereux, parce que plus contagieux. Nous sommes loin d’en connaître tous les ravages.
Le 8 juillet 1479, le Conseil de Moudon, présidé par le bailli de Vaud en personne, — c’était alors Humbert Cerjat — allait siéger en plein air, dans la cour de la maison de Claude Gaulé, à cause de l’épidémie; il s’y fait apporter du pain, du vin et du fromage; on donne deux pots de vin à deux hommes qui ont porté en terre un bourgeois mort de la peste; on ne peut trouver d’ouvrier qui consente à travailler aux canalisations de la ville, à cause de l’épidémie : propter mortalitatem 1.
Nous sommes mal renseignés sur celle d’avril 1494 2. Le 28 octobre 1507, nouvelle alerte : le Conseil donnait 12 s. (48 fr.) par mois à une femme pour soigner les pestiférés 3. La saison aidant, le mal s’arrêta bientôt, car le registre des délibérations du Conseil n’en parle plus. En 1519, la maladie reparut, en été cette fois. Le 1er juin, le Conseil chargeait « la pupille », une enfant trouvée élevée à l’hôpital, de soigner les malades moyennant 30 s. par mois (120 fr.); il en donne le double, plus son entretien et un demi-pot de vin, à un homme d’Aoste, qui doit enterrer les morts; un mois plus tard, ces deux personnes sont remplacées /478/ par un ménage qui a un salaire de 60 s. et son logement à l’hôpital 1. L’épidémie dure jusqu’au début de décembre 2.
Celle de 1527-1528 fut beaucoup plus grave; elle dura plus d’un an. Elle commença dans les derniers jours d’août; le Conseil se hâta de désigner un « marron » en la personne de Louis Joseph; on installa un lazaret dans la chapelle de St-Théodule; le 30 août déjà, le marron enterrait, au cimetière des pauvres, deux filles et leur mère qui venaient d’y succomber; à peine avait-il eu le temps de se procurer les outils nécessaires et une charrette pour transporter les cadavres. Au début de septembre, un des prêtres de St-Etienne étant malade 3, le Conseil fait faire une clef pour l’armoire où il a mis ses vêtements ecclésiastiques et l’église est désinfectée avec de la myrrhe. L’école est fermée. Le 5, un pauvre homme meurt; sa femme et le marron l’enterrent après souper; encore faut-il que le Conseil leur offre un repas à l’auberge, parce qu’il n’y avait rien à manger ni à boire dans la maison du défunt.
Le lazaret de St-Théodule paraissant trop éloigné /479/ ou insuffisant, le Conseil décida, le même jour, de faire bâtir une « cambuse » au Pré Bruant, sous un chêne; on y mit de la paille et on l’entoura d’une clôture d’osiers; le 12, la peste continuant à sévir, le prêtre chargé de « gouverner l’horloge » en remet la clef et se réfugie à Lausanne. Le Conseil y fait chercher de la myrrhe pour désinfecter les deux églises de Moudon et, précaution plus utile, il ordonne de nettoyer les rues de la ville; elles étaient, en effet, si fangeuses qu’on avait peine à pénétrer dans l’église St-Etienne 1.
Il y eut encore des décès en automne, et même, le 6 décembre 2, celui d’une femme qui mourut de nuit, sans confession. Mais le froid arrêta la contagion; le prêtre prudent put revenir dès le 14 décembre et reprendre le « gouvernement » de l’horloge; le marron n’eut plus rien à faire ni en décembre 1527 ni en janvier 1528; en février, la mort subite d’une vieille femme réveilla les inquiétudes; le marron fut chargé d’examiner son cadavre; nous ne savons pas comment il se prononça; mais, dès le mois de mars, il y avait de nouveau des pestiférés isolés à Saint-Théodule et l’on donnait congé au prédicateur appelé pour le carême; le marron reprenait son office, à raison de 6 florins (180 fr.) par mois. On fêta comme /480/ de coutume la St-Georges eu avril, la Fête-Dieu et la St-Jean en juin, mais on renonça, le 31 mai, au dîner de la confrérie du Saint-Esprit.
C’est que les gens craignaient fort la contagion; aucun des forgerons de la ville ne voulait réparer la pelle et la pioche du marron qui étaient gâtées, si bien qu’on dut lui en acheter des neuves. Au reste, l’activité de Louis Joseph donnait lieu à des plaintes répétées; c’était un métier que n’acceptaient pas les braves gens; il fut révoqué à la fin de juin et, quelques jours après, chassé de la ville; on lui donna un remplaçant que l’huissier municipal dut assister pour procurer aux pestiférés les vivres qui leur étaient nécessaires et les empêcher ainsi d’entrer en ville. Car la mortalité continuait; en août, le même jour, succombaient le notaire Jean Créaturaz et ce prêtre précisément qui, l’année précédente, avait cru échapper à son sort en quittant Moudon 1.
A la fin d’octobre 1528, la maladie s’arrêta. En décembre, le Conseil mettait à l’amende tous ceux qui, pendant la durée de l’épidémie, avaient contrevenu à ses ordonnances, ceux, par exemple, qui avaient enterré leurs enfants morts sans passer par le marron; il punissait aussi ceux qui allaient chercher de la laine à Fribourg, où, sans doute, la peste sévissait encore 2. /481/
En octobre 1530, on eut de nouvelles inquiétudes 1, mais le 1er novembre 1531, il semblait qu’il n’y avait plus de craintes à avoir; le Conseil général, en confirmant le règlement de police municipal, pouvait supprimer l’article qui interdisait d’aller acheter de la laine en des lieux pestiférés 2. Ce répit ne fut pas long. En février 1532, la ville devait engager de nouveau un marron; en août, un bourgeois considérable étant mort d’une maladie suspecte, le Conseil ordonnait à sa veuve et à ses enfants de s’enfermer chez eux pour six semaines et de n’ouvrir leurs portes et leurs fenêtres que la nuit; il prenait les mêmes mesures à l’égard de six bourgeois, dont un ecclésiastique, qui avaient visité le malade, et à l’égard de tous les autres habitants qui ne se portaient pas bien 3. Nous ne trouvons aucune trace d’autre cas cette année-là; peut-être le défunt n’avait-il pas succombé à la peste; peut-être ces mesures draconiennes avaient-elles fait de l’effet, à supposer qu’elles aient été appliquées, ce qui nous paraît difficile.
Quoi qu’il en soit, l’on n’était jamais tranquille et, le 1er novembre 1535, quand on confirma le règlement /482/ de police, on y réintroduisit l’article interdisant aux marchands d’aller, en temps de peste, acheter du drap, de la laine ou de la mercerie en des lieux pestiférés, sous peine d’amende, confiscation et quarantaine; une autre disposition obligeait les malades, en temps d’épidémie, à un isolement de 40 jours 1.
*
* *
La ville de Moudon était une étape obligée sur la route qui, de Suisse, menait en Savoie, à Genève et en France; aussi y voit-on passer et s’arrêter une foule de personnages de marque. Le Conseil allait les saluer et il leur offrait un verre de vin dans l’auberge où ils étaient descendus; les comptes communaux, abondent en indications de ce genre, car les conseillers ne dédaignaient pas ces occasions d’entrer en rapport avec des étrangers considérables; ils trouvaient là de quoi satisfaire leur curiosité comme leur besoin de sociabilité; de plus, on pouvait parler politique et s’assurer parfois des appuis utiles et des concours diplomatiques efficaces. Ces modestes réceptions jouaient alors un peu le même rôle que les congrès aujourd’hui. Leur nombre est trop grand pour que nous les signalions toutes; nous ne relèverons que quelques cas.
En décembre 1439, lorsque les ambassadeurs du concile se rendirent à Ripaille, ils passèrent à Moudon avant d’aller à Morges s’embarquer pour Thonon; le bailli Jean de Blonay était allé à leur rencontre pour les escorter sur les terres savoyardes 2. L’année /483/ suivante, le duc Louis, se rendant à Bâle au couronnement de son père le pape, passa par Rolle, Morges, Lausanne, Moudon, Payerne et Morat, où le procureur de Vaud lui avait fait préparer vivres et logement 1.
Plus tard, en 1508, nous y trouvons un ambassadeur du pape qui se rend à Berne et que le Conseil fait escorter par l’aubergiste qui l’avait reçu 2. D’autres fois, ce sont ceux, de l’empereur. Lorsque les cantons suisses furent entrés en rapports suivis avec les rois de France, c’est à Moudon que s’arrêtent les fonctionnaires royaux qui vont chez les Confédérés ou reviennent de chez eux 3. Souvent, c’est le comte de Gruyère; les uns après les autres, les chefs de cette famille furent reçus avec des égards particuliers par les bourgeois de Moudon, chaque fois qu’ils venaient dans leur ville, ce qui était fréquent 4.
L’évêque de Lausanne s’y arrêtait quand il allait à Lucens 5; en 1478, Humbert Cerjat recevait chez lui et festoyait l’évêque de Genève, Jean-Louis de /484/ Savoie 1. Plus souvent, on voyait passer de hauts fonctionnaires savoyards, envoyés en mission dans les cantons 2, des seigneurs du Pays de Vaud ou des délégués des villes, venus pour tenir les Etats, pour soutenir un procès devant la cour de Moudon ou pour conférer avec le bailli 3.
C’étaient enfin des magistrats confédérés. Parfois, ils voyageaient pour leurs affaires, ou pour leur plaisir; ils allaient chercher femme en pays romand 4. Plus tard, lors des guerres de Bourgogne, plus encore lorsque les affaires de Genève brouillent Fribourg et surtout Berne avec le duc, ce sont des commissaires, députés auprès de leurs alliés ou des ambassadeurs, envoyés auprès du prince. Leur nombre fut surtout grand dès 1525, depuis que la question des « Eguinots », c’est-à-dire des combourgeoisies avec Lausanne et Genève, fut devenue aiguë 5. Les syndics et les greffiers ont massacré les noms de ces Diesbach 6 ou de ces Mülinen, des Graffenried et des Endlisperg, qui venaient des « Allemagnes », mais ils les ont cordialement reçus chez Thomas Martin ou, plus tard, chez sa veuve Alexie, ou à l’auberge de l’Ange ou encore /485/ chez François Pidoux, à la Croix-Blanche, qui sont les meilleures hôtelleries de la ville. On ne pouvait avoir trop d’égards pour les représentants des très redoutés seigneurs de Berne et de Fribourg.
D’autres passants étaient plus redoutables encore : c’étaient les soldats suisses qui se rendaient au service du roi. Ainsi, en août 1480, on apprit qu’une bande « d’Allemands » allant en France devait traverser la ville 1; les 8 et 9, on envoya à Lausanne et à Lutry chercher du vin qu’on pût leur offrir; on l’amena le 17; quoiqu’on les attendît depuis quelques jours 2, les Suisses n’étaient pas encore là. Ils arrivèrent le 24 ou 25; tandis que deux hommes étaient envoyés jusqu’à Ouchy pour ordonner dans les villages qu’on leur préparât des vivres, deux conseillers les accompagnaient jusqu’à Lausanne, l’un à pied, l’autre à cheval. Ces Allemands étaient des Fribourgeois et des Gruyériens 3.
L’année 1482 fut troublée 4. « Certains garnements, nouvellement levés et qui portaient l’épée à demi hors du fourreau », menaçaient la sécurité des gens qui se rendaient aux foires de Moudon. A trois reprises, à la demande du Conseil, le bailli de Vaud dut mettre huit hommes sur pied, qui, avec les huissiers, /486/ montèrent la garde pendant trois jours chaque fois 1. Comme des gens de Bienne venaient de piller Cudrefin, on tenait à être sur ses gardes.
Si nous étions mieux renseignés, nous connaîtrions d’autres incidents analogues 2. Le passage de ces gens d’armes excitait l’envie de jeunes Moudonnois désireux de courir les aventures; quelques-uns partirent pour la guerre en lointain pays 3. Nous n’en connaissons aucun qui en soit revenu après avoir trouvé une brillante fortune.
La présence fréquente d’hommes armés rendait le pays peu sûr; déjà alors, les bois du Jorat étaient le théâtre d’actes de brigandage, qui n’épargnaient même pas les ambassadeurs de l’empereur 4. Ce fut bien pis lorsque les troubles politiques furent venus aggraver les choses. On sait que, lorsque Bonivard fut arrêté à Ste-Catherine en mai 1530, il revenait de Moudon 5. Aussi ne devons-nous pas nous étonner si, non seulement les seigneurs, mais les simples /487/ bourgeois, avaient pris l’habitude d’avoir toujours des armes avec eux. Mais le remède était pire que le mal : les gens ne faisaient que trop usage de celles-ci et le Conseil devait répéter l’interdiction de porter des poignards ou des rapières 1. Les batteries étaient fréquentes : coups de pied, coups de poing, coups d’épées, blessures; les coupables n’étaient pas nécessairement des gens de rien : de bons bourgeois, un prêtre même figurant dans la liste 2.
*
* *
Ce n’est pas que ces hommes fussent plus méchants que nos contemporains, mais les mœurs étaient rudes et se ressentaient du caractère rustique de la vie d’alors. Pour la même raison, ils étaient processifs à l’excès. Ils aimaient à utiliser toutes les ressources de la procédure d’alors et, de renvoi en renvoi, les procès duraient 3.
Leurs injures manquaient d’élégance 4. Il leur arrivait /488/ de jeter des pierres contre la maison des aubergistes quand ils voulaient se faire donner à boire après les heures de police, soit 9 heures du soir 1. Les rues n’étaient pas éclairées et l’obscurité favorisait les malfaiteurs; aussi était-il défendu de sortir de chez soi, après 9 heures en hiver, après 10 h. en été, sans chandelle allumée, sous peine de 60 s. d’amende, ou même d’emprisonnement à la Tour 2. Depuis 9 heures, tout bruit était interdit; on ne pouvait ni fendre des planches, ni rouler des tonneaux, ni crier, ni commettre des dégâts, ni se mal conduire, sous peine d’amende, de prison ou même d’expulsion pour un an 3. Ces prescriptions nous montrent quels délits étaient à craindre et les registres municipaux nous prouvent que des amendes furent prononcées contre des coupables. Mais dans quelle ville et dans quel temps cela ne se produit-il pas ?
Les Moudonnois aimaient le jeu; les règlements de police proscrivaient absolument les jeux de hasard 4; les jeux de cartes étaient autorisés, mais de jour seulement; passé 9 heures du soir, ils étaient défendus 5 et plus d’un particulier fut condamné pour avoir /489/ laissé jouer chez lui toute la nuit; il en était de même des pères des jeunes gens qui avaient prolongé par trop leurs parties 1. Même l’innocent jeu de quilles était interdit et l’on empêchait les enfants de s’y livrer dans les ruelles 2; elles étaient si étroites que la circulation y était déjà difficile.
Mais de tous les délits et contraventions que commettaient les gens de Moudon, le plus fréquent semble avoir été la maraude 3. C’est que la ville, au fond, n’était qu’un grand village.
Si les contraventions de cet ordre étaient fréquentes, la criminalité proprement dite paraît avoir été rare. La seule peine corporelle que prévoient les règlements municipaux est l’estrapade 4; elle s’applique au receleur 5.
Il est vrai que la justice criminelle ressortissait aux officiers ducaux et que les comptes de la châtellenie manquent pour la plus grande partie de la période qui nous occupe. On peut remarquer ceci cependant : En 1434, quand il fallut pendre un quartier du corps d’Antoine de Sure, il n’y avait /490/ pas de gibet et le compte de la châtellenie porte les dépenses qui durent être faites pour l’achat d’une perche et d’une chaîne 1. Plus de 20 ans après, un brigand de grands chemins devait être « pendu par le cou … pour ses démérites »; le châtelain fit constater par témoins « que, le 20 février 1459, il n’y avait pas de fourches où pût être exécuté un criminel, si le cas survenait »; on y remédia sur-le-champ et, le 10 mars, l’instrument du supplice était prêt 2. Toujours est-il que, pendant plus de vingt ans, aucune exécution de cette nature n’avait eu lieu à Moudon. En 1519 ou 1520, un malheureux, Etienne Vuagnières, fut roué; la ville prêta une échelle à cette occasion 3.
Pour être complet, il faut ajouter que l’on disposait d’autres moyens encore que la pendaison ou la roue pour faire passer les hommes de vie à trépas. Le 21 avril 1446, on arrêta une femme, accusée d’hérésie; le 28, deux hommes, sans doute dénoncés par elle, la rejoignaient dans les prisons de Moudon et, le 5 juin, tous trois étaient exécutés 4, par le feu assurément. On peut penser qu’il s’agissait d’un cas de sorcellerie 5. /491/
*
* *
Les gens de Moudon avaient cependant d’autres spectacles que la vue d’un bûcher. Ils aimaient les fêtes de tir. Le Conseil subventionnait les exercices des arbalétriers : ceux-ci convoquaient à leurs concours leurs voisins, les tireurs de Lucens et de Rue 1; plus tard, lorsque les armes à feu commencèrent à être employées, on donna également un prix « à ceux qui concouraient avec la poudre » 2. En 1535, la ville remet de l’argent aux arbalétriers pour qu’ils puissent arranger leur cible contre un rocher 3. Elle leur alloue des subsides quand ils vont à Yverdon, à Orbe ou à Lausanne se mesurer avec les compagnons de ces villes 4 et elle leur fournit un équipement rouge et vert 5. /492/
Parfois, il y avait des représentations théâtrales. Tantôt c’étaient des amateurs de l’endroit, des jeunes gens dressés par le maître d’école 1 ou quelque ecclésiastique; ils jouaient sur la Place, au Château, où l’on construisait des estrades pour les spectateurs et une scène rustique pour les acteurs; le Conseil en faisait les frais et régalait les jeunes artistes. Les sujets paraissent avoir été pris dans l’Ecriture sainte : ainsi, les 21 et 22 mars 1480, deux représentations de la Passion eurent un tel succès qu’on en redonna une troisième le dimanche 9 avril 2; le dimanche 5 septembre 1507, le sujet était tiré de la légende de saint Etienne, le patron de l’église de Moudon 3; en 1526, il s’agissait de l’histoire de Lazare, qui fut jouée devant l’église St-Etienne 4. D’autres fois, c’étaient des comédiens de passage, auxquels le Conseil accordait assez largement son appui 5. Quoiqu’il ait existé /493/ des textes écrits de ces mystères ou de ces moralités 1, aucun, malheureusement, n’est parvenu jusqu’à nous.
Il y avait d’autres fêtes encore. Nous aurons l’occasion de parler plus loin 2 de celles qui avaient un caractère exclusivement religieux et faisaient partie du culte. Nous ne voulons traiter ici que de celles qui avaient pris un cachet tout à fait laïque.
La première était celle des Rois 3. Le 6 janvier, dans plusieurs auberges de Moudon, des groupes soupent ensemble et mangent le gâteau des rois; celui qui a la fève est « roi » de la société avec laquelle il festoie; le Conseil offre du vin « au sérénissime roi des vénérables seigneurs du clergé, … à la reine des femmes de Moudon » et même, mais, la moitié moins, au « roi des enfants » 4. Il en est de même de la « reine des jeunes filles » 5 ou du « roi des cordonniers 6 », qui, nous l’avons vu, formaient une confrérie.
Le Conseil, lui aussi, soupait et tirait la fève; /494/ le gagnant était « roi de la ville ». Un cortège de fifres et de tambours l’escortait aux frais de la communauté 1. La fête prit une telle importance que le Conseil la réglementa; c’est que le roi de la ville, en retour des égards qu’on lui témoignait, devait donner des preuves de sa générosité 2; tout le monde ne voulait pas, ou ne pouvait pas, assumer cette charge. Le 7 janvier 1523, le Conseil désigna donc François de Glane, seigneur de Villardin, comme roi de la ville, pour l’année courante; le jour des Rois, l’année suivante, on tirera la fève au sort 3 entre ceux des assistants qui n’ont pas encore été rois, et l’on établit la liste de ceux qui sont dans ce cas : cinq conseillers, le secrétaire, neuf bourgeois de marque dont le maître d’école; sera exempté celui qui sera malade ou en deuil, ou encore à la guerre hors du pays, en particulier au delà des monts 4.
Onze ans plus tard, le 7 janvier 1534, une nouvelle ordonnance précisa encore : à l’avenir, tous les membres du Conseil, et les adjoints 5 qui n’auront pas encore été rois, devront se trouver au souper chez le roi de l’année précédente, le 6 janvier; là, ils tireront la fève /495/ ou la dragée, ou « le billet à la fortune »; celui qui refusera paiera une amende de 10 fl. (300 fr.), sauf les exceptions déjà existantes; le bailli de Vaud, Aymon de Genève-Lullin, accepte d’être roi pour cette année; François, fils de feu Jaques Cerjat, le sera l’année prochaine; la troisième année, ce sera Claude de Glane. Parmi les conseillers actuels et les adjoints, six ont déjà été rois; Pierre Cerjat refuse d’être parmi les concurrents, nous ne savons pourquoi 1.
Quoique Aymon de Lullin fût absent le 6 janvier 1535, jour où il devait fêter sa royauté, la ville fit les choses grandement; le 26 décembre précédent, le Conseil s’en était occupé. On dîna ensemble; le tambour et la clarinette du cortège furent habillés à la livrée de Moudon, ce qui coûta trois livres (150 fr.) par homme; en l’honneur du bailli de Vaud on brûla quatre livres de poudre, denrée coûteuse; son fils ayant été désigné comme roi à son tour, au lieu de François Cerjat, ce fut une nouvelle occasion de repas et de réjouissances 2. Le 6 janvier 1536 encore, malgré les dangers de la situation, le Conseil soupa avec le bailli de Vaud, aux frais de la caisse communale; il soupa également le lendemain, en l’honneur du nouveau roi, Jaques Cerjat 3.
Des fêtes analogues avaient lieu dans les villes et villages du voisinage et les cortèges « royaux » se transportaient /496/ volontiers d’un endroit à l’autre : le 6 janvier 1520, le « roi » de Combremont-le-Grand, le 6 janvier 1526, le « roi de Chavannes et son cortège » vinrent festoyer à Moudon où le Conseil leur offrit du vin 1; en 1534, on invite des gens de Rue 2; ceux-ci étaient déjà venus en 1531, déguisés en Albanais 3.
Le jour de la Saint-Georges (23 avril) et le lendemain, on fêtait la « confrérie » par un vaste banquet avec soupe aux pois, salé, pain et fromage 4; en 1520, on distribua le premier jour 2800 miches de pain et, le lendemain, 1600; quoiqu’il y ait eu 14 pièces de fromage, pesant 253 livres, et 11 pièces de salé, pesant 448 livres, il s’en fallut de 4 pièces de salé et de 100 livres de fromage pour que la « confrérie » fût complète, « comme il aurait fallu » 5. La ville dépensait pour cela, bon an mal an, plus de deux mille francs, sans parler de l’hôpital qui y consacrait 20 livres (plus de 1200 fr.) 6. /497/
Enfin, la Saint-Jean (24 juin). Cette date, qui semble correspondre à cette fête du solstice d’été que l’on retrouve dans toute l’Europe et ailleurs 1, était marquée par des réjouissances, dont nous ignorons le détail. Elles nécessitaient la mise sur pied d’une garde, divisée en deux troupes : le guet et le rière-guet 2; dans la soirée du 23, précédés de musiciens et de tambours, suivis de la jeunesse de la ville, ces hommes faisaient cortège, non sans brûler quelque peu de poudre pour manifester leur joie et, toute la nuit, ils montaient la garde autour de grands feux 3. La ville les restaurait : vin, collation, souper, et « petit boire » le lendemain matin.
Mais nous n’avons trouvé aucune trace de la fête des Brandons 4, le mot même ne figure dans aucun document de cette époque.
CHAPITRE XXI
MOUDON A LA VEILLE DE LA CONQUETE BERNOISE.
1435-1536.
L’Eglise
Moudon, avons-nous vu 1, avait deux églises, toutes deux propriétés de la ville qui avait la charge de leur entretien 2.
L’église Saint-Etienne, au début du XVe siècle, était encore couverte de bardeaux 3; il en était encore de même en 1458/9, au moins pour le clocher 4. Vingt ans après 5, nous voyons que celui-ci ainsi que la nef étaient recouverts de tuiles, transformation qui fut faite, sans doute, dans les années qui précédèrent les guerres de Bourgogne. En 1496, on refit la charpente de la toiture 6.
Un acte de 1437 nous apprend que, peu auparavant, /499/ on avait aussi rebâti le clocher, ou tout au moins sa partie supérieure 1. Il y avait là une chambre où se tenait le guet et dont le sol était de terre battue 2.
C’est au début du XVe siècle aussi que l’on avait commencé à placer des verrières 3; ce travail coûteux n’était pas entièrement terminé en 1453, lors de la visite d’église; on constata alors que les pigeons entraient par les fenêtres qui se trouvaient près de la voûte du chœur 4.
Les visiteurs firent observer aussi que le sol de l’église était inégal à cause des nombreuses tombes que l’on avait creusées au pied des autels et ils exigèrent qu’il fût régulièrement aplani et soigneusement dallé. L’église fut carronnée peu après, semble-t-il 5. En février 1532, un travail analogue fut ordonné par le Conseil; il s’agissait surtout de placer des cadres de pierre autour des caveaux funéraires 6. Entreprise au commencement de l’été 1533 seulement, cette réparation coûta fort cher; pour la payer, la ville dut prélever, dans toute la paroisse, un impôt extraordinaire de 3 sous par feu (7 fr. 50); en attendant que cet argent rentrât, il fallut contracter des emprunts auprès de riches particuliers.
Moudon consacra de grosses sommes à ses cloches. /500/ Vers 1428, on en avait fabriqué de nouvelles et le notaire François Champagniod, ancien recteur de l’hôpital, avait versé, pour le compte de la ville, au fondeur maître Georges 101 livres (10 000 fr.) 1.
Au commencement du XVIe siècle, nous ne savons pour quel motif, on se décida à fondre une grosse cloche. Une souscription fut ouverte 2; le Conseil rassembla tout l’argent qu’il put trouver et, dès 1510, il commença des versements au maître fondeur de Berne, qui, outre le travail, devait encore fournir le métal. L’année suivante, la cloche fut fondue 3, sur place, suivant l’usage; elle coûtait plus de 2 000 florins (près de 100 000 fr.) 4.
En 1534, on fondit encore une petite cloche, ou plutôt on en refondit une qui avait été brisée. On alla chercher « à l’Ours 5 » un char de charbon, et sous le Fey, sept chars de terre grasse à la grande indignation du propriétaire, Jaques Cornaz qu’on invita à souper /501/ pour le calmer 1. Le 5 novembre au soir, on brisa le moule, en présence de deux ecclésiastiques moudonnois, D. Jean Martin et D. Benoît Bridel, qui goûtèrent avec le fondeur et quelques conseillers. Le lendemain, on la suspendit; les jours sont courts en novembre : cette opération délicate n’était pas terminée lorsque la nuit tomba; le compte porte la dépense faite pour deux chandelles; le travail fini, on alla souper aux frais de la communauté.
Il y avait alors dans le clocher de Saint-Etienne quatre cloches au moins : la grosse, dont nous venons de parler; deux petites, dont on sonnait l’une à 10 heures en temps de carême; une quatrième qui s’appelait « l’aumonière »2.
Au-dessous des cloches, l’horloge, qui depuis 1526 pouvait frapper sur la grosse cloche 3. Cette horloge est un objet de souci constant : le mécanisme, encore très primitif 4, se détraque fréquemment, il n’y a pas de compte communal où l’on ne trouve notées les interventions répétées d’un forgeron ou même d’un spécialiste que l’on fait venir de loin. Le « gouvernement de l’horloge » est confié d’ordinaire à un ecclésiastique. Voici les clauses du contrat passé avec l’un d’entre eux, ce Jean Martin dont nous parlions tout à l’heure : /502/ moyennant 8 florins (240 fr.) l’an, il dirigera l’horloge et fera sonner les heures; il la graissera, mais il ne là touchera ni avec une lime, ni avec un marteau; il graissera aussi les cloches 1.
A l’intérieur, l’autorité municipale ne se bornait pas à faire reblanchir 2 ou réparer les voûtes 3 de l’édifice, quand besoin était; elle l’embellissait : pendant l’hiver de 1501 à 1502, on y plaça les magnifiques stalles qui en ornent encore aujourd’hui le chœur et qui sont l’œuvre du sculpteur Peter Vuarser. Nous ignorons, il est vrai, qui fut l’instigateur de ce travail et qui en paya la dépense, mais nous savons que le Conseil s’y intéressa 4 et tout nous porte à croire que c’est la ville qui en supporta la charge financière 5.

Pl. XII : Les stalles de l’église Saint-Etienne
côté N. du choeur
*
* *
La ville pouvait bien exiger des héritiers des fondateurs des chapelles latérales qu’ils en entretinssent les toits 6; elle n’avait pas le droit de demander au clergé de contribuer à l’entretien de l’église. Un procès qu’elle lui avait intenté vers 1436 s’était terminé à son détriment. Elle lui réclamait le dixième /503/ des frais qu’elle avait eus pour la réparation des cloches et du clocher, pour l’entretien des toits, pour l’achat de quatre chasubles et de deux tuniques, pour la confection d’un antiphonaire, comme aussi pour l’entretien des fontaines et des murailles. Le clergé le contestait absolument en vertu du droit canon, et parce que les prêtres, comme administrant le culte divin, n’ont d’autre fonction que de prier et d’intercéder auprès de Dieu pour les pécheurs; enfin, parce qu’ils n’avaient jamais payé précédemment. Deux arbitres, un dominicain de Lausanne 1, Uldric de Torrente, alors « visiteur de la paroisse de Moudon », et le bailli de Vaud, Jean de Blonay, se prononcèrent pour la thèse du clergé : celui-ci devait être dorénavant libre de toute espèce de charge envers la ville pour n’importe quelle espèce de dépenses, même si celles-ci avaient été faites pour les églises 2. Il semble bien que, ayant obtenu gain de cause, le clergé ne se soit pas refusé à quelques concessions 3.
Plus tard, le 19 avril 1510, l’évêque Aymon de Montfalcon autorisa le Conseil à employer, pendant 4 ans, à la réparation de l’église et en particulier à la fonte de la grosse cloche les revenus des confréries du Saint-Esprit et de Saint-Georges 4. Le 25 novembre 1515, /504/ le curé de Moudon autorisait la ville à placer dans l’église un tronc pour la fabrique de la dite église et à recueillir les aumônes faites après l’offertoire au grand autel, les dimanches et jours de fête, ceci en vue des réparations à faire au sanctuaire; mais il se réservait une redevance de 12 s. (1 fl.) chaque année 1. La commune ne tira pas de là des ressources bien considérables. En mai 1518, on y trouvait de quoi faire et dorer le calice de SaintEtienne; en 1519-20, de quoi acheter du parchemin; en 1520-1, le tronc donna 9 florins; en 1521-2, 2 florins; pour la plupart des années suivantes, nous n’avons aucune indication; en 1532-3, on y trouva 40 s. seulement (3 1⁄3 fl.) 2.
Quoique de dimensions plus modestes, l’église de Notre-Dame est d’un entretien assez coûteux. Lors de la visite d’église de 1453, elle n’était ni dallée ni planchéiée; les verrières n’étaient pas en bon état; les parois avaient besoin d’être reblanchies, car on avait la mauvaise habitude d’éteindre les cierges en les appuyant contre elles 3. Au cours de l’été 1459, on y fit des réparations assez considérables; il semble qu’on en ait rebâti le chœur 4. Par les comptes subséquents /505/, nous apprenons qu’elle avait deux portes : une grande devant, une petite au sud; elle avait une grande fenêtre, ce qui présuppose d’autres plus petites 1. Elle était cependant encore couverte de bardeaux à la veille de la Réforme 2. Dans son clocher, il y avait une grosse cloche et d’autres plus petites 3. Sur le portail, une statue de la Vierge 4.
Lorsque, dans la seconde moitié du XVe siècle, la ville avait dû prendre à sa charge la chapelle Saint-Eloi, sur le pont, dont les revenus étaient insuffisants, elle avait pris ses précautions : elle exigeait du desservant, qu’elle désignait, l’engagement d’entretenir ce petit édifice, en particulier de le maintenir couvert de tuiles 5. Comme, au cours de l’hiver 1524-5, une partie du toit était tombée dans la Broye, on exigea de D. Jaques Moine, qui en était alors le chapelain, le paiement des frais causés par la réparation. Il eut beau protester et même citer les membres du Conseil devant une cour ecclésiastique à Genève, il dut finir par payer une partie tout au moins de cette /506/ somme 1. Le fait qu’il était nommé par le Conseil 2 donnait à celui-ci barre sur lui.
L’autorité municipale prit des mesures analogues à propos de l’ermitage de Sainte-Catherine, sur le Mont de Tholes : comme un frère, venu d’un couvent espagnol, désirait s’y installer, le Conseil l’y autorisa, le 14 février 1521, mais à condition qu’il ne pût y demeurer qu’à bien plaire et que, s’il y bâtissait, ce fût à ses frais 3.
La ville ne s’intéressait pas moins au mobilier des églises; c’est elle qui faisait copier ou relier les livres nécessaires au culte 4; elle faisait réparer ornements et joyaux 5 et, de temps en temps, elle en prenait /507/ inventaire 1. Précaution utile, car il y avait là des étoffes de prix et de l’argenterie qui pouvaient tenter la cupidité, sinon des ecclésiastiques, tout au moins de leur entourage. Preuve en soit cet incident de 1513 : un membre du Conseil, Humbert de Sarandin, s’empara d’un calice doré appartenant à la chapelle de Notre-Dame dans l’église Saint-Etienne, chapelle dont son fils était le desservant et il le mit en gage chez un orfèvre de Genève. Le Conseil dut le racheter 2.
*
* *
Lors de la visite d’église de 1453, il y avait, à Saint-Etienne, outre l’autel principal, 13 autels, à Notre-Dame 6 3. Plusieurs autres furent fondés depuis, si bien qu’il y en avait une vingtaine dans l’église principale et 8 ou 9 dans l’autre à la veille de la Réformation 4. Tous avaient été fondés par des habitants de la ville, laïques ou ecclésiastiques; ils s’étaient enrichis par des donations ultérieures 5. En 1453, les revenus /508/ des 13 autels de Saint-Etienne s’élevaient à 131 livres, 8 florins de Florence et 37 coupes de froment, soit plus de 200 livres (20 000 fr.), ceux des 6 autels de Notre-Dame à plus de 146 livres (près de 15 000 francs) 1.
Pour desservir ces autels et dire les messes fondées 2, un nombreux clergé était nécessaire. Le curé tout d’abord, dont la présentation appartenait au Chapitre 3; c’est presque toujours un personnage important.
A Humbert Favre, d’Essertines, qui occupa ce poste fort longtemps 4, succéda Jean de Michaëlis, un Piémontais, familier de Félix V; chanoine de Lausanne et de Genève, cet ecclésiastique fut comblé de dignités et finit par devenir évêque de Lausanne 5. Il ne résida sans doute pas à Moudon, où nous le voyons remplacé par un vicaire 6; en 1451, il amodie sa cure, c’est-à-dire : il en donne les revenus à ferme à un ecclésiastique moudonnois, curé d’un village voisin 7; il résigna ses fonctions avant son élévation à l’épiscopat; dès 1463 8, il avait pour successeur à /509/ Moudon Jean de Liserio, de Villeneuve, que nous ne connaissons que par son testament 1.
Celui-ci vivait encore en 1476, mais le 9 mars 1481, il avait déjà pour successeur Antoine Oddet, le neveu d’un chanoine 2, que l’on trouve mentionné encore en 1500. A partir de 1502, le curé de Moudon est Jaques d’Estavayer 3. Fils de ce Claude d’Estavayer qui succomba en 1475 en défendant sa ville 4, neveu du bailli de Vaud 5, le nouveau curé de Moudon appartenait à une des grandes familles du pays, qui comptait deux de ses membres au sein du Chapitre où il devait entrer à son tour.
Il semble, au début tout au moins, avoir résidé assez régulièrement à Moudon, où sa famille avait bien des attaches, malgré qu’il eût d’autres prébendes ailleurs, entre autres une chapellenie à Estavayer 6. Cependant, il amodiait sa cure, en 1508 déjà 7; en 1521, le preneur s’engageait à lui verser 190 florins /510/ (près de 7500 fr.); il se réservait un logement pour quand il serait à Moudon 1. L’année suivante, il séjourna encore à plus d’une reprise dans cette ville 2, mais, dès 1524, son absence provoque des difficultés entre les autorités municipales et lui 3; c’est qu’entre temps, en 1523, il était devenu chanoine.
Il mourut en juillet 1530 et ne fut pas immédiatement remplacé. En mai 1531, le Conseil général de Moudon chargeait les magistrats d’en parler au bailli de Vaud. Aymon de Genève s’arrangea à réserver cette cure pour un de ses fils, un jeune garçon qui en porta le titre et en toucha les revenus, mais ne prit pas les ordres 4.
Aux côtés du curé, plus d’une vingtaine d’ecclésiastiques desservent les diverses chapelles 5. La plupart sont originaires de Moudon; leurs noms ne laissent aucun doute à cet égard, même lorsque le fait n’est pas établi par d’autres documents. Certaines familles /511/ y ont presque toujours un représentant; ainsi les Jayet 1, les Vuicherens 2 ou les Moine 3. Les familles qui ont quelque influence aiment à installer un des leurs dans une chapellenie : nous trouvons un de la Cour en 1462 4, un Demierre en 1504 5, un Créaturaz un peu plus tard 6. Les membres du Conseil y placent leurs fils : Humbert de Sarandin son fils Georges 7, Jean Nicati son fils Humbert 8, Boniface Bridel deux de ses nombreux enfants 9.
Aussi, le jour où le fils d’un Moudonnois dit sa première messe est-il un jour de fête que le Conseil marque par l’envoi de vin d’honneur 10. Bientôt, le jeune prêtre est pourvu d’une prébende 11. C’est /512/ facile : la ville a le droit de présenter le desservant de certaines chapelles 1; pour d’autres, le patronat appartient aux héritiers des fondateurs 2, qui sont des bourgeois de la ville.
Pour autant que nous pouvons en juger, il n’y eut que peu de prêtres étrangers à la localité, ou à son voisinage immédiat. Nous trouvons cependant quelques cas de ce genre : Ainsi, de 1438 à 1451 environ, Pierre de Lavigny, de la famille noble de ce lieu, chanoine de Lausanne et de Maurienne, chargé de multiples dignités à Lausanne, et dont un frère et un neveu, nommés Antoine tous les deux, furent comme lui chapelains à Moudon 3. Ainsi, encore un demi-siècle plus tard, Claude Savioz (ou Sage), d’une famille lausannoise 4. Chanoine de Lausanne, doyen de Neuchâtel depuis 1485 au moins, il était en outre curé de Combremont et de Promasens; il fut curé /513/ de Curtilles et, à Moudon, il fut recteur d’une chapelle depuis 1478 au moins 1.
Par quelle porte ces étrangers pénétraient-ils dans le clergé moudonnois ? Un exemple nous le fera comprendre : le 3 décembre 1507, le curé D. Jaques d’Estavayer, en vertu de sa charge de patron de l’autel de sainte Catherine en l’église Saint-Etienne, remettait cette chapellenie à un prêtre de Lausanne 2. Sans parler des bénéfices accordés par la cour de Rome, il n’est pas interdit de penser que, dans d’autres cas aussi, c’est le droit de présentation du curé qui a introduit dans les églises de Moudon des ecclésiastiques qui n’y résidaient pas et se contentaient de toucher les revenus de leurs charges.
*
* *
Que valait une de ces prébendes ? Il est difficile de le dire. Lors de la visite d’église de 1453, le revenu /514/ de chacune des chapelles fut déclaré 1. Il va de 3 liv. (300 fr.) pour la chapelle de saint André à 11 liv. et deux muids de froment, soit au moins 60 liv. (6000 fr.) 2, pour la chapelle de saint Georges, qui a plusieurs chapelains, avec une moyenne de 12 à 15 liv. (1200 à 1500 fr.), somme à laquelle vient s’ajouter la part de chaque chapelain aux fondations collectives faites en faveur du clergé en corps, ainsi que le casuel.
Ces chiffres sont modestes. La célébration des messes fondées n’absorbait pas toute l’activité des chapelains. Aussi, la plupart d’entre eux cumulaient-ils plusieurs fonctions. Ils étaient volontiers curés des paroisses voisines, ce qui leur permettait de continuer à vivre à Moudon, dans leur maison familiale et dans leurs habitudes bourgeoises, tout en se faisant remplacer par un vicaire en temps ordinaire. Ils sont curés de Bioley-Magnoux 3, de Curtilles 4, de Chapelle 5, de Mézières 6, de Combremont 7, de Dompierre 8, ou même de plus loin : de Grandvillars 9 ou d’Attalens 10. D’autres sont chapelains à Lausanne. /515/
D’autres encore pratiquent un métier : quelquefois, il s’agit de fonctions qui ne sont pas trop éloignées de leur caractère religieux; ils surveillent la marche de l’horloge 1, dirigent l’école 2 ou enseignent le chant d’église aux enfants de chœur 3; parfois leur profession nous paraît peu compatible avec les obligations d’un ecclésiastique : passe encore quand ils sont notaires 4; mais nous en connaissons qui sont de vrais agents d’affaires au service des seigneurs des environs dont ils ont pris à ferme les revenus 5; tel autre pratique ouvertement le prêt sur gages 6; plusieurs sont aubergistes 7.
Prenons comme exemple un des plus en vue des derniers prêtres de Moudon, D. Jaques Moine. Fils /516/ et petit-fils de notaires, il entra dans le clergé tout au début du XVIe siècle 1; il eut d’abord la chapelle de l’hôpital; vers la fin de 1512, il devint curé de Chapelle et renonça à sa prébende en ville 2; mais, plus tard, il fut recteur de Saint-Eloi 3, tout en conservant sa cure. Il succède à D. Claude Savioz comme doyen de Neuchâtel, avec le titre de doyen d’Orbe 4 et jouit d’une prébende à la cathédrale 5. Mais, ce fils de notaire était avant tout un financier; son nom se rencontre toujours dans des actes qui se rapportent à des affaires. Propriétaire du domaine de la Cerjaulaz 6 que son père avait acheté d’un Valacrêt 7 et où il avait bâti une ferme 8, D. Jaques Moine l’arrondit 9; il défriche 10; il exploite ses forêts 11. Ailleurs, nous le voyons acheter et vendre, prêter et emprunter 12; en 1521, il avait pris à ferme de l’abbé de Payerne, /517/ de compte à demi avec le seigneur de Vuissens, les revenus des prieurés de Baulmes et de Prévessin 1, ce qui était alors ce que nous appellerions aujourd’hui une spéculation. Certes, aucun des actes que nous possédons ne nous le montre comme un homme improbe; il n’en reste pas moins que cet ecclésiastique ne songeait pas à imiter saint François d’Assise; il n’avait pas renoncé aux biens de ce monde 2.
Au reste, nous aurions tort de nous scandaliser en voyant ces prêtres si souvent mêlés à des affaires d’argent : c’est pour eux une nécessité, plus encore un des devoirs de leurs charges. Chaque église, chaque chapelle, chaque fondation religieuse possède des biens dont le curé, le chapelain ou le recteur est l’administrateur. Ce sont parfois des maisons, des domaines, des vignobles 3; il faut qu’il en perçoive les loyers ou en surveille l’exploitation. La plupart du temps, ce sont des rentes foncières, des revenus en argent et en nature assignés sur des immeubles; il faut les faire rentrer, les utiliser, les vendre; il faut placer les capitaux remboursés et ceux qui proviennent de legs nouveaux; parfois il faut plaider contre des débiteurs défaillants, des héritiers mécontents, des voisins peu arrangeants ou peu scrupuleux.
L’ensemble des prêtres de Moudon forme une sorte /518/ de corporation 1, que, dans la langue du temps, on appelle la clergie; elle aussi possède des biens, distincts de ceux des chapelles; elle en confie l’administration à l’un de ses membres, son procureur ou fondé de pouvoirs, assisté souvent d’un notaire.
Ne nous étonnons donc point que les préoccupations de cet ordre aient rempli une grande place dans la pensée des ecclésiastiques d’alors, qu’elles aient même absorbé l’activité de quelques-uns d’entre eux à tel point qu’ils négligeaient leur tâche spirituelle 2.
Nous verrons bientôt que cette situation créa de graves abus 3. Pour le moment, il nous suffit de constater que, si le clergé savait gérer ses biens, s’il savait même se défendre contre la fiscalité de la cour pontificale 4, il n’avait pas en matière d’argent des exigences excessives et notoirement injustifiées.
*
* *
Pour autant que nous pouvons le savoir, la plupart de ses membres étaient des prêtres respectables. Les documents moudonnqis ne contiennent aucune trace de reproche à faire à ce Jaques Moine, par exemple, dont je parlais tout à l’heure. Cela est plus vrai encore de D. Antoine Jayet, recteur de la chapelle de la Trinité, dans l’église Saint-Etienne, dès 1522 /519/ au plus tard 1, vicaire de Jaques d’Estavayer à la fin de la vie de celui-ci et pendant la vacance qui suivit sa mort 2, jusqu’à la Réforme; il mourut, entouré de respect, en 1541 3.
Mais ce n’était pas le cas de tous. Il y eut des prêtres qui négligèrent leur office : il semble résulter de deux actes perdus qu’en 1466 le Conseil de Moudon dut se plaindre au vicaire épiscopal de ce que les prêtres ne visitaient pas les malades de l’hôpital et n’enterraient pas les pauvres 4. D’autres n’observaient pas consciencieusement les obligations de leurs charges 5 : Un Moudonnois, qui quittait le pays, faisait son testament le 23 juillet 1502; il y spécifiait que, si le clergé ne remplissait pas les conditions du legs par lui fait, ses héritiers seraient autorisés à retenir un sol de cense par messe qui ne serait pas dite, car, ajoute le testateur, « il arrive souvent qu’il célèbre moins de messes et ne remplisse pas les conditions des legs; et pourtant les ecclésiastiques sont acharnés à recouvrer les censes » 6. Aussi des testateurs chargent-ils le Conseil de Moudon d’exercer une certaine surveillance à cet égard 7.
D’autres furent des prêtres indignes. Ce Claude /520/ Savioz, que j’ai déjà nommé 1, fut accusé par un autre ecclésiastique d’avoir tué, d’une façon inhumaine, un tuilier de Payerne et d’avoir commis d’autres crimes alors qu’il prenait part aux guerres qui avaient désolé le pays 2. Il put se libérer de cette accusation puisqu’il conserva ses bénéfices, mais il n’en resta pas moins un homme cupide et violent : au printemps de l’année 1501, le curé de Morlens étant mort, les habitants de la paroisse se réunirent en armes, à son instigation, pour garder les joyaux de l’église et l’y introduire de force en en écartant le curé de Moudon, Jaques d’Estavayer 3. Au siècle précédent, D. Claude Jordan s’était vu condamné par la cour de Moudon pour injures et batteries 4; il avait une concubine qui, elle-même, était accusée de vol 5. Le curé Jean de Liserio avait quatre enfants illégitimes 6. En 1531, le Conseil autorisait un bourgeois à louer sa maison à D. Jean de Bruel, chapelain de Moudon, « à condition qu’il se conduisît comme un prêtre et n’eût pas de concubine 7 ». Ce D. Pierre Monard, qui avait été recteur des écoles 8, puis vicaire 9, se voyait défendre par le Conseil de coucher /521/ dans la maison d’Alexie Martin 1, une hôtesse veuve qui était trop accueillante. Au lendemain de la Réforme, Pierre Monard fut l’homme d’affaires que les Bernois chargèrent de la liquidation des biens d’Eglise; il servit de receveur aux premiers baillis, fonctions qui paraissent avoir mieux convenu à son caractère 2.
Tel autre abandonne complètement son poste : en 1474 ou 1475, le Conseil envoya une délégation à la commanderie de la Chaux pour prier frère Pierre Séraillon de venir desservir sa chapelle de Saint-Jean de Jérusalem 3.
Du reste, de même que l’entretien des églises, les dépenses nécessaires pour le culte incombent à la ville. C’est le Conseil qui fait venir à ses frais un prédicateur pour l’Avent et pour le Carême 4. C’est lui qui fournit la lampe qui brûle devant le saint sacrement et qui la fait remplir d’huile de noix 5, la chaire du prédicateur 6 et même la lanterne destinée /522/ à accompagner le prêtre lorsqu’il porte le saint sacrement 1.
Quand il y a procession, la ville salarie les sonneurs des cloches 2 ainsi que le clergé qui y a pris part; ainsi, le jour de la fête de saint Donat, où l’on se rend en cortège de la ville jusqu’à la chapelle du saint 3. Il est vrai qu’à cette occasion le Conseil n’oublie pas ses propres membres; puisqu’ils veillent au bien public, il est juste que, ce jour-là, ils dînent aux frais de la communauté 4.
C’est la ville aussi qui, chaque année, fait réparer et nettoyer, « au savon », le dais d’étoffe que l’on appelle « lo palioz » et que, le jour de la Fête-Dieu, l’on porte, orné de fleurs, sur la sainte hostie 5.
Enfin, c’est la ville également qui, non sans quelque peu protester, fait les dépenses nécessitées par des /523/ cérémonies, dont nous ne comprenons pas tous les détails, mais qui devaient frapper vivement les esprits. Le jour de l’Ascension, on donnait dans l’église Saint-Etienne une sorte de représentation symbolique : Notre Seigneur, sous la forme d’un mannequin peut-être, s’élevait dans les airs, pendant que les fumées de l’encens montaient et que, du haut du plafond de l’église, on jetait sur les prêtres qui officiaient du vin et une matière que nous ne savons déterminer 1. Le jour de Pentecôte, un mécanisme analogue faisait descendre le Saint-Esprit aux yeux des fidèles émerveillés 2. Et quand, le Vendredi-Saint, des acteurs /524/ représentaient la Passion, c’était encore aux frais de la bourse communale 1.
*
* *
Nos ancêtres ne jugeaient pas comme nous. Il semble qu’ils ne se soient pas indignés de l’inconduite de quelques prêtres; ils trouvaient naturel que la plus grande part des frais du culte retombât sur la communauté. Ce qu’ils n’ont jamais pu admettre, c’est que les ecclésiastiques aient cherché et réussi à se soustraire à la justice civile. Nos archives cantonales et communales abondent en documents qui se rapportent à ces conflits de compétence entre les cours ecclésiastiques et les tribunaux laïques.
Ce n’est pas que, comme certaines sectes anciennes et modernes, les gens d’Eglise aient refusé systématiquement de s’adresser à la justice des hommes. Quand ils étaient acteurs et que leur partie était un laïque, ils n’hésitaient pas à se présenter devant les tribunaux du pays. Nous en avons maintes preuves dans les archives de Moudon. En voici un exemple : Le dimanche 13 novembre 1446, le recteur de la chapelle de saint André en l’église Saint-Etienne déposait entre les mains du châtelain de Moudon une plainte contre Guillaume de Genève, seigneur de Lullin, qui refusait de payer les censes dont une maison nouvellement acquise par lui était grevée en faveur de cette chapelle. Le défendeur est assigné pour le lundi 21, par lettre remise à son épouse, car il était absent, étant pour lors au service du duc; cette absence se prolongeant, /525/ l’audience est remise de semaine en semaine, jusqu’au 12 décembre. Guillaume de Genève ne comparaît toujours pas. Alors le demandeur présente les titres de sa créance, d’où il appert, entre autres, que les arrérages n’ont pas été payés depuis 13 ans. Le défendeur est condamné par défaut et, comme il ne s’exécute pas, — il est toujours absent — la maison est saisie et vendue, le 30 janvier 1447 1. Il faut remarquer que Guillaume de Genève venait de déposer ses fonctions de bailli de Vaud; son successeur avait commencé les siennes le 12 novembre 2. Ce n’est pas une simple coïncidence si le plaignant s’était adressé au châtelain le 13. Dans d’autres cas, nous les voyons recourir à l’arbitrage 3.
Mais l’Eglise a sa justice et elle prétend s’en servir, malgré la résistance de l’Etat; elle revendique d’abord — cela est tout naturel — les accusés qui sont ses ressortissants territoriaux et les arrache à la juridiction /526/ civile 1. Puis dès qu’un clerc est l’objet d’une poursuite civile ou pénale, elle a seule le droit de le juger. En voici un cas typique : En 1437, un jugement arbitral avait décidé que les ecclésiastiques devaient payer le longuel, lorsqu’ils vendaient du vin à pinte 2. En 1493, le fermier de cet impôt indirect, autorisé par le Conseil de Moudon, réclama au vicaire de Thierrens, D. Benoît Abbé, 20 florins pour le longuel du vin qu’il avait vendu et, devant son refus de le payer, il fit saisir chez lui une certaine quantité de vin. Le vicaire répondit que les prêtres ne payaient pas le longuel, qu’en outre, ni la ville, ni aucun juge temporel ne pouvait connaître de ce cas, qui ressortissait uniquement, étant donné la personne du défendeur, à l’évêque de Lausanne. Le demandeur répliquait que quiconque vendait du vin dans la ville et châtellenie de Moudon, de quelque condition, degré social ou état qu’il fût, devait payer le longuel comme les taverniers de Moudon, que la ville tenait ce droit du prince 3, qu’enfin le vicaire avait été saisi, non comme prêtre, mais comme tavernier. La cause dut /527/ être portée devant l’évêque. Aymon de Montfalcon déclara d’abord qu’il défendait au vicaire de vendre vin à l’avenir; cela n’était pas digne, ni convenable pour des clercs et encore moins pour des prêtres; que même cela leur était défendu 1; que s’il lui arrivait jamais, malgré cette défense, de vendre vin, il devrait en payer le longuel. Mais il lui fit restituer le vin saisi, car ni la ville ni aucun juge temporel n’avait le droit de toucher à sa personne ou à ses biens, l’évêque étant en ce cas le seul juge compétent 2. Ce jugement, digne de Salomon, donnait en fait raison à l’administration municipale, mais maintenait, en droit, les privilèges de la juridiction ecclésiatique.
Celle-ci n’allait pas sans frais et sans complication, puisque de la justice épiscopale on en appelait à l’official de Besançon 3, puis en cour de Rome. Chose plus grave, cela portait un sérieux préjudice, matériel et politique, au souverain temporel du pays. Celui-ci cherchait à combattre les empiètements de la justice ecclésiastique 4; mais, quand il était un prince faible comme le duc de Savoie, ses efforts étaient vains. L’Eglise avait, pour se faire obéir, une arme redoutable : l’excommunication. Elle en menaçait sans hésiter ceux qui essayaient de se soustraire à sa justice. /528/ En voici un exemple : le mayor de Lutry, revendiquant certaines vignes, actionna un vigneron qui évoqua en garantie le clergé de Moudon. Aussitôt, le représentant du clergé s’adressa à l’official de Lausanne pour décliner toute juridiction temporelle sur les clercs ou sur leurs biens et l’official ordonna à tous ceux que cela pouvait concerner d’avoir à se désister de toute espèce de poursuite contre ce vigneron de Lutry sous menace d’excommunication. Le mayor perdit son procès 1.
Le clergé ne se bornait pas à menacer de cette peine ses débiteurs récalcitrants 2; il les en frappait même à l’occasion 3; il se servait aussi de cette arme dans les cas de conflits graves avec l’autorité civile 4. Ainsi en 1474, ou au début de 1475, la commune de Moudon avait fait arrêter à Démoret et mettre en prison à Moudon deux hommes, Pierre et André Jeannin; elle leur avait aussi fait saisir plusieurs têtes de bétail. A cette mesure, le Chapitre répondit en frappant de l’excommunication les deux syndics de Moudon qui l’avaient exécutée. Quelque temps après, le 13 mars 1475, un arrangement intervenait : hommes et bêtes étaient relâchés, les frais de leur détention étant à la charge des syndics; en retour, le Chapitre s’engageait à faire retirer, à ses frais, l’excommunication prononcée 5. Cet exemple n’est pas isolé 6. /529/
Dix ans plus tard, le Chapitre se servait du même procédé à l’égard d’un fonctionnaire ducal. Le duc avait ordonné la levée d’un subside, mais le Chapitre refusait de payer sa part pour Villars-Tiercelin; l’huissier de la châtellenie avait voulu prendre des gages dans ce village, mais les habitants les avaient arrachés de ses mains; le châtelain s’y rendit alors avec 13 soldats pour les y saisir de force; c’était le dimanche 5 septembre 1484. Alors, le Chapitre excommunia ceux qui avaient pris part à cette opération judiciaire. Le châtelain ne paraît pas s’en être beaucoup ému; les 6 et 9 septembre, il notifiait par exploit aux officiers du Chapitre à Lausanne qu’il les condamnait à une amende de trois livres (300 fr.) par personne qu’ils auraient excommuniée et, le dimanche 12, il allait avec une troupe de 110 hommes exécuter la saisie à Villars; il y trouve deux chanoines et un prêtre en pourpoint, armés et accompagnés de 50 soldats; ils les attaque, s’empare de leurs personnes et de cinq de leurs compagnons d’armes, qui furent emprisonnés au château de Moudon jusqu’au 25 septembre. La prison n’était pas sûre, il fallut que quatre hommes gardassent les chanoines jour et nuit. Le Conseil de Savoie, avisé, fit saisir /530/ les biens que le Chapitre pouvait posséder dans les bonnes villes du Pays de Vaud et requit la médiation de Berne et de Fribourg 1. L’affaire se corsait; nous ne savons comment elle se termina; mais quelle que fût l’énergie du jeune duc Charles, il est plus que probable qu’il dut finir par céder 2.
*
* *
L’excommunication était en effet une peine redoutable; car « l’âme est plus noble que le corps; elle est comme détenue et en danger de mort par le fait de la sentence d’excommunication, chose plus grave que si le corps seul était détenu et en prison, vu que l’âme alors n’est pas privée du paradis », dit un document de l’époque 3. Pour éviter la damnation, les hommes devaient finalement en passer par où l’Eglise voulait. On comprend que le clergé ait employé cette arme, d’une efficacité certaine, lorsqu’il s’estimait lésé dans la personne de ses membres ou dans ses biens.
Mais l’abus devient manifeste quand l’Eglise met cette arme au service de laïques qui sont en procès avec d’autres laïques et donne ainsi à celui qui en bénéficie un avantage évident sur sa partie. De ce fait nous connaissons des exemples nombreux 4. Celui dont /531/ les conséquences furent les plus graves, c’est l’affaire Cornaz.
Jaques Cornaz, alias Chères, était un des bourgeois les plus importants; fils d’un riche marchand, Etienne Cornaz 1, il continuait son commerce; il avait été syndic en 1509/10; il était banneret depuis 1501 2; il faisait partie du Conseil 3. Pour une raison que nous ignorons 4, la ville lui intenta un procès. Jaques Cornaz ne recula pas devant les moyens extrêmes : il demanda et obtint à Rome un monitoire apostolique portant menace d’excommunication contre les bourgeois de Moudon. De son côté, le Conseil envoya des députés à Rome pour y solliciter la main-levée de cette peine terrible; si l’on en croit Ruchat, ils y auraient été jetés en prison 5. Quoi qu’il en soit, cette affaire donna lieu à un procès qui, d’instance en instance et d’appel en appel, dura près de dix ans.
La ville de Moudon fut obligée d’avoir un avocat à Rome 6; elle correspondait avec lui par l’intermédiaire /532/ des voyageurs, plus nombreux qu’on ne pourrait le croire, qui se rendaient dans la capitale de la chrétienté 1. C’est à Genève qu’on trouvait les meilleures occasions; c’est par les banquiers de cette ville qu’on faisait parvenir à ces agents l’argent qu’ils réclamaient avec insistance 2. Moudon perdit son procès en cour de Rome 3.
Il ne nous est pas possible d’en suivre ici toutes les péripéties. Qu’il nous suffise de dire qu’il intéressa tout le pays. Le clergé de Moudon avait pris parti pour la ville 4. Les Etats de Vaud intervinrent 5; /533/ les villes vaudoises proposèrent leur arbitrage 1; les conseillers de Lausanne, où Cornaz s’était réfugié 2, s’employèrent à rétablir la paix 3; Jaques Cornaz fut irréductible. Les Bernois et les Fribourgeois, qui profitaient de toutes les occasions pour intervenir dans le Pays de Vaud, étaient prêts à lui racheter sa créance 4. Finalement, l’évêque de Lausanne eut peur que ce débat ne favorisât la Réforme; il prit sur lui — c’était en 1527, l’année du sac de Rome — /534/ de lever provisoirement l’excommunication qui pesait sur les bourgeois de Moudon 1. Enfin, ceux-ci s’en remirent à l’arbitrage du duc de Savoie 2; en juin 1528, celui-ci, qui n’avait cessé de se tenir au courant de l’affaire, trancha le procès à son tour par une décision souveraine. La ville de Moudon était condamnée à payer 1000 écus à Jaques Cornaz 3. Toutes les protestations du Conseil furent inutiles; il ne lui resta plus qu’à verser au banneret cette lourde indemnité et tous les frais que le procès avait coûtés 4.
Les Moudonnois se montrèrent beaux joueurs; ils ne gardèrent pas rancune à Jaques Cornaz, qui conserva son poste de banneret 5. Ils se cotisèrent pour que la ville pût faire sans tarder un premier versement de 200 écus 6; comme la cause de Moudon était celle /535/ de tous les laïques du pays, les paysans riches des villages voisins — il y en avait — offrirent de prêter de l’argent 1. Pour éviter des versements immédiats en numéraire, rare à cette époque, la ville s’engagea à satisfaire les créanciers de Jaques Cornaz 2, que son procès gagné avait presque ruiné. En été 1531, elle s’était acquittée de la plus grande partie de sa dette et, en octobre 1532, le banneret lui donnait quittance définitive 3.
Il ne s’était pas écoulé beaucoup plus de quatre ans depuis la sentence ducale; il fallut un peu plus de temps pour que fussent remboursés les Moudonnois qui avaient avancé de l’argent à la commune 4; c’est en vain que celle-ci avait cherché à se récupérer auprès de ceux de ses conseillers qui l’avaient engagée /536/ dans ce malheureux procès, en particulier le notaire Michel Frossard 1.
*
* *
L’affaire Cornaz n’est pas la seule de ce genre qui ait ému l’opinion à cette époque; à plus d’une reprise, pendant la même période, les Etats de Vaud avaient protesté contre les « excommuniements »2. Le 29 mars ou le 5 avril 1519, ils s’étaient réunis à Moudon « parce que l’évêque de Lausanne avait déclaré aux curés du pays que tous leurs paroissiens étaient excommuniés » 3. C’était le moment où commençait l’affaire Cornaz, avec laquelle cet incident ne paraît pas avoir eu de rapport direct. Le 23 avril 1527 encore, à Moudon également, ils avaient décidé que, lorsqu’un des sujets du duc serait injustement évoqué devant /537/ un tribunal ecclésiastique quelconque sous menace d’excommunication, les Etats auraient soin de lui établir un ou deux procureurs, c’est-à-dire de lui fournir des avocats, pour prendre fait et cause en mains, au nom du pays 1.
Le clergé n’en avait tenu aucun compte. La juridiction ecclésiastique avait joué un rôle utile dans les temps sombres du moyen âge; au XVIe siècle, elle ne se justifiait plus. Depuis longtemps l’Eglise y avait renoncé dans les cantons suisses, sauf en matières matrimoniales, parce que ceux-ci étaient des états forts 2; elle n’était pas disposée à céder devant le faible Charles III 3, ni devant les Etats de Vaud, dont l’autorité était bien fragile. Nous en connaissons un cas cependant. En été 1529, un mandat exécutoire du vice-official de Lausanne excommuniait le mayor de Crans, le bailli de Vaud et son châtelain Jaques Cerjat à la suite d’un procès engagé par le premier contre le châtelain de Nyon, qui avait évoqué le Chapitre en garantie 4. Les Etats de Vaud protestèrent; le bailli de Vaud fit saisir le temporel du Chapitre et lui réclama plus de 3000 écus d’or d’indemnité; il semble que ces mesures énergiques, et peut-être /538/ aussi la crainte de la Réforme, aient amené les chanoines à composition dans le cas particulier 1. Mais, à chaque occasion nouvelle, malgré la crise religieuse, l’Eglise maintenait ses prétentions. Le 7 juillet 1532, en présence du Conseil général, le syndic de Moudon faisait défense au vicaire Antoine Jayet de citer quelqu’un de Moudon pour une affaire civile et temporelle. Et comme ce dernier était sans doute disposé à se plier à cette injonction, le syndic, au nom de la ville, se portait garant vis-à-vis de lui pour toutes les difficultés que son obéissance à cet ordre pouvait lui amener 2. Le vicaire, en effet, refusa de procéder contre un bourgeois de la ville et le Chapitre le menaça d’une amende; le Conseil envoya deux de ses membres à Lausanne pour protester et la caisse communale prit à sa charge les frais du procès qu’il y eut entre le Chapitre et le bourgeois de Moudon. Six mois plus tard, le vicaire Jayet étant de nouveau en butte aux menaces du Chapitre pour avoir refusé d’exécuter des poursuites de cette nature, le Conseil n’épargna aucune démarche à Lausanne pour prendre sa défense 3.
En 1533 encore, Pierre Cerjat avait fait saisir les revenus de la chapelle de Saint-Pierre fondée par ses aïeux dans l’église Notre-Dame, parce que, affirmait-il, les recteurs de celle-ci ne faisaient plus les fonctions prescrites par la lettre de fondation; il fut excommunié /539/ et nous voyons le Conseil de Moudon insister auprès d’un chanoine pour obtenir la levée de l’excommunication 1. Cela se passait trois ans avant l’établissement de la Réforme.
*
* *
Ces Conflits à propos de la justice ecclésiastique ne paraissent pas avoir provoqué alors ce que nous appellerions aujourd’hui une crise d’anticléricalisme. Nous ne trouvons pas trace de mauvais procédés ou même de rancune de la part des gens de Moudon à l’adresse du clergé 2. Au contraire. Le Conseil ne manque jamais de présenter ses hommages à l’évêque, quand il en a l’occasion : au cours de l’hiver 1519/20, il lui envoie six vacherins, achetés à Romont pour 43 ½ s. (180 fr.) et quatre moutons; en été, on lui porte à Lucens le quartier d’un cerf 3; à la veille de Noël 1521, Sébastien de Montfalcon étant en son château de Lucens, la ville lui offre de nouveau quatre moutons, qui valent 10 florins (près de 500 fr.) 4; le 10 janvier 1529, au lendemain de l’affaire Cornaz, comme il était descendu à Moudon même chez le bailli de Vaud, le Conseil lui fait porter du vin 5; en 1526, ce corps n’avait pas fait de difficulté pour le dispenser /540/ du « pontenage », à condition qu’il reconnût par un titre bien en règle que cette concession était à bien plaire et n’engageait pas la ville à l’avenir 1. Les autorités n’étaient pas moins prévenantes pour les autres dignitaires ecclésiastiques du diocèse, quand ils passaient à Moudon 2.
Elles sont dans les meilleurs termes avec le clergé de la ville; quand le Conseil dîne aux frais de la caisse communale, il invite volontiers le chapelain qui a dit la messe avant la séance, le curé ou son vicaire 3; Le premier novembre, jour de l’élection des syndics, il leur offre du vin, ainsi qu’aux recteurs des chapelles dont la ville a le patronat.
Un homme comme le notaire Michel Frossard, l’adversaire de Jaques Cornaz, donne à l’un de ses fils deux ecclésiastiques comme parrains 4. Il commence son minutaire par une prière pleine de ferveur 5, accompagnée de passages des évangiles 6; il invoque Dieu et la Trinité 7. Le scribe qui a rédigé le compte communal de 1517-8 répète au haut de chaque page /541/ les mots : Jésus Maria. Nous en pourrions citer d’autres exemples.
Cette foi, dont la sincérité ne saurait être mise en doute, se manifeste sous toutes les formes que l’Eglise admet ou recommande. On vénère les reliques : dans son testament, le curé Jean de Liserio 1 lègue à l’église Saint-Etienne une coupe d’argent et un anneau de même métal afin de faire un reliquaire pour les reliques de saint Etienne, de sainte Catherine, de saint Théodule et autres reliques honorées dans la dite église 2. En 1491, sur la demande du peuple et du clergé de Moudon, le Chapitre de Sion envoya un fragment de la cloche de saint Théodule, ainsi que des reliques de saint Maurice et de ses compagnons, de saint Sébastien et de sainte Anne 3. Des bourgeois font des vœux et vont au loin en pèlerinage 4, et les syndics se transmettent soigneusement deux lettres d’indulgence que l’on garde dans le trésor de la ville 5.
On célèbre les jeûnes 6; on fait sonner les cloches /542/ pour les morts 1; et, au printemps, quand vers la fin d’avril, ou au début de mai, les paysans craignent le gel matinal, on fait des processions avant l’aurore, au son de toutes les cloches de la ville 2; de même, plus tard, quand l’orage menace 3.
Le Conseil punit d’une amende ceux qui se permettent de travailler les jours de fêtes chômées 4, ou de jouer aux cartes pendant l’office 5, de même que les blasphémateurs 6 et ceux qui ne ferment pas leurs boutiques sur le passage des processions 7. /543/
*
* *
La piété 1 des fidèles se marque mieux encore par les donations qu’ils font à l’Eglise dans leurs testaments, ou, tout au moins, est-ce sous cette forme que nous la saisissons le mieux, car ce sont là les actes qui se sont conservés les plus nombreux. Ces libéralités sont des œuvres méritoires : les prêtres prieront pour le donateur « afin que Jésus ait pitié de lui » de son vivant déjà et après sa mort surtout 2, car « ceux-là seuls obtiendront le repos éternel », dit un ecclésiastique moudonnois, « qui auront été précédés par leurs mérites 3 ».
De leur vivant, ils choisissent la place où ils dormiront de leur dernier sommeil; seuls les gens très modestes reposent dans le cimetière qui entoure l’église Saint-Etienne 4. Dès qu’un bourgeois possède /544/ quelques ressources, il achète le droit d’être enterré dans l’église elle-même 1, dont le sol devient ainsi le cimetière des familles aisées de la localité 2.
Les testateurs demandent au clergé de prier pour le repos de leur âme; de leur générosité dépendent les services qui seront célébrés en leur mémoire. Un don de vingt sous en capital ou d’un sou de rente permet une commémoration, soit une messe annuelle 3 : le nom du donateur sera rappelé une fois par an par l’officiant. Si le donateur veut que l’on célèbre les vigiles 4, il doit se montrer plus large 5. S’il a légué une rente de vingt sous, il peut exiger une grande messe de Requiem, avec diacre, et 16 messes parlées avec vigiles 6.
Mais la fondation la plus fréquente est celle que nos documents appellent un anniversaire; les chapelains doivent célébrer les vigiles « avec notes », et, /545/ le lendemain, une messe chantée, avec cierges allumés; puis, sur la tombe du défunt, ils chanteront un Libera me ou un de profundis; après quoi, le jour même, ou le suivant, ils prendront ensemble un repas 1; à l’issue de celui-ci, ils diront les grâces et prieront pour le repos de l’âme du donateur et des siens. A ce repas doivent être invités les héritiers du testateur; parfois celui-ci en personne, s’il a délivré son legs de son vivant; parfois un représentant du Conseil de la ville, et l’on peut se demander s’il n’y a pas là comme une sorte de contrôle sur l’emploi par le clergé des revenus de la fondation 2. Le prix d’un tel anniversaire est ordinairement de 40 livres en capital ou de 40 sous de rente, soit de 4 000 à 2 000 francs en capital et de 200 à 100 francs de rente, suivant que la donation est du XVe ou du XVIe siècle; le banquet est payé par les revenus de la fondation 3. /546/
D’autres sont plus généreux encore : ils prennent des dispositions pour qu’un certain nombre de messes soient dites pendant les jours qui suivront leur décès 1; ils instituent une messe hebdomadaire 2; ils fondent /547/ un autel 1. Dans d’autres testaments nous voyons des prêtres ou des femmes laisser des joyaux ou une des pièces les plus précieuses de leur garde-robe pour que l’on en fasse un vêtement ecclésiastique 2. Le curé Jean /548/ de Liserio, nous l’avons vu 1, avait donné une partie de son argenterie pour que l’on en fît un reliquaire; il y ajoutait « une pierre en forme d’ambre avec un entourage en forme d’un serpent blanc; … cette pierre, qui est excellente contre la morsure des serpents et a déjà guéri cinq personnes », devait être enchâssée dans le reliquaire et servir avec celui-ci à décorer l’autel de Saint-Etienne les jours de grande fête; il léguait encore dix ducats pour que l’on achetât une cloche que l’on devait placer dans la chapelle de Saint-Théodule 2. Un peu plus tard, un autre ecclésiastique moudonnois, le chapelain Jean Bollion, laisse deux coupes d’argent; on devait en faire un reliquaire pour les reliques de saint Etienne, « en particulier la moitié de son corps depuis les épaules au sommet de la tête » 3. Ce reliquaire, en forme de buste, existait encore à la veille de la Réformation 4.
*
* *
Il semble que les gens de Moudon aient eu quelque goût pour la musique; il n’y avait pas d’orgues dans leurs églises, il est vrai 5; mais ils tenaient à ce que /549/ le chant des enfants de chœur embellît les cérémonies religieuses. L’exemple en avait été donné par les évêques de Lausanne du début du XVe siècle qui avaient fondé et doté, à la cathédrale, l’institution des Innocents 1. C’est ainsi que l’on appelait alors les jeunes garçons élevés par l’Eglise et destinés à être des musiciens et des choristes pendant leur jeune âge, puis à devenir plus tard des ecclésiastiques.
En 1459 déjà, nous trouvons un maître de chant à Moudon 2, mais nous ne savons pas très bien quel était son rôle; peut-être se bornait-il à enseigner dans l’école de la ville 3. S’il s’agissait d’autre chose, son activité fut de peu de durée : les documents ne parlent plus de lui. En juin 1482 encore, c’est aux Innocents de la cathédrale qu’un bourgeois de Moudon fait un legs 4. Quelques mois plus tard, le 9 novembre de la même année, Nicod Moine, entre autres libéralités, laissait au clergé une rente de 24 sous (environ 120 fr.) pour l’entretien de deux jeunes garçons auxquels on apprendrait l’art de la musique; on devait leur faire à chacun un bon surplis, une chasuble noire de futaine et un bonnet noir, le tout avec les effets du testateur 5.
Dès lors, un des chapelains fut chargé de cet enseignement. /550/ Au début du XVIe siècle, c’était Simon de Cambrex; dans son testament, il spécifiait que le maître de chant desservant l’église de Saint-Etienne devrait toujours être invité au repas anniversaire qu’il fondait 1. Il ne parlait pas de ses jeunes élèves.
Ce chapelain avait une belle plume et il copiait de la musique : en 1517, le Conseil l’avait chargé de faire un livre de chant, un antiphonaire sans doute. Les comptes de cette année et des deux suivantes portent de fréquentes mentions à ce sujet : on lui fournit des « drogues » et des « matières » pour fabriquer de l’encre, des couleurs, du vermillon, du « vernis », de la gomme, de la colle et de belles feuilles de parchemin; la ville lui paie largement son travail 2. Au bout de près de trois ans, il avait mené à chef son œuvre de patience. Mais les pages qu’il avait soigneusement copiées et enluminées n’ont pas servi longtemps dans l’église de Moudon : une quinzaine d’années plus tard, son livre était de ceux que le Conseil débitait page après page et vendait à des notaires qui en faisaient des fourres pour leurs registres 3.
Mais revenons aux Innocents. On peut se demander s’il y en avait encore 4. Peut-être, maintenant que /551/ l’argent avait baissé de valeur, les revenus de la fondation de Nicod Moine étaient-ils insuffisants. Or il y avait, à ce moment, parmi les chapelains de Moudon, un vieillard, D. Jean Vuicherens, recteur de la chapelle de la Trinité dans l’église Saint-Etienne et curé d’Attalens 1. Il avait manifesté l’intention de participer à une fondation qui pourrait entretenir quatre Innocents 2. Comme la dame de Blonay 3 était morte à la fin de janvier 1519 et qu’une cérémonie avait lieu huit jours après ses funérailles, le Conseil y envoya deux délégués porteurs de quatre torches de cire 4; il les chargea de s’arrêter à Vevey en passant et d’y visiter le curé d’Attalens qui y résidait; ils devaient le sonder sur ses intentions 5.
Ils le trouvèrent favorablement disposé et, le 26 mai, il testait entre les mains du notaire François de Bulo; il laissait à l’hôpital 1000 florins — près de 50 000 fr., pour la fondation et dotation de deux Innocents chargés de desservir les offices divins de Dieu, de la Vierge et des saints dans l’église de Saint-Etienne; en retour, les Innocents devaient lui chanter une messe de la Vierge dans sa chapelle de la Trinité, de son vivant, et, après sa mort, une messe de Requiem; il instituait aussi un repas anniversaire auquel devaient /552/ assister tout le clergé de Moudon, les Innocents, le syndic et un conseiller 1. Le Conseil lui témoigna sa reconnaissance en lui faisant porter le 25 août, à Vevey, deux écus d’or au soleil, quatre poulets, des dragées et de la pâte de coings 2. En même temps il envoyait deux conseillers à Villars-le-Comte, chez le notaire François de Bulo, avec mission de prendre connaissance du texte de l’acte 3. On peut penser que le Conseil fut quelque peu déçu d’apprendre que la donation ne prévoyait que deux Innocents au lieu des quatre dont il avait été question; il nourrissait l’espoir que le curé d’Attalens compléterait ce nombre par la suite; en décembre, il renvoyait à Vevey Fr. de Bulo et Boniface Bridel faire visite à D. Jean Vuicherens et lui parler de la chose 4. Leur démarche n’eut aucun succès.
A peu près au même moment, les mêmes délégués se rendaient à Yverdon; ils s’informaient auprès du clergé de cette ville de la manière dont on s’y était pris pour organiser une fondation analogue. Ils firent rapport au Conseil les 27 et 29 décembre 5. Le 4 janvier 1520, ce corps faisait venir Simon de Cambrex et son collègue D. Jean Chinaud et s’entendait avec eux pour la direction des Innocents 6. Tout étant prêt, /553/ on put inaugurer, en quelque sorte, la nouvelle institution; le 20 mars, quatre hommes allaient à Vevey, sous la conduite d’un conseiller, pour y chercher le curé d’Attalens; on l’amena à Moudon en « brenle », c’est-à-dire dans une litière à chevaux que l’on avait préparée exprès pour lui; à son arrivée, on lui offrit quatre pots de vin d’honneur 1. La nouvelle fondation effaçait complètement celle de Nicod Moine 2.
Jean Vuicherens mourut le 24 juin 1526; il fut enterré le lendemain devant l’autel de la Trinité qu’il avait desservi. Il ne laissait pas d’autres dispositions testamentaires. Son héritier se trouvait être Boniface Bridel, qui devait connaître ses intentions, puisqu’il avait été mêlé à toutes les négociations concernant la fondation des Innocents. Il n’y ajouta rien et se contenta de donner au clergé une cense de 40 s. pour un anniversaire avec messes basses de Requiem et grand’messe, puis Libera me sur la tombe du défunt; un repas devait suivre; cet anniversaire, qui serait précédé des vigiles et répons, devait être célébré le jour des Saints-Innocents (28 décembre) 3.
*
* *
Il pouvait arriver que, dans leur générosité, les testateurs oubliassent les limites de leurs ressources /554/ ou imposassent au clergé de trop lourdes charges; ce dernier n’hésitait pas alors à refuser ces legs. C’est ce qu’il fit lorsque mourut le dernier des Asinier 1; il avait laissé un capital de 100 florins (6000 fr.) pour que les prêtres de Moudon chantassent chaque jour les heures canoniques dans l’église de Notre-Dame. Le clergé le refusa, soit, dit l’acte, parce que ses fonctions l’appelaient à desservir principalement l’église de Saint-Etienne, soit parce que la somme léguée était trop inférieure aux prestations exigées 2.
Les églises de Saint-Etienne et de Notre-Dame ne sont pas seules à jouir des libéralités des Moudonnois. Il n’est, pour ainsi dire, pas un testament qui ne mentionne la chapelle de Saint-Eloi, où une messe devra être dite pour le repos de l’âme du défunt. Le curé Jean de Liserio s’était intéressé à la chapelle récemment construite, hors de ville 3, en l’honneur de saint Théodule; outre la cloche dont nous avons parlé plus haut 4, il lui laissa 180 livres (18 000 fr.) pour trois messes hebdomadaires et un repas « autant qu’on en pourra faire » 5. Un peu plus tard, il y fondait encore une messe annuelle et spécifiait que, à cette occasion, les chapelains du clergé devraient apporter les ornements et autres choses nécessaires 6, dont sans doute la chapelle était dépourvue. /555/
Aucun testament, non plus, n’oublie les hôpitaux, celui du Saint-Bernard 1 et celui de Saint-Jean de Jérusalem 2 et encore moins celui de la Vierge Marie, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir 3. Deux fois, nous voyons associé à ces maisons charitables de Moudon l’hôpital de Sainte-Catherine du Jorat 4. D’autres pensent aux lépreux de la maladière 5 ou aux pauvres, auxquels leurs héritiers devront offrir un repas le jour de leurs funérailles 6. Mais certaines /556/ œuvres charitables d’autrefois semblent avoir perdu leur vogue : les confréries du Saint-Esprit ne sont plus que rarement l’objet de libéralités 1. Il en est de même de la confrérie de la Conception de la Vierge 2 et de celle de la chandelle de Saint-Etienne 3. Ces organismes subsistent, mais leur activité se borne à l’emploi de leurs revenus qui sont distribués aux pauvres conformément aux intentions des donateurs.
Parfois nous trouvons exprimées dans ces testaments des idées qui nous paraissent étranges. Ainsi, le notaire Fr. de Bulo, fort riche et très libéral, recommande à sa nièce qu’il institue son héritière, « de ne pas faire souffrir son âme après sa mort » et pour cela de ne pas se montrer trop exigeante dans le règlement de sa succession, et de ne pas être dure avec ses débiteurs 4. On peut dire aussi que les plus belles largesses posthumes ne sont pas une preuve de générosité, puisque ces biens que l’on donne sont ceux qui nous échappent. Cependant, il serait injuste de méconnaître les préoccupations charitables et les sentiments délicats 5 /557/ que nous avons rencontrés bien souvent dans les actes que nous avons eus sous les yeux.
*
* *
Une chose est certaine : leur libéralité est une preuve de leur docilité aux enseignements de l’Eglise; ils croyaient au mérite des œuvres et la Réforme, qui se répand, ne réussit pas à les atteindre dans leurs croyances. Quoique la ville fût placée sur une route très fréquentée, malgré le passage continuel de Bernois et de Genevois réformés, les idées nouvelles n’y trouvent guère d’écho, pas plus que dans le reste du pays savoyard.
Quand, le 23 mai 1525, les Etats de Vaud étant réunis à Moudon, le châtelain, Louis Pomel, proposa au nom du bailli que l’on prît des mesures contre « les mauvaises, déléales, faulces et hérétiques allégations et opinions de ce maudit et déléal hérétique et ennemy de la foy chrestienne, Martin Leuter », les représentants de Moudon, François de Glane, seigneur de Villardin, François de Bulo et Michel Frossard furent les premiers à les approuver. Les Etats, « pour maintenir la foy Chrestienne ainsi que vrays Chrestiens doivent faire », décidèrent que personne ne devait ni acheter ni garder des livres de Luther; si l’on en trouvait, ils devaient être brûlés, personne ne devait soutenir les opinions de celui-ci sous peine de trois jours de prison et de trois estrapades de corde; en cas de récidive, le coupable serait brûlé comme hérétique. Et les Etats, si pointilleux d’ordinaire sur les franchises du pays, déclaraient /558/ qu’aucun privilège, aucune liberté ou franchise quelconque ne pourraient être invoqués dans ce cas 1.
Cette décision intervenait au moment où le procès Cornaz agitait et inquiétait les gens de Moudon. Bien loin d’en prendre occasion pour se détacher de l’Eglise, le Conseil se hâta de faire faire par le secrétaire une copie authentique de ces « statuts » et de l’envoyer à Rome avec d’autres pièces 2, pour bien montrer qu’ils ne songeaient pas à se soustraire à l’obédience du pape.
La diffusion des idées luthériennes préoccupait cependant les autorités : les Etats de Vaud en discutèrent de nouveau le 18 novembre 1526 3 et, le 4 février 1528, ils confirmaient l’édit de 1525 4. Quinze jours auparavant, la crainte de l’hérésie avait poussé Sébastien de Montfalcon à relever provisoirement de l’excommunication des conseillers de Moudon qui en avaient été frappés à propos du procès Cornaz 5. /559/ Dans l’arrière-automne de la même année 1, les Etats de Vaud réclamaient de nouvelles mesures de répression. Tout en remerciant le prince pour un mandement contre les luthériens qu’il leur avait adressé, mandement dont ils « sont très joyeulx », disent-ils, et auquel « il voullent obéir de tout leur pouvoir », ils le « supplient commectre gens deux ou trois qui ayent gaiges pour pugnir 2 les contrevenans… car totallement sesdictz subjects ont délibérer de vivre et mourir en la foy de leurs prédécesseurs »; ils réservaient cependant les libertés et franchises du pays 3. Ce qui aggravait les inquiétudes de l’évêque et des magistrats, c’était que la propagande religieuse, qui venait de Berne, paraissait le signe avant-coureur d’une conquête prochaine 4 : « Les luthériens ne cessent de pratiquer gens et eux fortifier… », écrivait au duc un de ses agents à Berne, le 12 janvier 1529, « … car /560/ le plus grant désir quilz ayent cest de marcher sur vos pays » 1.
A Moudon même, il est vrai, l’on restait fidèlement attaché à l’ancien culte : le secrétaire commençait un nouveau registre par l’invocation de la Vierge et des saints 2; le 9 novembre 1529, à la nouvelle qu’un réformateur — c’était Farel — était venu à Lausanne avec l’intention d’y prêcher et que, s’il n’avait pas réussi encore à s’y faire entendre, un fort parti ne demandait pas mieux que de le voir revenir 3, le bailli et le Conseil, d’un commun accord, chargèrent le secrétaire d’écrire en hâte à Romont, à Rue et à Morges pour inviter les magistrats de ces villes à faire une démarche auprès de l’évêque, du Chapitre et des Conseils de la ville et les inviter « à ne pas permettre que le prédicateur luthérien qui était venu à Lausanne y prêchât 4 ». Le mercredi 10 novembre, de bon matin, Jaques et Pierre Cerjat, ainsi que Claude de Glane, étaient à Lausanne et s’y /561/ acquittaient de la mission dont ils avaient été chargés 1. Nous ne savons s’ils y rencontrèrent les députés des autres villes, mais ils n’empêchèrent pas les autorités de Lausanne de se préparer à accueillir Farel; s’il ne put y prêcher, ce fut à cause de l’opposition du clergé 2.
La situation s’aggravait. Le 17 décembre, au reçu de nouvelles inquiétantes, le Conseil de Moudon faisait convoquer précipitamment les Etats de Vaud pour le dimanche 19, malgré qu’il tombât une pluie diluvienne et qu’on eût de la peine à trouver des messagers pour remettre de porte en porte les convocations des villes et des seigneurs 3.
Comme on le voit, il y avait un parfait accord entre les gens de Moudon et le bailli de Vaud qui partageait leur haine de la Réforme. Mais, malgré toutes les mesures prises, les idées nouvelles gagnaient du terrain; Lullin était obligé de le constater lui-même : dans une lettre au duc, il déclare que tous les jours il appliquait l’estrapade à quelque luthérien 4. Le bailli de Vaud se vantait pour se faire bien /562/ voir de son maître; si le nombre des réformés mis à la torture avait été considérable, nous le saurions et Berne serait intervenue, comme elle le fit ailleurs, pour protéger ses coreligionnaires. Il ne faudrait donc pas croire que le spectacle de ce supplice ait pu être quotidien à Moudon.
Cependant, en avril 1530, le bruit courut que les gens de Cudrefin allaient adopter la Réforme. Les Etats de Vaud furent convoqués en toute hâte pour le 19 1. Trois mois ne s’étaient pas écoulés, qu’ils devaient se rassembler à nouveau. C’était à Payerne cette fois que l’incendie menaçait : on disait que, dans cette ville comme à Cudrefin, la majorité de la population avait autorisé la prédication du « misérable Farel » 2, que, pour la première fois, le secrétaire appelle par son nom.
A vrai dire, nous ne sommes pas certain que Farel /563/ ait passé par Payerne en juillet 1530 1. Quoi qu’il en soit, le 23 de ce mois, le bailli de Vaud, accompagné des députés des bonnes villes, se rendit en mission à Payerne pour y maintenir le culte catholique; Pierre Cerjat et Michel Frossard y représentaient Moudon. Cette démarche intimida les réformés; pendant quelques mois on n’entendit plus parler d’eux.
Mais le feu couvait sous la cendre et il n’était plus au pouvoir de personne de l’éteindre. En juin 1531, les Etats de Vaud durent intervenir de nouveau. Payerne désirait renouveler sa combourgeoisie avec Berne; la république exigea que la ville laissât prêcher librement l’Evangile; Farel, qui était à Berne, accourut et essaya, le dimanche 18, de prêcher la doctrine nouvelle à Payerne; il en fut empêché par une émeute et faillit y perdre la vie 2. A Moudon, on s’émut fort. Dans le premier élan de leur indignation, le bailli et le Conseil décidèrent d’aller se plaindre à Berne, d’où venait tout le mal. Vers le 21 juin, Aymon de Genève, Pierre Cerjat et le notaire Jean Luysii partaient courageusement. Ils ne dépassèrent pas Payerne 3, /564/ soit qu’à la réflexion ils se fussent repentis de leur hardiesse, soit que, Farel ayant quitté Payerne, ils aient trouvé la situation moins grave qu’ils ne l’avaient craint, soit que les députés des autres villes aient manqué au rendez-vous. Le 26, les Etats, convoqués d’urgence, se réunissaient à Payerne même et confirmaient une fois de plus les statuts de 1525 1.
Quelques mois plus tard, sur le champ de bataille de Cappel, la cause de la Réforme subissait une défaite qui, sur le moment, parut irrémédiable. Les partisans des idées nouvelles durent se taire pendant quelque temps. Mais, dès le printemps 1532, la situation des réformés s’étant raffermie en Suisse, Berne put reprendre sa politique confessionnelle et étendre de nouveau son bras protecteur sur tous ceux qui partageaient sa foi. Les « évangéliques » de Payerne affirmèrent alors hautement leurs convictions 2.
Ces manifestations de l’esprit nouveau ranimèrent l’inquiétude des catholiques dans le Pays de Vaud et à la cour de Savoie. A une date que nous ne pouvons préciser, le prince lui-même écrivait à Lullin : « Je suis fort marri de ce que cette secte de Luther vient si avant. Gardez que mes pays n’en soient infectés 3. » /565/
Les réformés de Payerne se plaignaient d’être entourés de tous côtés de villes et de villages dont les habitants les menaçaient 1. Parmi ces voisins malveillants, il faut certainement placer les gens de Moudon. Ils n’avaient eu jusqu’ici aucun différend avec leurs amis de Payerne, mais ils ne pouvaient comprendre qu’ils abandonnassent l’ancienne foi. Au début d’avril 1532, ils leur envoyaient Pierre Cerjat et Rod. Demont « à cause de la Secte luthérienne, parce qu’on disait que plusieurs bourgeois de Payerne voulaient l’adopter 2 »; sans doute avaient-ils pour mission de les en détourner. Trois semaines plus tard, Boniface Bridel et Jean de Martherenges y accompagnent le châtelain Jaques Cerjat 3; il s’agissait, cette fois, de deux réformés qui avaient été incarcérés pour avoir abattu une croix 4. Il n’est pas interdit de penser que les députés de Moudon avaient pour mission de demander qu’ils fussent punis.
Dans les premiers jours de mai, à la suite d’incidents que nous ignorons, les Etats de Vaud furent convoqués d’urgence pour le lundi 6 5. Le résultat de leurs délibérations fut que Boniface Bridel, Claude de Martherenges et d’autres députés des bonnes villes furent envoyés à Payerne avec le bailli de Vaud pour poser catégoriquement aux gens de Payerne cette /566/ question : « Voulez-vous être luthériens ou non ? » 1 Nous ne savons ce que ceux-ci répondirent.
En juin, Charles III visita son Pays de Vaud 2; à cette occasion, il y eut plusieurs séances des Etats. A celle du 25 juin, à Morges, les représentants du pays insistèrent pour que des mesures fussent prises contre l’hérésie qui s’étendait; le duc, qui ne demandait pas mieux, approuva toutes les propositions qui lui furent faites à ce sujet 3.
Le 29 décembre, les Etats de Vaud s’occupèrent encore de la même question 4, mais ils ne prirent aucune résolution, semble-t-il. L’homme est ainsi fait qu’il s’habitue à tout, même aux pires malheurs. Comme la Réforme gagnait toujours du terrain à Payerne, il fallut bien s’accommoder d’une situation que l’on ne pouvait plus modifier.
Du reste, la foi nouvelle s’étendait partout : le 17 février 1533, deux magistrats fribourgeois passaient à Moudon et descendaient à l’auberge de dame Alexie Martin; tandis qu’ils soupaient, les conseillers de Moudon vinrent leur tenir compagnie et leur offrir à boire; au cours de la conversation, il apprirent que ces députés se rendaient à Genève « à cause de la secte luthérienne qui se préparait à régner en cette ville » 5. /567/
Que pouvait-on bien faire encore pour s’opposer à un mouvement si puissant ? Le 10 janvier 1534, sur l’ordre du jour des objets à traiter par les Etats, la « foi catholique » figurait en bonne place à côté de « l’autorité du duc » et du « bien de la patrie 1 »; mais ces mots résonnent comme une formule vide. Quand les Etats se réunirent à nouveau le 1er mars, deux ambassadeurs fribourgeois se présentèrent devant eux; ils leur demandèrent si le Pays de Vaud voulait les aider à lutter contre les luthériens 2. Nous ignorons la réponse qu’ils reçurent. Tout nous porte à croire qu’elle fut affirmative, mais il est certain qu’elle ne fut suivie d’aucun effet. Dans notre pays, on se résigne volontiers à l’inévitable et l’on aimé à laisser couler le flot que l’on ne peut plus endiguer.
Pour les deux dernières années du régime savoyard nous ne trouvons, dans les archives de Moudon, qu’une seule mention relative aux conflits confessionnels : Le dimanche 14 février 1535, les réformés de Payerne, sans en avoir reçu la permission de leurs magistrats, avaient célébré leur culte dans l’église paroissiale de leur ville 3. Cet acte d’audace, présage d’un triomphe prochain, mit hors de lui le bailli de Vaud. Il protesta avec véhémence à Berne et à Fribourg, et il convoqua /568/ les Etats de Vaud 1. Ceux-ci désignèrent des députés qui l’accompagnèrent à Payerne, à Fribourg et à Berne 2. Pendant qu’ils accomplissaient leurs démarches diplomatiques, le Conseil de Moudon députait à Payerne deux de ses membres, Boniface Bridel et Jaques Créaturaz, avec mission d’exposer aux Payernois les dangers que le pays pourrait courir du fait de la « secte luthérienne 3 ». Ce ton résigné n’est-il pas la preuve qu’à Moudon l’on ne se faisait plus beaucoup d’illusions sur le sort du culte catholique à Payerne ?
*
* *
A notre connaissance, Payerne est la seule ville du Pays de Vaud savoyard où la Réforme ait pénétré avant 1536. Mais si, partout ailleurs, les habitants sont restés attachés à l’ancien culte, ils n’ont pas été sans subir le contre-coup du mouvement réformateur. Quoique, au début, on ait voulu faire passer Luther et ses disciples pour des hommes de plaisir 4, il fallut /569/ bientôt se rendre compte que les réformés ne s’attaquaient pas seulement aux dogmes catholiques, mais qu’ils luttaient aussi contre les mauvaises mœurs.
Il ne semble pas qu’à Moudon l’inconduite ait été pire qu’ailleurs; les naissances illégitimes n’y étaient pas en nombre inquiétant 1. Cependant tout n’allait pas pour le mieux dans la ville. Le règlement du Conseil, de 1512, prévoyait que, si l’un de ses membres était accusé d’entretenir une concubine, il devait être admonesté; s’il ne réformait pas sa conduite, il devait être exclu du Conseil, car « celui qui fait la loi doit l’observer 2 ». Le 31 juillet 1522, le Conseil décidait d’expulser les femmes de mauvaise vie 3. Le 23 octobre suivant, nous trouvons un bourgeois /570/ condamné à 30 s. (100 fr.) pour avoir logé dans sa maison telle femme désignée par son nom. Le 17 septembre 1523, un autre bourgeois est condamné pour le même fait, tandis qu’un troisième est mis à l’amende pour avoir hébergé certaines femmes 1. En 1533, un autre était condamné pour avoir logé une femme qui se conduisait mal, mali regiminis 2. Le 5 mars de la même année, on répéta l’ordre d’expulsion de 1522 : toutes les courtisanes et leurs souteneurs devaient quitter la ville sous la peine de l’estrapade de corde 3 — c’était précisément le châtiment dont on menaçait les réformés. — Toutes ne s’exécutèrent pas; elles furent alors incarcérées dans la Tour. Le mari de l’une d’elles voulut empêcher qu’on emmenât sa femme; il résista aux agents et fit du scandale, ce dont il s’excusa plus tard devant le Conseil 4.
L’inconduite des prêtres était un fait beaucoup plus grave et qui justifiait les attaques des « luthériens ». Au printemps de l’année 1523 déjà, Sébastien de Montfalcon était intervenu : dans un synode tenu à Lausanne, il avait condamné les prêtres concubinaires et rappelé son clergé à l’obligation de la continence 5. Nous avons vu qu’à Moudon même il n’était pas toujours obéi et que le Conseil avait pris des /571/ mesures contre un des chapelains 1. Le 7 novembre 1535 encore, la même autorité menaçait d’une amende de 60 s. (150 fr.) les prêtres qui entretiendraient publiquement des concubines 2.
L’influence des idées nouvelles se fait sentir autrement encore. La prédication était la meilleure arme des réformés; la lecture et l’explication de la Bible formait l’essentiel du nouveau culte dont les « prédicants » étaient les champions. Le texte des Saintes Ecritures était si mal connu que, lorsque ces exhortations et ces récits étaient mis en langue vulgaire à la portée des populations, celles-ci les écoutaient émerveillées. Les catholiques finirent par s’en apercevoir; ils essayèrent d’emprunter aux réformateurs certaines de leurs méthodes.
Parmi les vœux présentés le 17 avril 1528, à Chambéry, lors de la séance des trois Etats de Savoie 3, les délégués des Etats de Vaud présentaient le suivant : « Pour entretenir et nourrir le peuple en toute fermeté, ferveur et dévotion, plaise a notre tresredoubté seigneur prier messieurs de lesglise et leur intimer de commectre vicaires et aultres leurs suppos 4 qui soyent si gens de bien et qualiffiés qui saichent prescher notre saincte foy catholicque, les commandementz de la loy divine et de saincte esglise, principallement /572/ toutes les dimanches ». A cette requête le duc fit répondre : « Monseigneur le veult, prie et intime ausdicts seigneurs prelatz dainsi faire, ce quilz luy ont accorde et promys 1 ». Et le premier décembre de la même année, le représentant du prince, en ouvrant les Etats en son nom 2, exhorta tous ses sujets à faire leur devoir, en particulier « les ecclesiaticques a prier dieu, maintenir et prescher la foy, vivre bien et vertueusement montrant bon exemple aux laiz 3. »
Nous ne savons pas quel fut, à Moudon, l’effet de ces bonnes résolutions. En septembre 1535 encore, — ce devait être la dernière fois 4 — un moine prêchait les « grandes indulgences du jubilé 5 ». Quelques semaines plus tard, le 7 novembre, le Conseil et la communauté intimaient au curé et au vicaire l’ordre de lire chaque dimanche, en célébrant la messe, les dix commandements 6.
Les gens de Moudon restaient sincèrement attachés à la religion de leurs pères, mais, sans s’en rendre bien compte, ils avaient fait une première concession à l’esprit nouveau. Le temps n’était pas loin où ils devraient en faire beaucoup d’autres.
CHAPITRE XXII
MOUDON A LA VEILLE DE LA CONQUETE BERNOISE.
La commune
Combien y avait-il d’habitants à Moudon ? Nous ne le savons pas exactement 1. La statistique est une préoccupation très moderne. Cependant nous avons quelques indications : dès la fin du XVe siècle, la coutume s’établit d’offrir à tous les ménages de la ville un ou deux pots (1 ½ ou 3 lit. environ) de vin le jour de la Toussaint. Les comptes nous donnent ainsi des chiffres précis, 162 feux pour 1469, 191 pour 1474, près de 200 pour 1477, 170 pour 1478. En 1524, ce chiffre est de 215; il descend à 206 en 1528; il est de 224 en 1534, pour revenir à 215 en 1535 2.
Nous avons encore, parfois, la liste complète de tous ceux qui ont participé à la distribution 3 et nous /574/ pouvons constater que l’administration municipale était fort large; on y voit figurer les noms de plusieurs membres du clergé 1, des veuves 2, des orphelins, des assistés, les lépreux. Dans ces conditions on ne peut guère compter plus de 5 à 6 personnes par ménage, ce qui nous donnerait une population de 1200 âmes environ 3.
Au sein d’une population aussi restreinte, tout le monde se connaît; on emploie les prénoms, de préférence aux noms de famille, comme dans un village. Tous s’intéressent aux circonstances particulières de chacun; ainsi, lorsqu’une personne se marie, le Conseil lui fait offrir quelques pots de vin « au souper de ses noces » 4. /575/
Il y a deux catégories de personnes : les bourgeois et les habitants; à bien des égards, on ne fait guère de différence entre eux 1. Ils sont soumis les uns et les autres à des charges semblables; mais les habitants n’ont pas part à tous les avantages des bourgeois : en particulier, ils doivent payer une redevance pour pouvoir envoyer paître leur bétail sur les pâquis communs 2, dont ils ne sont pas copropriétaires. Aussi, tous ceux qui le peuvent acquièrent la bourgeoisie, qui n’est pas fermée. Le nouveau bourgeois est admis par le Conseil 3 et présenté par lui au châtelain, ou même au bailli de Vaud en personne, qui lui fait prêter serment 4.
L’admission à la bourgeoisie, qui coûtait une ou deux livres (100 à 200 fr.) au début du XVe siècle 5, se paie 3 livres (près de 250 fr.) un siècle plus tard 6; celui qui n’a pas de maison en ville doit s’acquitter d’une redevance annuelle de 12 deniers (env. 4 fr.) 7. C’est une prestation supplémentaire, qui remplace la garantie offerte à la ville par le bourgeois du fait /576/ qu’il y possède un immeuble 1. Il n’est pas impossible que le fisc savoyard ait encaissé, lui aussi, un émolument 2.
A partir du 8 mai 1533, le nouveau bourgeois verse une contribution supplémentaire d’un florin (30 fr.); avec les sommes ainsi obtenues, la ville achètera deux « seringues » et des seillons de cuir bouilli 3, qui serviront en cas d’incendie. Le 4 novembre 1535, nous voyons les bourgeois nouvellement reçus offrir un dîner aux conseillers, aux syndics, au secrétaire et au maître d’école 4, mais nous ne savons pas s’il s’agit là d’une gracieuseté ou d’une obligation nouvelle.
Cette aggravation du coût de la bourgeoisie ne la ferma pas; il y avait eu 3 admissions en 1516 5 et 6 entre 1517 et 1534 6; il y en eut 10 en /577/ 1535 1. La bourgeoisie est un privilège héréditaire 2. Les propriétaires du voisinage, par exemple les abbayes de Montheron et de Haut-Crêt, le recherchent et paient pour cela une redevance annuelle 3. Il en est de même de certains communiers de Chavannes; le 1er décembre 1530, six d’entre eux, quatre Dutoit, un Durussel et un Décosterd, renouvellent leur serment de bourgeoisie; ils jurent « d’être bons et fidèles à notre illustrissime seigneur le duc et à la ville de Moudon, de chercher leur prospérité et d’éviter leur dommage et préjudice de tout leur pouvoir, et de faire tout ce qui est du devoir des vrais et honnêtes bourgeois » 4.
A côté d’avantages d’ordre économique, la bourgeoisie /578/ donne à celui qui la possède des privilèges honorifiques et juridiques; ainsi, en vertu du serment qu’il a prêté comme bourgeois 1, sa parole fait foi, devant l’autorité municipale et même devant les tribunaux 2. Aussi, cette dignité, dont on se pare comme d’un titre, n’est-elle accordée qu’à des personnes honorables : tel candidat, pour l’obtenir, doit s’engager à payer les dettes de son père 3.
Il n’y avait pas de registre des bourgeois et nous ne pouvons dresser la liste de ceux-ci. Mais nous pouvons tirer des comptes de la commune le rôle à peu près complet des habitants de la ville. Des 148 familles représentées à Moudon le 1er novembre 1534 4, 29 sont encore bourgeoises de cette localité aujourd’hui 5. En voici les noms : Borel, Braillard, Bridel, Busigny, Cerjat, Chatelanat, Cornaz, Créaturaz, Demierre, Faucherre, Frossard, Gindre, Golay, Guex, Jayet, Jossevel, Maquelin, Nicati, Pache, Papaud, Pidoux, Poëterlin, Porchet, Roberti, Thomas, Tissot, Violet, Voruz et Wagnière.
*
* *
Réunis en assemblée, les membres de la communauté, nobles 6, bourgeois et habitants 7 forment le Conseil /579/ général 1 ou le commun. La séance ordinaire, le jour de la Toussaint (1er novembre), a toujours lieu dans le « chancel » 2 de l’église de Notre-Dame 3. Quand il est convoqué à l’extraordinaire, un dimanche presque toujours 4, c’est là qu’il siège aussi 5, mais, parfois, il se réunit à l’hôpital 6, où il y a des salles suffisantes.
Le nombre des assistants est très irrégulier : de 50 à 60 au XVe siècle 7, il s’élève au XVIe, pour une séance ordinaire, jusqu’à 102 8; les séances extraordinaires sont beaucoup moins fréquentées; il n’y a souvent que de 20 à 30 assistants 9; il est vrai qu’elles ne sont pas suivies, comme les autres, d’une distribution de vin.
Les compétences du Conseil général ne semblent /580/ guère avoir changé depuis l’origine 1; nous ne le voyons plus cependant donner décharge de leurs comptes aux syndics. Les documents, plus nombreux que par le passé, nous le montrent légiférant en matière de police : le 1er novembre, dans sa séance ordinaire, il confirme les « statuts » 2, c’est-à-dire le règlement de police municipal; il le modifie suivant les besoins du moment; il fixe le prix du vin 3; il règle minutieusement la police des auberges, le taux et le mode de perception du longuel, les obligations des fourniers; il prend des dispositions pour le pâturage ou le marché 4. Les plus complets de ces règlements sont ceux de 1528 et de 1535 5 : on y trouve des mesures à propos de la peste ou du pacage du bétail, contre le jeu, le blasphème ou le port d’armes; nous les avons déjà relevées 6. En voici quelques autres : il est interdit à un propriétaire de louer tout ou partie de sa maison, ou de recevoir chez lui un étranger, sans l’autorisation du Conseil; les aubergistes doivent avoir des lanternes; on leur enjoint, ainsi qu’aux fourniers, de refaire leurs cheminées; on menace du pilori les maraudeurs 7 et de l’estrapade les receleurs 8; on fait de la dénonciation une obligation civique. /581/
D’ordinaire, semble-t-il, les décisions étaient prises à l’unanimité et sans débats. Parfois, cependant, l’opposition faisait entendre sa voix : le 1er novembre 1522, l’assemblée refusa de confirmer pour l’année suivante l’interdiction aux particuliers de louer sans l’autorisation du Conseil, bien que cette autorité eût demandé le maintien de cette disposition 1. Le 1er novembre 1533, tous les « statuts » furent confirmés sans discussion sauf un : 13 bourgeois, dont un membre du Conseil, insistèrent pour que l’on abrogeât l’article qui interdisait tout négoce avec les villes où régnait la peste; ils voulaient pouvoir aller acheter de la laine à Fribourg; la crainte de la contagion l’emporta sur les préoccupations commerciales; ils furent battus 2.
Pour avoir force de loi, ces règlements de police devaient être chaque fois approuvés par le châtelain 3; il ne semble pas que ce magistrat ait jamais refusé de le faire.
*
* *
Nous ne voyons pas que le Conseil général se soit occupé de politique; celle-ci était du ressort du Conseil /582/ étroit 1. Pas plus qu’autrefois, le nombre des membres de ce Conseil n’est strictement fixé. Il semble qu’en principe on se soit arrêté au chiffre de douze; mais fréquemment il n’est pas atteint et parfois il est dépassé.
Le Conseil se recrute par cooptation, chaque fois qu’il le juge utile. Ainsi, le 30 octobre 1522, « sur l’humble requête » de Nicod de Prez, donzel de Rue, de Boniface Bridel et de Michel Frossard, les conseillers consentent à admettre dans leur sein Jean Philippon 2; le 13 novembre, Jean Luysii est reçu également « sur sa demande », ainsi que Rodolphe Demont 3; le 3 mars 1530, le Conseil admet quatre nouveaux membres 4; de même le 24 mars 1532, « sur la demande des bourgeois » 5. Le 12 mars 1534, Claude de Glane 6 est admis à son tour. Les nouveaux conseillers prêtent serment entre les mains du châtelain 7 ou d’un autre officier de justice 8. /583/
Primitivement, le Conseil se confirmait lui-même chaque année 1; cet usage tomba peu à peu en désuétude; il est signalé pour la dernière fois au printemps de l’année 1516 2. On peut dire que, dès lors, cette charge est devenue viagère, en fait sinon en droit 3; il faut avoir commis un acte délictueux pour être destitué 4.
Ce corps, qui n’est point issu du suffrage populaire, se recrute parmi les personnages les plus considérables de la ville. Nous y trouvons Jaques de Glane 5 et Humbert Cerjat. Dans ces familles, les fils succèdent à leurs pères et les neveux à leurs oncles; on ne voit aucun inconvénient à ce que deux ou plusieurs proches parents s’y rencontrent en même temps 6. Le Conseil s’honore de compter dans son sein les nobles seigneurs qui habitent en ville; leurs noms figurent toujours en tête des listes des conseillers. Même le bailli de Vaud Jean d’Estavayer ou, plus /584/ tard, le châtelain Jaques Cerjat, seigneur de Denezy 1, assistent au Conseil quand il leur plaît 2, non pour le surveiller ou le présider, mais parce qu’ils sont attachés à la ville par tout un passé; ce ne sont pas leurs fonctions, c’est leur naissance qui leur en donne le droit. Les autres conseillers sont presque toujours des notaires 3.
L’usage tempérait ce que ce régime pouvait avoir d’oligarchique. Pour garder le contact avec l’opinion publique, le Conseil s’adjoignait fréquemment quelques bourgeois, chaque fois que cette collaboration paraissait utile 4. Le 31 décembre 1517, le nombre de ces « adjoints du commun » est de neuf 5.
Mais cette précaution ne semble pas avoir prévenu tous les mécontentements. En 1530, le nombre des membres du Conseil étant réduit à 9, ce corps se /585/ compléta en recevant 4 nouveaux membres 1, sans réussir à satisfaire toutes les ambitions. Le dimanche 24 juillet, 16 personnes, représentant le Conseil général, réunies dans la maison de l’hôpital, désignaient à l’unanimité 12 bourgeois auxquels elles donnaient pour mission d’assister le Conseil dans les délibérations importantes et difficiles où il serait, sans cela, nécessaire de consulter le Conseil général; ils vérifieraient les comptes 2. C’était transformer en une institution définitive ce qui, jusqu’ici, n’avait été qu’un usage. Peut-être les circonstances, qui étaient graves 3, y poussaient-elles aussi.
Le 3 novembre suivant, nous voyons le Conseil nommer lui-même ces douze bourgeois, dont quatre devaient fonctionner comme vérificateurs des comptes; le dimanche 6, le Conseil général, représenté par 23 de ses membres et les conseillers, donne à ces adjoints pleins pouvoirs en ratifiant à l’avance tout ce qu’ils feraient; sur-le-champ, à genoux et les mains jointes sur les évangiles, ils sont assermentés par le bailli 4.
Cette nouvelle institution ne paraît pas avoir répondu à un besoin profond; les adjoints ne s’intéressaient que médiocrement aux affaires de la ville /586/ et, le 17 août 1531, on prévoyait déjà une amende pour ceux qui n’assisteraient pas aux séances 1. Le 4 novembre, le Conseil désignait encore ceux qui devaient fonctionner pour la nouvelle année 2; mais ils ne sont plus mentionnés dans le registre du Conseil.
Quelques mois plus tard, de nouvelles difficultés se produisirent 3; le 24 mars 1532, le Conseil acceptait dans son sein quatre nouveaux membres 4, pris parmi les adjoints des années précédentes. Cela ne parut pas suffisant : le 24 juillet, nous voyons 18 bourgeois s’adjoindre aux conseillers 5; le jeudi 24 avril 1533, le Conseil décide de choisir dorénavant 24 adjoints, chargés de représenter la communauté; ils ne pouvaient refuser cette charge et recevaient pleins pouvoirs du Conseil général. Celui-ci ratifia cette résolution 6.
Il est bien difficile de savoir quels calculs et quelles intrigues se cachent derrière ces décisions; la fixation d’un nombre d’adjoints double de celui des conseillers pourrait faire croire à un désir de majoriser ceux-ci; d’autre part, on peut se demander si, en créant un intermédiaire entre lui et les bourgeois, le Conseil ne songeait pas à faire disparaître peu à peu le Conseil général, de même que les Conseils des Deux-Cents /587/ avaient fini par se substituer aux assemblées générales des bourgeois dans la Suisse allemande.
Quoi qu’il en soit, le Conseil de Moudon ne se pressa pas de désigner ces adjoints dont il s’était prudemment réservé l’élection; il n’y procéda que le 28 août. Après qu’ils eurent été assermentés, on les pria de confirmer un règlement de police fait par le Conseil trois semaines auparavant, confirmation bien superflue, semble-t-il, car cette ordonnance, déjà publiée dans toutes les règles, était depuis plusieurs jours en vigueur 1. Après quoi l’on s’en fut dîner aux frais de la commune 2.
Il ne paraît pas que, depuis, les choses soient alléés beaucoup mieux. Les mécontents continuaient à se plaindre. Lassé, le Conseil se fâcha. Le 7 novembre 1535, il fit prendre par 40 bourgeois, réunis en Conseil général, la décision suivante : Lorsque dans une séance du Conseil ou du commun quelqu’un aura donné son opinion, plus personne ne doit critiquer, ni murmurer, ni dans le Conseil, ni en ville dans les rues ou dans les tavernes. Le coupable sera privé d’assister au Conseil ou au commun, jusqu’à ce qu’il ait été rappelé 3. Nous ne savons pas si cet ukase réussit à réduire l’opposition au silence.
Le Conseil se réunit toujours le jeudi 4, de bonne /588/ heure le matin. Avant la séance, les conseillers doivent entendre la messe à l’hôpital 1. Le notaire Jean Crespy, qui avait été membre du Conseil et avait légué ses biens à cette institution charitable, avait spécifié que, à l’autel qu’il avait fondé à Saint-Etienne, on dirait chaque jeudi une messe du Saint-Esprit, mais jamais avant 9 heures, afin que les membres du Conseil empêchés par la séance d’aller à la messe ordinaire, pussent au moins entendre celle-ci 2.
Le Conseil siège à l’hôpital, dans la grande salle d’abord 3; plus tard 4, il se fit aménager une pièce plus confortable, que nos documents appellent « la chambre de devant » 5.
Aucun texte ne nous indique qui le préside. Dès 1507, on pouvait voir, dans la salle des séances, un règlement affiché, que tous les conseillers devaient jurer d’observer 6; il prévoit que ceux-ci doivent s’asseoir par ordre d’ancienneté, sous peine d’amende 7; on en pourrait conclure que le plus ancien assumait la présidence. Les discussions doivent se faire avec décence et avec ordre; les jurements sont interdits, /589/ sous peine d’amende, ou même d’exclusion en cas de récidive grave; de même les injures et les disputes. Il est défendu de sortir de la question ou d’interrompre les orateurs; lorsqu’ils ont fini de parler, on peut leur répondre, mais seulement « pour remettre les choses au point et non autrement ». Sous peine de l’exclusion 1, nul ne doit révéler ce qui s’est dit en Conseil. Chacun doit parler et voter selon sa conscience; les décisions sont prises à la majorité des voix 2.
Tous les conseillers doivent assister aux séances et ne pas quitter la salle avant la fin des délibérations; l’absent paie une amende de 3 s. à moins qu’il ne se soit excusé ou qu’il n’ait été à une demi-lieue de la ville 3.
Il ne faudrait pas se figurer que nos pères fussent bien différents de nous; leur assiduité aux séances du Conseil laissait parfois à désirer et il fallait de temps en temps leur remettre en mémoire le serment qu’ils avaient prêté. Ainsi, quelques mois après la révision du règlement, en 1512, six conseillers juraient à nouveau, entre les mains du vidomne, d’assister aux séances pendant un an 4. Vingt ans plus tard, en août 1531, le Conseil était obligé de rappeler à ses membres leurs obligations à cet égard et de menacer les défaillants de faire saisir des gages chez eux. /590/ Le châtelain Jaques Cerjat déclara tout net qu’il refusait de se plier à ces exigences et son cousin Pierre ne s’engagea que pour les séances ordinaires du jeudi 1. Le 24 mars 1532, une décision analogue fut prise en Conseil général et les deux Cerjat refusèrent à nouveau de s’y soumettre, ce que l’assemblée admit 2. Pour des hommes qui avaient de nombreux biens à gérer et des affaires importantes à suivre, l’obligation d’être au Conseil tous les jeudis matin était une charge.
Le conseiller doit en outre se tenir à la disposition du Conseil, un mois à tour de rôle, pour être, le cas échéant, envoyé en mission au dehors 3. Dans ce cas, les députés sont défrayés, assez largement, nous semble-t-il, et quand la vie renchérit, ils ne manquent pas de demander une augmentation de leur indemnité de route 4.
Par ailleurs, les fonctions de conseiller sont gratuites 5, à cette réserve près que, depuis 1522 tout au moins, ils s’octroient parfois au premier janvier 10 florins pour leurs « estrennaz 6 ». Mais il y a bien /591/ des petits avantages accessoires. D’abord, les amendes perçues des collègues absents sont « bues » à la sortie de la séance par les conseillers vertueux qui ont accompli leur devoir 1. Il en est de même de certaines amendes de police 2. Ces dépenses ne figurent pas, d’ordinaire, dans les comptes des syndics, ce qui nous empêche de savoir si ces occasions étaient fréquentes. D’autres ne manquaient pas. Pour peu que, le jeudi matin, les délibérations se prolongeassent, le Conseil en corps dînait aux frais de la ville 3. Des conseillers étaient-ils envoyés en mission ? Leurs collègues leur tenaient compagnie après leur avoir donné leurs instructions; à leur retour, ils s’asseyaient à table avec eux pour entendre leur « relation ». Il en était de même quand une commission avait un projet à examiner, quand on signait un contrat, quand se rassemblaient les Etats de Vaud, quand passaient des hôtes de marque, quand on choisissait les syndics, etc., etc. 4.
Cet article nous paraît revenir bien souvent dans les comptes. Cependant ce serait une erreur de croire que nous avons affaire à des festins sardanapalesques ou à des beuveries excessives. Les dépenses de ce fait sont chaque fois bien modestes 5. Surtout il ne faut /592/ pas oublier que c’est grâce à elles et aux notices par lesquelles les syndics les justifient que nous connaissons un peu de la vie et de l’histoire des vieux Moudonnois.
Les comptes sont beaucoup plus intéressants que les registres du Conseil.
On considérait ces repas comme un droit si incontestable pour les membres du Conseil que, lorsque l’un d’entre eux, malade ou absent, était empêché d’y prendre part, ses collègues lui faisaient porter chez lui sa portion ou lui remettaient en argent la valeur de son écot 1.
Sur quels objets le Conseil délibérait-il ? Nous ne le savons pas aussi bien que nous le voudrions. Il semble que, jusqu’au début du XVIe siècle, le Conseil n’ait pas enregistré ses décisions; on se contentait de dresser un acte notarié de celles qui paraissaient les plus importantes. Le premier registre que nous possédions commence avec l’année 1507 2; il ne fait aucune allusion à un volume antérieur et il débute par la copie de quelques actes, datant des dix dernières années. Pendant deux ans environ, le secrétaire — un notaire — releva soigneusement pour /593/ chaque séance la liste des présents et des absents et nota les décisions qui provoquaient ou justifiaient des dépenses 1; depuis 1509, il se borne à relever celles-ci et à donner copie de quelques reconnaissances de dettes. Pour de nombreuses séances il n’y a aucune indication quelconque. Les registres du Conseil de Moudon ne sont pas des procès-verbaux, mais des aide-mémoire en vue de la reddition des comptes; leur intérêt historique est très médiocre.
Le Conseil s’occupait de politique tout d’abord, quoique le registre soit muet à cet égard; mais nous pouvons le deviner d’après tout ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. Cette politique a pour seul but de sauvegarder les libertés, ou — pour employer un mot moderne — les privilèges de la ville, contre le clergé 2, contre les nobles du voisinage 3, contre les officiers savoyards et contre le duc lui-même 4. Que le prince ne prélève pas d’impôt, qu’il ne réclame pas de soldats, qu’il n’intervienne pas dans l’exercice de la justice; qu’il consente d’autre part à accroître les avantages dont Moudon jouit, voilà ce à quoi tend toute l’ambition des conseillers. Et si, assez souvent, ils demandent l’appui des autres /594/ bonnes 1 villes vaudoises et cherchent à grouper leurs efforts, c’est dans le but d’obtenir un avantage particulier au détriment de l’Etat savoyard. Jamais les conseillers de Moudon n’ont entrevu autre chose que cette œuvre, au fond destructrice, dont ils n’apercevaient pas le danger, hypnotisés qu’ils étaient, en quelque sorte, par leur rêve d’une autonomie toute locale.
Quand d’aussi graves sujets ne sont pas à l’ordre du jour, ils ont assez à faire avec la police de la ville; les conseillers sont responsables de l’ordre public; ils font incarcérer ceux qui le troublent 2; quand besoin est, ils mettent sur pied des veilleurs de nuit 3; ils prennent toutes les mesures 4 que les circonstances /595/ imposent; ils surveillent les pauvres 1. C’est le Conseil qui applique les « statuts » votés par le Conseil général 2 et punit les délits qui aujourd’hui ressortissent à nos tribunaux, de police ou à nos municipalités : tapage nocturne 3, port d’armes prohibées 4, bris de clôture 5, maraudage 6, etc. Sous réserve de l’approbation du châtelain 7, il édicte des ordonnances à ce propos 8.
La moitié des amendes est versée à la caisse communale; l’autre moitié revient au duc, sauf en ce qui concerne la police du bétail; dans ce cas, la ville et le prince ne touchent qu’un tiers chacun; l’autre tiers est la part du messeiller 9.
Le Conseil est fort occupé par ce que nous appellerions le commerce des denrées alimentaires et tout d’abord par la police des auberges, non pour y réprimer les excès qui pourraient se produire dans ces locaux /596/ accueillants, mais pour en contrôler la marchandise et en surveiller le débit. C’est lui, en effet, qui accorde la licence de vendre vin 1; il impose aux taverniers l’obligation d’en servir, et de bonne qualité, à tous ceux qui en demanderont; le refus d’en livrer entraîne les plus graves punitions 2; le prix de vente est fixé; les conditions du marché sont suivies de très près par l’autorité qui impose un maximum dès qu’une hausse se fait sentir. Quand les aubergistes protestent et font mine de dépendre leurs enseignes, c’est-à-dire de faire grève, le Conseil se fâche et leur répond en les menaçant de les frapper de grosses amendes et de l’interdiction de continuer leur métier 3.
Les contraventions étaient incessantes et les amendes prononcées sont très fréquentes 4. Il est plus rare que l’on ait prononcé le retrait de la patente; je n’en connais qu’un seul exemple 5. Une fois, le Conseil exclut de son sein un cabaretier qui avait exagéré ses prix 6. /597/
Après les aubergistes, ce sont les bouchers 1 qui occupent le plus le Conseil. Chez eux aussi la marchandise vendue est soumise à un contrôle sévère; un maximum des prix est établi. De là de continuelles difficultés 2. Remarquons en passant que les gens de Moudon paraissent avoir eu une prédilection pour la viande de mouton; ils tiennent à en trouver toujours sur les étals des boucheries et exigent qu’elle soit de bonne qualité 3. La contre-partie de cette réglementation est que les bouchers sont protégés contre la concurrence 4.
Le Conseil surveille aussi les fourniers et les boulangères 5. A la veille du carême, ses membres visitent les harengs et les olives, ainsi que les figues et les raisins secs qui se vendent dans les épiceries. C’est, pour les conseillers, une occasion de déjeuner ensemble, en dégustant ces produits rares 6; n’est-il pas tout /598/ naturel que la communauté régale les magistrats qui veillent ainsi à sa santé ?
Malgré son cachet agricole 1, Moudon devait se procurer au dehors une partie tout au moins du blé nécessaire à ses habitants, car seuls les gens aisés avaient des domaines; les artisans modestes étaient obligés d’acheter leur pain. L’approvisionnement en céréales y était donc, comme dans les autres villes, un souci pour les magistrats qui réglementaient le commerce du blé. Une halle pavée et couverte 2 était réservée pour le marché de cette denrée, qui ne pouvait se vendre ailleurs. On comptait par là empêcher ou ralentir la hausse des prix, et entraver les accaparements. Dans les années où le blé est cher, le Conseil n’hésite pas à mettre à l’amende les paysans qui contreviennent à cette défense 3 ou même ceux, qui ont détaché leurs sacs avant l’heure officielle d’ouverture du marché 4. Lorsque, en juillet 1525, la cherté du sel « fait crier tout le peuple », le Conseil fixe un prix maximum 5 et remet la vente exclusive à un marchand qui s’est engagé à observer ce prix.
La lecture des manuaux et des comptes nous donne l’impression que ces conseillers de Moudon étaient des hommes dévoués à la chose publique et qui voulaient la prospérité de leur ville natale. Mais, élus à /599/ vie et soustraits à tout contrôle, ils avaient des allures qui, aujourd’hui, nous paraîtraient bien autoritaires 1. Ils étaient sévères et croyaient que, s’ils devaient « protéger les bons », ils devaient aussi « chasser les méchants »; ils pensaient qu’il fallait « plutôt réprimer les vices que provoquer les vertus ». En tous cas, ils étaient très fiers du rôle qu’ils jouaient; « il est certain », affirment-ils en tête du règlement du Conseil, « que les chefs de la ville de Moudon ont brillé jusqu’ici et ont dirigé la République grâce à leurs forces de telle sorte qu’elle est apparue comme le miroir de la patrie (de Vaud) 2 ».
*
* *
Cette vanité naïve n’a rien que de très humain. Si elle dépasse — ce que nous ignorons — celle que l’on pouvait rencontrer dans les autres villes vaudoises, c’est que les conseillers de Moudon avaient sur leurs /600/ collègues un avantage : c’est parmi eux que se recrutait assez régulièrement la cour du châtelain 1; cela faisait d’eux, jusqu’à un certain point, les juges suprêmes du pays. Les registres de la Cour de Moudon — s’il y en a eu — sont perdus 2; les actes qui nous ont transmis ses arrêts ne donnent jamais au complet la liste des membres du tribunal. Nous ne possédons pas plus le rôle des juges que celui des conseillers. Cependant la plupart des noms que nous rencontrons sont communs aux deux corps 3. Cela est très naturel : le Conseil ne comptait-il pas dans son sein les jurisconsultes les plus éminents de la ville ? Il était normal que le châtelain appelât pour l’assister ces notaires influents 4.
Ce qui était un usage très ancien devint un droit à partir de 1524 au plus tard. Nous voyons, en effet, une délégation du Conseil général désigner, le 2 juin, six conseillers et sept bourgeois, qui doivent faire partie de la Cour de Moudon. Ces « élus » sont tenus d’assister aux séances de ce tribunal, le samedi et le lundi 5, sous peine d’une amende de trois sous, qui /601/ sera versée aux juges présents; ils sont, en retour, dispensés du giète et des corvées 1.
Il est certain que cela donnait aux conseillers de Moudon un prestige qui s’étendait au delà des murs de leur ville. Aussi sont-ils souvent choisis comme arbitres par des gens du dehors 2, ce qui ne peut manquer d’avoir pour eux des avantages matériels et moraux. Parfois même, le Conseil en corps fonctionne à ce titre 3; il semble que cela l’ait amené à se constituer lui-même en autorité judiciaire. Le dimanche 7 juillet 1532, le Conseil général décidait que, lorsque deux bourgeois seraient en procès, le Conseil offrirait sa médiation; si les deux parties acceptaient, le Conseil fonctionnerait comme arbitre; il trancherait dans les huit jours, au plus tard dans les quinze jours; la partie qui ne se soumettrait pas à sa sentence paierait 10 livres d’amende et pourrait être expulsée pour un an; ceci sans préjudice pour l’autorité ducale et sous réserve de son approbation 4. On comprend que les Moudonnois aient voulu mettre fin aux procès trop nombreux et trop longs qu’il y avait alors 5. Mais il est évident, d’autre part, que, si le Conseil de /602/ la ville devenait le juge ordinaire des procès civils, ce ne pouvait être qu’au détriment de l’autorité savoyarde. Nous ne savons ce que fit Charles III; il est probable que, au milieu des affaires beaucoup plus graves qui l’absorbaient, il négligea celle-ci. Il est vrai que cette mesure, fort révolutionnaire dans son essence, n’eut pas le temps de déployer ses effets.
*
* *
Un notaire fonctionne comme secrétaire du Conseil. Depuis juin 1516 1, cette charge fut confiée à Rodolphe Bondet 2, qui la conserva pendant très longtemps, bien au delà de la conquête bernoise. Il fut en même temps le greffier des Etats de Vaud 3. Son nom revient très souvent pendant toute la période de la fin du régime savoyard et les actes sortis de sa plume sont très nombreux. Quoiqu’il n’y ait jamais laissé transparaître sa pensée ou ses sentiments personnels, tout nous porte à croire que ce fut un homme d’ordre et de tête, qui acquit de bonne heure une grande expérience des affaires et joua un rôle très supérieur à celui d’un scribe ordinaire.
Le secrétaire touche un salaire de 24 s. vers 1510 /603/ (près de 100 fr. 1). Un peu plus tard, il reçoit 30 s. 2, mais on lui alloue un émolument pour chaque lettre qu’il écrit, pour chaque acte qu’il rédige, pour chaque pièce qu’il copie et, chaque fois, il dîne ou soupe aux frais de la ville, qui lui paie encore le prix de ses chandelles quand il doit veiller la plume à la main. En 1535, on y ajoute une indemnité de 6 d. (1 fr. 25) par séance du Conseil, pour l’inscription du procès-verbal sur le registre 3. En fin de compte, cela faisait une somme.
*
* *
Si l’autorité du Conseil tend à s’accroître, il n’en est pas de même de la position du syndic, qui reste un simple agent d’exécution 4.
En général, il y a deux syndics et ils restent en fonctions un an; mais il arrive qu’il n’y en ait qu’un ou que les deux syndics restent en charge deux ans, sans que nous apercevions les motifs de ces exceptions. Ce sont fréquemment des notaires, mais aussi des artisans, cordonniers ou forgerons, des négociants, des aubergistes, un maître d’école, de nobles seigneurs, des Cerjat ou des Glane. Dans ce dernier cas, il arrive que, trop occupé ailleurs, le seigneur devenu syndic se fasse remplacer par un « serviteur », c’est-à-dire un suppléant qui, sous sa responsabilité, lui tient lieu de secrétaire-comptable 5. /604/
Les syndics sont désignés par le Conseil 1 assisté des adjoints, quand il y en a, puis présentés par lui à l’assemblée des bourgeois le 1er novembre de chaque année. Celle-ci confirme l’élection, en termes flatteurs pour les élus, et leur délivre bonne et due procuration 2. Après quoi, ils prêtent serment 3.
A cette occasion, on délivre du vin à tous les ménages de la ville 4 pour célébrer le « joyeux avènement 5 » des syndics nouveaux et, quelques jours après, le Conseil s’offre, des deniers de la communauté, un repas en leur honneur. Celui du 3 décembre 1529 fut particulièrement brillant : outre les conseillers, dont Pierre et Jaques Cerjat ainsi que François de Glane, on y voyait le bailli de Vaud : « le vaillant chevalier Aymon de Genève, seigneur de Lullin » avec la « dame baillive », François de Blonay, seigneur de Carrouge et la « dame de Carrouge »; la « dame de Ropraz » accompagnait son mari, F. de Glane 6. /605/
A leur entrée en fonctions, les syndics recevaient de leurs prédécesseurs le sceau de la ville 1, auquel vinrent s’ajouter plus tard deux lettres d’indulgence attachées l’une à l’église Saint-Etienne, l’autre à Notre-Dame 2, les clefs de la « crotte 3 », petite niche voûtée qui servait de chambre forte, et parfois une ou deux pièces d’argent ou d’or 4.
La tâche des syndics n’est pas facile 5; ils doivent exécuter sur-le-champ les décisions du Conseil; s’ils ne le font pas dans les huit jours, cette autorité a le droit de leur infliger l’amende qu’elle juge convenable, qui est doublée s’ils tardent encore, à moins d’excuse valable 6. Ce ne sont pas là de vaines menaces; nous constatons dans les comptes qu’à plus d’une reprise les syndics furent frappés d’amendes quelquefois assez lourdes pour leurs négligences ou leurs fautes 7. /606/
Ils sont aussi les boursiers de la commune, autre source de difficultés et de risques; ils doivent percevoir les amendes, dont ils sont responsables 1 et à la place desquelles ils courent le danger de recevoir des mauvais propos ou des coups 2. On les tient pour responsables aussi des accidents qui pourraient survenir pour défaut d’entretien des ponts 3.
En retour, ils sont médiocrement payés. Au XVe siècle, le ou les syndics recevaient un traitement de 15 livres, soit près de 1500 fr. 4. Au XVIe siècle, ils se partagent 55 florins 5, qui ne valent pas beaucoup plus, et les petits profits qu’ils pourraient faire sont bien rares 6.
Aussi a-t-on beaucoup de peine à trouver des /607/ syndics. Le règlement communal a beau prévoir une amende de 10 livres 1 (plus de 800 fr. au début du XVIe siècle, un peu moins plus tard); plus d’un bourgeois préfère la payer et éviter cette charge 2. Celle-ci n’est assumée que par les nouveaux venus 3, qui ne peuvent faire autrement, ou par des hommes doués de plus d’esprit civique que les autres 4.
*
* *
A côté des syndics, il y a peu de fonctionnaires, au sens actuel de ce mot. Nous trouvons un huissier 5 qui, souvent, cumule ces fonctions avec celles de sonneur 6. En 1521, la police proprement dite était confiée au guet : le dimanche 13 janvier, le Conseil général, assez nombreux, se trouvait réuni à l’hôpital; vu les vols, maraudages, scandales et incendies qui se produisent de nuit, il instituait trois ou quatre guets, pour lesquels on décidait de faire une chambre dans /608/ le clocher de Saint-Etienne 1. Ils devaient veiller de 9 heures à 3 heures en été, de 9 à 4 en hiver 2; ils surveilleront les feux. Le dimanche et les jours de fête, ils feront des rondes; de même le lundi, jour du marché, les jours de foire et la veille de ceux-ci. S’ils trouvent quelqu’un sans chandelle, ils le mèneront au châtelain ou au vidomne, à moins que ce ne soit un bourgeois de bonne fame, dont la chandelle serait éteinte ou morte. Ils visiteront les auberges et veilleront à ce qu’on ne joue, ni ne fasse du scandale passé dix heures. Ils surveilleront les maraudeurs. Ils sonneront les cloches, en particulier celle de midi, pour mériter les indulgences contenues dans un bref obtenu du pape par le duc 3, ils sonneront les processions; ils sonneront le glas à raison de 20 sous si on sonne toutes les cloches, 10 sous si on sonne la moyenne et l’aumônière 4, 3 sous si on ne sonne que l’aumônière; ils sonneront gratis pour les mourants de l’hôpital. Ils recevront 3 sous des chapelains qui les feront sonner pour leurs chapelles. Ils sonneront contre le temps 5 quand ils en recevront l’ordre. Ils surveilleront et dénonceront les blasphémateurs. Pour leur salaire ils recevront un bichet 6 de blé de chaque tenant charrue et 2 sous de chaque faisant feu. /609/ Les quatre guets commencèrent leur service le 16 février 1. Ils touchèrent cette année-là un salaire de 15 liv. 2 (environ 900 fr.); puis ils disparaissent des comptes communaux, probablement parce que leurs fonctions de sonneurs furent remises à d’autres 3, et qu’ils ne gardèrent que leur tâche d’agents de police et de guets proprement dit. Payés par la population qui profitait directement de leurs services, ils ne recevaient plus rien de la bourse communale.
Le dernier fonctionnaire permanent est le fontenier, un charpentier qui prend à ferme la « conduite » des fontaines, c’est-à-dire la surveillance et les réparations des canalisations en bois qui amènent l’eau en ville 4. Ce n’est qu’occasionnellement que l’on trouve des maisonneurs 5.
*
* *
Vers la fin du régime savoyard, on créa de nouveaux fonctionnaires, les dizeniers, visiblement destinés à soulager les syndics. La première mention est du 28 août 1533; ce jour, le Conseil et les adjoints décident /610/ de les instituer 1; on se heurta probablement à quelque résistance, car, le 18 octobre, les mêmes magistrats annonçaient que, pour les récompenser de leurs peines, on dispenserait les dizeniers des giètes, soit impôts extraordinaires 2. Cela ne suffit pas à rendre l’institution populaire et c’est dix-huit mois plus tard seulement, le 25 mai 1535, que la décision du Conseil fut mise à exécution.
« Pour rabillier les chemyns et voyes et aultres chouses necessaires pour le bien public », six dizeniers étaient installés. A chacun d’eux était confié un quartier de la ville avec les fermes avoisinantes et les villages du ressort; au premier : Le Mauborget avec Chavannes, le Plan, la Faye, Bressonnaz, Ferlens 3, les Cullayes; au second : Le Pont, jusqu’à la maison de Calley et jusqu’à Saint-Etienne, avec Forel et Oulens; au troisième : Grenade, depuis et y compris la Croix-Blanche 4 jusqu’aux deux portes de la ville 5, et la rue des Tissots, avec Bussy, Tholes 6, Gréchon, Grange-Verney; au quatrième : Les Plans-Borgeaux et le Coude avec Thierrens, la Cerjaulaz, Fremont, Neyruz; au cinquième : Le Rotto-Borgeau, le Château, la Place, avec Chapelle-Vaudanne, Chalabruz, Belregard, Cornier et Sottens; au sixième : Laya et le /611/ Vieux-Bourg avec Vucherens, Hermenches, Rossenges, Valacrêt, Belflory 1.
Les six dizeniers choisis pour la première fois sont des bourgeois de condition moyenne; le seul nom à relever est celui du fils de Jaques Cornaz 2. On leur donne pour mission : tout d’abord de veiller à l’entretien des chemins, d’obliger les propriétaires bordiers à y participer, d’organiser les corvées pour cela, quand besoin est 3. Ils ont le droit d’exiger que tout habitant fasse sa part; les défaillants seront condamnés à une amende de trois sous (7 fr. 50) que le dizenier du quartier encaissera et qui sera « bue » par ceux qui auront travaillé.
Les dizeniers auront aussi la police du feu : ils visiteront les maisons et feront l’inspection des cheminées. Enfin, ils veilleront à l’équipement militaire des bourgeois; ils les conduiront aux revues 4. Ils ne sont pas rémunérés, mais ils sont francs de giète et non rééligibles. Leur charge est considérée comme un devoir civique auquel on ne doit pas se soustraire; celui qui la refuse paie dix livres (500 fr.) d’amende 5. /612/
Il y avait encore à Moudon un banderet 1. C’est ce fameux Jaques Cornaz, dont nous avons déjà parlé 2. Considérant sa sagesse, sa loyauté et ses connaissances, une cinquantaine de Moudonnois 3, réunis le mardi 7 septembre 1501 pour une revue, l’avaient élu, à l’unanimité, pour porter la bannière de la ville. Le châtelain, André de Bruel, l’avait reconnu capable de remplir cet office, mais il n’avait pas voulu recevoir son serment et avait réservé l’approbation du bailli, Jean d’Estavayer, alors absent. Ce ne fut que dix ans plus tard, le 20 mars 1511, que le duc confirma cette élection 4.
Que faut-il penser de cela ? Jaques Cornaz est le premier banderet de Moudon dont nos documents fassent mention depuis 1407 5, le premier dont ils nous donnent le nom. Venait-on de rétablir cette charge après un siècle de vacance ? serait-ce de là que viendraient les hésitations du châtelain et le retard de l’approbation ducale ? Nous ne le savons 6. Ce qui est certain, c’est que Jaques Cornaz n’eut jamais à porter sur le champ de bataille la bannière de Moudon; quand il mourut, peu après la fin de son /613/ procès, nous ne voyons pas que la ville lui ait donné un successeur.
Au reste, le banneret n’est pas un magistrat, à peine un officier. Il prend sa charge à ferme 1 et son seul rôle consiste à parader à la tête des « compagnons » de la ville en portant à bras tendu la bannière municipale.
*
* *
Cette étude de l’organisation municipale moudonnoise nous amène à cette conclusion : les institutions du passé ne suffisaient plus aux besoins nouveaux. Les affaires publiques devenant plus nombreuses et plus difficiles, bien des magistrats se trouvaient trop chargés; le souci de leurs aises ou de leurs intérêts matériels poussait beaucoup de citoyens à refuser les honneurs. Il en résultait que, ceux à qui leur fortune le permettait, ou ceux que leur goût y poussait, concentraient entre leurs mains l’administration de la ville. On essayait de créer de nouvelles fonctions afin d’empêcher la formation d’un patriciat; en répartissant les charges publiques entre un plus grand nombre de personnes, on cherchait à intéresser plus de monde à la chose publique tout en allégeant le fardeau de chacun. Il est visible aussi que l’on subissait l’influence des cantons suisses dont on était tenté d’imiter les institutions. /614/
Il ne semble pas que l’on ait réussi dans ces tentatives, qui ne sont pas spéciales à Moudon 1. Dans ce domaine comme en tant d’autres, les cadres du monde ancien craquaient de toutes parts en ces premières années du XVIe siècle.

Sceau de Christin,
recteur du Mont-Joux,
1286.
CHAPITRE XXIII
LES FINANCES COMMUNALES
Grâce aux nombreux cahiers de comptes que les archives de Moudon possèdent encore, l’état des finances communales est ce que nous connaissons le mieux du passé de cette ville.
Il est vrai que ces comptes ne sont pas tenus selon nos exigences modernes : il y a des fautes de copie et d’addition; ces dernières s’expliquent par l’absence de colonnes sur les pages, par l’emploi des nombres complexes et par la présence de plusieurs monnaies. Ils ne sont pas clairs et manquent d’ordre; parfois ils ne sont pas bouclés; ils ne balancent jamais.
Ils ont pourtant été vérifiés avec soin. Pendant le mois de novembre et de décembre, et même plus tard, les conseillers, et d’autres vérificateurs 1, ont passé des journées à les apurer; souvent, ils ont continué leur travail le soir à la chandelle. Parfois ils se sont installés dans une des bonnes auberges de la ville, où ils ont de quoi se restaurer 2; parfois ils siègent à l’hôpital, dans la salle ordinaire de leurs séances et ils s’y font apporter une collation : deux /616/ pots de vin, une miche de pain blanc — un luxe —, un quart de fromage 1, à quoi ils ajoutent une fois un quart de pommes 2.
Les vérificateurs des comptes pointent tous les articles; les syndics doivent donner des explications, justifier leurs dépenses, préciser les dates 3, présenter les reçus. Quand le bénéficiaire ne sait pas écrire, ce qui est fréquent, un notaire atteste sur le registre que l’argent lui a été livré. Si la pièce manque, le secrétaire écrit en marge : il faut apporter le reçu 4, ou même : cet article est refusé 5.
Cette vérification est sévère, trop sévère; elle est visiblement injuste. Les syndics reviennent à la charge; ils réclament; ils insistent deux fois, trois fois et plus encore. Généralement, le Conseil, à qui appartient la décision, admet quelques-unes de leurs réclamations 6. Le compte est alors bouclé, mais, comme nous dirions aujourd’hui : sauf erreur ou omission. Il n’est pas rare que l’on s’aperçoive plus tard d’une erreur 7, dont on tient compte dans la suite. Cela contribue à rendre peu claire cette comptabilité.
Il arrive trop souvent que ces discussions se prolongent /617/ et que les comptes ne peuvent se boucler ou qu’ils ne se bouclent qu’au bout de plusieurs années. Et l’argent est si rare que les soldes, de quelque côté qu’ils soient dus, ne sont réglés souvent que quinze ou vingt ans après. En voici quelques exemples :
La redevance des syndics de 1469-70 n’est établie définitivement que le 4 janvier 1491 et la part incombant à l’un d’eux est soldée par ses héritiers en novembre 1518 1, soit 48 ans après sa sortie de charge. Le compte de 1474-5 est bouclé pour la troisième fois le 14 novembre 1493, quoiqu’il manquât encore quelques reçus; les syndics ne les ayant pas présentés dans les deux mois, tous les articles non justifiés sont biffés le 8 mars 1494 et le compte est bouclé une quatrième fois, au détriment des syndics 2. Le 2 juillet 1495, Pierre de Saint-Germain s’engageait à payer à Noël, si la somme était inférieure à 10 livres (1000 fr.), par sixième à chaque Noël, si elle était supérieure, sa part du solde des comptes des années 1478 à 1480, où il avait été syndic avec Claude Gaulé 3. Et en octobre 1518, des commissions de deux membres, un du Conseil, un du commun, étaient chargées de percevoir ces soldes arriérés; il y en avait plusieurs antérieurs à 1500; le plus ancien remontait à 1473, soit à 45 ans en arrière 4. /618/
Il est vrai que ce n’est pas toujours le cas; il y eut, en tout temps, des syndics qui furent des hommes d’ordre. Le compte de 1477-8, qui bouclait par une redevance de la ville de 26 livres et quelques sous (2600 fr.), est réglé le 10 novembre de la même année 1. Celui de 1517-8 est réglé en août 1520 2. A ce moment, on fit de sérieux efforts pour améliorer la comptabilité. Le compte de 1521-2 est soigneusement tenu : la plupart des dépenses sont visées à mesure par le Conseil; vérifié dans les derniers jours de l’année et au début de 1523, le compte est bouclé et réglé le 28 janvier 1524 3. Celui de 1522-3 est réglé le 29 novembre 1526 4.
Mais ces bonnes habitudes ne durèrent pas. Le compte de 1524-5, bouclé le 28 novembre 1528, n’est pas réglé en 1533 5; le 28 octobre 1530, les syndics mettaient en poursuites l’ancien syndic Claude Fabri, recteur des écoles, pour le règlement de son compte qui ne fut obtenu qu’en 1533 6; la ville ne s’acquitta qu’en mai 1554 du solde du compte de 1530-1 qu’elle devait aux syndics Antoine Bridel et Jean Grest 7. Cela permettait au premier de payer à la ville une partie de ce qu’il lui redevait sur son /619/ compte de 1531-2; il ne versa le solde que le 31 oct. 1564 1. En novembre 1534, la reddition des comptes fut difficultueuse; en septembre, déjà, les syndics avaient refusé de faire de nouveaux paiements avant que le Conseil eût approuvé les précédents 2. Aussi, l’année suivante, les comptes sont-ils mieux tenus et rapidement bouclés 3; mais ceux de 1535-6 de nouveau ne sont réglés qu’en 1554; il est vrai qu’ils comportaient une redevance des syndics de plus de 270 livres, soit de 13 500 fr. 4.
Ajoutons que, si parfois les comptes des syndics portent tout ou partie des sommes versées par leurs prédécesseurs, d’ordinaire celles-ci n’y figurent pas; nous ne savons pas à qui furent versées les 452 livres (plus de 22 000 fr.), qui nous sont indiquées comme le montant des sommes redues en 1531 par les syndics des dix années antérieures 5. En outre, à côté de ce que nous pourrions appeler son budget ordinaire, la ville a toute une comptabilité extraordinaire que nous ne connaissons pas 6. /620/
*
* *
Voici, à titre d’exemples, comment se présentent les comptes de Moudon, pour quelques années prises au hasard au cours du siècle qui nous occupe 1 :
| Recettes | Dépenses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| livres | sous | deniers | livres | sous | deniers | |
| 1458-59 | 397 | 5 | 5 | 329 | 17 | 11 |
| 1469-70 | 253 | 16 | 5 | 241 | 7 | 6 |
| 1477-78 | 218 | 15 | 10 | 241 | 6 | 7 |
| 1478-79 | 222 | 1 | – | 110 | 2 | 7 1⁄2 |
| 1479-80 | 204 | 19 | – | 213 | 19 | 2 |
A cette époque la livre vaut une centaine de francs de notre monnaie. Quarante ans plus tard, elle n’en vaut plus que 80 à peine; les comptes nous donnent alors les chiffres suivants :
| Recettes | Dépenses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| livres | sous | deniers | livres | sous | deniers | |
| 1517-18 | 421 | 3 | ½ | 382 | 4 | 2 |
| 1518-19 | 427 | 6 | 9 3⁄4 | 309 | 0 | 4 |
| 1521-22 | 504 | 10 | 6 1⁄2 | 486 | 9 | 1 1⁄2 |
Dix ans après, alors que la livre ne vaut plus que 50 fr., nous trouvons :
| Recettes | Dépenses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| livres | sous | deniers | livres | sous | deniers | |
| 1532-33 | 477 | 1 | 7 1⁄2 | 489 | 12 | 8 |
| 1533-34 | 493 | 11 | 2 1⁄2 | 485 | 3 | 11 |
| 1534-35 | 574 | 15 | 10 1⁄2 | 477 | 13 | 11 1⁄2 |
/621/On voit que la valeur réelle de ces sommes ne varie pas beaucoup dès que l’on prend une moyenne entre quelques années. Mais s’il survient des événements graves ou des calamités, les chiffres changent : en 1474-75, nous avons aux recettes 1737 livres 13 sous et 11 deniers, et plus de 1600 livres aux dépenses 1; c’est que nous sommes à la veille des guerres de Bourgogne et qu’il a fallu mettre la ville en état de défense 2. En 1531-32, où la réception du duc 3 et les paiements à Jaques Cornaz 4 grevèrent le budget, la somme des recettes s’éleva à 814 livres un denier une obole, et celle des dépenses à 745 livres 8 sous 6 deniers; le compte de 1535-36 porte 936 livres 5 sous 4 deniers et une obole aux recettes, et 665 livres 14 sous aux dépenses.
*
* *
C’est l’impôt qui fournit à la caisse communale la presque totalité de ses ressources. La vente du droit de bourgeoisie ou les redevances payées par les nouveaux bourgeois 5, la location des bancs de boucheries 6, l’intérêt de quelques créances ne font que de bien médiocres sommes. Il en est de même de ce que la ville retire de la location des fossés, transformés en /622/ jardins et loués aux habitants depuis 1491 au moins, sous la réserve que l’autorité pourrait en disposer en cas de guerre 1.
L’impôt dont le produit est le plus faible est le pontenage 2. Donné à ferme pour trois ans au plus haut enchérisseur, il rapporte annuellement 15 livres en 1442 3, 18 en 1475 4, 10 livres en 1480 5, 20 livres pendant les premières années du XVIe siècle 6, pour descendre ensuite à 13 livres et un tiers en 1524 7 et à 12 en 1533 8.
Cette diminution progressive 9 du pontenage a-t-elle des causes économiques ? C’est probable et l’on pourrait supposer que le trafic au travers de Moudon avait baissé depuis le déclin des foires de Genève. Mais, pour pouvoir l’affirmer avec quelque assurance, il faudrait être mieux renseigné que nous ne le sommes sur le taux et les modalités de cet impôt. /623/
Nous ne savons qu’une chose : sa perception provoqua des conflits avec l’évêque de Lausanne. En 1477 ou 1478, la ville envoya une lettre à ce propos à Fribourg par son huissier; celui-ci portait un surnom pittoresque : il s’appelait Ulrich Tranchemontagne, surnom qu’il ne démentit point, puisqu’il affronta un affreux temps de pluie pour remplir cette mission, dont nous ignorons le résultat 1. Plus tard, lorsque régna Sébastien de Montfalcon, Moudon s’entendit avec lui et lui accorda l’exemption du pontenage, mais à bien plaire et sa vie durant seulement 2. Chaque année on déduisait pour cela six sous de la redevance des fermiers 3.
On peut penser que, à cause de son château de Lucens, l’évêque était exposé, plus souvent que toute autre personne, à payer ce droit; il est possible aussi qu’il estimât que, en vertu de son titre de comte de Vaud, il ne devait pas y être assujetti.
Le seul impôt indirect qui rende vraiment, c’est l’impôt de consommation sur le vin. Non pas celui sur la vente en gros, que l’on appelle la corde 4. Son produit, en effet, est presque nul : il oscille entre 12 et 33 sous au XVe siècle 5, entre 24 et 30 dans les années 1520 à 1532 6. Le longuel seul, l’impôt sur le /624/ vin vendu au détail 1, est vraiment productif. Voici quelques chiffres, en face desquels je mets aussi souvent que possible le total des recettes de la même année 2 :
| Longuel | Recettes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| livres | sous | deniers | livres | sous | deniers | |
| 1439 | 200 3 | |||||
| 1469-70 | 195 | 253 | 16 | 5 | ||
| 1472 | 220 4 | |||||
| 1477-78 | 194 | 218 | 15 | 10 | ||
| 1478-79 | 202 5 | 222 | 1 | |||
| 1479-80 | 180 | 204 | 19 | |||
| 1497-98 | 200 6 | |||||
| 1506-07 | 248 7 | |||||
| 1507-08 | 283 8 | |||||
| 1511-12 | 266 9 | |||||
| 1513-14 | 302 10 | |||||
| /625/ | ||||||
| 1515-16 | 300 1 | 478 | 2 | 2 3⁄4 | ||
| 1517-18 | 327 2 | 421 | 3 | ½ | ||
| 1518-19 | 330 3 | 427 | 6 | 9 3⁄4 | ||
| 1519-20 | 410 | 17 | 7 | 597 | 12 | 3⁄4 |
| 1521-22 | 395 | 10 | 4 | 504 | 10 | 6 ½ |
| 1523-24 | 441 | 4 | 10 | 486 | 7 | 1 |
| 1524-25 | 366 | 449 | 19 | 2 ½ | ||
| 1525-26 | 418 | 19 | 3 4 | 502 | 17 | ½ |
| 1527-28 | 381 | 15 | 479 | 13 | 6 ½ | |
On le voit, ces chiffres forment les trois quarts, quand ce n’est pas les neuf dixièmes de la somme des recettes 5 et ils correspondent assez exactement à la dépréciation de la monnaie.
Le longuel se composait de deux éléments : l’un qui variait avec le prix du vin, l’autre qui dépendait de la quantité vendue 6. Tandis que le premier semble /626/ avoir été immuable, le second présentait des possibilités d’adaptation aux besoins nouveaux. A partir de 1528, quand le procès Cornaz eut déséquilibré le budget de la commune, on augmenta le longuel d’un denier par pot, soit de 360 deniers ou 30 sous (90 fr.) par char de 505 lit. 44 1. Cet impôt extraordinaire fut renouvelé pour six ans, le 6 août 1531 2. Aussi le longuel produit-il en :
| livres | sous | deniers | |
|---|---|---|---|
| 1528-29 | 716 | 14 | 1 |
| 1529-30 | 569 | 17 | 10 |
| 1531-32 | 712 | 3 | 11 |
| 1532-33 | 414 | 14 | 6 |
| 1533-34 | 437 | 18 |
On avait pris des mesures analogues à l’époque des guerres de Bourgogne en exigeant des fermiers du longuel un supplément de 10 livres chaque année pour que l’on pût acheter des pièces d’artillerie 3.
Les chiffres du longuel nous permettent de nous rendre compte de la quantité de vin qui se buvait à Moudon et dans les villages avoisinants, où la ville percevait également ce droit. En 1526-27, la somme encaissée fut, pour les villages (Chapelle, Thierrens, Neyruz, etc.), 18 livres 10 sous 2 deniers, et, pour la ville, 433 livres 11 sous 8 deniers; le vin valut de /627/ 8 à 12 sous suivant la saison; mettons une moyenne de 10 sous; cela fait 9 chars, ou plus de 4500 litres pour les villages et plus de 222 chars, soit plus de 112 000 litres pour la ville, ce qui est un chiffre élevé pour douze cents habitants; il est vrai qu’il y avait, à Moudon, beaucoup de passage.
Jusqu’en 1519, la perception du longuel fut donnée à ferme 1; à partir de cette date, la ville le fit percevoir directement par les syndics assistés de l’huissier 2.
Ce n’était pas chose commode : pour éviter la fraude, il fallait un contrôle continuel. Nul ne pouvait décharger un char de vin sans la présence des « longataires 3 », qui constataient la contenance et le nombre des fûts. De temps à autre, les syndics, en compagnie d’une délégation du Conseil, faisaient la visite des « certours », soit des caves des hôteliers et pintiers 4, /628/ afin d’estimer ce qui avait été vendu. Ces expertises se terminaient par un repas officiel. Plus tard, avant de régler les comptes annuels, on discutait longuement avec les aubergistes, pour établir la quantité de vin qu’ils avaient débitée, et calculer, en tenant compte de toutes les variations des prix, la somme d’impôt qu’ils devaient; cela n’allait pas sans récriminations.
Il y eut, à l’occasion, des difficultés d’un autre ordre : le clergé, à certain moment, contesta qu’on pût l’obliger à payer le longuel. Un arbitrage, qui dispensait les ecclésiastiques des autres impôts, trancha la question en faveur de la ville 1. Elle se posa à nouveau, en 1493, à propos du vicaire de Thierrens, comme nous l’avons vu plus haut 2. Au XVIe siècle, les ecclésiastiques qui vendaient du vin payaient le longuel sans protester 3. Nous ignorons si d’autres catégories de personnes firent des objections analogues; nous ne savons pas en particulier quelle était à cet égard la situation du bourgeois qui était propriétaire de vignes 4.
Lorsque la ville a de grosses dépenses et que les ressources fournies par le longuel sont insuffisantes, /629/ elle recourt à l’impôt direct; cette contribution extraordinaire s’appelle le « giet » ou giète. Ainsi, vers 1439, il en fut perçu un pour les fortifications et les autres « nécessités » de la ville 1; nous ne possédons aucun renseignement à son sujet; c’est le cas du reste de la plupart d’entre eux : ils ne figurent que rarement dans les comptes des syndics. Nous avons vu que c’est par ce procédé que Moudon parvint à boucler son compte en 1474-75 2. Un impôt de ce genre fut prélevé en 1507, nous ne savons pour quoi 3.
C’est de la même manière que la ville se procurait les sommes nécessaires pour payer au prince les « dons gratuits » qu’il exigeait. Ce qui nous frappe, c’est que la ville, quand elle le pouvait, c’est-à-dire quand la convention avec le duc prévoyait un chiffre global, faisait retomber le poids de l’impôt sur les villages d’alentour. Ainsi, quand le Pays de Vaud dut payer 3000 florins pour le mariage de la marquise de Montferrat 4 et le passage du prince d’Antioche, roi de Chypre, la part de Moudon étant de 309 florins et 6 sous, on exigea des villages et des grangiers de la banlieue les deux tiers de cette somme 5. En 1514 et /630/ 1515, on exigea d’eux plus de la moitié 1. Souvent, cela provoque des difficultés 2.
Quand tout cela ne suffit pas, il reste toujours une ressource : l’emprunt. Nous avons vu que Moudon n’hésitait pas à l’employer 3. Entre 1435 et 1458, quand la ville eut grand besoin d’argent pour ses fortifications 4, elle se fit prêter au moins 257 livres, /631/ près de 26 000 fr., par l’hôpital 1. Et ce n’est pas la seule fois qu’elle eut recours aux capitaux de cette institution charitable, qui lui appartenait et avec laquelle il lui était facile de traiter 2. Elle trouva aussi à emprunter ailleurs 3.
Nous avons montré qu’au début du XVe siècle les magistrats de Moudon avaient tenu à amortir rapidement les dettes qui pesaient sur les finances communales. Leurs successeurs agirent de même, mais avec plus de lenteur 4. Peut-être les lourds impôts prélevés par les ducs de Savoie 5 les ont-ils empêchés de faire autrement. A l’époque des guerres de Bourgogne, les dettes dues à l’hôpital subsistaient presque entièrement 6. Plus tard, pour des motifs qui nous échappent, mais qui doivent avoir été impérieux, la ville remboursa toutes ces créances et ne contracta plus de dettes à long terme auprès de lui 7. /632/
Les malheurs des temps obligèrent ensuite la commune à contracter de nouvelles dettes, en particulier une de 400 livres (40 000 fr.) en faveur du forgeron P. de Bulo 1; en 1523, elle en payait encore l’intérêt à son fils 2, qui la céda au clergé pour la fondation d’une chapelle 3. Elle s’en acquitta jusqu’à la Réforme.
L’affaire Cornaz entraîna de telles dépenses que la bourse communale dut à nouveau recourir à l’emprunt 4. Mais celle-ci remboursa rapidement les dettes faites à ce propos 5. Et l’on peut dire que, à la veille de la conquête bernoise, Moudon n’avait plus qu’une dette insignifiante. Si nos calculs sont justes 6, elle se composait de la créance de Bulo en faveur du clergé, d’un montant de 400 livres, d’une autre créance en faveur du même corps, pour laquelle la ville payait un intérêt de 4 livres et 16 deniers, ce qui représente un capital de 96 livres, d’une créance de 60 livres en faveur de la chapelle de la Trinité et d’une autre de 30 livres en faveur de la chapelle de Notre-Dame à Saint-Etienne 7, en tout 586 livres (moins de 30 000 fr.). /633/
En revanche, la ville avait des débiteurs; lorsque l’occasion était favorable 1, elle prêtait l’argent disponible qu’elle avait. Sa situation financière était parfaitement saine.
La commune possède quelques immeubles : des maisons en ville 2, ainsi que quelques parcelles de terrain non bâti, des jardins, des chenevières (oches) 3, plus loin, des râpes ou pentes boisées 4. Elle commence à acquérir en Charmet des parcelles, qui forment les premiers éléments du beau domaine qu’elle s’y constituera plus tard 5. Elle loue ces biens, mais le produit de ces locations n’est pas très élevé 6.
Dans la plaine que traverse la Broye, les pâquis communs lui appartiennent, de même que le droit de /634/ parcours sur tous les prés des particuliers. Vers la fin de la période qui nous occupe, quelques-uns de ceux-ci, désireux de profiter de la seconde récolte d’herbe, demandèrent de pouvoir passer leurs prés à clos, c’est-à-dire de pouvoir les entourer d’une haie et les soustraire ainsi au parcours commun. Le Conseil n’accorde qu’avec peine cette autorisation; il exige au profit de la communauté, qu’il estime lésée, une indemnité qui représente une bonne partie de la valeur du pré; il limite à trois ans la durée de la concession, délai au bout duquel la commune peut rétablir le parcours en restituant au propriétaire la somme versée par lui 1. Elle ne se fait pas faute d’user de ce droit qu’elle s’est réservé 2.
Cette hostilité vis-à-vis d’une mesure qui a été la condition première du progrès agricole s’explique par la crainte des habitants de manquer d’une surface suffisante pour le pâturage. Si tous les propriétaires riches passaient leurs prés à clos 3, on redoutait qu’il ne restât plus de quoi faire paître le bétail des gens de condition plus modeste.
*
* *
Nous avons vu quelles étaient les ressources de la ville. Examinons maintenant ses dépenses :
Autrefois, comme aujourd’hui, les travaux publics /635/ en absorbent une bonne part. Au XVe siècle, ce sont les fortifications qui sont une lourde charge pour le budget d’une ville. Nous ne sommes pas renseignés sur l’importance des travaux qui furent faits à partir de 1435 pour la défense de Moudon 1. Nous avons vu plus haut ceux que nécessitèrent les guerres de Bourgogne 2.
Au lendemain de ces événements, il semble que l’on ait senti, à Moudon, toute l’inutilité des sacrifices consentis. Les documents postérieurs ne contiennent plus aucune trace de travaux de ce genre 3. Au contraire, la ville permettait aux bourgeois d’appuyer leurs maisons aux murailles de la ville, d’y percer des portes et des fenêtres 4 et d’en murer les créneaux 5; elle laissait les jardins envahir les fossés 6. /636/
Et pourtant, le danger d’une guerre prochaine existait toujours; lorsqu’il parut imminent, le Conseil ordonna une inspection des fossés et des murs. Noble François de Glane, le conseiller Jean Philippon, le syndic Benoît Nicati se mirent en route, le mardi 15 juillet 1535; ils dînèrent chez l’aubergiste Etienne Jugnet; ils y prirent également les quatre heures; ils soupèrent chez Jaques Fraschat 1. Leur rapport, que nous possédons 2, nous renseigne sur l’état de défense où se trouvait Moudon.
En partant du pont Saint-Eloi pour se diriger vers Saint-Etienne, ils constatent, dans le jardin de Boniface Bridel, un cornouiller à un pied du mur; chez Michel Frossard, un prunier à demi-pied de celui-ci; chez Pierre Demont, plusieurs pommiers et poiriers; dans le jardin de la maison du clergé, deux cerisiers à deux pieds du mur, trois poiriers, deux pommiers et un cognassier; dans le jardin de la cure, trois noyers; près de la petite tour qui est derrière la cure, le mur est en ruine; sa base est en mauvais état jusqu’à ras du sol; dans le jardin du seigneur de Ropraz 3, il y a un prunier; dans les fossés de la porte de Payerne, plusieurs noyers et pommiers; au « belluard 4 » près du clos Vionnet, il y a trois noyers; plus loin, deux portes sont percées dans le mur; près de la porte du /637/ Montellier, il y a un noyer; derrière l’école, des pruniers; derrière la maison de Fr. Espaz, près de la Mérine, un noyer et plusieurs grands arbres; dans les jardins du seigneur de Denezy 1, derrière la place de Notre-Dame, plusieurs noyers; plus haut, un noyer est en train de ruiner le mur; près de la dernière maison du Bourg, la muraille est trouée en plusieurs endroits; au belluard de la Terrassettaz, il y a un gros trou; dans les jardins du Bourg, côté Mérine, beaucoup d’arbres dégradent le mur; celui-ci est en mauvais état près du moulin Bridel 2, et, tout près de là, un bourgeois a construit des latrines; les fossés du Mauborget ainsi que les fausses brayes 3 contiennent des arbres et le mur est percé de poternes 4.
Le coup d’œil devait être pittoresque; les fossés de Morat, dans leur état actuel, peuvent nous en donner une idée. Mais quelle résistance la ville pouvait-elle présenter à l’ennemi ? Sans doute, le Conseil de Moudon savait-il à quoi s’en tenir à cet égard. Dépourvu de toute illusion, il ne prit aucune mesure pour remédier à l’état des choses. /638/
*
* *
Les autres travaux sont ceux que la nécessité impose aux administrations urbaines de tous les temps : l’adduction d’eau et l’entretien des fontaines 1, des chemins et des ponts 2. A partir de 1521, on fit des constructions nouvelles à l’hôpital 3 et, en 1527, on dut reconstruire les ponts sur la Mérine et le marché couvert, détruits par une inondation 4.
D’autres dépenses viennent encore charger le budget. Ce sont les procès 5, les frais de délégations et courriers, qui varient de 1 livre et 16 sous (100 fr.), en 1526-7, à 34 (2000 fr.), en 1520-1, et à 85 6, en 1531-2 (plus de 5000 fr.), et représentent plus du dixième des dépenses annuelles 7, les Etats de Vaud; car, malgré quelques protestations 8, la ville paie, outre les frais de ses délégués, ceux des convocations et des réceptions faites aux députés 9. De 2 livres 11 sous et /639/ 6 deniers (un peu plus de 120 fr.), en 1520-1, ces dépenses passent à 64 livres 8 sous et 2 deniers (plus de 3800 fr.), en 1525-6, près du sixième des dépenses totales 1. Les vins bus par les conseillers ou offerts aux hôtes de marque 2, les repas pris aux frais de la communauté coûtent en 1526-7, — c’est le chiffre le plus bas — 10 livres 19 sous et 3 deniers (quelque 600 fr.); mais, habituellement, on y consacre plus de 20 livres (1200 fr.); en 1522-3, 1525-6 et 1528-9, cette somme dépasse 50 livres (3000 fr.), soit plus du dixième du total des dépenses; en 1531-2, elle atteint 66 livres 3 sous et 10 deniers (plus de 3300 fr.).
*
* *
L’école coûte moins cher. Comme par le passé 3, la ville paie au receveur du duc une rente de deux livres de gingembre pour « le privilège de l’école ». A cette redevance s’en ajoute au XVIe siècle une autre de 20 sous et quelques deniers 4; il est possible que ce soit la teyse 5 du bâtiment où l’école est logée. Celui-ci est situé au Coude 6, à côté de la grange /640/ des nobles Espaz 1; il est adossé au mur de ville 2 et à la « grande porte » 3. La Mérine coule derrière la maison; un pont la franchit; il est en bois, sur des culées de pierre; les latrines de l’école s’y trouvent précisément 4. Refait en 1475 5, le toit du bâtiment était, en 1530 encore, couvert de bardeaux 6.
Avec l’année 1531 commencent des réparations assez importantes : on refit d’abord la poutraison de la cave 7. Le Conseil avait décidé de changer la « ramure » du bâtiment et de le couvrir de tuiles; il chargea de ce travail le meilleur charpentier de la ville 8. On fit amener des billes de sapin des bois du Jorat 9; on prépara la charpente 10; cela remplit la fin de l’année et toute la suivante. Ce n’est qu’en mai 1533 qu’on « leva » le toit de l’école 11; il était surmonté de deux « pomels » de tôle blanche.
Satisfaits du travail fourni, les conseillers allouèrent au charpentier deux aunes de drap pour qu’il s’en /641/ fît des chausses à la livrée de la ville 1, récompense ordinaire accordée aux bons entrepreneurs. Mais, il faut croire que les charpentiers d’alors ne savaient pas encore calculer le poids de la tuile : en septembre, on s’aperçut que les chevrons et les lattes étaient trop faibles. Une expertise tourna à la confusion des constructeurs 2.
En mai 1535, on continuait les réparations en blanchissant les chambres, en plaçant les foyers de molasse et en établissant les cheminées 3.
Sur le toit de l’école, il y avait une petite cloche 4. Le Conseil la fit refaire en 1508 5, en 1525 6, et en 1534 7; l’année suivante, il y faisait placer la cloche de l’ermitage de Sainte-Catherine 8.
Les comptes de la ville, les devis et les inventaires qui figurent dans les registres du Conseil nous permettent de nous faire quelque idée de cette maison : Au rez-de-chaussée, à côté du « cétôur » ou cave, dont nous venons de parler, il y avait une cuisine et une étable; à l’étage, une seconde cuisine et trois pièces, dont deux donnaient sur la Mérine; il y avait une quatrième pièce au second, semble-t-il; celle-ci /642/ et une de celles du premier étaient chauffées par deux poêles en catelles 1; à l’intérieur, certaines pièces étaient séparées par des parois de bois avec montants de chêne 2; deux autres étaient l’une gypsée, l’autre blanchie à la chaux 3. La façade avait des fenêtres à meneaux en pierre de taille 4.
Le mobilier se composait, en 1515, de 14 bois de lit, 7 bancs, une chaire et une lampe 5; en 1533, le Conseil fit faire des meubles neufs : un bois de lit avec roulettes pour chacun des deux « poêles » ou chambres chauffables et, pour chacune des autres pièces, deux cadres assez hauts pour qu’on pût glisser dessous des sous-lits 6. L’école de Moudon était un internat qui devait manquer de confort et d’hygiène, comme toutes les demeures d’alors.
A chaque vacance, le Conseil prenait inventaire de ce modeste mobilier 7 qui allait servir au maître et à ses élèves 8; celui-ci le restituait à son départ 9. /643/
Pour des motifs fiscaux, la cour des comptes de Chambéry émit, en 1482 ou 1483, la prétention que le titulaire ne pût exercer son office sans avoir reçu une lettre ducale l’y autorisant 1; mais, le Conseil de Moudon ne tint aucun compte de cette exigence et ce fut lui, et lui seul, qui toujours choisit le maître de son école, sans en référer aux autorités savoyardes 2.
Nous sommes loin de connaître les noms de tous ceux qui occupèrent ce poste; quand le nom de l’un d’entre eux nous a été conservé 3, c’est, en général, tout /644/ ce que nous savons de lui. Il n’y en a guère que deux sur lesquels nous ayons quelques renseignements.
Jean de Chardonet, maîtres ès arts, du diocèse d’Autun 1, était recteur des écoles d’Yverdon au printemps 1491; il y épousait Marguerite Vulliemin; le père de celle-ci donnait à sa fille une dot de 30 livres (quelque 3000 fr.), plus deux vêtements de drap de couleur, deux jupes de bonne étoffe, une coître, un oreiller, une couverture, 12 draps, 12 aunes de serviettes et autant de nappes; suivant l’usage, l’époux reconnaissait à sa femme un augment de dot de 15 livres 2. Tout en continuant son enseignement, Jean de Chardonet sut faire valoir cette petite fortune 3; après un court passage à Lausanne, où il était maître d’école en 1500 4, il vint s’installer à ce titre à Moudon, nous ne savons à quelle date. Le 11 octobre 1506, il achetait une maison, ou plutôt deux maisons réunies en une, aux Plans-Borgeaux, soit à la Grand’Rue, côté Broye 5. L’année suivante, il acquérait encore une chenevière, puis un petit verger 6. La maison lui avait coûté 400 florins, la chenevière 18; cela faisait plus de 20 000 fr. /645/
A ce moment, « égrège et de grande prudence maître Jean de Chardonet » est un bourgeois respectable et aisé; quoique certains documents l’appellent encore le recteur des écoles, il avait renoncé à cette profession 1. Il mourut entre 1511 et 1514 2; il laissait une fille mariée à un chirurgien de Fribourg, maître Jean Bonjour, et cinq enfants mineurs sous la tutelle de leur mère, qui survécut au moins trente ans à son mari 3. Quoique veuve et chargée de famille 4, Marguerite Vulliemin sut se débrouiller 5; elle tint boutique 6. En 1519 et 1520, elle partageait entre ses enfants les biens de son mari 7; il résulte de ces actes que, outre sa maison et deux chenevières, le défunt avait laissé 16 s. et demi de rente en argent, 20 coupes et demie de rente en froment (plus de 7000 fr. en capital); il avait donné à sa fille aînée une dot de 45 florins (plus de 2000 fr.). A la même époque, sa veuve achetait du curé de Moudon un emplacement pour sa tombe dans l’église de Saint-Etienne 8. Un de ses fils /646/ vivait à Moudon 1, un autre était chapelain 2, nous ne savons où.
Peu de temps après la mort de Jean de Chardonet, Claude Fabri vint à Moudon. Il était originaire de Frangy, dans le diocèse de Genève 3, et ne manquait pas de lettres. Nous possédons encore de lui un billet qui prouve l’influence que l’humanisme avait eue sur lui 4; il écrivait un latin sinon d’une correction impeccable, tout au moins d’une élégance un peu précieuse. Le 7 juillet 1515, la ville de Moudon lui confia la direction de ses écoles 5.
Claude Fabri s’acclimata vite à Moudon où il sut se faire apprécier. C’est à lui, plutôt qu’à l’un des notaires de la ville, que sa voisine, Isabelle, fille de Noble François de Treytorrens 6, femme de Noble Guillaume Espaz, s’adressa quand elle désira faire son testament; elle le lui dicta, le 21 septembre 1519, assise à sa fenêtre, deux clercs de l’école servant de témoins 7. Claude Fabri prend femme en ville : /647/ le 6 juillet 1522, il épouse Girarde, fille d’Antoine Jayet, un bon bourgeois 1; à cette occasion le Conseil lui offre huit pots de vin 2. Il assiste aux séances du Conseil général 3; en février 1526, il acquiert la bourgeoisie 4; en 1528, il siège à la cour 5; le 1er novembre de la même année, il devient syndic.
Il était alors en vacances, si l’on peut dire; depuis la fin de 1526, l’école était fermée, à cause de la peste, sans doute 6. Il ne rentra pas dans l’enseignement; quoiqu’il conserve le titre de recteur des écoles, les honneurs le détournent de sa classe : en novembre 1530, il est désigné comme adjoint du Conseil, avec mission spéciale de vérifier les comptes 7; il est recteur de la confrérie du Saint-Esprit des Borgeaux 8. Claude Fabri avait eu tort de se vouer aux affaires publiques où il fit médiocre figure 9; sa situation financière était serrée; il avait peine à régler ses comptes de syndic et, en 1533, la ville lui consentait un prêt de 120 florins 10; il avait perdu sa femme l’année /648/ précédente 1; lui-même mourut peu après, laissant de jeunes enfants 2.
A la fin de 1529, quand, après trois ans de vacances, on songea à rouvrir l’école, le Conseil reçut des offres d’un candidat originaire d’Orbe 3. Il ne conclut pas avec lui, nous ne savons pas pour quelles raisons; mais, deux ans plus tard, nous trouvons installé comme maître à Moudon Pierre Callesi, d’Orbe 4; il est fort probable que c’était le candidat que l’on avait écarté une première fois. Le 27 avril 1533, ce jeune homme, devenu prêtre, disait sa première messe et le Conseil lui offrait un cierge et quelques testons 5; des membres de sa famille et des ecclésiastiques de sa ville natale étaient venus à Moudon pour cette circonstance; le Conseil leur avait fait porter, la veille, six pots de vin. Tous ignoraient que c’était la dernière fois que cette cérémonie était célébrée.
Le dernier maître d’école de Moudon paraît avoir été le seul qui ait été un Vaudois 6, comme il est à /649/ peu près le seul ecclésiastique d’une liste qui ne compte, pour ainsi dire, que des laïques 1. Notre pays n’avait ni université ni même une école un peu supérieure où de jeunes maîtres eussent pu se former; on avait beaucoup de peine à trouver des candidats capables; il fallait aller les chercher assez loin 2. Quant à ceux qui se présentaient d’eux-mêmes, ils n’inspiraient pas grande confiance 3. Les uns et les autres, du reste, étaient de pauvres hères qui n’avaient pas un sou vaillant 4.
Quand, par aventure, on avait un bon maître, une ville voisine l’attirait : ainsi, en 1467, Lausanne engagea les deux maîtres de Moudon 5, qui prit sa revanche, trente ans plus tard, en faisant venir Jean de Chardonet 6. D’ordinaire, on en était réduit aux services d’inconnus, errants et vagabonds, ou de clercs, échappés d’une étude de notaire; ils n’attendaient qu’une occasion pour aller chercher fortune /650/ ailleurs ou pour faire un beau mariage et s’évader dans les affaires.
Il faut avouer que, si le titre de recteur des écoles donnait un certain lustre, — la connaissance des lettres anciennes avait encore un certain prestige aux yeux des hommes ignorants — le métier, par contre, ne nourrissait pas son homme. Le traitement du maître d’école est de 6 livres par an, dans les meilleures conditions 1; or, cela faisait 600 francs au XVe siècle, 300 seulement à la veille de la conquête bernoise. Il est vrai que le maître exigeait en outre de ses élèves un écolage dont nous ne connaissons pas le chiffre précis 2. Il avait de plus ses pensionnaires; en 1479, nous en voyons trois payer chacun 3 sous (15 fr.) par trimestre 3; en 1519 et pendant les années suivantes, la ville de Moudon paie au maître la pension du jeune Crespy, bâtard de ce notaire dont elle a hérité 4; le prix est de 4 florins (200 fr.) l’an 5.
Il n’y a pas là de quoi faire fortune; ajoutons qu’autorités et particuliers paient souvent avec du /651/ retard ce qu’ils doivent au pauvre recteur des écoles 1. Aussi les maîtres qui étaient arrivés à l’aisance avaient-ils dû tirer d’ailleurs leurs ressources; nous venons d’en voir un exemple. En voici encore un autre : maître Guillaume de Pierre 2 prêtait sur gages 3. Nous ignorons ce qui avait permis à Jean Magister ou Meystre de faire de son fils un gros notaire 4.
Après les maîtres, les élèves. Qui étaient-ils ? Nous n’en possédons aucune liste et souvent les noms que nous rencontrons nous sont inconnus. Nous voyons cependant par le testament de Guillaume de Pierre, qui indique ses débiteurs, que les principaux bourgeois de Moudon, les Gaulé, les de la Cour, les Planchet, les de Bulo, les Ensis envoyaient leurs fils à son école 5; nous pouvons donc penser que c’est dans l’école de leur ville que, génération après génération, les jeunes Moudonnois de bonne famille sont allés apprendre à lire et à écrire, en français et en latin.
A côté des jeunes Moudonnois, qui étaient des « externes », il y avait d’autres écoliers, des « internes »; c’étaient les pensionnaires du recteur des écoles. Guillaume de Pierre avait une clientèle choisie : les seigneurs des environs, Rod. de Saint-Germain, Girard de Vuippens, Pierre de Prez, de Rue, châtelain de Bulle, plusieurs bourgeois de Romont lui avaient /652/ confié leurs fils; Jean Malliardoz, donzel, de Rue, lui avait envoyé ses trois neveux 1. Mais il semble que ce ne soit pas dans ce monde-là que se soient recrutés d’ordinaire les élèves des écoles de Moudon. Lorsque les documents postérieurs nous donnent leurs noms — ce qui est très rare —, ce sont ceux de jeunes gens de famille obscure, sinon inconnue : l’un s’appelle Porchet 2, un autre Gilliéron 3, un troisième Romain 4.
Ces garçons de familles très modestes, originaires de la région, y venaient avec le désir d’entrer ensuite dans le clergé ou le notariat. Ils manquaient de ressources et le Conseil les employait comme messagers, pour porter des lettres 5, comme manœuvres, pour nettoyer les fontaines 6, tendre des tuiles 7 ou décharger des chars 8; cela leur permettait de gagner quelques sous.
Ces écoliers — on n’ose les appeler des étudiants — n’étaient pas tous en pension chez le maître d’école. Quelques-uns, par économie sans doute, avaient leur chambre en ville. Peu occupés et mal surveillés, ils devenaient facilement des éléments de désordre. /653/
Le 27 avril 1514, le Conseil ordonnait à leurs logeurs de les obliger d’aller à l’école ou de les faire déguerpir : tous les « clercs » étrangers qui étaient à Moudon, devaient se rendre à la grande école, à moins qu’ils ne préférassent l’école de chant; sinon, ils devaient quitter la ville 1.
Ce texte nous apprend qu’il y avait deux écoles à Moudon : l’une, celle qui nous occupe et où se trouvaient des élèves plus âgés et plus avancés, d’où son nom de grande école 2; l’autre, qui recrutait des élèves plus jeunes, se bornait à préparer des enfants de chœur 3; c’était l’école de chant 4.
Qu’apprenait-on à la grande école, que les comptes du XVIe siècle 5 appellent un gymnase ? Nous le savons très mal. A écrire d’abord, et à lire; puis le latin; les élèves devaient posséder une grammaire 6; peut-être, un peu de philosophie : un élève avait remis en gage à Guillaume de Pierre un Aristote 7; il est très /654/ douteux qu’on y ait jamais fait du grec, quoique un clerc inconnu ait employé des formes grecques dans la copie des comptes qui sont parvenus jusqu’à nous 1.
Les élèves de l’école de Moudon paraissent y avoir acquis l’usage du latin, qu’ils écrivent couramment, mais non sans faute; leur syntaxe est celle du latin médiéval; parfois elle est pire : un scribe ose écrire : ventus ipsa die … 2. Leur vocabulaire n’est pas d’une sûreté parfaite : tel écrit : in dictis statutis pour statibus, qu’il emploie du reste ailleurs 3; un autre : prevoto, pour preposito 4; Rod. Bondet lui-même, qui sait pourtant son latin, emploie le mot sabulum pour désigner le sable 5. L’orthographe de certains d’entre eux est inimaginable et décèle une prononciation qui n’a rien de classique 6. Mais il est dangereux de juger une école d’après quelques-uns de ses élèves seulement. Peut-être les meilleurs étaient-ils précisément ceux qui ne nous ont laissé aucune ligne de /655/ leur écriture 1. Une chose est certaine : ce latin devait paraître bien inculte aux hommes comme les réformateurs, qui avaient subi fortement l’influence de l’humanisme; on comprend leur mépris pour les éducateurs qui les avaient précédés.
*
* *
L’assistance coûte encore moins que l’école à la bourse communale. Ce n’est pas que le Conseil s’en désintéresse absolument : il exerce une certaine surveillance sur les confréries du Saint-Esprit 2 et veille à ce que leurs revenus soient employés en aumônes pour les pauvres 3; il en nomme les administrateurs, qui sont en fonctions pour trois ans 4. Plus tard, il confie cette charge à deux de ses membres 5. /656/
Il lui arrive de prêter quelque argent à un bourgeois pour les relevailles de sa femme 1 et d’allouer un petit secours aux malheureux du voisinage qui ont été incendiés 2 ou à un bourgeois qui a eu le toit de sa maison écrasé par la neige 3; et quand, en mai 1531, les sœurs de Sainte-Claire d’Orbe viennent quêter pour leur maison, on leur donne deux florins, « pour l’amour de Dieu » 4.
Mais tout cela est bien peu de chose; la charge de l’assistance incombe à l’hôpital.
Cette institution, nous l’avons vu 5, est fort riche : elle possède des maisons en ville, des domaines aux alentours 6, des rentes un peu partout, des capitaux /657/ disponibles qu’elle prête à la ville 1 ou aux particuliers 2; elle a le patronat d’un autel à Saint-Etienne 3. Les dons se succèdent et viennent accroître ses ressources : nous ne citerons que les plus importants : elle hérite du notaire Champagniod 4; plus tard de Jaques Coquerel 5. Au XVIe siècle, de Jean Crespy 6 et de François de Bulo 7. Elle reçoit aussi des dons en nature 8. L’hôpital, à la façon d’un /658/ gros propriétaire, fait rédiger de temps en temps ses extentes, ou reconnaissances 1. En 1517, pour trancher les contestations avec ses débiteurs et censiers, il désigne comme juge François de Bulo, qui jugera à l’hôpital, assisté de quatre conseillers, et sa sentence vaudra celle du châtelain. Cette décision, qui dessaisit les tribunaux ordinaires, est approuvée cependant par le bailli, le châtelain et le vidomne 2. C’est que « qui terre a guerre a »; le recteur de l’hôpital devait parfois recourir à des procès longs et coûteux pour défendre les droits de cette maison 3, ce que l’on espérait éviter par là.
L’hôpital 4 était composé de plusieurs corps de bâtiments, à destinations diverses 5. Les religieux /659/ qui venaient prêcher l’Avent ou le Carême y étaient logés; ils disposaient, au fond d’un corridor, d’une petite chambre chauffée, un « poêle », meublée d’un lit, d’un buffet, de trois pupitres pour les livres, et d’une petite table 1; les fenêtres, en papier, furent remplacées en 1527 par des volets de bois, pour que le prédicateur n’entendît pas « susurrer » la Broye 2. Toute une partie de la maison était affectée aux pauvres : un grand dortoir avec huit lits, et d’autres petites chambres occupées par les pensionnaires habituels; une cuisine, avec crémaillère et grande chaudière; un lardoir ou dépense contenant des « tablars » et un saloir. Enfin, certains locaux étaient réservés à la commune : la chambre neuve ou poêle du Conseil 3, où l’on gardait /660/ les comptes de la ville et de l’hôpital dans une arche ferrée; cette arche fut placée plus tard dans la « crotte » 1. La grande salle, où s’assemblaient parfois les bourgeois, est boisée et pavée 2. Elle semble à l’occasion servir de cantine, avec ses deux cuisines attenantes : ainsi lorsque Jean Tilliet y célèbre ses noces 3.
Le mobilier consistait surtout en bancs, arches et armoires; à part les huit lits du grand dortoir, et celui du prédicateur, il y en avait quatre autres. Les inventaires indiquent encore de la literie et de la lingerie neuve ou usagée, pas très abondante; elle est marquée d’un M gothique surmonté d’une croix 4.
L’hospitalier, ou recteur de l’hôpital, nommé par le Conseil et confirmé par le Conseil général, comme les syndics, était généralement un laïque 5; il devait résider personnellement, héberger les pauvres, percevoir les revenus, entretenir les bâtiments et faire rentrer les arrérages. Cette charge était amodiée pour trois ans ordinairement, parfois pour un ou deux seulement; le même homme pouvait être recteur pendant deux périodes consécutives, ou à plusieurs reprises 6. Les contrats sont les mêmes dans les grandes lignes /661/ du début du XVe siècle à la fin de l’époque savoyarde, le prix seul varie; les sommes payées par les tenanciers allaient grossir, semble-t-il, le capital de la maison 1. Par son contrat, Antoine Bridel, nommé pour trois ans en 1473, s’engage à payer 160 livres à la fin des trois ans, et à fournir 10 pièces de toile neuve, 10 pièces de serviettes et 10 de nappes 2. D. Pierre Vaulery, recteur en 1504-7, s’engage à hospitaliser et bien traiter les pauvres, à leur donner deux fois par jour de bon jus soit potage, à leur faire bon feu, à chauffer convenablement en due saison les poêles, à nettoyer la maison 3. En 1519, l’hospitalier Pierre Guex doit, de par son contrat, loger les religieux qui viennent prêcher l’Avent ou le Carême, héberger les autres religieux trois jours, et fournir aux pauvres feu et potage deux fois par jour 4. La somme d’argent payable en espèces n’est pas constamment la même : de 250 livres (environ 25 000 fr.) pour trois ans en 1421 5, elle passe à 150 livres en 1446 6, à 100 en 1504 7, et n’est plus que de 80 livres (6400 fr.) en 1511 8, pour remonter il est vrai à 111 livres en 1524 9; pour des raisons qui nous échappent, le prix de l’amodiation a donc baissé peu à peu. /662/
Le système de la ferme présentait des inconvénients évidents; il est vrai qu’on ne risquait pas grand’chose, puisque c’était le Conseil qui prononçait sur les admissions à l’hôpital et fixait les prébendes 1; cependant on y renonça et, dès 1528, Jaques Créaturaz est gérant et procureur de l’hôpital, avec un salaire total de 20 florins pour les trois ans 2.
Le Conseil surveillait de près la gestion de l’hospitalier; en 1519, il lui inflige une amende d’un écu d’or parce qu’il a mal soigné les pauvres 3.
L’hôpital était destiné à tous les pauvres, sans distinction d’origine; on y soigne quatre Allemands et un Bourguignon, en 1479-81 4. Il pratiquait les diverses œuvres de miséricorde : il donnait à manger à ceux qui avaient faim, à boire à ceux qui avaient soif; il hospitalisait les étrangers et recueillait les orphelins, les enfants trouvés 5 et même les enfants illégitimes 6. Les petits enfants étaient mis en nourrice, parfois placés 7. A la fin de 1528, on trouva un enfant à Saint-Jean de Jérusalem; le Conseil le fit recueillir, mais, tout en étant généreux, il ne se souciait pas d’accroître trop les charges de la maison 8; il s’occupa d’autre part de retrouver la mère; /663/ pendant plusieurs semaines, l’huissier de la ville fit des recherches du côté de Vaulruz, du moulin de la Pierre, de Siviriez et de Romont, sans résultat, semble-t-il. L’hôpital soignait les malades 1, les femmes en couches 2 et faisait distribuer des secours aux infirmes de la ville 3.
Enfin, il s’occupait de faire enterrer décemment les indigents dans une partie du cimetière de Saint-Etienne, appelée de ce fait le cimetière des pauvres 4; il leur fournissait un linceul; en 1466-9, il paie celui de 22 pauvres 5; plus tard, le service funèbre d’un Allemand 6.
Surtout, nous l’avons vu 7, c’était une sorte d’asile de vieillards et d’orphelinat tout à la fois; il recevait des pensionnaires réguliers, malades ou non. Au début du XVIe siècle, il n’y avait, semble-t-il, que deux de ceux-ci : la pupille, que l’on charge de soigner les pestiférés en 1519 8, et Otto Revy, qui rendait certains services à la communauté 9.
Le recteur était chargé en outre de présider à certaines distributions, à celles de la Saint-Georges 10, par exemple, et de Pentecôte, dont il payait une /664/ partie 1 et à des repas d’anniversaires; ainsi Jean Crespy veut qu’à l’anniversaire de sa mort, il distribue aux pauvres du pain jusqu’à trois coupes de froment, une coupe de pois cuits bien salés et du beurre; pour ce repas, le recteur sera aidé par un prêtre et le héraut de la ville. Le même jour, le recteur fera un repas dans la maison de l’hôpital pour les membres du Conseil étroit, pour tous ceux du moins qui auront été à Saint-Etienne et auront mis au moins une « pitte » sur les autels, en y associant le recteur; auquel repas assisteront le prêtre du dit autel et le héraut de ville; et y sera invité le châtelain de Moudon « afin qu’il soit bien disposé à faire brève justice à l’hôpital 2 ».
Des hôpitaux de Saint-Jean de Jérusalem et de Saint-Bernard, nous ne savons presque rien 3, sinon que les revenus du premier s’élevaient en 1473 à 40 florins (2400 fr.) 4. Ceux du second ne valaient pas davantage en 1531. A cette date, et depuis longtemps probablement, cette maison ne recevait plus ni malades ni passants 5.
CHAPITRE XXIV
LA CONQUETE BERNOISE
Nous avons vu plus haut 1 que depuis une dizaine d’années le Pays de Vaud était périodiquement menacé d’une invasion bernoise; des circonstances qu’il serait trop long d’exposer ici avaient toujours calmé provisoirement ces alarmes au moment où elles paraissaient le plus vives. Mais en automne 1535, l’heure du dénouement allait sonner.
Le 1er novembre 2, le dernier des Sforza mourait. Cette mort rouvrait la question du Milanais; François Ier allait faire valoir ses prétentions sur le duché que Charles-Quint voulait retirer à lui comme fief d’empire. Une guerre seule pouvait trancher le différend qui renaissait entre les deux princes. Brouillé avec son oncle, le duc de Savoie, depuis quelques années déjà 3, le roi n’attendait qu’une occasion pour occuper la Savoie et les passages des Alpes qu’elle commandait.
Entre temps, la situation de Genève empirait, si bien que les magistrats désespérés appelaient au secours /666/ de tous les côtés 1. Le 14 décembre, un aventurier français entrait en ville 2; blessé et battu, il n’amenait pas les soldats qu’il avait promis, mais il prétendait parler au nom du roi : le 17 décembre, il offrait officiellement à la cité désespérée l’appui de son maître 3.
Les Bernois en furent avertis 4. A tort ou à raison, le gouvernement crut à l’imminence de l’occupation de Genève par les troupes de François Ier, première étape de la conquête de la Savoie 5. Il se décida à la prévenir. Cette résolution lui fut facilitée par un mouvement d’opinion qui se produisait alors dans le peuple bernois. A la fin de novembre, il y avait eu à Aoste d’ultimes négociations entre le duc et les ambassadeurs de la République : ceux-ci avaient posé comme première condition que ce prince s’engageât à ne plus molester Genève et à lui laisser librement pratiquer le culte réformé 6; Charles III avait refusé avec hauteur et, le 29, les négociations étaient rompues.
Tant que le conflit entre le duc et Genève était resté sur le terrain juridique, le sentiment populaire à Berne était demeuré assez froid. Maintenant que /667/ la question religieuse entrait en jeu, il en était tout autrement; le peuple bernois voulait secourir ses coreligionnaires genevois.
Le 27 décembre, le gouvernement se décidait à rompre avec le duc 1; le 29, il consultait les bailliages par voie de referendum 2. Vers le 10 janvier, le Grand Conseil prenait connaissance du résultat de ce vote. Tous les bailliages sauf un se prononçaient pour la guerre 3.
Il semble que tout cela n’ait pas pu se faire en secret. Une chose est certaine cependant : ni Charles III 4, ni les Genevois 5, ni même les Fribourgeois 6 ne se doutèrent de ce qui allait arriver; les Bernois bénéficiaient de leurs longues tergiversations; on se figurait que tout s’arrangerait, cette fois encore, comme les précédentes. A Lausanne toutefois, on était moins aveugle ou mieux renseigné : le 19 décembre, persuadé que la guerre était imminente, le Conseil désignait les officiers de la milice urbaine et, le 6 janvier 1536, quand les députés de la ville partirent pour aller à Berne renouveler le serment de combourgeoisie, ils avaient mission de demander aux Bernois de les avertir à temps, quand ils se décideraient à marcher sur Genève 7. /668/
Les gens de Moudon n’étaient pas combourgeois de MM. de Berne; ils ne paraissent pas avoir cru le danger aussi proche; malgré une lettre assez menaçante, adressée le 28 novembre par Berne aux Etats 1, ceux-ci ne furent pas convoqués tout de suite. Le bailli de Vaud était à Gex; le Conseil reçut de lui, le jeudi 16 décembre seulement, une lettre, datée de cette ville, qui ordonnait la convocation des Etats. On envoya des exprès de tous les côtés; la séance eut lieu le samedi 18 2. Nous ne savons pas ce qu’on y discuta. Mais nous avons tout lieu de croire qu’il s’agissait d’une demande d’argent destiné à payer les soldats que le bailli cherchait à recruter, non pour défendre le pays contre Berne, mais pour attaquer Genève 3.
Le 27, Lullin rentrait à Moudon, venant de Gex. Le 29, deux députés de Rue venaient conférer avec le Conseil sur l’objet soumis aux délibérations des Etats 4. Ceux-ci se réunirent encore le 30 décembre et le 2 janvier 1536. C’est ce jour seulement que les bonnes villes arrêtèrent la réponse à faire au bailli 5.
L’inquiétude ne devait pas être bien grande à Moudon, /669/ puisqu’on y célébra aussi joyeusement que de coutume la fête des Rois 1. Il ne faudrait pas voir dans l’achat de quelques livres de poudre à Fribourg 2 une mesure de précaution militaire : il s’agissait de fournir aux compagnons « du roi de la ville » de quoi fêter dignement sa royauté éphémère. Une seule préoccupation assombrissait le front des magistrats : ils craignaient que les gens de Romont et de Rue n’eussent cédé aux exigences du bailli, contrairement aux décisions des Etats 3. Le 15 et le 16 janvier, libres de tout autre souci, ils discutaient avec un particulier de Fribourg qui se prétendait créancier de la ville 4.
*
* *
A cette date, le sort de notre pays venait de se décider à Berne. Comme, le 13 janvier, le seigneur d’Estavayer 5 s’était présenté devant le Conseil pour se plaindre des attaques des Genevois, celui-ci lui répondit en lui notifiant la rupture 6; le 14, la République se procurait à Bâle l’argent nécessaire 7; le 15, elle requérait le secours de ses alliés de Lausanne 8; /670/ le dimanche 16, le défi solennel était lancé au duc 1. Une armée de 6000 hommes était mise sur pied pour le samedi suivant 2.
Lorsque ces nouvelles parvinrent à Moudon, le Conseil décida de tenter une démarche pour conjurer la menace de guerre, comme les Etats l’avaient fait six mois plus tôt 3. Le lundi 17 janvier, il envoya François de Glane, Sr. de Ropraz, à Romont, pour engager les autorités de cette ville à désigner des délégués qui accompagneraient à Berne les députés de Moudon; le lendemain, mardi, Claude de Glane, frère de François, se mettait en route; mais il n’alla pas plus loin que Payerne et revint, le même jour, à Moudon 4. A Payerne, Claude de Glane avait appris sans doute que le défi était lancé et la guerre déclarée au duc depuis le 16, soit depuis deux jours. Vassal de Savoie, le Sr. de Villardin ne pouvait se rendre à Berne sans un sauf-conduit.
Pour en demander un, le Conseil dépêcha un messager à Payerne dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19; en même temps, il dépêchait un autre messager à Rue pour inviter les gens de cette ville à venir délibérer à Moudon avec lui. La réponse fut favorable sans doute, car le lendemain matin un conseiller de Moudon était délégué à Romont avec mission d’engager les autorités de cette ville à envoyer des députés à /671/ Payerne où ils se trouveraient avec ceux de Rue et de Moudon 1.
Sans attendre, semble-t-il, la réponse de Romont, le Conseil déléguait de nouveau à Berne Claude de Glane et Pierre Cerjat, Sr. de Combremont-le-Petit et de Syens; ils avaient ordre de se rendre à Payerne et d’y attendre le sauf-conduit, que, supposons-nous, les gens de Payerne avaient fait demander à Berne. Les deux seigneurs moudonnois restèrent à Payerne tout le jeudi, attendant cette pièce qui ne venait pas; le vendredi, 21 janvier, ils revinrent à Moudon sans avoir pu accomplir leur mission.
On peut se figurer l’inquiétude des conseillers; ce même jour encore, ils expédiaient un exprès à Romont et à Rue, pour se maintenir en contact avec ces deux villes, également menacées 2.
Le samedi, 22 janvier, comme des députés fribourgeois passaient, se rendant à Lausanne, on leur offrit, selon l’usage, le vin d’honneur 3; les Fribourgeois ne cachèrent pas leur crainte des Bernois. Aussi le lendemain, dimanche 23 janvier, le Conseil envoya à Fribourg Claude de Glane et Boniface Bridel, pour mettre la ville sous la protection des seigneurs de Fribourg.
Nous ne savons quel accueil les députés de Moudon y trouvèrent, ni quelle réponse ils rapportèrent. Peut-être reçurent-ils de bonnes paroles. Ils durent cependant /672/ constater qu’à Fribourg on n’était pas prêt à faire la guerre à Berne 1. En outre, pendant que Claude de Glane et Boniface Bridel chevauchaient du côté de Fribourg, les événements s’étaient précipités; venant de Morat, où elle avait cantonné la veille, l’armée bernoise était arrivée à Payerne. Force fut donc aux Moudonnois de reconnaître qu’il ne leur restait plus qu’à s’arranger avec le vainqueur.
Entre temps un messager envoyé à Payerne en avait enfin apporté le sauf-conduit 2; on pouvait se mettre en rapport avec les Bernois. Mais on ne voulut se rendre au-devant d’eux qu’avec les députés des villes voisines. On envoya donc à Rue un conseiller, dans l’après-midi, puis, une seconde fois, dans la soirée, ce pendant qu’un autre bourgeois allait de nuit à Romont; ils invitaient les Conseils de ces villes à envoyer leurs députés à Payerne le lendemain en même temps que ceux de Moudon 3.
Le lundi 24 janvier avant midi, les ambassadeurs des trois villes se présentèrent devant les capitaines bernois à Payerne. Moudon était représenté par Pierre Cerjat et Jean Philippon. Ils essayèrent de discuter; mais, sans se montrer impitoyable, le général exigea une soumission complète. Les députés n’avaient pas des pouvoirs suffisants pour signer une capitulation sans conditions. Ils furent congédiés avec ordre de revenir le lendemain matin munis de pleins pouvoirs 4. /673/
Dès qu’ils furent rentrés à Moudon, on convoqua le Conseil général : 12 conseillers et 79 bourgeois étaient présents, ainsi que les délégués des villages voisins. On ne songea pas un instant à se défendre; les murailles de la ville n’étaient pas en état de soutenir un siège 1; les habitants n’avaient plus aucun entraînement militaire 2.
Considérant « plusieurs raisons militantes, ici à cause de brièveté non déclarées »; constatant la puissance de l’armée bernoise, la faiblesse de la ville, l’absence non seulement de tout secours, mais de tout message de la part du duc; reconnaissant naïvement qu’il était plus profitable de se rendre que de s’exposer à perdre vie et biens, l’assemblée chargea Pierre Cerjat, Claude de Glane, Jean Philippon et Boniface Bridel, du Conseil, Antoine Bridel, son fils, syndic, Georges Cornaz 3, Pierre Riguet et Vuiffrey Clerc, bourgeois, de rendre la ville aux « très magnifiques seigneurs MM. de Berne », à condition que ceux-ci les laissassent jouir de leurs « libertés, us, coutumes et franchises comme par le passé », ce que les officiers avaient déclaré être prêts à garantir 4. /674/
De bonne heure, le mardi 25 janvier, les députés de Moudon se mirent en route, à cheval, suivis d’un domestique à pied. Ils furent rejoints par ceux de Rue; ceux de Romont ne se présentèrent pas 1. L’armée bernoise, après avoir couché à Murist, avait repris sa marche dans la direction d’Echallens, où des vivres et des cantonnements lui étaient préparés 2. L’état-major se trouvait à mi-chemin, non loin de Démoret 3, lorsqu’il fut rejoint par la petite troupe qui venait de Moudon. Les députés firent leur soumission au nom de leurs villes et prêtèrent le serment exigé; au nom de LL. EE., le général Nægeli leur jura de respecter leurs droits et libertés, sauf en ce qui touchait leurs obligations vis-à-vis du duc; il les assura qu’en matière de religion on n’exercerait sur eux aucune contrainte, à condition qu’ils laissassent prêcher l’Evangile 4. Cette promesse répondait à un désir des Moudonnois, mais ils n’avaient pas osé en faire une des conditions de leur capitulation. /675/
Nægeli retint auprès de lui Claude de Glane, qu’il nomma bailli de Vaud 1, et garda jusqu’au lendemain, peut-être comme otages, peut-être pour les gagner par des égards exceptionnels, — nous ne savons — Pierre Cerjat, Boniface Bridel, Jean Philippon et Georges Cornaz, ainsi que Benoît Cherpilliod qui les accompagnait. Les autres rentrèrent à Moudon avec les députés de Rue 2.
Si le résultat ne satisfaisait pas tout le monde à Moudon 3, les citoyens prudents pouvaient se dire que jusque-là l’on ne s’était pas trop mal tiré d’affaire. A tout le moins, quelqu’un triomphait : c’était le nouveau bailli de Vaud 4.
Le jeudi 27 janvier, tout le peuple de Moudon était réuni, au son de la grosse cloche, dans la chapelle de Notre-Dame, au Château. Là, à genoux et les deux mains posées sur les livres saints, Claude de Glane jura « d’être bon, fidèle et loyal envers nos très redoutés seigneurs, les seigneurs de Berne, de faire son possible pour leur procurer avantage, honneur et profit, d’éviter tout ce qui pourrait leur causer perte ou dommage, de respecter les libertés et franchises, écrites et non écrites, de la ville de Moudon, ainsi que ses coutumes, usages et statuts 5 ». Le serment fut prêté avec le /676/ même cérémonial qu’employaient les baillis savoyards à leur entrée en fonctions.
La nomination de Claude de Glane était un acte habile de H. Fr. Nægeli : Claude de Glane faisait partie du Conseil de la ville 1; les Moudonnois avaient l’impression d’être gouvernés par un des leurs, et non plus par un courtisan du duc; la conquête bernoise semblait leur assurer un degré d’automonie qu’ils n’avaient pas connu depuis le temps très court où Humbert Cerjat avait été bailli de Vaud 2.
*
* *
Mais de nouvelles angoisses leur étaient réservées; ce même jeudi 27 janvier, ils apprenaient que Moudon était sérieusement menacé par ses voisins de Romont et de Rue. Romont avait refusé de capituler; Rue, après l’avoir fait, revenait en arrière. On crut que la guerre allait éclater dans la vallée de la Broye. On dépêcha Georges Cornaz et le conseiller Créaturaz auprès de Nægeli, qui campait alors à Crissier 3; en même temps, l’aubergiste Pidoux courait à Payerne afin de demander aux autorités de cette ville de se tenir prêtes à venir au secours de Moudon, si besoin était. Le vendredi 28, tandis qu’on envoyait un exprès à cheval au camp des seigneurs bernois, à Morges, deux bourgeois partaient du côté de Romont pour faire le guet; ils restèrent en faction tout l’après-midi et ne rentrèrent qu’à la nuit 4. /677/
A Berne, on était renseigné; on savait qu’il y avait près de Romont de l’agitation et des conciliabules, où des gens de Rue et de Vaulruz avaient pris part. On craignait un coup de main sur Moudon, pendant que l’armée marchait sur Genève; on redoutait surtout l’intervention de Fribourg, dont la politique sournoise autorisait tous les soupçons. On crut prudent de mettre de piquet un contingent de 7000 h. Des ordres très précis étaient donnés à Payerne, à Lausanne, et à Moudon même pour défendre cette ville contre une attaque soudaine, et le lendemain une lettre comminatoire était expédiée à Romont par un héraut 1.
Pendant ce temps, à Moudon, on se décidait à prendre des mesures militaires : les portes de la ville furent réparées; pendant plusieurs jours, charpentiers et forgerons remirent en état la porte de la Planche et celle du cimetière, la grande porte du clocher et celle du Vieux-Bourg : plateaux et barres de chêne, serrures, verrous et gonds usés furent remplacés par des pièces neuves. Le 29 janvier, les gens de Brenles furent invités à faire le guet du côté de Romont 2. Un homme fut mis de garde, la nuit, sur le clocher de Saint-Etienne 3.
Le lendemain, dimanche 30 janvier, il y eut une panique; on disait avoir entendu battre le tambour du côté de Romont. Aussitôt on envoya deux bourgeois /678/ en éclaireurs dans cette direction, pendant que Georges Cornaz partait pour Payerne, pour y chercher des soldats 1. On n’osait guère lever les gens des villages, qui n’étaient pas sûrs, ou qui refusaient de marcher 2.
Georges Cornaz n’eut pas à aller bien loin; à Lucens, il rencontra le héraut bernois qui se rendait à Romont. Sa présence, l’annonce des mesures militaires prises par le gouvernement bernois rassurèrent le Moudonnois; il rentra avec le héraut et lui donna un homme pour l’accompagner à Romont; quand le Bernois revint, le lendemain, après avoir accompli sa mission, la ville lui remit deux testons de gratification 3.
La lettre de Berne fit quelque effet; la menace d’un coup de main s’éloigna. Les gens de Moudon continuèrent cependant à prendre des précautions; un corps de garde fut installé près de l’église et des veilleurs se relayèrent dans le clocher pour faire le guet pendant la nuit 4.
Mais le répit fut de courte durée; une nouvelle alarme éclata le mercredi 2 février au soir; des bourgeois de marque, dont le syndic Antoine Bridel et le secrétaire Bondet, passèrent la nuit à faire le guet. Pour augmenter le nombre des défenseurs, on fit appeler, le jeudi matin, les gens d’Essertes, des Cullayes, de Montet et de Villars-Tiercelin 5.
Cet incident amena les Moudonnois à demander /679/ une garnison bernoise. Une centaine d’hommes vinrent — nous ne savons pas quel jour — occuper la ville, sous le commandement du commissaire Jacob Koch, que le compte des syndics appelle Jacob Cocquot 1.
Au fond, nous ne savons pas ce qui se passa à Moudon entre le 3 et le 10 février, qui furent les jours les plus critiques. Le jeudi 10 février, le calme étant revenu, le secrétaire recommence à noter dans son registre les décisions du Conseil 2; ce corps fait régler par les syndics les dépenses des semaines précédentes; on paie aux, conseillers et aux bourgeois leurs vacations; au Sr. de Combremont (P. Cerjat), 15 fl. 11s. (475 fr.); à Claude de Glane pour journées employées au service de la ville, 10 fl. ½ (315 fr.) 3; ceux qui sont allés à Démoret, le jour de la capitulation, reçoivent 1 fl. (30 fr.) ou 3 fl. (90 fr.), suivant la durée de leur absence 4. On indemnisa les guets et les tambours. On s’occupa aussi des soldats bernois. Devant l’imminence du danger, on n’avait pas songé à faire marché avec eux. Beaucoup mangèrent et burent à crédit dans les auberges de Moudon; les hôteliers présentèrent leurs notes au Conseil 5.
Maintenant que le danger semblait passé, on avait hâte de se débarrasser de ces militaires encombrants et coûteux. On leur régla leur compte 6; la ville dépensa /680/ plus de 134 fl. (4000 fr.) pour les festoyer. Il ne resta que sept compagnons pour tenir compagnie et servir de garde au commissaire bernois.
Mais on n’était pas encore au bout. Dans la soirée du mercredi 16 février, nouvelle alerte : à neuf heures du soir, le Conseil fait sonner l’alarme par le fifre et le tambour de la ville et il envoie en toute hâte un courrier réclamer l’aide des gens de Mézières, Carrouge, les Cullayes, etc. Ils vinrent et, le lendemain, la situation étant éclaircie, on put les renvoyer chez eux, mais non sans leur avoir alloué à chacun 1 s. et 6 deniers (3 fr. 75); ils étaient 82 1.
*
* *
A cette date, la campagne touchait à sa fin. Après avoir conquis, sans coup férir, toute la Côte et le pied du Jura, l’armée bernoise était entrée à Genève le 2 février 2, puis elle avait soumis tout le Chablais 3. Les 9 et 12 février, des ambassadeurs français s’étaient présentés au quartier général et avaient annoncé confidentiellement aux officiers que le roi s’apprêtait à attaquer le duc; on s’était entendu pour se partager les dépouilles de Charles III 4. Le Valais /681/ de son côté, était entré en campagne et avait pris le Chablais jusqu’à la Dranse 1. Dès le milieu de février également, Fribourg s’était décidé à prendre sa part du butin savoyard 2.
Les gens de Moudon pouvaient se tranquilliser. Ils avaient reçu du général une lettre rassurante, datée du 13 février et qui répondait à une demande que nous ne connaissons pas 3. Il semble même qu’ils fussent tout à fait acquis au nouveau régime. Le bailli de Vaud faisait des prisonniers pour le compte de l’armée bernoise 4. Sur l’ordre de Nægeli, Jean Philippon se chargeait d’aller faire prêter serment aux gens de Bossonens, que l’on comptait soumettre 5.
Lorsque, le 22, l’armée bernoise, revenant par Cossonay, La Sarraz et Rances, vint mettre le siège devant Yverdon, le Conseil envoya du pain, dont il paya le charroi 6. Le 24, une délégation du même corps accompagnait des ambassadeurs bâlois qui se rendaient au camp bernois 7 devant Yverdon; les /682/ députés de Moudon se présentèrent à Grandson, au quartier général, et se plaignirent fort, non des exigences des vainqueurs, mais de ce que LL. EE. eussent cédé Romont, Rue et Surpierre à Fribourg, places qui, disaient-ils, étaient des dépendances de leur ville, Rue surtout où ils avaient l’habitude de mettre un châtelain 1. Il est évident que le partage du pays savoyard entre les deux cantons diminuait l’importance de Moudon et détachait du ressort de sa cour quelques châtellenies; bailli, juges et notaires s’en indignaient, et pour cause.
Mais c’est une preuve que, un mois après la capitulation, les autorités ne considéraient pas leurs nouveaux maîtres comme des oppresseurs, et que le chagrin qu’ils pouvaient ressentir des événements n’était pas assez profond pour les pousser, je ne dirai pas à une rébellion, mais même à une résistance sourde.
La noblesse des environs partageait ces sentiments, sauf, il va sans dire, Aymon de Genève-Lullin. Il avait quitté Moudon peu après la fête des Rois; il était dans le Chablais en février; le 16, le général bernois chargeait le châtelain et les syndics de Thonon de se saisir de lui 2. Il échappa, mais ses jeunes enfants tombèrent aux mains des Bernois qui les gardèrent comme otages et ses terres furent confisquées 3. /683/ Les autres seigneurs n’avaient pas hésité à faire leur soumission; les Glane et les Cerjat avaient donné l’exemple 1. Le 26 février, le fils du seigneur de Blonay se présentait à Yverdon pour faire sa soumission en son nom et en celui de son père 2. M. de Daillens, qui habitait Moudon, avait déjà fait le même geste, le 18 3.
Toutefois, on n’était pas sans quelque anxiété à Moudon. Le nouveau bailli, Claude de Glane, qui faisait du zèle, rendait la ville responsable des troubles qui s’étaient produits, les semaines précédentes, dans la région et avaient obligé le Conseil à engager cette garnison bernoise qui lui avait coûté si cher. Les magistrats estimaient que les coupables devaient payer leur part des frais; ils décidèrent d’envoyer des députés à Berne pour demander à LL. EE. l’autorisation de l’exiger des « paysans rebelles » 4. Pierre Cerjat et le conseiller Rod. Demont partirent le 1er mars, accompagnés d’Etienne Papoillat, de Thierrens, qui devait leur servir de truchement. Ils avaient encore pour mission de demander au gouvernement de confirmer les franchises de la ville 5.
Nous ignorons le résultat de leur mission. Il est plus que probable qu’on ne trouva pas le temps de leur répondre. A ce moment, l’armée victorieuse /684/ venait de rentrer à Berne sans avoir perdu un seul homme, mais officiers et soldats étaient très irrités contre le gouvernement, qui, à leurs yeux, avait été trop large dans ses concessions aux Fribourgeois; en particulier, ils s’opposaient à la cession de Vevey 1. Ce conflit, qui faillit provoquer une guerre entre les deux républiques, dut exciter de nouvelles angoisses à Moudon, mais nous n’avons à ce sujet aucun renseignement 2.
Entre temps, les châteaux et villes des alentours se soumettaient l’un après l’autre à Fribourg : Surpierre le 1er mars, Rue et Romont le 3 3. C’était un spectacle qui ne devait pas réjouir les Moudonnois.
A ce moment, François Ier entrait en campagne contre Charles III 4. Berne se décida à achever la conquête du pays. Chillon restait encore entre les mains des fonctionnaires ducaux, et jusqu’ici les terres de l’évêque de Lausanne avaient été respectées. On n’ignorait pas cependant son attitude belliqueuse et son hostilité pour la République 5. Pourtant, on l’avait ménagé jusqu’alors par égard pour le roi de France 6. Le 11 7, une armée fut mise sur pied. Elle partit le 20 et conquit sans peine le reste du /685/ Pays de Vaud. Elle passa par Payerne, d’où elle gagna Saint-Sulpice 1 et ne traversa Moudon ni à l’aller, ni au retour; du moins, les comptes et le registre du Conseil sont muets à cet égard. Le seul incident qui se produisit dans la vallée de la Broye fut l’occupation du château de Lucens. Lorsqu’ils apprirent les intentions des Bernois, les habitants du petit bourg épiscopal s’adressèrent à Sébastien de Montfalcon; ils lui envoyèrent une délégation à Glérolles pour lui demander ce qu’ils devaient faire; l’évêque, conscient de son impuissance, leur conseilla de se donner de nouveaux maîtres 2.
Claude de Glane, fidèle serviteur du nouveau régime, se hâta d’en informer des commissaires bernois qui étaient à Yverdon. Ceux-ci le chargèrent de s’emparer de la place; s’il trouvait les gens disposés à se soumettre à Berne, il devait les leur envoyer; il fallait les empêcher de devenir Fribourgeois 3. Comment cet ordre fut-il exécuté ? Nous ne le savons. Le 31 mars, le capitaine bernois Hubelmann recevait des mêmes commissaires l’ordre d’occuper Lucens 4 et, quelques jours après, les autorités de Moudon lui offraient huit pots de vin ainsi qu’à un de ses camarades 5. A cette date, la conquête du Pays de Vaud était terminée. /686/
*
* *
Malgré la bonne discipline de l’armée et les précautions qui avaient été prises 1, certaines régions du pays conquis avaient beaucoup souffert du passage des troupes, à ce que constatait un officier zuricois qui était allé à Genève 2. La contrée broyarde avait été moins maltraitée que la Côte. Toutefois, Treytorrens et Champtauroz avaient particulièrement souffert 3.
Du pays qui s’était soumis si bénévolement, Berne exigea une rançon 4. Le 13 mars, des commissaires du gouvernement étaient arrivés; ils étaient chargés de prendre les premières mesures et d’organiser l’administration des provinces conquises : en même temps, ils fixaient à chaque ville et à chaque seigneur le chiffre de la rançon qui lui était imposée, lorsque celui-ci n’avait pas été fixé lors de la capitulation 5. Le 15 mars, ils étaient à Yverdon; le 16 on les attendait à Moudon; mais leurs affaires les retinrent à Yverdon. C’est en vain que deux conseillers allèrent à leur rencontre 6.
Des seigneurs moudonnois, les Glane, les Cerjat et les Blonay échappèrent à la lourde contribution /687/ qui frappa la plupart de leurs pairs, mais le Sr. Michel de Daillens 1 dut payer 300 écus 2.
La ville elle-même semblait devoir être épargnée; il n’avait pas été question de rançon le jour de la capitulation et les commissaires quittèrent le pays sans lui en imposer une. Mais, le lundi de Pâques, il y eut une émeute, provoquée par l’arrivée d’un prédicant 3. Moudon dut verser 400 écus (50 000 fr.) 4, autant que Vevey, deux fois plus que Cossonay ou Morges, mais moins qu’Yverdon, lourdement frappée d’une contribution de 1000 écus, comme punition de sa résistance.
Le Jeudi-Saint, 13 avril, les derniers emblèmes savoyards qui se trouvaient encore sur quelques-unes des portes de la ville avaient été enlevés 5. Depuis une dizaine de jours, les Français étaient entrés à Turin; tout le Piémont était entre leurs mains 6. La monarchie savoyarde semblait disparue à jamais.
La conquête bernoise apparaissait ainsi comme un incident de la politique générale. Le loyalisme survit rarement à la défaite complète d’un prince. D’autre part, ce que nous appelons aujourd’hui le patriotisme était inconnu alors. Les événements des premiers mois de 1536 n’avaient donc blessé aucun sentiment /688/ profond chez les bourgeois de la bonne ville de Moudon. Leur autonomie municipale semblait sauvegardée 1; le culte catholique paraissait devoir être maintenu. C’était ce à quoi ils tenaient le plus.
Les Bernois exerçaient leur autorité à Echallens et à Morat, à Orbe et à Grandson, à la satisfaction de leurs administrés 2. Leur gouvernement n’avait nullement alors le caractère qu’il eut à la fin du XVIIIe siècle. Rien ne nous autorise à penser qu’au début d’avril 1536 on considérât, à Moudon, la conquête bernoise comme un malheur terrible.
*
* *
Cependant, un nouveau régime s’installait et la force des choses, plus que la volonté des hommes, allait amener beaucoup plus de changements que vainqueurs ou vaincus ne pouvaient le supposer. Une nouvelle histoire commençait pour Moudon comme pour le Pays de Vaud tout entier.
