CHAPITRE III
DU CONTRAT FÉODAL.
SECTION PREMIÈRE.
DE LA FORMATION DU RAPPORT FÉODAL.
Les anciens jurisconsultes ont donné du contrat féodal diverses définitions.
Le livre des fiefs définit le fief: « Quod ex benevolentia alieni ita datur ut proprietate quidem rei immobilis beneficiatæ penes dantem remanente, ususfructus illius rei ita ad accipientem transeat, ut ad eum heredesque suos, si de his nominatim dictum fuit, in perpetuum maneant. »
Cujas le définit plus brièvement: « Jus in prædio alieno; » et Dumoulin: « Servitus quædam aut quasi servitus. »
Schilter définit le contrat féodal: « Conventio socialis qua dominus rem in feudum confert vasallo protectionem desuper promittens et vasallus ob eam rem domino fidelitatem præstat. »
Struvius s’exprime en ces termes: « Feudum est jus dominii utilis in re immobili, a domino directo vasallo et ejus /304/ heredibus masculis concessum, ut fidelitas et servitia militaria præstarentur. »
Nettelblatt: « Jus est res cujus dominium in utile et directum divisum est sub conditione mutuæ fidelitatis. »
Hervé dit: « Le fief est une convention faite à la charge d’une reconnaissance toujours subsistante qui doit se manifester de la manière convenue. »
Toutes ces dispositions, et mainte autre que nous pourrions ajouter, ont le double défaut d’être à la fois trop larges et trop étroites. Elles peuvent s’appliquer à autre chose que le fief, et ne s’adaptent pas à plusieurs des modes d’existence que le fait juridique dont il s’agit a revêtus. Une institution aussi complexe peut se décrire, se raconter et non se définir.
Les objets qui peuvent être inféodés sont: a) un fonds de terre; b) un droit public, tel que ceux de comté, d’avouerie, et de juridiction; c) un revenu privé, comme celui d’un moulin banal, d’un péage, d’une dîme.
Ces divers objets supposent tous la possibilité de la durée de la jouissance du vassal, et de la transmission de cette jouissance à ses successeurs, ce qui est une des conditions essentielles du contrat féodal. Par ce motif, un bien-meuble ne saurait devenir l’objet du contrat féodal.
Voyons maintenant qui peut inféoder, et qui peut recevoir en fief.
Sur cette matière, le droit féodal allemand avait établi une doctrine plus systématique qu’aucun autre et entièrement à part. Nous l’exposerons en premier lieu, d’après les renseignements que fournit le Sachsenspiegel.
La capacité féodale était, en Allemagne, en rapport direct avec le heerschild, c’est-à-dire avec la capacité militaire; cela est une conséquence de l’origine de la féodalité dans ce /305/ pays, puisqu’elle avait été introduite et développée essentiellement en vue du service impérial.
Ainsi, celui qui appartient à une des catégories du heerschild, qui a un bouclier, est par là même capable de devenir partie dans une inféodation. Le bouclier est le symbole et la marque de la plénitude du droit et de la capacité militaire; ceux qui ont le droit de le porter sont susceptibles de devenir chevaliers; ils sont ritterburtig, suivant le terme consacré. Celui qui n’a pas de bouclier, ou plutôt de heerschild, n’est pas ritterburtig, ce qui, dans le système féodal allemand, veut dire qu’il n’est pas noble. Cependant, il est à observer que l’on peut avoir un heerschild sans être soi-même guerrier; dans ce cas, on a un remplaçant. Ainsi, les dignitaires ecclésiastiques, même une abbesse, ont un heerschild; c’est ce que le droit germanique appelle gemachte ritterschaft (noblesse créée). Cette étroite dépendance de la capacité féodale et du heerschild implique le but essentiel de l’inféodation, savoir, le service de chevalier dû par le vassal à son seigneur.
Nous avons mentionné, dans le chapitre précédent, quels étaient les divers degrés du heerschild et leur rapport avec la hiérarchie féodale allemande. D’après Eichorn, chaque degré du heerschild forme une classe, ou catégorie distincte, d’hommes libres; d’autres, et spécialement Weiske, estiment que les degrés du heerschild se fondent uniquement sur le rapport féodal et ne comprennent que les possesseurs de fiefs. Cette dernière opinion soulève cependant une objection très sérieuse; en fait, le service de chevalier était fourni aussi par des propriétaires de terres non féodales, de terres libres (alleux), eigen, selon l’expression du droit allemand. En outre, le roi, qui forme le premier degré, et qui est à la tête de tout le heerschild, n’est pas seulement le premier suzerain, /306/ mais aussi le dépositaire du pouvoir impérial; il commande l’armée de l’empire, non-seulement d’après le droit féodal (lehnrecht), mais aussi d’après le droit du pays (landrecht), et ces deux systèmes de droit ont toujours figuré parallèlement. Les trois degrés suivants du heerschild renferment la noblesse; savoir: le deuxième, les princes ecclésiastiques; le troisième, les princes laïques; le quatrième, les seigneurs (freie herren), vassaux ou non-vassaux des princes. Les trois derniers degrés renferment l’ordre des hommes libres: le cinquième renferme les hommes libres vassaux des seigneurs, ou propriétaires indépendants; le sixième, les hommes libres vassaux d’hommes du cinquième degré; le septième degré comprend les hommes libres non-ritterburtig, c’est-à-dire non-nobles, et qui, ne devant pas le service de chevalier, font cependant partie de l’armée, mais avec un droit militaire incomplet. Ainsi, d’après le Sachsenspiegel, le troisième et le sixième degrés seuls contiennent exclusivement des hommes engagés dans le lien féodal, tandis que, dans les quatrième et cinquième degrés, le vasselage n’est pas une règle absolue: le quatrième degré renferme des seigneurs propriétaires d’alleux, et le cinquième degré renferme, à côté des vassaux des seigneurs, la classe entière des hommes libres, dont la propriété supporte le service à cheval; cette classe que les juristes appellent les schœffenbaren, savoir, ceux qui, par naissance, peuvent être échevins. D’après les principes admis dans le Sachsenspiegel, celui qui devient vassal de son égal descend d’un degré dans la hiérarchie.
Le Schwabenspiegel est d’accord avec le droit des Saxons sur ces divers points, à quelques nuances près; cependant, il semble considérer aussi le septième degré du heerschild /307/ comme comportant la capacité féodale, car il déclare incapables ceux qui sont en dehors du septième degré. Les deux codes sont d’accord, en ceci que la capacité féodale cesse avec le heerschild. A cette limitation de la capacité féodale se rapporte la règle du Sachsenspiegel, « le bénéfice ne va pas au delà de la sixième main, » règle sur la généralité et l’exactitude de laquelle il reste d’ailleurs quelque doute.
Des principes que nous venons de poser, on peut déduire que telles classes de personnes sont incapables de donner et de recevoir un fief: ce sont les femmes, les clercs, sauf l’exception déjà mentionnée en faveur des seigneurs ecclésiastiques; les paysans vivant du travail de la terre, auxquels le port de l’épée et de la lance est interdit; les marchands (ceux-ci pouvaient porter l’épée en voyage seulement, suspendue à la selle, et pour se défendre contre les brigands); enfin, tous ceux qui ne sont pas ritterburtig, c’est-à-dire ceux dont le père et le grand-père n’ont pas vécu en chevaliers, et ceux qui sont sans droit (rechtlose), tels que les bannis et les enfants naturels.
L’abaissement dans la hiérarchie du heerschild était cause que l’abaissé ne pouvait plus acquérir ou même conserver la seigneurie vis-à-vis de certaines personnes.
En général, le fils conserve le rang, l’écu de son père; mais il peut descendre de ce rang lorsqu’il est issu d’un mariage inégal, d’une mésalliance, ou en devenant vassal de celui qui est au même rang que lui; cet abaissement subsiste pendant deux générations, lors même que le lien féodal a cessé. Ainsi, le petit-fils seulement de celui qui, le premier de sa race, a mené la vie de guerrier, peut être armé chevalier. Cette exigence de trois générations pour établir le rang paraît reposer sur l’idée d’une sorte de prescription /308/ immémoriale. Il est assez curieux que le vasselage auquel on s’est soumis, en expiation d’un meurtre (feudum pœnæ), ne nuise pas aux enfants.
L’élévation dans la hiérarchie du heerschild a lieu lorsqu’on passe d’un ordre civil dans un ordre ou état plus élevé, par exemple, lorsqu’un simple homme libre devient chevalier, ou lorsqu’un seigneur devient prince par l’acquisition d’un fief de drapeau (fahnlehen)
.La doctrine du heerschild répond à cette question: qui peut recevoir un fief? Sur la question: qui peut inféoder? il faut seulement remarquer que, pour inféoder, il faut être maître du bien qu’on inféode et en avoir la possession.
L’inféodation faite ou reçue par celui qui n’a pas de heerschild ne créé pas un vrai rapport féodal; toutefois, elle n’est pas entièrement sans effet. En général, si un capable inféode à un incapable, la convention tient vis-à-vis de lui, mais elle ne lie pas son successeur; de même, si un incapable inféode à un capable, ce dernier n’est pas en droit de demander le renouvellement du fief au successeur de l’incapable. Ainsi, dans les deux cas, le contrat ne vaut que pour la personne des contractants.
Exceptionnellement, des incapables, tels que femmes, ou clercs, peuvent inféoder tout fief qui n’est pas tenu au service impérial, par exemple, un fief de château (burglehn), ou un fief ecclésiastique (kirchlehn), et cette inféodation lie les successeurs.
Lors bien même qu’ils jouissent d’un fief, les incapables, par manque de heerschild, ne peuvent siéger dans une cour féodale, ni y prêter un témoignage, ni y fausser un jugement.
En ce qui concerne la position des femmes, le seigneur /309/ peut, au lieu du service impérial, exiger d’elles un impôt de guerre; leur incapacité peut aussi, dans une certaine mesure, être suppléée par un tuteur.
En France, les règles sur la capacité féodale furent moins sévères et moins strictement observées. Une ordonnance de 1273, rendue par Philippe III (le Hardi), ordonne aux non-nobles qui avaient acquis des fiefs dans la mouvance du roi, ou de ses vassaux immédiats ou médiats, de les rendre ou de payer au roi trois années de revenus. Ainsi, de bonne heure les non-nobles acquirent des fiefs, et, bien qu’on n’envisageât pas cela comme régulier, on se contentait de les imposer; cette imposition, devenue la règle, fut plus tard réduite à un an de revenus; on l’appelait droit de franc-fief.
Les femmes furent aussi admises, en France, à posséder des fiefs, du moins dans beaucoup de coutumes, bien que cela fût contraire à la règle générale connue sous le nom de loi salique; les fiefs qui ne passaient pas aux femmes étaient appelés fiefs masculins.
Après avoir recherché qui peut inféoder et recevoir en fief, voyons comment s’opère l’engagement, le contrat féodal.
La formation du rapport féodal, l’inféodation, nécessité toujours un acte solennel qui sert à former le lien personnel; cette formalité est l’hommage. Le vassal, tête nue, mettait ses deux mains entre les mains de son seigneur, assis et couvert; c’est l’ancienne forme de la recommandation (sese tradere); le vassal recevait du seigneur un baiser sur la bouche (osculo pacis), puis il prêtait serment. Dans le latin du moyen âge, l’hommage se nomme hominium; en vieil allemand, manscape, ou hulde. Dans le droit lombard, l’hommage se nomme vassalagium. Le mot hommage ne se trouve pas dans le livre des fiefs, mais seulement celui de fidélité, /310/ qui, dans le droit féodal français, a un sens différent. La fidélité exprime les devoirs du sujet, et l’hommage les engagements du vassal; ainsi, la fidélité était due au seigneur justicier, et l’hommage au seigneur féodal.
Phillips, dans son Histoire du droit anglais, distingue aussi la fidélité de l’hommage, en ce sens qu’hommage exprime l’engagement pris en raison d’un bien donné en fief. Phillips croit que la même distinction existait dans le droit féodal germanique. D’après lui, manscape serait l’hommage, et hulde la fidélité, mais cette opinion doit être rejetée; la distinction française entre fidélité et hommage n’existe point en Allemagne, et, s’il y a une différence d’acception entre manscape et hulde, c’est que manscape désigne la partie mimique de la cérémonie, et hulde le serment prêté par le vassal.
Le droit féodal français fait aussi une distinction entre l’hommage simple et l’hommage lige: l’hommage simple peut être fait à plusieurs, l’hommage lige ne peut être fait qu’à un seul, « comme étant le plus étroit lien qui serre la personne dans l’usage des fiefs », disent les feudistes. En effet, l’hommage lige contient la promesse de servir son seigneur envers et contre tous; d’où il résulte nécessairement qu’il ne peut être rendu qu’à un seul. Dans le cérémonial de l’hommage lige, le vassal se mettait à genoux devant le seigneur, tandis que, d’ordinaire, pour l’hommage simple, le vassal était debout.
L’hommage est dû à toute mutation du seigneur ou du vassal, quelle que soit la naissance de l’un ou de l’autre; en sorte qu’en France, où le roturier peut avoir des fiefs et en donner, son vassal noble lui devrait l’hommage; de même, un ecclésiastique, quelle que soit sa dignité, n’est point dispensé de l’hommage à raison des fiefs qu’il possède, soit /311/ comme propriétaire, soit comme titulaire de bénéfice. Le vassal devait rendre hommage en personne et non par procureur. Il y avait exception à cette règle, en France, pour le roi, jusqu’à l’ordonnance de 1302, qui permit de réunir un fief servant, confisqué pour félonie, confiscation, aubaine, déshérence, ou autrement, au domaine royal, déchargé de la mouvance du seigneur de qui il relevait, sauf indemnité. Les religieuses sont aussi dispensées de faire l’hommage en personne. Le mari pouvait le faire pour les fiefs de sa femme; l’aîné noble le faisait tant pour lui que pour ses puinés.
L’hommage est suivi de la délivrance du fief, ou investiture. Le droit féodal germanique employait diverses formes symboliques dans cette occasion. Les fiefs princiers, ou fiefs de souveraineté laïque, étaient symbolisés par le drapeau, et de là appelés fahnlehen; les fiefs princiers ecclésiastiques l’étaient avec le sceptre. Les fiefs militaires non-princiers s’investissaient avec le gantelet; c’était ainsi que le prince investissait le comte, et le comte l’avoué (schultheiss). Pour une terre donnée en fief, on se servait d’un rameau; pour un fief ecclésiastique ordinaire, d’une clef. Il y avait aussi l’investiture du chapeau, ou capuchon, que le seigneur posait sur la tête de son vassal. Les images qui nous ont été conservées des divers actes du droit féodal germanique, dont Kopp a publié une collection, présentent des exemples de ces divers symboles et de quelques autres encore.
D’après la règle, on investissait du fief l’acquéreur et sa descendance, et cette clause se supposait du fait du silence, tandis que le contraire devait être exprimé; on nommait, dans le droit germanique, en raison de cela, fief paternel, ou fief ancien (feudum paternum vel antiquum), celui qui revenait au feudataire d’un prédécesseur ayant avec son successeur /312/ un auteur commun ayant joui du fief, tandis qu’on appelait fief nouveau (feudum novum) celui qui arrive à un collatéral du premier possesseur. Il fallait, pour que l’on héritât d’un fief dans cette dernière condition, une convention particulière dans le pacte d’investiture (feudum novum jure antiqui concessum). Une convention pouvait aussi rendre le fief révocable à volonté, ou bien au bout d’un temps déterminé, ou à la mort du feudataire. Lorsque plusieurs personnes étaient investies en même temps du même fief, il y avait coinvestiture. D’après le droit lombard, on supposait des parts faites aux coinvestis. Le droit allemand voyait, au contraire, dans la coinvestiture, une véritable indivision; cette distinction a surtout de l’importance dans la question de la succession au fief. L’investiture pouvait enfin être provisoire et éventuelle lorsqu’elle était promise pour le cas où le fief deviendra disponible; c’est ce qu’on appelait une expectative. Ce cas était fréquent.
Nous avons vu comment le fief était constitué; il nous reste à dire un mot des diverses sortes de fiefs qui pouvaient être établis au moyen de l’inféodation.
Le partage de la propriété complète en un droit sur la substance et un droit sur l’usage de la chose, et la fidélité réciproque à laquelle s’engagent les deux personnes revêtues de ces droits, constituent l’essence du contrat féodal. A ces caractères, on reconnaît le fief de ce qui n’est pas fief; ce sont les conditions essentielles du contrat, disent les feudistes.
Les conditions, qui, selon la loi féodale, accompagnent ordinairement le contrat, mais qui pourraient en être séparées sans que le contrat cessât d’être lui-même, sont appelées les conditions naturelles. /313/
Les lois féodales étant différentes dans les divers pays, et même de province à province, ces conditions naturelles ont beaucoup varié.
Bornons-nous ici à indiquer les conditions naturelles admises d’après le droit féodal lombard, qui était considéré, jusqu’à un certain point, comme le droit commun, faisant règle à défaut de loi ou de coutume spéciale appartenant au pays même.
Le droit lombard envisage comme conditions naturelles des fiefs:
1° Que le fief soit établi sur une chose immobilière, ou susceptible d’être assimilée à un immeuble.
2° Que le vassal jure le serment de fidélité.
3° Qu’il soit obligé envers son seigneur au service militaire.
4° Qu’il ne puisse aliéner le fief sans le consentement de son seigneur.
5° Que le fief passe aux descendants mâles du premier possesseur.
6° Que la demande du renouvellement de l’investiture doive être faite à chaque changement de la personne du seigneur.
7° Que le seigneur ait la juridiction sur ses vassaux.
8° Que le fief se perde par suite de la violation des obligations qu’il impose.
Nous reviendrons sur la plupart de ces points lorsque nous traiterons des effets du contrat féodal. Nous les indiquons préliminairement ici, pour faire comprendre ce qu’on entendait, dans la langue féodale, par le fief proprement dit, le fief ordinaire, ou régulier (feudum rectum), par opposition aux autres espèces de fiefs, aux fiefs impropres. /314/
Les autres conditions qui ne découlent ni de l’essence du fief, ni de la loi, sont appelées les conditions accidentelles; elles résultent de la volonté des parties, et par là même sont susceptibles de varier à l’infini.
Les conditions naturelles peuvent être changées par la volonté des contractants, sans que le fief cesse d’être fief, si d’ailleurs il conserve du fief les caractères distinctifs. L’existence de ces conditions se présume, tandis que l’exception à ces conditions, ou la condition accidentelle, doit être prouvée par celui qui la soutient.
Des grandes diversités qui se trouvent dans les conditions naturelles, et des diversités infinies résultant des conditions accidentelles, il résulte que les diverses sortes de fiefs reconnues dans la pratique sont excessivement nombreuses, et qu’il serait aussi difficile que superflu d’en vouloir fournir un catalogue complet; mais il ne sera pas inutile d’indiquer les principales espèces citées par les commentateurs.
a) D’après la nature de l’inféodation, on distingue le fief nouveau et le fief ancien, dont il a été question tout à l’heure; le nouveau, prenant son origine dans la personne du vassal; le fief ancien, ou fief paternel, provenant d’un ascendant. Cette distinction s’applique aux fiefs propres, ou réguliers, comme à tout autre.
L’origine de cette distinction est assez obscure. Il paraît qu’il faut la chercher dans la circonstance suivante.
Dans l’ancien droit féodal germanique, la succession au fief ne fut pas admise tout d’abord, comme elle ne l’avait pas été longtemps pour les bénéfices, et, pour l’introduire, on avait recours à une investiture simultanée. Lorsque cette investiture simultanée se rapporte aux vassaux, ceux-ci se nomment lehenträger; lorsqu’elle se rapporte aux seigneurs, elle se nomme gesammte hand. /315/
Dans le droit lombard, sous l’influence franque, le fief fut plus anciennement transmissible aux descendants; de sorte que, lorsque les empereurs allemands apportèrent les idées germaniques en Italie, on cessa un moment de considérer le fief comme transmissible de droit pour les fiefs nouveaux: mais on conserva le principe de succession pour les fiefs anciens, relativement auxquels ce principe avait déjà été réalisé.
D’après le droit lombard, le fief ancien passait aux collatéraux, et non point le nouveau; de plus, le fief nouveau pouvait être aliéné du consentement seul du seigneur, tandis que, pour aliéner le fief ancien, il fallait le consentement du seigneur et de tous ceux auxquels le fief est affecté et qui pourront y avoir droit.
Cette distinction n’a pas la même portée dans le droit allemand; ici, elle ne s’applique pas à la succession des collatéraux, mais à la preuve seulement. En France, en général, la règle était que les fiefs suivaient les principes du fief ancien; mais s’il a été expressément stipulé un fief nouveau, c’est-à-dire si la concession a eu lieu in feudum novum, alors le fief conserve sa nature de fief nouveau, non-seulement en la personne du vassal, mais encore en celle de tous ses descendants.
b) D’après la nature des droits réservés aux seigneurs, le droit français distinguait les fiefs d’honneur et les fiefs de profit. Dans les fiefs d’honneur, aussi appelés quelquefois francs, le possesseur ne doit au seigneur que l’hommage, la bouche et les mains, disaient les feudistes.
Les fiefs de profit sont sujets à des droits utiles envers le seigneur, tels que lods et ventes, quints, requints, plaits ou rachat, corvées ou censives. /316/
Cette distinction date évidemment d’une époque où le service militaire n’était plus exigé en France, le pouvoir central s’étant réservé à lui seul le droit de guerre; les fiefs d’honneur sont donc les anciens fiefs militaires, où l’obligation principale du vassal, ayant cessé, n’a pas été remplacée par d’autres. D’après certains auteurs, ces fiefs sont aussi appelés fiefs nobles, parce que, disent-ils, la nobilité du fief ne se règle pas par la condition de la personne qui le reçoit, mais par la loi de la concession. Dans ce point de vue, le fief de profit serait fief roturier. D’Argentré (Coutume de Bretagne), Caseneuve (Traité du franc-alleu), de Laurière (Glossaire du droit français), assimilent complétement le fief d’honneur et le fief noble, le fief de profit et le fief roturier; cependant, il était d’usage plus général, en France, de réserver l’épithète de fief noble aux fiefs auxquels la justice était annexée.
En Allemagne, et dans le droit lombard, cette distinction n’existe pas, car un fief de profit ne serait pas considéré comme fief.
Le droit français nomme fiefs de danger ceux qui sont sujets à la commise, lorsque le vassal n’a pas satisfait aux devoirs du fief dans un temps marqué, ou lorsqu’il a aliéné le fief sans la permission du seigneur, ou lorsqu’il a pris possession du fief avant d’avoir prêté hommage. Il est à présumer que les anciens fiefs étaient tous de danger, et que la distinction est née de l’adoucissement des coutumes, qui ont, par exemple, exigé que le vassal qui n’avoue pas le fief, lorsque le seigneur a changé, soit mis en demeure avant que l’on prononce la commise, c’est-à-dire la reprise du fief par le seigneur. Ainsi, les fiefs lombards étaient toujours fiefs de danger. /317/
Nous mentionnerons encore ici le fief rendable (feudum reddibile), qui n’est pas, comme quelques-uns l’ont cru, un fief réversible au seigneur par le décès du vassal sans postérité; c’est un fief dans la concession duquel le seigneur s’est réservé de le reprendre temporairement, en cas de guerre ou d’autre nécessité; c’est le même qui, selon Rosenthal, s’appelait, en Allemagne, ein offenes haus (une maison ouverte).
La qualité de rendable n’est pas naturelle, et elle doit se trouver dans le pacte d’investiture. On appelait aussi ce fief fief de retraite, parce que le vassal est obligé de recevoir le seigneur et de lui donner retraite lorsqu’il en a besoin. Quelquefois, le seigneur pouvait garder le château ou la forteresse du vassal un temps indéfini; ordinairement, il devait se retirer quarante jours après la guerre terminée.
c) D’après le devoir spécial imposé au vassal, on avait aussi différentes espèces de fiefs. Ainsi, le fief de garde (feudum guardiæ), qui est la récompense du vassal chargé de la garde d’un château. Dans le droit germanique, ce fief constituait, sous le nom de burglehn (feudum castrense), une espèce de fief bien distincte. Ce genre de service était, en Allemagne, considéré comme moins onéreux que le service de campagne, et des femmes, ainsi que des ecclésiastiques, pouvaient recevoir cette sorte de fief, parce qu’un tel service n’était pas service impérial. Il est de l’essence des burglehn que le vassal habite le château qui lui est confié.
Il y a une autre espèce de fief de garde, ou feudum custodiæ; c’est celui que le seigneur donne provisoirement pendant la minorité du vassal, lorsque le seigneur ne remplit pas lui-même les fonctions de tuteur. En France, on appelait la tutelle féodale garde noble. Le feudum guastaldiæ était donné en /318/ récompense pour la charge d’intendant d’un domaine. Le feudum advocatiæ a quelque rapport avec le précédent, car l’avoué (vogt) est appelé guastaldus dans les lois des Lombards; mais ce terme s’appliqua plus tard essentiellement à l’officier laïque qui gérait un bénéfice ecclésiastique, et faisait en lieu et place du seigneur ecclésiastique les prestations qui ne pouvaient être faites par des clercs. Le feudum de cavena est la récompense donnée à un maître d’hôtel, ou majordome. Le feudum procurationis obligeait le vassal à fournir certains repas au seigneur et à ses gens. Le fief de plejure oblige le vassal à se porter, en certains cas, caution de son seigneur.
d) Enfin, on distingue les fiefs d’après la nature de la chose inféodée. Nous trouvons spécialement dans le droit allemand les espèces suivantes:
1° Le fief en expectative (lehn mit gedinge). Cette espèce a lieu lorsqu’un même bien est concédé à deux personnes, de manière que l’une en ait la jouissance, et que l’autre ait la promesse d’obtenir cette jouissance dans le cas où le possesseur actuel mourrait sans héritier.
Remarquons que ceci est l’expectative d’un fief déterminé, si le seigneur a seulement promis de donner en fief à quelqu’un le fief qui deviendra vacant; cette promesse constitue une expectative indéterminée (anwartung). En général, dans l’un et l’autre cas, les héritiers de celui qui a promis l’expectative ne sont pas tenus par la promesse de leur auteur, le promettant seul est lié. Mais, dans l’expectative déterminée, le fief devenu vacant passe de droit à celui qui en a l’expectative, tandis que, dans l’expectative à première vacance, le fief revient au suzerain; d’où il suit qu’en cas de conflit, l’expectative déterminée l’emporte sur l’indéterminée, même plus ancienne en date. /319/
2° Le fief d’otage (pfandlehn); c’est celui que le créancier reçoit pour sûreté de sa créance; le créancier devient ici vassal de son débiteur pour le gage qu’il a reçu de lui. Il est de la nature de ce contrat de cesser avec le paiement de la dette; pour le reste, il suit les règles ordinaires du contrat féodal.
3° Le fief de tutelle est celui dont jouit le tuteur d’une femme ou d’un enfant mineur. Le droit du tuteur repose sur son pouvoir tutélaire, non sur l’inféodation; c’est pourquoi le tuteur perdant sa tutelle perd le fief, lors même qu’il est par lui-même capable de le conserver. Dans l’inféodation, le tuteur et le pupille reçoivent le bien en même temps. Ces trois premiers cas se rencontrent dans tout système féodal, mais comme condition accidentelle du fief plutôt que comme espèce à part.
4° Le fief temporaire (zeitlehn) est contraire à la règle féodale; l’Auctor vetus des Saxons le nomme reprobabilis, parce que, dit-il, le fief doit être concédé au moins pour la vie durant. Schilter prétend que, d’après l’ancien droit féodal lombard, les fiefs des valvassini, ou minimi, pouvaient être repris à volonté par le seigneur.
Le droit allemand mentionne aussi des fiefs d’habitation (baulehen) qui cessent quand le vassal cesse de résider sur le bien imposé. Un fief, dans lequel il est stipulé que le bien ne passera pas aux héritiers du vassal, n’est pas aussi contraire au droit féodal que le serait un fief à temps ou un fief restituable à volonté; cependant, ces sortes d’inféodations faites à des personnes capables de recevoir des fiefs sont très rares; elles sont plus fréquentes envers des incapables, par exemple, envers des femmes, comme pension pour leur vie durant, ainsi comme douaire pour la veuve du vassal; /320/ quelquefois aussi, le mari hypothéquait sur son fief une somme destinée à servir de douaire à la femme; il fallait pour cela le consentement du seigneur.
5° Le fief de propriété (lehn an eigen) est une particularité assez étrange du droit féodal germanique. Qu’un particulier donne en fief sa propriété, c’est, semble-t-il, le cas ordinaire et régulier. En Allemagne, au contraire, c’était l’exception, la plupart des fiefs ayant été concédés par l’empire ou par des communautés religieuses; en sorte que, le cas où un particulier concède sa pleine propriété (eigen) en fief est réellement une exception. Ce fief est régi par des règles plus favorables au concédant; ainsi, il peut remplacer le bien donné en fief par un autre du même revenu provenant du bien impérial (à supposer qu’il ait un droit à disposer de ce dernier): de plus, l’inféodation n’oblige que la personne du concédant et ne s’étend qu’à la personne du vassal.
6° Le fief princier. Si ce fief donne la qualité de prince ecclésiastique, on le nomme fürstenlehn; s’il donne celle de prince laïque, on le nomme fahnlehn. Ces fiefs doivent être conférés immédiatement par le roi; l’investiture se donnait par le sceptre ou par le drapeau. A un tel fief était inhérente la juridiction du comte; il ne pouvait être partagé; et lorsqu’il revenait au roi, celui-ci devait l’inféoder de nouveau dans l’an et jour.
/321/
DEUXIÈME SECTION.
DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU RAPPORT FÉODAL.
§ I.
Des droits et obligations personnelles.
Le vassal doit au seigneur, en raison du contrat féodal, la fidélité (treue). En France, cette fidélité se subdivisait en foi et hommage; elle comprend le service militaire et le concours à la justice féodale (service d’host et de court).
a) La fidélité est envisagée comme le premier et le plus essentiel d’entre les devoirs du vassal.
En Allemagne, le vassal jure d’être, envers son seigneur, hold und treu, termes plus ou moins synonymes, que l’Auctor vetus du Sachsenspiegel traduit par amicus et fidelis.
Du devoir de fidélité découlent diverses conséquences: on envisagera comme violation de la fidélité l’attentat à la personne du seigneur, l’acte de prendre les armes contre lui, et celui de maltraiter les vassaux de son seigneur. Le vassal peut se refuser à plaider dans une cause pénale contre son seigneur; en revanche, il n’est pas défendu à la personne qui est dans le rapport féodal avec une autre, de prendre part à un jugement dans lequel l’autre est partie, ni de prêter /322/ contre elle main-forte au roi ou au juge pour empêcher une injustice. Le dommage causé au seigneur par les gens de son vassal sans la participation de celui-ci n’est pas non plus envisagé comme rupture du devoir de fidélité (félonie). On envisage encore comme félonie l’acte de déserter le service de son seigneur.
En Allemagne, la doctrine donnait au devoir de fidélité entre personnes féodales une extension à peu près analogue à celle de la fidélité que se doivent les parents de sang.
L’obligation d’obtenir le consentement du seigneur au mariage des filles du vassal, qui existait en France et dans le nord de l’Europe, ne se rencontre, en Allemagne, qu’isolément et dans des cas très particuliers.
b) Le service militaire. L’obligation d’y obtempérer cesse pour le vassal auquel son seigneur refuse de rendre justice; elle cesse pour la vie, si le seigneur a refusé l’investiture.
Le service militaire féodal comprend, d’après les usages germaniques, le hervart (service de campagne, in expeditionem ire); ce genre de service est, en Allemagne, dû uniquement à l’empire; ainsi, le vassal n’était pas obligé de suivre son seigneur dans les expéditions privées que celui-ci pouvait entreprendre. Cette différence notable entre le droit féodal germanique et le droit français montre bien le caractère et l’origine différente des deux systèmes. Le service impérial était commandé au seigneur six semaines à l’avance, sous forme d’arrêt (urtheil); le seigneur ne pouvait le demander à ses vassaux avant d’avoir été lui-même commandé.
Le vassal n’était tenu régulièrement qu’à servir en Allemagne, mais il servait pendant six semaines à ses frais; le seigneur le dédommageait toutefois pour les pertes dont il souffrait à son service. Six semaines avant l’entrée en /323/ service, et durant le service, le vassal ne pouvait être assigné devant une cour féodale.
L’expédition pour accompagner le nouveau roi des Allemands à Rome était soumise à des règles spéciales; elle était due par quiconque possédait un fief impérial; on en avisait un an à l’avance. Ce service cessait au jour du couronnement.
On pouvait être dispensé du service effectif par le paiement d’un impôt militaire s’élevant à la dîme du revenu du fief.
Les burglehen et les fiefs d’ecclésiastiques étaient exempts du service impérial.
c) Le service de cour (hofvart) comprend l’obligation de paraître à la cour du suzerain pour en relever l’éclat, d’assister au conseil et de prendre part aux jugements. Nous parlerons plus au long de ce dernier objet en traitant de la juridiction.
Dans l’obligation féodale sont comprises, d’après le droit commun, non-seulement l’obligation du possesseur actuel du fief, mais aussi un devoir de fidélité de la part de ceux qui ont à cette possession un droit éventuel. Ce devoir consiste seulement à ne rien faire contre la fidélité, de la part des agnats, en leur qualité d’ayant-droit à la succession du fief; mais il est positif pour les covassaux, même lorsque ceux-ci n’ont qu’une investiture éventuelle, ce qui pouvait arriver, selon le droit allemand. Dans ce cas, le devoir des divers obligés peut être rempli par une personne qui les représente collectivement; c’est le provassallus, en allemand lehenträger, qui se distingue du simple fondé de pouvoirs en ce qu’il peut remplacer le vassal dans des actes pour lesquels celui-ci, dans la règle, devrait agir en personne, et par cette /324/ raison doit être une personne capable de posséder un fief, tandis que cette condition n’est pas exigée du fondé de pouvoir ordinaire. Il y a donc nécessairement un provassal, lorsque le vassal est une personne morale, une communauté. La félonie du provassal peut entraîner la reprise du fief.
En France, le service militaire est dû par tout vassal à son seigneur. Le service militaire, avons-nous vu, était la condition originaire de toute concession bénéficiaire; lorsque les bénéfices se divisèrent en fiefs et en censives, le vassal noble, ou possesseur de fief, fut seul appelé à concourir aux expéditions de son seigneur; le censitaire, en revanche, était chargé de subvenir aux besoins de l’armée féodale.
Mais, à côté du service militaire féodal subsistait l’obligation générale pour tout homme libre de marcher à la défense du pays.
En Allemagne, cette obligation a donné naissance aux baillis impériaux, qui percevaient un impôt de ceux dont la fortune ne suffisait pas pour qu’ils pussent servir en personne à leurs propres frais.
En France, ce service faisait partie des obligations justicières dont le comte poursuivait l’exécution. Ce qui prouve que le service militaire des hommes libres n’était pas féodal, c’est précisément que les comtes s’en firent un moyen de forcer l’homme libre à s’engager envers eux dans les liens féodaux, en recommandant leur propriété. « Illum semper in hostem faciant ire usquedum pauper factus, nolens, volens, suum proprium tradat aut vendat, » dit Baluze.
Les Capitulaires avaient cherché à concilier le service justicier et le service féodal, mais l’intérêt seigneurial l’emporta, sur ce point comme sur les autres; les seigneurs, réunissant le fief et la justice, assujettirent indifféremment à leur service /325/ les vassaux et les sujets justiciers. Cependant, il paraîtrait, d’après l’ancienne coutume d’Anjou, que l’obligation justicière, l’ancien hériban (bannum ad hostem), garda le nom d’ost, et que l’obligation féodale prit plus particulièrement le nom de chevauchée (cavalcata). « Il y a, dit cette coutume, différence entre houst et chevauchée, car houst est pour défendre le pays, qui est pour le profit commun, et chevauchée est pour défendre son seigneur. » Le droit de guet est dérivé du service justicier; c’était l’obligation de faire des patrouilles contre les voleurs. Ce droit fut plus tard converti en rentes, que l’on qualifia de féodales dans certaines localités; cette qualité fut néanmoins vivement contestée par les nobles, qui, exempts des obligations justicières, n’auraient pas été exemptés d’une obligation censée appartenir au fief.
En France, où l’institution du fief militaire n’est pas aussi soigneusement distinguée qu’en Allemagne, les vassaux étaient tenus à des obligations personnelles qui sembleraient étrangères à l’institution féodale; ces obligations-là ont presque toujours leur origine dans la justice et non pas dans le fief, et, dans le fief, elles pesaient sur les censifs et les cultivateurs non-libres, ainsi que sur les vassaux militaires.
Quoique la plupart des droits, de corvée, de gîte, de past, etc., fussent des droits de justice, on en trouve qui appartiennent à des seigneurs féodaux, et même à des propriétaires ordinaires; mais il est à supposer que ces obligations ont été stipulées à l’instar des redevances justicières; celles-là sont réelles et non-personnelles. Il ne faut, du reste, pas confondre la charge de fournir des chevaux de transport avec la redevance féodale et militaire du roussin de service, dont les coutumes font aussi mention; cette dernière appartient au contrat de fief et aux obligations qui tiennent au service /326/ militaire. C’est à tort que l’on a cru les corvées exclusivement serviles, ou issues de stipulations d’affranchissement ou de fermage; il y a eu sans doute des corvées de ce genre, et en grand nombre, et ce sont celles-là que l’on rencontre dans les fiefs, ainsi que dans les censives, à la nature desquelles elles se rattachent encore plus.
Les nobles, étant exempts de toute obligation justicière, étaient par là exempts des corvées personnelles; mais de Laurière observe que cette exemption ne se rapporte pas aux corvées réelles; si elles sont réelles, le noble, tenancier du fonds qui les doit, donne un homme qui les fait pour lui.
Au nombre des obligations du vassal qui tiennent à ses devoirs personnels, je pense qu’il faut ranger les aides féodales, ce que l’on appelait aussi, en France, les quatre cas; c’était une subvention en argent que le seigneur avait le droit de demander à ses vassaux: 1° quand son fils aîné était reçu chevalier; 2° quand il mariait sa fille aînée; 3° quand il allait à la croisade; 4° pour payer sa rançon, s’il était fait prisonnier.
En Allemagne, on retrouve l’une des aides sous le nom de maritagium, ou fräuleinsteuer.
Les aides étaient, dans le principe, dues par les possesseurs de fiefs seulement, et en raison de leur devoir de fidélité; mais, en France, les seigneurs justiciers cherchèrent à les étendre à leurs sujets, alors les aides prennent le nom de taille des quatre cas. Nous en parlerons en traitant des redevances justicières.
Les obligations personnelles du vassal n’engageaient point sa liberté, par la raison qu’il pouvait toujours les faire cesser en renonçant au bénéfice; c’est cette faculté de renoncer au fief qui constitue l’homme libre. Dans l’époque barbare, elle /327/ paraît quelquefois contestée, parce que les rapports y sont encore dans un certain vague, et qu’on ne distingue pas nettement les leudes libres des ministériaux. Dans le droit féodal, ce droit est incontestable; en Allemagne, il constituait la principale différence entre le vassal proprement dit et le ministériel. Ce droit à lui seul démontre que la société féodale était originairement de droit privé, et que le pouvoir du seigneur féodal avait pour base un contrat et non pas un pouvoir politique. Beaumanoir, qui vivait au temps où la féodalité fut le plus fortement constituée, ne limite le droit de renonciation du vassal que par la bonne foi, qui ne permet pas de rompre une société en temps inopportun, pour en éviter les charges après en avoir recueilli les bénéfices: « Si aucuns cuident que je puisse lessier le fief que je tiens de mon seigneur, et la foi et l’oumage, toutes le fois qui me plait ... Mais se il advenait que messires m’eût recours pour un grand besoing, et je en tel point vouloi lessier mon fief, je ne garderai pas bien ma foi et ma loyauté envers mon seigneur; car, à l’oumage fère, promet on foi et loyauté, et puisque en est promise, elle ne serait pas loyauté de renoncer el point que ses sires doit l’un aidier. »
Les devoirs de fidélité sont réciproques; le seigneur est donc obligé vis-à-vis de son vassal, bien qu’il ne s’engage pas par serment; « il ne doit nuire à son vassal ni par conseil, ni par action, » disait le Sachsenspiegel; ou, selon les termes d’un document allemand de 1244, le seigneur devait être propicius et benignus à l’égard de son vassal.
Vu cette réciprocité, le seigneur viole la foi féodale envers son vassal dans les mêmes cas où le vassal commet une félonie. Seulement, le droit féodal a plus explicitement déterminé les obligations du vassal et les effets de leur violation. /328/
D’après le livre des fiefs, la violation de la foi par le seigneur a pour conséquence de lui faire perdre ses droits seigneuriaux sur le fief du vassal: « Domino comittente feloniam ut ita dicam, per quam vasallus amitteret feudum si eam comitteret, quid obtinere debeat de consuetudine queritur et responditur, proprietatem feudi ad casalium pertinere sive peccavit in casalium, sive in alium. » (Liv. II, tit. 26, § 22. )
/329/
§ II.
Des droits et des obligations concernant les choses.
Dans le contrat féodal, la propriété du sol reste au seigneur, sous le nom de domaine direct ou dirigeant; le vassal a un droit de jouissance sur le bien inféodé, un droit approchant de l’usufruit, que l’on a nommé domaine utile. Ainsi, le système du fief comprenait la propriété tout entière, le dominium plenum, et la partageait entre les membres de l’association féodale.
Les concessions féodales s’opéraient le plus souvent par le démembrement d’un domaine, dont une portion limitée était donnée à titre de bénéfice aux vassaux et aux censitaires, tandis que le seigneur conservait sur l’autre partie, appelée le domaine, une pleine et complète propriété.
Relativement au fonds du vassal, le fonds resté aux mains du seigneur était appelé fonds dominant, et celui du vassal s’appelait fonds servant: le second relevait du premier; au premier étaient attachés les droits appelés, par le droit français, la directe, sous le rapport de la propriété, et la mouvance, sous le rapport du fief.
Dans le droit lombard, tel que nous le présente le livre des fiefs, la concession d’un fief a pour effet de rattacher la possession du vassal au fonds même du seigneur qui l’a constituée; elle créé un droit réel; en sorte que la supériorité qui existe de seigneur à vassal existe également de la terre /330/ du premier à celle du second. Il y a, dans le fief, une hiérarchie personnelle et une hiérarchie territoriale correspondant l’une à l’autre, inséparables l’une de l’autre.
En France, la hiérarchie féodale est seulement personnelle; il n’y a pas, entre la terre du seigneur et celle du vassal, un lien résultant du contrat féodal. Le fief servant ne relève du fief dominant qu’à cause du seigneur.
Pendant longtemps, sans doute, les seigneurs avaient conservé la propriété de leur domaine en pleine jouissance; mais, par la suite des temps, en raison des partages de succession et pour cause d’appauvrissement, les seigneurs français furent conduits à inféoder ou aliéner les terres qu’ils s’étaient réservées, et le rapport féodal n’en fut pas pour cela rompu. On disait, dans ce cas: « Le seigneur fait de son domaine son fief. »
Le seigneur qui avait inféodé la dernière parcelle de son domaine conservait néanmoins la directe et la mouvance de tous ses fiefs. Les fiefs appartenant à un seigneur sans domaine furent appelés fiefs en l’air, ou fiefs incorporels.
Dumoulin et Loiseau, se fondant sur le livre des fiefs, considèrent l’existence de ces fiefs en l’air comme tout à fait anormale; mais elle n’en est pas moins généralement admise dans le droit féodal français; c’est une de ces variétés qui s’établissent dans les usages féodaux d’un pays à un autre, comme nous en avons déjà vus, et comme nous en verrons encore. Nous n’y saurions, du reste, rien trouver d’anormal.
D’Argentré, le seul d’entre les feudistes français du XVIesiècle qui ait lutté avec conséquence et savoir contre l’application des sources étrangères au droit coutumier et national, observait déjà qu’en matière de fiefs, les usages varient considérablement, et il répondait à Dumoulin, qui soutenait /331/ qu’on ne pouvait alléguer l’existence des fiefs en l’air que par ignorance du livre des fiefs: « Le livre des fiefs est le droit du Milanais, et lorsqu’il s’agit de notre droit, je ne m’en inquiète pas plus que de ce qui peut se faire dans le sérail du Grand-Turc. »
Pourtant, il faut bien le dire, pour ce qui concerne la partie du droit féodal dont nous traitons actuellement, force est bien de recourir au droit lombard et même aux droits saxon et souabe; car, là du moins, cette matière a été développée dans des écrits qu’il nous est possible de consulter, tandis que les nombreux écrivains français qui l’ont traitée ne remontent pas à l’époque véritablement féodale. Or, du moment que le service militaire a cessé d’être le principe des obligations du vassal, le rapport féodal a changé tellement de nature, qu’il n’est pas possible de déterminer les obligations de l’époque antérieure à l’aide de celles qui appartiennent à l’époque subséquente, beaucoup plus compliquée d’ailleurs. Au reste, lorsque, comme dans la question des fiefs en l’air, une divergence notable pourra être reconnue entre le droit féodal français et le droit impérial, nous aurons soin de l’indiquer.
Le domaine direct constitue une possession (gewehre) exercée au profit du seigneur par le vassal; le seigneur peut invoquer cette possession en vue de revendiquer son fief, soit contre un tiers quelconque, soit contre le vassal lui-même, par exemple, lorsque le fief n’a été concédé que pour un temps déterminé, lorsque le vassal l’a aliéné sans le consentement du seigneur, ou lorsqu’il l’aurait perdu par sa faute.
Dans l’ancien droit féodal, les droits du seigneur étaient plutôt personnels que réels, puisque la concession moyennant rétribution constitue un contrat distinct, la censive, dont il sera parlé plus tard. /332/
Le seigneur peut, en vertu de sa directe, promettre le fief à un autre, pour le cas où il lui reviendrait; mais il ne peut l’ôter au vassal qui le possède sans le consentement de celui-ci. Ce consentement se présume si le vassal présent à la nouvelle concession n’y a pas mis opposition.
En principe, le seigneur peut aliéner son domaine direct, qui est sa propriété; mais, d’après le livre des fiefs, ainsi que d’après le droit germanique, cette faculté est soumise à certaines restrictions, fondées sur les droits du vassal. Ainsi, le seigneur ne peut aliéner sa directe en faveur d’une personne qui lui est inférieure en rang, sans le consentement du vassal 1 .
Le seigneur ne pouvait pas, par le même motif, changer un rechtelehn en un burglehn, car le burglehn est envisagé comme inférieur au fief régulier; il ne donnait pas lieu au service de chevalier et accès au heerschild.
On ne pouvait pas non plus inféoder le fief de son vassal tout en le lui conservant, c’est-à-dire placer un tiers entre son vassal et lui; car, par là encore, on aurait rabaissé le vassal.
Ces principes protecteurs de la position du vassal furent abandonnés lorsque la puissance territoriale (landhoheit) eut atteint, en Allemagne, son entier développement. Rosenthal observe qu’il a vu souvent des territoires et des comtés cédés /333/ en entier, et les vassaux transférés, par le même fait, sans aucune contradiction.
On ne voit pas que des règles pareilles existassent dans l’ancien droit français; toutefois, il faut qu’elles n’y fussent pas totalement inconnues, car, lorsqu’en 1308, Philippe-le-Bel céda le duché de Bretagne à Edouard II, roi d’Angleterre, le duc Arthur, alors mineur, s’y opposa par le motif qu’il n’avait pu, sans son consentement, être cédé à un seigneur inférieur en rang. Le jurisconsulte Azzo, un des célèbres docteur de Bologne, interrogé sur le cas, donna raison au duc de Bretagne. On sait que le roi d’Angleterre était vassal du roi de France pour le duché de Normandie; le duc de Bretagne serait donc devenu arrière-vassal.
En France, comme en Allemagne, le domaine direct était indivisible, ainsi que ses effets; cela est de l’essence du fief. D’après le droit germanique, si le seigneur aliène la directe d’une partie du fief, le vassal suit la plus forte part, si, du reste, il n’a pas opposé ou n’avait pas de motifs à opposer à l’aliénation, car il ne peut être obligé à servir deux seigneurs.
Le domaine utile donne aussi lieu à une possession en faveur du vassal: « Das gud und die gewere des gudes, » dit la glosse du Sachsenspiegel (proprietas et possessio feudi); et les tableaux symboliques donnent le même symbole pour la propriété et pour la possession.
Cette possession est acquise par le fait de l’investiture; d’où il résulte que le premier investi a la préférence sur le second investi, et qu’il peut également revendiquer la possession vis-à-vis du seigneur et le sommer de lui monstrer le fief (weisen, demonstrare). Cette démonstration est nécessaire si l’objet du fief n’est pas un immeuble déterminé, par exemple, /334/ s’il comprend des droits incorporels, des péages, des dîmes, etc. Si le seigneur refuse la démonstration, le vassal peut s’en passer.
Le domaine utile du vassal, en opposition avec le domaine direct du seigneur, comprend l’usage de tous les droits du propriétaire, pour autant que la chose n’en est pas détériorée; un tel usage dépasse les droits compris dans le simple usufruit. Le vassal jouit: 1° De tous les fruits civils et naturels, ordinaires et extraordinaires; ces fruits, une fois séparés, deviennent la propriété allodiale du vassal. 2° Il exerce tous les droits qui appartiennent au fief, juridictions, servitudes, etc. 3° Il peut changer l’économie du fief, en ce sens que ce changement ne constitue pas une détérioration; car une détérioration grave, lorsqu’elle est précédée d’une menace de reprendre le fief de la part du seigneur, peut entraîner la perte du dit fief; et, dans tous les cas, la détérioration motive une action en dédommagement, soit au profit du seigneur, soit au profit des successeurs au fief, contre les biens allodiaux du vassal qui en est l’auteur. 4° Les charges publiques et privées, et les frais de réparation ordinaires et extraordinaires, sont à la charge du vassal.
Le vassal a droit d’exiger que son seigneur n’amoindrisse pas le fief, ou, en cas de nécessité, lui donne un dédommagement, qu’il reconnaisse en tous temps sa qualité de vassal, et qu’il le garantisse contre les prétentions des tiers: « Warandiam concessionis plenam et integram præstantes, » disent les documents. En vertu de cette garantie, le seigneur doit, dans certains cas, défendre lui-même la possession de son vassal; cela arrive, entre autres, lorsque l’adversaire fait dériver son droit d’une concession conférée par un autre seigneur. Le seigneur est, en revanche, dispensé de la /335/ garantie, s’il a été forcé de livrer le fief par autorité de justice, et sans promettre de se présenter en lieu et place de son vassal; si le vassal a négligé de prendre possession lorsqu’il le pouvait, etc.; si le seigneur refuse son secours, le vassal a le droit de s’adresser au suzerain pour le faire obliger à le fournir, et, en cas de refus obstiné, il devient vassal direct du suzerain. Si, malgré l’intervention du seigneur, le vassal est évincé, le seigneur doit lui donner une compensation; par exemple, lorsqu’il aurait précédemment investi un autre, ou lorsque son investiture a succombé devant celle d’un autre seigneur, dont le droit a prévalu.
Si la possession n’a pas été précédée d’investiture, elle est appelée unrechte gewere, dans le droit saxon, et une telle possession est sans valeur. La juste possession ne peut être attaquée sans jugement préalable, et, vis-à-vis du seigneur qui intente procès à son vassal, elle sert de caution à ce dernier. Si le vassal en possession est attaqué par le suzerain, celui-ci doit d’abord prouver en justice la légitimité de son droit vis-à-vis du seigneur du vassal.
Le domaine utile, la jouissance du bien inféodé (die nut, quelquefois die nieder eigenthum), constitue le droit du vassal. Le vassal peut améliorer un bénéfice, mais il ne doit pas le détériorer, comme on l’a vu plus haut: « Que les bénéfices soient restaurés, et non détruits ou désertés (restaurata, non destructa aut deserta), » disent déjà les Capitulaires. D’après cela, un vassal pouvait bâtir sur le fief sans la permission du seigneur; mais ce qu’il a construit accroît le fief. Le vassal peut aussi acquérir une servitude pour le fief, mais ne peut lui en imposer; s’il le fait, elle n’oblige que lui ou son héritier, mais non point le seigneur.
Le vassal ne peut céder son fief à un autre sans le consentement /336/ du seigneur, car le contrat féodal est à la fois réel et personnel, et la personne du vassal n’est pas indifférente au seigneur. D’après le droit lombard, la transmission de tout ou partie du fief à un tiers est jugée d’après la règle générale, qui défend au vassal de porter dommage, soit au seigneur, soit aux agnats. Une aliénation qui ferait perdre au seigneur le service féodal est nulle, et entraîne la perte du fief pour le vassal; celle d’une portion du fief seulement peut être révoquée sur la demande du seigneur, si la portion aliénée est inférieure à la moitié du fief. Une constitution de l’empereur Lothaire II punit toute aliénation de la peine de la commise, parce qu’elle nuit au service impérial; cette ordonnance sévère fut répétée par Frédéric Ier. Les droits saxon et Souabe n’allaient pas aussi loin: tout acte du vassal qui lui fait perdre la possession est sans valeur sans le consentement du seigneur, mais n’entraîne pourtant pas après lui la perte du fief.
Le vassal peut sous-inféoder son bénéfice sans le consentement du seigneur; car, dans ce cas, il ne cesse pas d’être vassal, et ne fait que donner à son seigneur un sous-vassal de plus, ce qui est pur profit, sans chance de perte. L’arrière-fief est appelé, en droit germanique, affterlehen, en latin subfeudum.
Toutefois, le droit lombard apporte quelques réserves au droit d’inféodation du vassal. « La sous-inféodation ne doit pas être faite avec ruse (callide), » dit le livre des fiefs; cela veut dire qu’on ne peut inféoder pour arriver par là à laisser le fief. On ne doit pas non plus sous-inféoder à une personne trop puissante et que le seigneur ne pourrait pas maintenir dans le devoir. Enfin, on ne peut sous-inféoder d’après une loi et des conditions différentes de celles selon lesquelles on a /337/ reçu soi-même le bien, par exemple, donner en fief féminin ce qu’on a reçu en fief mâle. En Allemagne, on ne pouvait pas sous-inféoder un burglehn.
L’arrière-vassal doit honneur et respect au seigneur du vassal, sous peine d’être privé de son arrière-fief; il a, du reste, tous les droits qu’a le vassal lui-même. Si le fief devait cesser par convention à une certaine époque, les arrière-fiefs créés sur lui cessent également; ils cessent aussi, si le vassal qui en est seigneur est privé de son fief par sa faute, ou s’il décède sans laisser d’héritiers.
A la question des sous-inféodations se rattache celle des jeux de fiefs, ou démembrements.
Nous avons dit que l’inféodation, étant un contrat personnel, le feudataire ne pouvait pas disposer de son fief au profit d’un tiers. En France, durant la première époque féodale, ce principe était dans toute sa force; mais, au XIVesiècle, il avait déjà décliné devant les progrès de la possession du vassal. Le seigneur ne pouvait plus refuser son consentement à la transmission du fief, mais il avait le droit de ne l’accorder que dans certaines conditions. Dès lors, et jusqu’aux derniers temps du régime féodal, le domaine direct se manifesta de deux manières: la première consiste dans les lods et ventes qui formaient le prix d’un consentement, devenu forcé par l’usage, à la transmission du fief; ces lods consistaient dans une partie du prix de vente qui était livrée au seigneur. La seconde consiste dans le retrait féodal, c’est-à-dire la faculté de reprendre le fief aliéné en remboursant le prix. Les lods et le retrait ont subsisté jusqu’à la Révolution. Nous reviendrons sur ce sujet; mais, pour le moment, nous voulons parler seulement du droit en vigueur durant l’époque féodale. /338/
Il est à remarquer que la sous-inféodation n’est permise que dans les fiefs de service; le censitaire ne pouvait pas sous-inféoder.
Le vassal ne peut donner en hypothèque son fief sans le consentement du seigneur; le consentement du seigneur devait être exprès et formel; de même, dans une hypothèque de tous biens en général, on n’entend pas qu’il faille comprendre les biens tenus en fief.
L’hypothèque, une fois constituée avec le consentement du seigneur, peut être transférée à un tiers sans son consentement.
Si elle a été constituée sans le consentement du dit seigneur, le vassal qui l’a constituée est tenu de la dette sur ses biens personnels, et le seigneur peut l’obliger à libérer le fief dans un délai donné; mais si, connaissant l’hypothèque, il la laisse subsister pendant an et jour, il est censé avoir donné son consentement tacite.
Dans le droit germanique, pour hypothéquer le fief, il fallait, outre le consentement du seigneur, celui des agnats du vassal, qui avaient droit de succession sur le bénéfice.
Le droit germanique admettait exceptionnellement que le vassal, possesseur d’un fief impérial, pouvait en aliéner ou hypothéquer une partie sans le consentement de l’empereur; mais, en cas d’hypothèque, l’exécution sur le fief n’avait lieu qu’à défaut d’autres biens.
On n’envisagerait pas comme aliénation interdite, d’après le droit allemand, la cession du fief donnée à une personne comprise dans la première investiture; de même, on ne punissait pas de la perte du fief l’aliénation commise par erreur, de telle sorte, que le vassal lui-même pourrait la faire révoquer. Lorsque le fief est repris ensuite d’aliénation sans le /339/ consentement du seigneur, cette reprise est au détriment du vassal qui a aliéné et de ses descendants; mais, eu égard à des successeurs au fief non-descendants, la consolidation du fief serait seulement temporaire. L’aliénation temporaire ne fait consolider que ce qui a été réellement aliéné. Le droit de revendication du seigneur n’est soumis à aucune prescription; mais le seigneur peut remettre au vassal les conséquences de sa faute, et, dans ce cas, son pardon les efface définitivement.
Les aliénations interdites prennent donc validité par le consentement postérieur du seigneur, et deviennent dès lors irrévocables en ce qui le concerne; mais les successeurs au fief qui ne les auraient pas consenties peuvent en demander la révocation, lorsqu’ils arrivent à la succession; cette actio feudi revocatoria n’appartient pas toutefois aux descendants du vassal qui a aliéné. Les descendants de l’agnat qui a consenti à l’aliénation sont aussi exclus de ce droit de révocation.
A côté du droit de révocation qui a lieu pour les aliénations défendues, pour les aliénations non-défendues existe le droit de retrait, qui appartient tant au seigneur qu’aux successeurs au fief. Les descendants de l’aliénateur, ou de celui qui a consenti à l’aliénation, ne sont pas exclus du droit de retrait, comme ils le sont du droit d’opposer à l’aliénation, et la péremption de ce droit ne court pas pendant la minorité; seulement, l’aliénateur et les consentants peuvent renoncer d’avance, pour eux et leurs descendants, à l’exercice du droit de retrait, et ce renoncement les lie. En cas de collision, le droit de retrait du seigneur ne vient qu’après celui des successeurs au fief.
Nous avons vu, en traitant de la hiérarchie, ce que le droit /340/ germanique appelle le territoire (territorium); c’est le district sur lequel s’exerce la haute juridiction et la landhoheit. Lorsque le seigneur féodal avait un fief dans le territoire d’autrui, un tel fief s’appelait auswärtigelehn. Les feudistes germanistes en citent comme exemple les fiefs que les rois de Bohême, l’électeur palatin, et le marquis de Brandebourg, possédaient en Autriche. Ici, il y avait lieu de distinguer soigneusement entre le devoir du sujet et celui du vassal 1 .
/341/
TROISIÈME SECTION.
DU FIEF DANS SES RAPPORTS AVEC LE DROIT DE FAMILLE.
(MARIAGE, TUTELLE, SUCCESSION FÉODALE.)
§ I.
Mariage.
Lorsque les fiefs furent devenus patrimoniaux, il arriva souvent que, malgré la préférence qu’obtiennent presque partout les mâles dans la succession féodale, le fief parvenait à des femmes; et lorsque la femme était fille ou veuve, il importait beaucoup au seigneur que l’époux qu’elle prendrait et qui aurait à faire le service du fief, fût un vassal fidèle et non un ennemi. Cet intérêt prévalut sur le droit de famille et conduisit à restreindre la liberté civile même des vassales en âge de majorité; ce fut le seigneur qui maria ses vassales, comme leur tuteur, si elles étaient mineures; comme leur seigneur, si elles avaient atteint leur majorité.
Dans l’origine, ainsi que le remarque avec raison M. Laboulaye (De la condition civile et politique des femmes), cette règle fut plutôt favorable aux femmes, en ce que le seigneur, libre de se choisir un vassal, n’avait plus d’intérêt majeur à s’opposer à l’hérédité du fief. Mais, quand le principe de la patrimonialité des fiefs se fut consolidé, le droit des seigneurs /342/ concernant le mariage de leurs vassales apparut, au contraire, comme une étrange vexation; la vassale ne pouvait conserver la liberté de se marier à son gré qu’en abandonnant son fief.
La condition de la femme mariée, dans le système féodal, a été déterminée principalement par les institutions germaniques. D’Argentré, le savant commentateur de l’ancienne coutume de Bretagne, prémunissait déjà contre la tendance des praticiens à appliquer les idées romaines à une législation dont l’esprit est très différent.
Chez les Germains, comme chez les premiers Romains, la femme est toujours en tutelle; elle passe du mundium de ses parents sous celui de son époux, et le pouvoir du mari est à peu près aussi étendu que celui du père de famille. Mais, déjà dans la plupart des lois barbares, sous l’influence du christianisme, la rigueur du pouvoir marital s’est considérablement adoucie, la personnalité et la fortune de la femme sont plus protégées.
Dans le droit féodal, tant que dure le mariage, le mari est, encore en vertu du mundium, seul administrateur du bien conjugal, seul propriétaire vis-à-vis des tiers; la femme ne peut ni aliéner, ni disposer sans le consentement de son mari, car elle est en tutelle; mais cette tutelle est avant tout dans l’intérêt du protégé. Le Sachsenspiegel exprime nettement ce caractère protecteur du mundium germanique. Ainsi, le mari est le chef de l’association conjugale, mais il n’en est pas le maître; il peut disposer des revenus du bien de sa femme et en fait les fruits siens, mais il ne peut aliéner les propres de sa femme, et quand elle les aliène, le mari figure dans l’acte seulement par son autorisation, accompagnée souvent de celle des parents de sa femme. Il y a même /343/ des pays dans lesquels la femme, considérée comme héritière de son époux, doit à son tour consentir, comme les héritiers de sang, à la vente des propres de celui-ci.
En somme, le principe chrétien, qui considère le mariage comme une société où les deux époux ont des droits égaux, a prévalu complétement; et si le mari est administrateur, il y a tendance à protéger la femme contre sa mauvaise administration.
La loi féodale anglaise a seule conservé la dureté du système germanique primitif. Les lois du continent européen, les lois allemandes et françaises, entre autres, ont mieux compris les rapports mutuels des époux, et leur point de vue sur la nature de la puissance maritale a passé jusqu’à nous. En ce qui concerne le fief que la femme possède, celle-ci, passant sous la mainbournie (le mundium) du mari, seul chargé d’exercer pour elle tous ses droits, il y a mutation de vassal; car c’est au mari à desservir le fief. Le mari étant seigneur de tous les biens de la communauté, c’était une conséquence naturelle qu’il représentât sa femme en justice, et qu’il exerçât les actions qui lui appartenaient: « Nulle femme n’a réponse en cour laïe, » disent les Etablissements. Il faut excepter les actions relatives à des injures personnelles de la part du mari. D’après le droit canon, en revanche, la femme pouvait agir de son chef devant les cours ecclésiastiques, malgré l’avis contraire émis par Dumoulin.
Dans l’origine, le douaire ne pouvait pas être établi sur le fief, parce que le tenancier ne pouvait grever la jouissance de son successeur; le livre des fiefs le dit positivement. Néanmoins, plus tard, on vint à le permettre, lorsque le défunt ne laissait pas d’autres biens sur lesquels on pût l’asseoir.
Le Sachsenspiegel dit aussi qu’on ne peut établir le douaire /344/ que sur les propres; mais la glosse nous apprend que, depuis Frédéric II, la position des veuves a été améliorée. Le Schwabenspiegel permet de placer le douaire sur le fief, et les coutumes françaises également. Beaumanoir fait remonter à Philippe-Auguste l’établissement du douaire coutumier, qui était l’usufruit de la moitié ou du tiers 1 du bien du mari, à défaut de douaire convenu. Mais si l’on examine les lois barbares, on voit qu’elles connaissaient déjà le douaire coutumier. Peut-être, sous Philippe-Auguste, fut-il seulement permis de l’imposer aux fiefs.
La femme a un droit réel sur l’immeuble frappé de douaire, elle est saisie. Elle ne peut empêcher néanmoins le mari d’aliéner les biens sur lesquels il est assis; mais une telle aliénation est révocable du jour du prédécès du mari.
A l’égard du seigneur, la jouissance de la douairière est des plus franches; l’héritier doit la garantie de l’hommage et de toutes redevances, et, faveur remarquable, il ne peut forfaire le fief au préjudice de la veuve. Ainsi, l’héritier prend les charges du fief, et la veuve n’en doit avoir que les bénéfices.
D’après le Sachsenspiegel, on exigeait le consentement de l’héritier lors de la constitution du douaire. Les coutumes françaises, pourvoyent par un autre mode à l’intérêt de la famille, faisaient du douaire la propriété des enfants issus du mariage.
Les juridictions canonique, seigneuriale et royale, se disputèrent chacune les questions de douaire: l’Eglise, parce que le douaire est une condition essentielle du mariage; les /345/ seigneurs, parce que cette donation repose sur leurs fiefs; le roi, parce qu’il se posait comme le tuteur naturel des veuves et des orphelins. Par la convention de Philippe-Auguste avec les barons de France, il fut permis à la veuve de s’adresser à celle de ces juridictions qu’il lui plairait de choisir.
Les lois barbares ne défendaient pas les donations entre époux; leur esprit diffère en cela de celui des lois romaines. Le Sachsenspiegel interdit les donations de la femme au mari, par le motif seulement que la femme mariée est mineure. Quant aux donations pour cause de mort, elles furent généralement permises; le don mutuel fut, entre autres, entouré de beaucoup de faveur.
Les coutumes féodales de France et d’Allemagne laissaient ordinairement à la femme remariée le douaire et les gains nuptiaux; mais, communément aussi, on stipula, dans le contrat de mariage, la révocation de ces avantages en cas de secondes noces.
Depuis le XVIesiècle seulement, l’introduction du droit romain vint limiter, en cas de seconde union, les avantages nuptiaux que la femme pouvait faire à son second mari.
Le formariage est une coutume qui dérive du servage et non du fief, mais dont le principe remettait au seigneur le droit de choisir l’époux de la fille noble venant à hériter du fief. Le formariage est le droit qu’a le maître d’empêcher ses serfs de se marier sans son consentement, prohibition qui fut limitée plus tard au mariage contracté avec des personnes qui n’étaient pas de la même seigneurie ou de la même condition; cette conséquence du droit de propriété de l’homme sur l’homme fut étendue des serfs aux vilains originairement libres, par suite des usurpations de la puissance /346/ justicière. Si, en Allemagne, le formariage était exercé rigoureusement à l’égard des ministériaux, c’est que, dans la condition de cette classe, la liberté de la personne est engagée.
Durant l’époque barbare, le maître de la femme serve, pour se réserver les enfants, cassait de son chef le mariage contracté avec le serf d’un autre. L’Eglise lutta avec succès contre cet usage, contraire à la sainteté du mariage.
Soit en Allemagne, soit en France, il s’introduisit, pour concilier le vœu de l’Eglise et l’intérêt des maîtres, la coutume de stipuler, entre les seigneuries, des mariages par échange; de sorte que, de cette façon, l’un ne pût pas s’enrichir aux dépens de l’autre; ces conventions sont surtout fréquentes entre les couvents, du Xe au XIIesiècle. Souvent aussi, on stipula le partage des enfants entre les maîtres des deux époux. Cette dernière coutume avait passé de la loi romaine dans la législation des Wisigoths. Enfin, au XIIesiècle, le formariage fut réduit assez généralement à une simple redevance. De ces redevances payées pour se marier sont nées ces coutumes bizarres connues sous le nom de droit du seigneur, coutumes auxquelles on a prêté une portée immorale et absurde qu’elles n’eurent pas dans la réalité, tout au moins en tant que règle; car l’abus et la tyrannie sont possibles en cette matière comme en toute autre.
/347/
§ II.
De la tutelle féodale.
La tutelle romaine était moins une précaution législative ayant pour but de préserver le mineur des suites de son inexpérience qu’une institution juridique destinée à maintenir les droits de la famille et les intérêts des agnats. La tutelle germanique, qui n’est qu’une application du mundium, est bien différente; la puissance du mundwald est faite pour le protégé et non pour le protecteur. La tutelle féodale, que le langage juridique du moyen âge appelle bail, garde, ou mainbournie, repose sur d’autres principes, savoir: 1° sur le droit qu’a le seigneur de ne pas perdre, pendant la minorité, le service de vassal en vue duquel le fief a été concédé; 2° sur le droit qu’il a en conséquence à faire représenter le mineur par une personne apte à rendre ce service, et qui soit à la convenance du seigneur.
En conséquence de ce double droit, la garde des vassaux mineurs était attribuée au seigneur; il pouvait l’exercer lui-même en faisant les fruits siens, à charge d’entretenir le ou les mineurs, ou bien la remettre à l’un de ses vassaux, qui était chargé du service du fief moyennant la jouissance du fief que le seigneur lui concédait.
On a expliqué la garde seigneuriale par l’intérêt même /348/ des mineurs. C’est ainsi que les Etablissements de Normandie exposent les motifs de la garde des orphelins 1 .
Le seigneur faisait les fruits siens, mais à la charge de payer les dettes: « Qui garde prend, quitte la rend. »
L’ancien droit féodal germanique reconnaissait aussi au seigneur le droit de garde sur le fief du vassal mineur jusqu’à sa puberté, et celui de faire les fruits siens ou de les laisser à un provassal, qui faisait le service militaire à la place du mineur.
Le droit du seigneur à faire les fruits siens est appelé, par le Sachsenspiegel, anevelle, angefälle.
On donnait un tuteur au vassal en état de minorité ou de faiblesse d’esprit, comme aussi en cas d’absence du vassal; mais, dans ce dernier cas, quelques-uns pensent que la curatelle était donnée de droit au plus proche parent, successeur présomptif.
Le tuteur n’était pas nécessairement un homme capable de posséder un fief; mais, s’il ne l’était pas, la cour féodale /349/ désignait un tuteur pour le fief qui était en lehenträger (provassal) et devait être par conséquent capable de posséder un fief; l’administration restait au tuteur personnel, mais le devoir féodal était rempli par le provassal.
D’après ce livre de droit, l’enfance allait jusqu’à treize ans et six semaines, et l’anevelle ne dure que jusqu’à ce terme; mais depuis, et jusqu’à vingt-quatre ans, le jeune homme est encore mineur et il a un tuteur; l’Auctor vetus dit seulement qu’il peut en avoir un. Depuis treize ans et six semaines, l’enfant est zu seinen jahren; son tuteur lui doit compte annuel.
La minorité n’empêche pas de recevoir le fief. D’après le droit germanique, qui permettait à plusieurs frères de choisir celui d’entre eux qui serait investi, l’investiture faite à l’aîné était accompagnée d’une promesse donnée avec garantie que les mineurs n’attaqueraient pas le seigneur à ce sujet. Ce que l’enfant a fait ou négligé de faire pendant sa minorité ne doit pas lui nuire; ainsi, s’il n’a pas obtenu l’investiture, il a encore un an dès sa majorité pour la revendiquer. Dans le droit féodal français, le tuteur ne pouvant prêter l’hommage pour son pupille, le seigneur devait lui accorder ce qu’on appelait souffrance féodale, c’est-à-dire lui laisser le fief en attendant que l’hommage pût être prêté.
Le droit germanique admit cependant la tutelle testamentaire, qui pouvait être laissée, non-seulement à un autre vassal, mais aussi à un étranger au fief, et qui l’était de préférence, d’après le droit saxon, en faveur du tuteur naturel, à savoir le plus proche agnat (der nächsten schwertmagen). Cette tutelle de l’agnat le plus proche était aussi établie dans les mains princières au moyen de pactes de famille.
En France, lorsque le mineur avait un fief du roi, le roi /350/ prit la garde de tous les autres fiefs. La garde seigneuriale ne se maintint du reste pendant longtemps qu’en Normandie et en Bretagne. Dans quelques provinces, la tutelle fut conférée aux parents; mais si le tuteur pouvait hériter du fief, il n’avait que la tutelle de la personne du mineur; l’ascendant pouvait réunir la tutelle et la garde, parce que le fief ne pouvait lui revenir. Entre collatéraux, la tutelle de la personne était donnée au parent le plus éloigné, et celle du fief au plus proche. Le tuteur, ou baillistre, donnait caution de ne pas marier le mineur sans le consentement de ses parents, de lui donner une éducation convenable, de tenir le fief en bon état et d’en faire le service.
/351/
§ III.
De la succession féodale.
Entre la tendance constante des vassaux à perpétuer dans leur famille une concession originairement temporaire ou viagère et le droit du seigneur à reprendre ce qu’il avait concédé selon ses convenances, il s’était établi une suite de luttes et de transactions dont l’issue fut l’hérédité des fiefs, et par conséquent la victoire du possesseur sur le propriétaire, du domaine utile sur le domaine direct, la transformation du fief en patrimoine.
« Dans l’ancien temps, dit le livre des fiefs 1 , les fiefs étaient tellement au pouvoir du seigneur dominant, qu’il pouvait révoquer à son gré la donation qu’il avait faite. On en vint ensuite à concéder le fief pour un an; puis on établit qu’il resterait au vassal sa vie durant, mais sans passer aux enfants par droit de succession. Enfin, on en vint à transmettre le fief à celui que le seigneur agréerait. Aujourd’hui, le fief appartient à tous les fils également. » /352/
Les faits sont certainement loin de s’être développés dans un ordre aussi systématique; mais on a vu que l’hérédité des fiefs était le but auquel concouraient en effet tous les efforts durant l’époque barbare, et que ce but une fois atteint, l’hérédité des bénéfices et des honneurs une fois reconnue comme loi, l’époque féodale, c’est-à-dire un système nouveau de possession et d’organisation sociale se trouva inauguré.
Néanmoins, un grand principe domine toujours toutes les concessions féodales, c’est la nécessité du service militaire stipulée au profil du seigneur; car, pour ces petits suzerains, toujours en guerre avec leurs voisins, et sans armées permanentes, ni argent pour les solder, la première condition d’existence était d’avoir toujours des vassaux prêts à les soutenir; aussi, toutes les institutions civiles qui se rattachent au fief, la garde, le mariage, les successions, furent-elles, dans l’origine, organisées en vue du service militaire. L’esprit militaire est ce qui donne un cachet particulier à la législation féodale et la distingue des législations barbares dont elle est issue.
Quand le triomphe de la royauté fit cesser l’indépendance des seigneurs féodaux et mit un terme à leurs guerres continuelles, quand la société fut mieux assise et le service militaire moins nécessaire, cet esprit militaire, qui appartient à la première époque féodale, fut remplacé par l’esprit aristocratique et nobiliaire, lequel retarda encore pour un temps assez long la victoire des sentiments naturels.
En exposant la matière des successions féodales dans son développement historique, nous verrons tout spécialement l’influence de ces deux principes particuliers au droit féodal, l’esprit militaire d’abord, l’esprit aristocratique plus tard, et, /353/ dans ces deux principes, nous trouverons la clef et l’explication naturelle de maintes dispositions qui pourraient paraître anormales, si on ne les envisageait qu’au point de vue du droit de famille et du droit naturel.
Le droit du vassal ne reposant pas sur ce qu’il a le fief, mais sur la concession qu’il en a obtenue, la succession féodale n’a pas sa source dans le droit du vassal, mais dans l’investiture.
Le passage du fief aux enfants du vassal doit donc être envisagé, en réalité, comme une nouvelle investiture de la part du seigneur; c’est une confirmation du bénéfice promise par avance, et chaque successeur est comme le représentant d’une concession qui existe encore virtuellement en sa faveur, et remonte dès lors, quant à la source de son droit, non au dernier possesseur, mais au premier concessionnaire.
De là, la différence qui existe en principe entre la succession féodale et la succession ordinaire.
Cette différence ne se manifeste pas dans la succession des descendants, qui est commune aux deux; mais, en revanche, les exigences du service militaire motivent l’exclusion des femmes de la succession féodale, et cette exclusion se rencontre en effet dans les plus anciens documents concernant l’hérédité des fiefs.
De ce nombre est la constitution de Conrad-le-Salique, de 1027 1 . Cet édit concède le fief au fils, au petit-fils, en ligne masculine, et, à défaut, au frère de père. /354/
L’exclusion des filles n’étant pas la suite d’une incapacité légale, comme dans les lois barbares, mais le simple effet de la concession, là où la concession admet la fille, elle succède au fief sans obstacle 1 , ainsi que les descendants.
Le fief passant aux descendants en ligne féminine était appelé fief féminin. Quelques anciens jurisconsultes pensèrent que le fief féminin ne devait passer qu’aux femmes, comme le fief masculin ne passait qu’aux mâles; mais cette interprétation a été écartée à juste titre 2 . Il y a plus, même dans le fief féminin, la fille n’hérite, pas, comme ses frères, mais seulement à défaut de ses frères.
La distinction entre la succession naturelle et la succession féodale, qui est basée sur la continuation supposée de la concession, explique l’exclusion des ascendants dans la succession féodale, le fief ne pouvant revenir à quelqu’un à qui il n’a pas été concédé, mais uniquement au seigneur 3 .
Un ascendant peut cependant reprendre le fief, si, l’ayant cédé à son descendant, il s’est réservé expressément de le reprendre au cas où celui à qui il le cède viendrait à mourir avant lui. Encore dans cette convention, il est nécessaire de faire intervenir le consentement du seigneur 4 . /355/
La succession en ligne collatérale a cela de commun avec la succession des ascendants, que l’on ne compte pas la parenté en partant du dernier possesseur, mais en partant du premier acquéreur; ainsi, les collatéraux du dernier possesseur, qui ne seraient pas en même temps descendants du premier acquéreur, ne peuvent recueillir le fief.
La succession des collatéraux n’avait été admise premièrement, selon le livre des fiefs, qu’en faveur des frères de père; depuis la constitution de Conrad-le-Salique, elle fut étendue aux agnats, jusqu’à l’infini, pour les fiefs anciens; pour les fiefs nouveaux, la succession des agnats n’avait lieu qu’en vertu de convention, ou s’il a été acquis par des frères de leurs deniers communs, ou par des frères indivis, ou encore s’il est dit que le fief nouveau est concédé selon la loi des fiefs anciens.
En premier lieu succèdent les frères germains ou consanguins; dans les fiefs paternels, ceux-ci excluent les utérins, qui, en revanche, excluent les consanguins dans les fiefs maternels 1 . /356/
Les fils des frères morts concourent, avec les frères vivants, par droit de représentation 1 .
A défaut de frères, les neveux excluent les oncles de père, d’après la règle que l’investiture descend, mais ne remonte pas.
A défaut de frères et de neveux, les agnats du sexe masculin succèdent à l’infini, à la condition d’être descendants du premier acquéreur du fief; mais ici se présente une question qui a beaucoup embarrassé les feudistes, c’est celle de savoir comment il faut compter le degré de parenté.
Selon les uns, on ne doit pas du tout tenir compte du dernier possesseur, et rechercher qui aurait eu le fief, s’il n’avait pas existé; c’est ce qu’on appelle le système de la succession purement linéale. Selon les autres, l’héritier du fief est celui qui aurait eu le fief, si le dernier possesseur n’eût pas existé, et qui est en même temps le plus proche entre ceux, s’il y en a plusieurs, qui auraient eu le fief à la place; c’est ce qu’on a appelé le système de la succession linéale et graduelle.
Comme on voit, l’un et l’autre système diffèrent du système de la succession civile romaine, dans lequel l’héritier est le parent le plus rapproché du défunt; celui-ci est le système de la succession purement graduelle 2 . /357/
Le texte du livre des fiefs (II, 50) paraît en faveur de la succession purement linéale: « Si ille, qui feudum habet decesserit, nullo filio relicto, an ad omnes vel ad quos perveniat, quæritur. Respondeo, ad solos, vel ad omnes, qui ex ea linea sunt, ex qua iste fuit. Et hoc est, quod dicitur ad proximiores esse dicuntur respectu aliarum linearum, sed omnibus ex hac linea deficientibus omnes aliæ lineæ æqualiter vocantur. »
Cependant, c’est le système linéal et graduel qui a prévalu généralement; probablement parce qu’il s’éloigne moins de celui de la succession ordinaire.
Les lignes se comptent comme suit: la première sort du père, la seconde de l’aïeul, la troisième du trisaïeul, etc. 1
La parenté avec le dernier possesseur est, du reste, si peu un motif d’être appelé à la succession du fief, que, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, deux frères ne se succèdent pas pour un fief, si leur père n’avait pas eu le fief auparavant 2 . /358/
Que la femme et le mari ne se succèdent pas dans le fief, il n’y a rien là de surprenant; car, là où la parenté de sang est elle-même repoussée, on ne saurait prendre égard à l’affinité 1 .
La succession féodale n’étant pas un héritage proprement, mais une investiture continuée, il en résulte que le successeur au fief n’est pas en même temps le successeur aux dettes. Cette règle n’est pas applicable aux descendants qui ne peuvent prendre le fief et laisser les alleux avec les dettes; elle s’applique seulement aux agnats 2 . Cependant, si les agnats y consentent, le fils peut répudier la succession, et recevoir comme de nouveau le bénéfice de la main du seigneur; dans ce cas, il est déchargé des dettes de la succession paternelle.
La succession féodale germanique diffère assez essentiellement de la succession lombarde, qui, en cette matière, a été envisagée comme le droit commun. En Allemagne, on s’en tenait de plus près encore aux termes des anciennes concessions; on n’admettait que la succession des descendants, et, en principe, on repoussait celle des collatéraux tout comme celle des ascendants. Le Sachsenspiegel et le Schwabenspiegel concordant sur ce point.
L’empereur Henri II fit une loi pour introduire la succession /359/ lombarde des agnats en ligne collatérale en Allemagne; mais les princes Saxons refusèrent de laisser changer leur coutume, et Henri n’insista pas; de sorte que la succession des agnats s’est introduite dans le sud, tandis que le nord, qui suivait la loi saxonne, continuait à la repousser.
Pour concilier l’intérêt des frères avec le droit du seigneur, on recourait, en Allemagne, à une investiture simultanée (conjuncta manu; gesammte hand). Cette sorte particulière d’investiture reposait sur l’ancien usage germanique de l’indivision du bien familial.
Lorsqu’un fief avait été inféodé conjuncta manu à la mort d’un des frères, ses fils prenaient sa place, et s’il n’en avait pas, l’indivision continuait entre les frères restants. Tous les coinvestis étaient également censés en possession du fief; mais ils devaient désigner l’un d’entre eux pour rendre au seigneur le service du fief. Si le fief cessait d’être indivis, la part du vassal décédé sans enfants revenait au seigneur. En revanche, tant qu’il était indivis, aucun des possesseurs ne pouvait disposer à son égard sans le consentement des autres.
Ces principes du droit germanique s’appliquaient aussi aux fiefs auxquels était attaché un office impérial; l’hérédité des duchés et des comtés n’avait pas effacé en eux l’idée primitive de l’office, lequel était de sa nature indivisible; de sorte que, dans ces fiefs, s’il y avait plusieurs enfants, l’office passait à un seul d’entre eux, désigné tantôt par le père, tantôt par l’empereur; le plus souvent, c’était l’aîné. Seulement, si le père possédait plusieurs offices et fiefs impériaux, il pouvait les répartir entre ses fils, et alors l’aîné conservait ordinairement l’office principal.
Mais nous avons vu que peu à peu l’idée de l’office s’effaça derrière celle de la possession à titre privé, et que les /360/ territoires tendirent à devenir des propriétés de famille; alors aussi on chercha à donner une part de cette propriété à chacun des fils, et l’on chercha différents moyens, soit de les faire jouir en commun, soit même d’opérer des partages. Les comtés étant devenus les premiers des propriétés privées, l’aîné conserva le manoir de la famille, et les autres fils eurent les autres châteaux. Depuis la seconde moitié du XIIIesiècle, il en advint de même pour les principautés; seulement, l’aîné a seul conservé le titre. Pour concilier les considérations de famille avec la constitution de l’empire, qui statuait l’indivisibilité, on recourut à l’investiture par conjuncta manus. Le premier exemple que l’histoire d’Allemagne présente d’un tel fait, arriva en 1231, dans la maison de Brandenbourg. Puis, pour faciliter cette possession en commun, on la localisa par une répartition de l’usage, tout en conservant l’indivision, quant à la propriété; c’est ce qu’on appela mutschirung, ou oerterung (cantonnement). Enfin, on en vint à un partage effectif (dateylung, thattheylung). Dès ce moment, l’ancien droit n’existait plus; c’est ce qui a donné naissance à la gesammte hand du nouveau droit. De tels partages, en se continuant un peu, auraient eu inévitablement pour effet l’appauvrissement des familles régnantes et la division à l’infini des territoires. Pour éviter ces funestes conséquences, déjà au XIVesiècle on commença à introduire le droit de primogéniture, au moyen de pactes de famille. La bulle d’or fit de ce droit et de l’indivisibilité du territoire une loi de l’empire pour les électorats laïques; tous les autres princes suivirent cet exemple dans l’intérêt de la conservation de leur maison.
Touchant la succession des femmes, la coutume d’Allemagne n’avait pas la rigueur de la loi lombarde; les femmes, /361/ exclues par les mâles au même degré, étaient admises lorsqu’elles étaient en concours avec des mâles d’un degré plus éloigné. Senckenberg affirme qu’il n’y avait pas, en Allemagne, de seigneurie où les femmes n’eussent pas été appelées à succéder. On connaît le fameux distique composé sur la maison d’Autriche, à l’occasion des deux mariages de Maximilien avec Marie de Bourgogne et Jeanne de Castille:
- Namque Mars aliis, dat tibi regna Venus. »
En France, l’hérédité des fiefs avait été le centre autour duquel tournaient toutes les évolutions de l’époque féodale; l’indivisibilité des baronnies y fut admise en règle générale. Dans les fiefs secondaires, on chercha à obtenir un résultat analogue, au moyen du droit d’aînesse; car il fallait veiller à ce que chaque fief pût nourrir l’homme qui en rendait le service: « Ne me semble mie que fiez puisse estre partiz ne doit, dont chacun partie n’est sofisans à servir, » dit Desfontaines. Lorsque la raison du service militaire n’exista plus, pour ne pas partager le fief, le principe aristocratique conduisit au même résultat. Ainsi naquit le droit d’aînesse, non moins généralement répandu en France que dans l’empire.
Les puisnés étaient pourvus au moyen du parage; l’aîné gardait à lui la principale partie du fief et laissait les autres en fief à ses frères; ce qui ne constituait pas une division du fief, car l’aîné restait le seul vassal. Le parage correspond, dans le droit féodal français, à la conjuncta manus du droit germanique. En 1209, Philippe-Auguste rendit une ordonnance dans le but d’établir que les divers héritiers du fief relèveraient, non de leur aîné, mais du suzerain; mais cette ordonnance, évidemment contraire au maintien de la /362/ féodalité, tomba promptement en désuétude, même dans les domaines de la couronne, pour lesquels elle avait été rendue.
Les coutumes varient considérablement, quant au privilége accordé à l’aîné. D’après Beaumanoir et les Etablissements, il avait le manoir principal, avec une certaine étendue de domaine sis à l’entour; c’est ce que les coutumes appellent le vol du chapon, ou préciput. En succession collatérale, il n’y avait de droit d’aînesse que quand le fief était indivisible; en ligne directe, mais entre filles, la règle générale était le partage égal; c’est celle du grand coutumier, qu’a suivi la coutume de Paris. Les coutumes de Touraine, Maine et Anjou, accordaient, en revanche, un privilége à l’aînée.
Dans les tenures roturières, il n’y avait pas de primogéniture: « En villenage ains emporte autant li maisnés comme li aisnés, » dit Beaumanoir.
En France, les femmes n’étaient pas exclues en principe de la succession aux fiefs, comme en Allemagne; ce qui prouve combien est erronée l’opinion qui veut invoquer la loi salique au sujet de l’hérédité des fiefs 1 ; seulement, elles étaient exclues par un mâle au même degré; mais elles /363/ excluaient le mâle d’un degré plus éloigné. L’hérédité des femmes s’appliqua même au domaine des grands vassaux, et les rois l’utilisèrent habilement au profit des biens de la couronne.
L’ancien droit appelait la succession en ligne directe descendement, et la succession collatérale eschoite; c’est, en ce qui concerne cette dernière succession, que l’on remarque particulièrement la différence entre les pays de droit écrit et les pays de coutume. Dans les premiers, on conserva en général tous les principes dirigeants de la législation romaine; mais ils durent nécessairement être modifiés, en ce qui concerne les fiefs, par la nature particulière de l’objet de la succession. Dans les coutumes, en revanche, les principes germaniques prévalurent dans la succession même des biens non-féodaux; de sorte que, pour les alleux, par exemple, elles renferment, quant aux successions, des règles qui rappellent tout à fait le droit féodal.
Le testament est une institution contraire à l’esprit de la loi féodale, puisque le fief était une concession dont le vassal ne devait pas pouvoir disposer sans le consentement du seigneur. Au jour de sa mort, le droit du concessionnaire est épuisé; l’héritier est appelé, non par la loi, que la volonté d’un testateur peut remplacer, mais par le contrat lui-même.
Dans le droit germanique, le testament était admis, en ce sens que le père pouvait désigner celui de ses fils qui aurait le fief, en fixant les portions des autres. Pour les fiefs anciens, le père n’avait pas même le droit d’exhérédation, mais oui bien pour un fief nouveau, ou un fief héréditaire, c’est-à-dire dont la succession est réglée par la loi des alleux.
En France, l’usage général était de permettre au testateur de disposer librement des meubles, des conquets, assimilés /364/ aux meubles, et d’une part des propres, un cinquième, un quart, ou un tiers.
« Chacun gentilhomme, ou homme de poeste, qui n’est pas serf, peut, par notre coutume, laisser en un testament ses meubles, ses conquets, et le quine de son héritage, là où il lui plaît, excepté qu’à ses enfants il ne peut laisser à l’un plus qu’à l’autre, » dit Beaumanoir. La portion disponible était toujours chargée des dettes.
La règle « le mort saisit le vif » n’a point d’application par rapport aux fiefs; car l’héritier du fief n’entre en possession qu’après avoir prêté l’hommage. En France, l’héritier devait le demander dans les quarante jours.
/365/
QUATRIÈME SECTION.
DE L’EXTINCTION DU RAPPORT FÉODAL.
Le fief peut s’éteindre, ou parce que le domaine utile du vassal revient au seigneur (on nomme ce cas la consolidation), ou parce que le vassal unit à son domaine utile la directe qu’avait le seigneur, et se trouve ainsi posséder le bien du fief en pleine propriété (ceci est l’appropriation). Cette réunion des deux parts de la propriété peut avoir lieu sans faute, ou ensuite d’une faute de la part d’un des membres du rapport féodal.
Le rapport féodal cesse sans faute d’aucune part:
1° Par la réunion; par exemple, lorsque le vassal, venant à mourir sans héritiers et sans successeur désigné par expectative, le fief revient au seigneur; ou bien lorsque le seigneur acquiert le domaine utile de son fief par vente, échange, décret, etc.; ou encore, lorsque le vassal acquiert la directe d’un fief dont il a le domaine utile.
La réunion est le retour de la partie au tout; c’est unir une seconde fois ce qui avait été détaché, soit d’un fief, soit d’un arrière-fief. Si la réunion a lieu entre une censive, ou tenure roturière, et un fief dominant, son effet est de rendre à la terre roturière la qualité féodale qu’elle avait perdue. La réunion qui a lieu par mariage, lorsque l’un des époux apporte le domaine utile, et l’autre la directe, n’est pas une /366/ véritable réunion, puisque, si les époux n’ont pas d’enfants, les deux domaines se sépareront de nouveau à la dissolution du mariage.
2° Par la renonciation du vassal, laquelle comprend deux cas: le premier où le vassal laisse volontairement le fief, purement et simplement, sans demander au seigneur de l’inféoder à un autre; dans ce cas, la cessation du rapport réel précède et entraîne la cessation du rapport personnel.
Le second cas de renonciation est la dénonciation que le vassal fait de la rupture du lien féodal (das aufsagen, dit le droit germanique). Ici, le vassal renonce à la fidélité due au seigneur; cette dénonciation a lieu de bouche, et si le seigneur ne permet pas à son vassal de se présenter devant lui, elle a lieu dans la maison la plus proche de la demeure du seigneur, ou bien, en Allemagne, dans une assemblée de justice. Cette dénonciation était le prélude nécessaire et ordinaire d’hostilités entre le vassal et le seigneur; car le vassal eût été félon, s’il fût entré en hostilité avec son seigneur avant d’avoir renoncé à sa foi. Une constitution impériale de 1235 exige que la dénonciation ait lieu de jour, et que les hostilités ne commencent qu’au quatrième jour dès sa date. Ici, c’est la rupture du rapport personnel qui entraîne la rupture du rapport réel.
En dénonçant sa foi, le vassal doit délaisser le bien, sous peine de félonie; la bulle d’or condamne expressément le feudataire qui renonce frauduleusement, c’est-à-dire qui, après avoir dénoncé volontairement, occupe néanmoins le bénéfice, ainsi que celui qui renonce intempestivement ou malicieusement. Cependant, d’après le droit germanique, le vassal n’est pas tenu de délaisser en renonçant, lorsqu’il porte plainte au landrichter pour délit commis par le seigneur, /367/ ou lorsqu’il se défend contre une attaque du seigneur.
3° Il y a renonciation tacite, lorsque le vassal laisse inféoder un autre en sa présence sans opposition, et lorsqu’il perd totalement son heerschild; par exemple, en entrant dans un couvent. En revanche, le défaut corporel survenu, qui aurait empêché de recevoir le fief, n’empêche point de le garder. Le Sachsenspiegel contient à ce sujet une disposition formelle.
Le rapport féodal s’éteint par la faute du vassal, et le vassal, en conséquence, perd son fief pour cause de violation grave du devoir féodal; les violation légères sont réprimées ordinairement par une simple amende.
Les violations graves, et qui entraînent la perte du fief, sont appelées félonie, perfidie, c’est-à-dire transgression de la foi promise, ou déloyauté; ces termes sont synonymes en droit féodal.
On considère comme félonie:
1° La violation du devoir de ne pas nuire à son seigneur, ainsi l’acte d’attaquer son seigneur, de le blesser, de lever la main contre lui, de lui tendre des embûches, de l’assiéger ou de tenter quelque chose de pareil, de contracter alliance avec l’ennemi du seigneur, de séduire la femme, la fille, la sœur, ou la nièce du seigneur.
2° La violation des devoirs du service féodal, comme ne pas paraître lorsque le seigneur convoque le ban de ses vassaux; si plusieurs vassaux doivent fournir un homme, le refus par eux de choisir celui qui doit les représenter; l’acte d’abandonner son seigneur dans le combat, et partout ailleurs où il est en péril de vie; de ne pas l’avertir d’un péril imminent; de ne pas le libérer de captivité lorsqu’on l’a pu, etc. /368/
3° Le refus obstiné de paraître, lorsqu’on est cité devant la cour du seigneur ou d’exécuter le jugement.
4° La négligence pendant un temps, qui est fixé différemment suivant les coutumes, à demander le renouvellement du fief: D’après le droit impérial, il fallait an et jour.
5° Les actes par lesquels le vassal porte atteinte aux droits du seigneur sur le fief, ainsi le désaveu et le faux aveu d’un autre seigneur, ou l’aliénation du fief sans le consentement du seigneur.
Sur ces deux cas, la jurisprudence féodale française a introduit certaines règles qu’il faut rappeler. Les coutumes françaises exigeaient généralement que le désaveu eût lieu en jugement. Le désaveu extraordinaire n’était envisagé comme tel que quand on y persiste en jugement; car, jusqu’à ce moment, on peut encore se rétracter. Elles veulent encore que le désaveu soit fait sciemment et frauduleusement, c’est-à-dire contre les preuves qu’on a ou qu’on peut avoir, que le seigneur est mal désavoué. Dumoulin dit, à ce sujet: « Tum enim convictio de mendacio non est parcendam, quia mendicus similis est furi; » et il ajoute: « Non immerito amissione feudi mulctetur ingratitudo commissa in patronem, cui vassalus sacramento adstrictus ad fidelitatem. »
Le désaveu n’emporte que la perte de la portion du fief sur laquelle il a porté spécialement.
Sur le faux aveu, les coutumes françaises varient. En général le faux aveu n’est désaveu et n’entraîne la perte du fief que quand le vassal, actionné par son vrai seigneur, ajoute le désaveu au faux aveu, c’est-à-dire persiste à soutenir seul qu’il a dû reconnaître un autre seigneur; car le vassal qui, actionné par un autre seigneur que celui qu’il a reconnu, met celui qu’il a reconnu en cause et offre de reconnaître qui de droit, n’est pas exposé à perdre son fief. /369/
Cependant, certaines coutumes, comme celles de Châlons, Reims, Laon, Saint-Quentin, portaient expressément que le vassal doit avouer ou désavouer; à leur égard, la jurisprudence admit que l’on pouvait avouer le roi sans danger, parce que le roi, étant la source de tous les fiefs, son aveu ne peut faire injure au seigneur. Cette doctrine est évidemment une dérogation au système féodal rigoureux. La jurisprudence est allée bien plus loin encore, et moins dans un but d’équité que dans l’intention de favoriser le fisc; elle a établi pour règle, comme on le voit dans Dumoulin, que l’aveu qu’on fait d’un seigneur au préjudice du sien n’entraîne la perte du fief que relativement aux vassaux dont le fief relève immédiatement de la couronne.
D’après certaines coutumes, le vassal devait avouer ou désavouer avant la communication des titres du seigneur; d’autres exigent cette communication préalable, afin que le vassal ne soit pas exposé à faire erreur. Dans les coutumes qui admettent le franc-alleu sans titres, le seigneur doit instruire la cause avant que le possesseur soit tenu d’avouer ou de désavouer, ce qui n’a pas lieu pour la justice, relativement à laquelle il n’y a rien d’allodial.
Le désaveu pouvant entraîner la perte du fief, pour désavouer, il fallait avoir la capacité d’aliéner, ainsi celui qui ne possède pas pro suo: l’usufruitier, le mineur, l’interdit, les communautés, les bénéficiers ecclésiastiques, ne pouvaient pas valablement désavouer. Le grevé de substitution le peut; mais, s’il perd le fief, ce ne sera que pour sa vie durant; après son décès, le bien retourne au substitué.
D’après quelques coutumes de France, le seigneur pouvait reprendre tout son fief, lorsque le vassal en avait aliéné plus du tiers, même en retenant devoir, ou moins d’un tiers, sans /370/ retenir devoir; le cas qui donne lien à cette reprise est appelé le dépié. La peine du dépié introduite dans ces coutumes, par exemple, celles du Maine, d’Anjou, de Touraine, de Lodunois, qui est de faire rentrer dans la directe du seigneur ce que le vassal en a successivement fait sortir, n’a pas lieu en cas de partage de succession. Le dépié opérait in instanti la dévolution de tous les arrière-fiefs en faveur du seigneur, les arrière-vassaux devenant les vassaux immédiats, et tous les droits féodaux étant rétablis dans l’état où ils étaient lors de la concession du fief.
Le droit féodal français nomme commise la peine de la perte du fief que le vassal a encourue par sa faute. Il admet que l’on peut poursuivre la commise, même après le décès du vassal coupable du fait pour lequel elle est poursuivie; toutefois, comme la commise n’est pas encourue de plein droit, mais seulement en vertu d’un jugement, le seigneur ne pourrait demander la commise contre les héritiers du vassal qu’il a laissé en possession sans l’actionner, ou vis-à-vis duquel il a agi de manière à montrer qu’il lui remettait la faute commise à cet égard.
La réunion du domaine du vassal qui a encouru la commise a lieu en l’état où il se trouve; ainsi, par exemple, elle ne saurait révoquer un démembrement du fief fait avant la félonie, ou préjudicier au douaire accordé à la femme; en un mot, la révocation du bénéfice a lieu ex nunc et non ex tunc, et ne nuit pas au droit des tiers. Cette règle a surtout pris de l’importance dans le droit féodal nouveau, où le vassal avait acquis le droit d’aliéner et d’hypothéquer le fief, droit qu’il n’avait pas dans les temps proprement féodaux.
Le seigneur à qui le fief est adjugé par commise gagne, en revanche, toutes les augmentations et améliorations faites /371/ par le vassal, ainsi que les arrière-fiefs réunis au fief et reportés, comme tels, dans le dénombrement avant la faute: « Ante noxiam quia amplius non sunt sub feudo sed partes integrales feudi cadentes in commissum, » dit Dumoulin: mais ceux qui ne sont pas réunis au fief commis ne sont pas enveloppés dans la commise, non plus que ceux qui ont été réunis depuis la faute.
La plupart des feudistes confondant la confiscation dévolue au justicier avec la commise; c’est une erreur contre laquelle il importe de se prémunir. La commise est la résolution du contrat de fief, par suite d’inexécution des conditions. Le vassal, manquant à ses obligations féodales, le seigneur reprend le domaine utile qu’il n’avait aliéné que moyennant des obligations corrélatives dont la violation entraîne la nullité du contrat; c’est l’effet résolutoire naturel à l’inaccomplissement des conventions.
Dans la confiscation, il n’en est point ainsi; l’appropriation du justicier est nouvelle; il n’avait aucun droit de propriété sur les biens confisqués; il n’y a, entre le justiciable et lui, aucune convention violée; son titre ne remonte pas au delà de la condamnation.
Cependant, Henrion de Pansey, par exemple, dit, dans ses notes sur Dumoulin, qu’il existe deux espèces de commises: l’une, pour délits publics, l’autre, pour délits envers le seigneur. Suivant cet auteur, jusqu’au XIVesiècle, quelque cause qu’eût la commise, on ne distinguait point, et la commise profitait au seigneur dominant. Depuis lors, la commise pour délit public aurait profité au seigneur justicier; celle qui avait pour cause la félonie ou le désaveu s’opéra, comme auparavant, au profit du seigneur féodal, sans qu’on aperçoive l’époque précise de ce changement. Pour appuyer /372/ cette thèse, Henrion de Pansey part de la supposition qu’originairement, le fief et la justice sont une même institution. Dans ce système, en effet, le seigneur dominant représentant le prince, a droit à toutes les confiscations, quelle que soit la cause qui les motive. Mais la supposition qui sert de principe est fausse, et la règle qu’on en déduit est contraire à toutes les coutumes. Henrion de Pansey rejette ces coutumes, parce qu’elles ne sont pas en harmonie avec son système; mais c’est son système qui n’est pas d’accord avec la vérité. Henrion de Pansey invoque en sa faveur la législation anglaise et les assises de Jérusalem; mais, soit dans la législation anglaise, soit dans les assises de Jérusalem, l’institution des justices féodales n’a pas été, comme en France, un élément donné d’avance pour la constitution du système féodal. Ces législations ont pu réunir l’autorité publique et le droit de propriété, et faire abstraction de la règle: « Fief et justice n’ont rien de commun, » qui n’eût été pour elles qu’un embarras. Dans ces législations, le seigneur dominant fut donc le véritable souverain; la commise fut une confiscation, parce que la félonie était elle-même un délit public.
Les jurisconsultes allemands, qui placent au nombre des causes de perte du fief par le vassal les délits commis envers d’autres que le seigneur, paraissent aussi n’avoir pas suffisamment distingué la commise et la confiscation. Cependant, Struvius observe que, pour les fiefs anciens, lorsque la faute ou le délit n’a pas été commis envers le seigneur, par conséquent ne constitue pas une félonie, le fief passe aux agnats, sauf le cas de rupture de la paix publique; et, dans ce cas, où la confiscation du fief est ordonnée par les constitutions impériales, le fief revient cependant aux agnats après la mort /373/ du coupable auquel il a été confisqué, et de ses descendants.
La Caroline (art. 20) porte que le délit du vassal ne peut causer préjudice aux agnats, ni a toute autre personne qui a un droit de succession sur le fief. D’après le livre des fiefs, dans les cas où la perte du fief est encourue par les prélats et ceux qui sont à la tête d’une communauté, le fief est restitué à l’Eglise, ou à la communauté, après la mort du délinquant.
De même que la violation de son devoir de vassal envers le seigneur entraîne pour lui la perte du fief, la violation des devoirs du seigneur envers le vassal peut aussi entraîner pour lui la perte du domaine direct. Un capitulaire de l’an 816 indiquait déjà, comme motif justifiant le vassal de quitter son seigneur, les cas où le seigneur a voulu obliger le vassal à un service indu, où il a attaqué la vie de ce vassal, où il a commis adultère avec sa femme, où il a refusé de lui accorder protection. A ces cas, il faut ajouter celui où le seigneur retient le bien du vassal, ou refuse de lui donner la garantie due, ou de lui faire droit, ou de le représenter en justice, lorsqu’il en a reçu l’ordre du suzerain; enfin, selon le droit germanique, celui où le seigneur rabaisse son heerschild, ou rabaisse le bien féodal.
Par exemple, le seigneur rabaisse son heerschild seulement lorsqu’il reçoit lui-même en fief de son égal un autre bien que celui dont il s’agit; il rabaisse le bien lorsqu’il consent à le recevoir d’un suzerain inférieur en rang à celui de qui il le tenait d’abord, ou lorsqu’il reçoit du même suzerain, comme burglehn, le bien qu’il tenait d’abord comme rechtlehn.
Il peut arriver aussi que, dans un changement de seigneur, /374/ le nouveau seigneur ne soit pas du même rang que l’ancien.
Lorsque le seigneur a perdu le domaine direct, quelle en est la conséquence? Dans la règle, le domaine direct ne rejoint pas le domaine utile dans les mains du vassal, mais, au contraire, il passe aux mains du suzerain; c’est pourquoi, d’après le droit germanique, la perte du domaine direct ne pouvait être encourue pour un fief impérial, car l’empereur n’a personne au-dessus de lui. Le domaine direct passait au vassal, d’après le même droit, lorsque le fief était primitivement la pleine propriété du seigneur qui l’a concédé (lehn an eigen).
/375/
CINQUIÈME SECTION.
DE QUELQUES POSSESSIONS DISTINCTES DU FIEF QUI SE RATTACHENT AU SYSTÈME FÉODAL.
§ I.
Des terres tributaires.
Selon les mœurs germaniques, cultiver la terre pour un autre entachait la liberté; cette idée avait passé dans la féodalité, et, au moyen âge, les terres qui payaient un cens, soit en nature, soit en argent, les terres tributaires, furent appelées les tenures roturières, par opposition à la tenure noble, que constitue le fief. Ces tenures roturières, dont il y avait une grande variété, puisque les conditions du contrat dépendaient de la volonté des parties, rentrent, en France, dans le droit féodal, tandis qu’en Allemagne, elles rentrent, pour la plupart, dans le hofrecht.
En traitant de la hiérarchie féodale, nous avons eu l’occasion d’examiner la condition des classes de personnes qui vivaient sur ces tenures diverses; maintenant, nous avons à les considérer en elles-mêmes.
L’origine de la plupart des possessions dont il s’agit ici, remonte au droit impérial romain. Dans ces temps de dissolution et de désordres, qui précédèrent et suivirent la /376/ conquête barbare, le nombre des terres tributaires alla en croissant; car nous avons vu que beaucoup de propriétaires indépendants, mais faibles, furent obligés d’acheter, au prix d’un cens qui diminuait même leur liberté personnelle, la protection des forts. Quand les Barbares prirent des terres dans les contrées où ils s’établissaient, c’était d’abord pour vivre sur elles, et non pour les cultiver.
La dépossession absolue et la complète servitude ne furent point, dans l’origine, la condition générale des cultivateurs. Fournir aux besoins de leurs nouveaux maîtres, en conservant tacitement et précairement quelque part dans la propriété de la terre qu’ils faisaient valoir, tel fut le plus souvent leur sort. Les Lombards, par exemple, prirent d’abord le tiers du revenu des terres, c’est-à-dire qu’ils les firent toutes passer dans la condition tributaire. Ce fait a dû se reproduire, à peu de différences près, partout où s’établit un chef barbare avec ses compagnons. Puis, chaque chef continua à s’arroger, sur les propriétés voisines de son établissement, des droits qui se résolvaient communément en redevances de diverses natures.
Les mêmes causes qui tendirent à multiplier les bénéfices aux dépens de la propriété libre, agirent avec bien plus de force dans le sens de l’augmentation des terres tributaires, et les grands propriétaires, avides et sans frein, trouvaient plus d’avantage à réduire leurs voisins à cette condition qu’à les dépouiller tout à fait.
On voit des traces fréquentes de cette conduite dans les lettres que Charlemagne écrivait aux comtes de la Gaule méridionale, au sujet des réfugiés espagnols chassés par les Maures: « Gardez-vous d’imposer un cens à ceux qui, venus d’Espagne, se sont rangés sous notre foi, et ont occupé avec /377/ notre permission des terres non encore cultivées. » Les mêmes injonctions se répètent sans cesse sous Louis-le-Débonnaire, mais avec peu de fruit. Beaucoup de grands propriétaires, indépendamment des concessions qu’ils faisaient, à titre de bénéfices, aux hommes qu’ils voulaient s’attacher, distribuaient aussi une partie de leurs terres à des colons, tantôt libres, tantôt serfs. Une foule de témoignages attestent qu’à la fin de l’époque barbare, la grande majorité des cultivateurs exploitaient des terres tributaires. Une circonstance plus générale ne permet pas d’en douter, c’est la concentration progressive de la propriété foncière dans les mains des seigneurs et de l’Eglise, dont la protection était surtout recherchée, à cause de la douceur de sa domination et de la plus grande sécurité qu’elle donnait à ses vassaux de toutes conditions.
Ce n’est pas un des moindres mérites des travaux de M. Guérard d’avoir montré, entre autres, par les polyptiques, qu’à peu près dans le même temps où les bénéfices et les honneurs devenaient héréditaires, les terres tributaires le devenaient aussi; par l’effet d’un même mouvement social, les tenures supérieures et inférieures s’affermissaient également dans les mains de leurs possesseurs, et il fut bientôt aussi difficile d’expulser un colon ou un serf de sa manse qu’un vassal de son fief.
Nous indiquerons maintenant les principales espèces de tenures roturières qui étaient en usage.
1° Le précaire (precaria, precaturia). Il doit son origine au precarium romain 1 ; mais il en diffère, en ce qu’il était /378/ constitué pour un temps donné et moyennant un cens, tandis que le precarium romain cessait à la volonté du donateur, et était gratuit.
Ce contrat fut surtout usité pour les biens de l’Eglise, et fut un des principaux moyens à l’aide desquels elle étendit et multiplia ses possessions immobilières 1 .
Lorsque quelqu’un lui recommandait sa propriété, c’est-à-dire la lui concédait pour la reprendre en usufruit, l’Eglise accordait ordinairement la jouissance d’une certaine quantité de terres en sus de celles qu’elle avait reçues.
Lorsque l’Eglise donnait des terres en précaire, sans en recevoir en même temps, la concession était faite communément pour le terme de cinq ans. /379/
Les détenteurs du précaire payaient au donateur, à titre d’indemnité et en signe de dépendance, une redevance annuelle (census). Dans certains cas, le défaut de paiement du cens pouvait faire révoquer la donation; souvent, il était stipulé, au contraire, que cette reprise ne pourrait avoir lieu.
L’Eglise avait le soin, assez rare alors, de faire ses contrats par écrit, afin de prévenir toute usurpation; l’acte fait au nom du cédant se nommait præstaria, et celui qui émanait du preneur se nommait precaria; ils avaient ordinairement la forme d’une lettre.
Charlemagne interdit de posséder des biens provenant de l’Eglise sans titres, et autrement qu’en précaire, et, en revanche, il statua, au profit des héritiers de ceux qui avaient recommandé leurs terres à l’Eglise, que celle-ci leur continuerait le précaire, encore que cela n’ait pas été stipulé dans la donation.
Charles-le-Chauve ordonna que, lorsqu’un précaire serait constitué en faveur d’une église, celle-ci donnerait au preneur la jouissance du double de ce qu’elle recevait en propriété, et que, dans le cas où le preneur ferait abandon immédiat des biens compris dans la donation, elle lui en donnerait le triple. Il fut enfin interdit à chacun de forcer quelqu’un à donner son bien en précaire, et le roi lui-même s’interdit de donner en précaire des biens d’Eglise sans le consentement de celle-ci. Ces dispositions montrent que ce qu’elles défendaient était un abus existant, contre lequel il était devenu nécessaire de rendre des lois.
Les chartes de précaires sont fréquentes, en France, jusqu’au XIesiècle; il est question d’actes du même genre dans les lois des Allemands et des Bavarois.
C’était une sorte de placement à fonds perdu, dans lequel /380/ chaque partie, on le conçoit, pouvait trouver son intérêt. L’Eglise n’en avait pas seule, à ce qu’il semblerait. Cependant, le capitulaire cité pour le prouver 1 , et qui ordonne de distinguer soigneusement les précaires établis par l’autorité royale de ceux qui ont été constitués par l’autorité ecclésiastique, me paraît se rapporter justement à ces précaires consistant en biens d’Eglise que le roi concédait de son autorité, et pour lesquels on reconnut ensuite que le consentement de l’Eglise, véritable propriétaire, devait être obtenu préliminairement.
2° L’emphytéose tire aussi son origine du droit romain. D’après le code justinien, l’emphytéose est la concession d’un usufruit à perpétuité, ou à long terme, à charge d’une redevance annuelle en denrées ou en argent.
La durée de la concession et la redevance distinguent ce contrat du precarium.
Sous l’empire romain, il fut surtout mis en usage par le fisc; ainsi, les terres des vétérans et des lètes leur étaient données en emphytéose, avec exemption de l’impôt. Depuis Constantin, l’Eglise constitua aussi des terres en emphytéose.
Lorsque le précaire cessa d’être gratuit, il se confondit avec l’emphytéose, ainsi que l’a montré Muratori: ce dernier contrat joue, en Italie, le même rôle que le précaire joue ailleurs. Comme lui, il fut d’abord en usage surtout pour les biens ecclésiastiques; ensuite, dans le midi de la France, l’emphytéose est devenu tout à fait ce qu’était la censive dans les pays de coutumes. Dans le Dauphiné, il prend le nom d’abergement. /381/
3° La censive est un contrat tout à fait semblable aux précédents, mais qui était employé plutôt par les seigneurs laïques 1 ; c’est également une terre donnée en usufruit, à charge de redevance. Le censitaire n’a le droit ni de vendre, ni de détériorer la censive; ce qui était déjà la condition de l’usufruitier romain. On ne peut la lui enlever aussi longtemps qu’il acquitte exactement le cens, à moins qu’il n’y ait un terme fixé à cet effet.
Les lois des Lombards et des Bavarois renferment une disposition qui a passé dans les coutumes du moyen âge; c’est celle qui décide que les adjonctions et constructions faites par le censitaire appartiennent au propriétaire, lorsque le censitaire quitte, moyennant restitution du prix. La censive n’imposait pas toujours un cens seulement, mais souvent aussi des prestations corporelles.
Pendant longtemps, ce contrat ne fut pas très nettement distingué du bénéfice, et le mot de bénéfice fut appliqué aussi aux censives; de sorte que l’ensemble de l’acte indique seul de quelle sorte de tenure il s’agit. Il faut observer que, dans le système féodal, la censive est tenure noble aussi bien que /382/ le bénéfice, par rapport au seigneur dominant; elle n’est roturière, ou vilaine, que par rapport au censitaire.
Nous avons vu que, dans les fiefs, les sous-inféodations étaient libres, et le vassal pouvait même créer une censive sur son fief; il n’en était pas de même dans les censives. Le censitaire n’avait pas la faculté de créer une sous-censive; la jurisprudence des Olim et la plupart des coutumes sont d’accord sur ce point, que « cens sur cens n’a pas de lien. » Cela devait être, puisque le cens suppose une certaine seigneurie chez celui qui le reçoit. C’est ce qu’exprime l’ancienne coutume par ces mots: « L’on ne peut mettre censive sur censive; car le premier l’emporte. » En général, et même lorsque le système féodal fut transformé par la cessation du service militaire, et que, comme la censive, le fief ne donna plus au seigneur que des droits réels, le droit du censitaire fut toujours plus faible que celui du vassal.
Souvent, le vassal fut l’égal du seigneur, et parfois plus puissant que lui; mais le censitaire fut toujours dans une position inférieure. Lorsque le régime féodal n’exista plus qu’à l’état de souvenir, et que les roturiers purent aussi posséder des fiefs, le vassal et le censitaire purent bien être égaux en rang. Quelquefois, le censitaire fut supérieur au propriétaire de la directe; mais les principes étaient posés, et le contrat de censier resta ce qu’il avait été pendant des siècles, le caractère respectif des possessions conserva la trace de son origine.
Le domaine utile fut donc toujours la portion la plus faible de la propriété. Dans les censives, non-seulement le vassal fut, comme le censitaire, assujetti, pour disposer de sa tenure, aux droits de lods et ventes, mais encore il n’eut ni le droit d’en changer la culture, ni celui d’en jouir pleinement; /383/ en un mot, la directe se conserva plus puissante et plus efficace, s’altéra moins profondément dans la censive que dans le fief.
Les tenures des colons ne diffèrent guère des censives. Les colons étaient des hommes libres, mais d’une liberté incomplète, qui avaient droit à la possession de leur tenure, sous obligation d’en remplir les charges, et qui la transmettaient ordinairement à leurs enfants. Les censitaires sont des hommes libres, dont la liberté est aussi diminuée par le fait de leur condition censitaire. Cependant Guérard a cherché à distinguer le censitaire du colon, qui aurait été moins libre que lui; du reste, les tenures colonaires disparaissent, selon lui, dès le Xesiècle, c’est-à-dire vers la fin de l’époque intérimaire. Les tenures des lides, ou lites, qui sont les demi-serfs de race germanique de l’époque barbare, ainsi que celles des serfs, ont un caractère plus précaire, par cela même que les personnes qui les possèdent sont plus fortement engagées dans les liens de la servitude; les serfs, en effet, ne se possédant pas eux-mêmes, ne peuvent pas posséder de la même manière que l’homme libre.
Guérard paraît penser que, dans l’époque féodale, les conditions des serfs, des lides, et des colons, se confondirent, ainsi que leurs tenures, et formèrent la grande classe des vilains, qui possèdent par tenure roturière; la condition des serfs s’améliorant dans le même temps que celle des cultivateurs libres, mais roturiers, s’empirait. Sans nier un mouvement vague dans le sens indiqué, et tout en reconnaissant même qu’en fait, l’usurpation des seigneurs, et particulièrement, en France, celle des justiciers, a rendu souvent le sort des vilains pire que celui des serfs, nous devons observer cependant que, durant toute l’époque féodale, la /384/ condition juridique des serfs et des vilains fut nettement distinguée. Beaumanoir, Desfontaines, et plus tard les coutumes, en fournissent la preuve à chaque instant.
Le Miroir de justice, coutumier normand du XIIIesiècle, publié par Houard, dans ses Coutumes anglo-normandes, nous montre même que l’une des différences essentielles que l’on faisait entre les vilains et les serfs, était tirée du caractère de leur possession.
« Naïf, dit le Miroir de justice, n’est autre chose que serf, et tout soit que toutes créatures dussent être franches, selon la loy de nature; par constitution, néquident et de fait des hommes, sont gens et autres créatures asservies, si comme est de bêtes en parcs, poissons en réservoirs, et oiseaux en cage ... De Sem et de Cham sont issus les gentils chrétiens, et de ceux de Cham, les serfes, que les serfes peuvent donner et vendre, comme leur autre chattel (meuble), mais créent deviser en tenement, pour ce que adonc sont annexées à franc tenement, et de ceux sont plus que les autres.
» Nota, que vilains ne sont mie serfes; car serfes sont dits de garder, si comme est dit. Ceux-ci ne peuvent rien purchasser (acquérir), fors que à l’œps de leur seigneur; ceux-ci ne savent de vêpres de quoi ils serviront le matin, ni nulle certaineté de service; ceux-ci peuvent les seigneurs firger (fustiger), emprisonner, battre et châtier à volonté, sauve à eux la vie ou les membres entiers; ceux-ci ne peuvent suivre, ni dédire leur seigneur, tant comme ils trouvent de quoi vivre, ni à seul les loin les recevoir sans le gré de leur seigneur; ceux-ci ne peuvent avoir nulle manière d’action contre leur seigneur, fors qu’en félonie; et si ces serfes tiennent fiefes de leur seigneur, est à entendre qu’ils le tiennent de jour en jour, à la volonté des seigneurs, ni par nulle certaineté de services. /385/
» Vilains sont cultivateurs de fiefs (on a vu que la censive est fief, par rapport au seigneur direct), demeurant en village; car, de ville est dit vilain; de bourg, bourgeois; et de cité, citoyen. Et de vilain est fait mention en la charte des franchises, où est dit que vilain ne soit mie si grièvement que sa gaignure ne soit à lui sauve; car de serfes ne fait elle mention, puisqu’ils n’ont proprement rien à perdre. Et nota, que ceux qui sont francs et quittes deviennent asservis par contrats faits entre le seigneur et le tenancier, et sont fiefs plusieurs manières de contrats, si comme de don, de rente, d’échange, de ferme, etc. »
Les jurisconsultes de l’époque féodale considérèrent comme affranchis ceux auxquels le seigneur avait donné une tenure, pour eux et leurs hoirs, jugeant qu’en voulant qu’ils eussent des hoirs propres, autres que lui, il avait reconnu en eux le caractère essentiel de la liberté.
Nous pensons donc que les tenures serviles ne sont pas des tenures dans le véritable sens de ce terme, des possessions garanties par la loi, et ne peuvent être confondues ou assimilées avec les tenures roturières.
La distribution du sol en manses est-elle un des caractères juridiques de la possession durant l’époque barbare, ainsi qu’on l’admet aujourd’hui assez généralement, depuis les publications des polyptiques faites par M. Guérard?
Pour ma part, je vois dans l’organisation des manses un fait d’économie domestique intéressant, et qui jette du jour sur la vie des classes agricoles, mais non un fait juridique. L’organisation des manses est une répartition que l’Eglise faisait de ses terres aux cultivateurs libres, ou non, qui vivaient sur elles; c’est la forme extérieure que revêt la tenure à titre tributaire, par l’effet d’un arrangement /386/ intérieur, généralement usité pendant un certain temps. Cette forme, ainsi que le remarque Guérard tout le premier, peut se concilier avec des tenures de toutes sortes. Il paraît qu’elle fut usitée aussi dans les domaines royaux, sous les Carlovingiens, comme on le voit par le Capitulaire de villis; peut-être fut-elle employée aussi par les grands propriétaires laïques. Vers l’époque féodale, elle tend à disparaître. La manse a toutefois laissé sa trace dans le régime féodal, en ce qui concerne les tenures roturières; c’est d’elle que sont sorties les communautés rustiques, appelées encore meix par les coutumes de Bourgogne, dont nous nous occuperons tout à l’heure, à l’occasion de la main-morte.
Nous ne saurions entrer dans le détail minutieux des diverses charges que les coutumes féodales ont fait peser sur les terres tributaires; ces charges dépendaient des contrats de concessions et pouvaient varier au gré des contractants. Nous nous bornerons à indiquer les principales d’entre elles.
La première, celle qui caractérise le contrat et lui donne un nom, est le cens. Ce cens est ordinairement annuel et se paie, soit en argent, soit en nature; c’est une charge pesant directement sur le fonds, indivisible et imprescriptible. D’après la plupart des coutumes, le retard à l’acquitter entraînait une amende, mais non la perte de la jouissance du fonds. Le cens était rendable et portable. Le seigneur, outre l’amende, avait un droit de gage sur les fruits de l’immeuble, en cas de négligence à payer le cens.
Outre le cens résultant d’un contrat de censive, ou bail à cens, il y en avait d’autres, qui se rattachent à la seigneurie justicière, et par la confusion des idées, que nous avons si souvent eu l’occasion de signaler, on a justement interverti les rôles et donné pour le cens contractuel celui qui ne l’était /387/ pas, savoir, le menu cens: « Le menu cens est le chef cens, » dit Rageau, et cette opinion a été adoptée par Schaffner.
Mais comment supposer que le menu cens, souvent si minime, qu’il ne pouvait être considéré comme un revenu, fût le cens contractuel, lorsqu’on sait que, même après la cessation des services militaires, les fiefs étaient grevés de charges si pesantes, qu’on les estimait souvent moins que les censives à gros cens? On a dit que le cens était devenu si minime, en raison de la dépréciation des monnaies; mais cette explication tombe, puisque le menu cens se payait souvent en denrées.
Le cens contractuel est donc, selon nous, le gros cens, et le menu cens est un droit de justice. C’est pour cela que le gros cens était portable, comme tous les devoirs féodaux, tandis que le menu cens était quérable, comme tous les devoirs de justice; c’est aussi pour cela que le gros cens devait toujours se fonder sur un titre ou un aveu, tandis que le menu cens, appelé même quelquefois cens coutumier, était considéré comme une charge naturelle du sol.
Remarquons encore que le menu cens était établi à raison de chaque objet possédé, pro modo jugerum, comme l’impôt romain, tandis que le gros cens s’attachait presque toujours à la concession générale d’un domaine, et que la perte ou le défaut de récolte était un motif de diminuer le gros cens, tandis que le menu cens, comme l’impôt, était invariable.
Lorsque le cens contractuel consiste en une partie aliquote des fruits, la moitié, le tiers, le quart, il se nomme champart, terrage, arrage ou agrier, carpot, complant, etc. Ces droits sont envisagés comme seigneuriaux, lorsqu’ils ont été imposés dans la première concession; dans le cas contraire, ce ne sont que de simples rentes foncières. /388/
Outre le cens, le possesseur du domaine utile d’une terre tributaire avait à payer au seigneur un droit chaque fois que ce domaine utile changeait de mains: « Censive porte tout, rettenue et amende, » dit l’ancienne coutume de Bourgogne. Louz, ou lods (laudimium), sont sensés payés au seigneur pour obtenir de lui la permission de transmettre la concession: les lods se payaient, dans la règle, en cas de vente ou d’échange avec soulte d’argent, non en cas de donation, héritage, constitution de dot, ou échange sans soulte; la retenue, ou relief, se payait au changement de mains, par succession, donation, etc., c’est-à-dire pour les transmissions qui ne constituent pas une vente et ne donnent pas naissance aux lods; elle est d’un produit inférieur à ceux-ci.
Les feudistes expliquent l’introduction de ces sortes de droits de mutation dans les tenures à titre tributaire par une imitation de ce qui aurait eu lieu dans le fief; mais cette explication supposerait que de tels droits ont existé pour les fiefs avant d’exister pour les censives; or, c’est ce qui n’a point eu lieu: les lods et le relief apparaissent dans les fiefs dans le temps où le service militaire féodal cessait, ils l’ont remplacé. Ces droits ne sont pas plus de l’essence du fief qu’ils ne sont de l’essence de la censive; ce sont des droits de justice que l’on a introduits dans les concessions féodales par imitation, comme bien d’autres perceptions, comme les corvées, les banalités, etc.
Nous pencherions même à penser que les lods et le relief ont été introduits dans les tenures tributaires, et par conséquent vilaines, avant de l’être dans les tenures nobles, et cela pour deux motifs.
Premièrement, parce que les droits qui sont des droits utiles, payables en argent, sont plus conformes à la nature /389/ de cette espèce de tenure, tandis qu’ils répugnent à la nature du fief militaire, tel qu’il était compris dans les temps proprement féodaux.
Secondement, parce que, dans les tenures vilaines, ces droits nous apparaissent comme un adoucissement dans la condition des tenanciers, dont la condition de servage se ressent. En effet, les serfs étaient, dans le principe, et furent assez longtemps, pendant l’époque féodale, soumis à un droit bien plus rigoureux, savoir, à la main-morte.
On disait des mains-mortables qu’ils sont appelés ainsi parce que, n’ayant pas la faculté de tester, ils sont censés morts, et qu’ils vivent libres et meurent serfs.
Par le droit de main-morte, à la mort du tenancier qui dessert la terre, celle-ci faisait retour au seigneur 1 .
La coutume de Troyes, dans le passage suivant, nous montre à la fois et le droit rigoureux du seigneur, et l’exception favorable que la jurisprudence introduisit avec le temps: « Les autres, dit-elle (art. 1er), sont, à cause de leur personne, de condition servile, main-mortables, envers leur seigneur, en tous biens, meubles et héritages, quelque part qu’ils soient assis, quand ils trépassent sans délaisser enfant né de mariage, étant de leur condition et en celle. » En celle veut dire en leur maison, en leur demeure, sur la tenure dont, à défaut d’enfant, le seigneur aurait hérité. /390/
Ce droit de main-morte, et la faculté d’y échapper qui était laissée à l’enfant resté au foyer de ses parents, donnèrent naissance à l’usage des communautés. Ces communautés d’une famille, dont les enfants restent indivis sur la tenure héréditaire, ne sont autre chose que les meix, ou manses, de la coutume de Bourgogne, dont nous avons parlé plus haut. L’idée de ces indivisions rappelle la législation germanique, où la propriété de la famille était envisagée comme bien commun, géré au profit de tous par le chef de famille, le mundwald. Ceux qui sortaient de la communauté, par exemple, les filles en se mariant, perdaient leurs droits à l’héritage; de même, dans les manoirs rustiques de la France féodale, l’enfant, à quelque sexe qu’il appartient, qui quitte la communauté, qui ne mange plus au même chanteau (quartier de pain), perd son droit à la succession de la terre qui nourrissait la communauté, et s’il n’y a pas d’enfant resté en communauté, elle retourne au seigneur; de là, cet adage: « Le chanteau part le vilain. »
Comme les seigneurs avaient intérêt à multiplier les dissolution de communautés, ils cherchèrent à établir une règle plus rigoureuse, savoir, « qu’un parti, tout est parti; » que la retraite d’un seul membre dissout la communauté. Le seigneur héritait à la fois des meubles et de l’héritage, c’est-à-dire de la terre; mais, s’il renonçait aux meubles, il n’était pas tenu des dettes de la succession.
Cependant, le mouvement de la civilisation et la force même des choses allaient à l’encontre de toutes ces duretés du droit seigneurial; le moment venait où le seigneur avait besoin de ses tenanciers, ou cessait d’être le plus fort, ou, pour tout autre motif, trouvait son intérêt à leur faire des concessions. La main-morte, droit absolu sur l’héritage du vassal, se /391/ transforma en un droit utile beaucoup plus modéré, par exemple, celui de prendre le meilleur meuble ou la meilleure tête de bétail dans la succession du défunt, le droit de meilleur cattel (meuble), en Allemagne beste haupt (la meilleure tête). Ce droit se rencontre déjà dans les temps Carlovingiens, où la main-morte régnait généralement; il la remplaçait peut-être, lorsque le seigneur n’en voulait pas user.
Salvaing rapporte qu’autrefois la main-morte s’exerçait, en Dauphiné, même sur les nobles qui s’étaient reconnus vassaux liges. J’ai expliqué ailleurs la cause de ce fait, que l’on a considéré comme une anomalie; c’est que les nobles dont il s’agit étaient des ministériaux. Humbert II, dernier dauphin, abolit la main-morte dans tous ses domaines; néanmoins, elle persista encore jusqu’au règne de Henri II.
Ces redevances, qui, plus tard, furent envisagées comme un reste odieux de la féodalité, furent, au XIIesiècle, le prix fort équitable dont une foule de serfs ou de demi-serfs payèrent la faculté de transmettre un héritage à leurs enfants.
Nous avons déjà parlé des corvées, en traitant des obligations du vassal; il va sans dire qu’elles se retrouvent bien plus encore dans les tenures à titre tributaire que dans les tenures à titre de bénéfice féodal.
Lorsque la censive n’emportait pas le pouvoir seigneurial, on la nommait rente foncière; la rente foncière n’est qu’un droit réel, qui n’est pas considéré avoir rien de féodal; par ce motif, elle ne doit pas les lods, tandis que la censive les doit.
Nous avons observé déjà que l’emphytéose était la censive de la France du droit écrit. C’est à tort que quelques-uns assimilent plutôt l’emphytéose à la rente foncière des pays coutumiers, et qu’ils ont dit que l’emphytéose /392/ n’engendrait pas le lien féodal. Lorsque nous examinons l’emphytéose dans les coutumes du sud, par exemple dans celles de la Provence, du Languedoc, du Dauphiné même, nous voyons, au contraire, que ce contrat est considéré comme constituant un rapport féodal. Ainsi, il donnait lieu aux droits de lods et ventes, au rachat, ainsi qu’au droit de prélation, ou de retrait.
En Dauphiné, où la censive coexiste avec l’emphytéose, Salvaing discute avec beaucoup de développements la question de savoir si l’emphytéose donne lieu au droit de prélation, et il conclut qu’il a existé de plein droit; mais que, de son temps, savoir au XVIesiècle, il n’existe que s’il est exprimé dans le titre.
En Provence et en Languedoc, l’emphytéose remplace tout à fait la censive, et donne lieu à une seigneurie, mais à une seigneurie d’un genre particulier, appelée la directe; les lods y sont dus pour toute vente du fonds emphytéotique, et le droit de prélation également. L’auteur anonyme d’un traité de jurisprudence féodale pour ces deux provinces rapporte même, chose digne de remarque, que le droit de prélation a été établi pour l’emphytéose avant de l’être pour les fiefs; et, contrairement à l’usage du Dauphiné, il admet que, dans les inféodations, ainsi que dans les baux emphytéotiques, la réserve du retrait est toujours sous-entendue.
A la différence des pays coutumiers, l’emphytéote pouvait donner à bail un fonds; mais, dans ce cas, le nouveau bail ne porte plus le nom d’emphytéose, il se nomme sous-locatterie perpétuelle. L’emphytéote qui sous-loue n’a toutefois pas une seconde directe; il n’y en a qu’une, et le seigneur direct a le choix de la faire reconnaître, ou par le locateur ou par le locataire. Il faut observer que la seigneurie est directe /393/ ou emphytéotique dans ces provinces; mais on n’en doit pas conclure que l’emphytéose n’est pas envisagé comme féodal, puisqu’en Provence, la seigneurie d’un fief elle-même n’est pas possession noble, si à ce fief n’est pas rattachée une justice ou une part de justice. Il faut simplement conclure de ces divergences que, dans le sud, la féodalité ne pénétra pas aussi complétement que dans le reste du royaume, ce qui a sa raison d’être toute naturelle dans la puissance du droit romain dans ces contrées; la loi des Wisigoths, qui s’en était si fortement imprégnée, fut le fonds sur lequel la féodalité vint s’enter, principalement après les guerres des Albigeois; et, en réalité, la France du midi est moins féodale que l’Italie lombarde, et ne l’aurait presque pas été, tout comme l’Espagne, si le nord de la France ne lui eût fait subir sa pression au temps même où la féodalité était la plus forte et la plus vivace.
En Allemagne, l’histoire des terres tributaires est aussi celle de la classe des paysans. Les biens des paysans (bauerngütern) se distinguent en deux grandes catégories: ceux des anciens hommes libres (schœffenbarfreien, biergelden, pfleghaften, wachszinsigen), dont la possession même est d’origine libre, et par conséquent soumise en principe au droit national (landrecht), et ceux des demi-libres (ministériaux, lassen, hœrigen), dont la terre, primitivement concédée, doit ressortir au hofrecht.
Dans ces deux catégories sont renfermés tous les biens-fonds qui ne sont pas des fonds nobles (rittergütter), ou autres biens privilégiés, tels que ceux d’Eglise et des terres sises sur le territoire des villes.
Les rapports spéciaux basés sur l’avouerie (vogtei) du landherr, ou d’autres personnes, qui s’étaient étendus, depuis la /394/ naissance de la landhoheit (souveraineté territoriale), sur tous les biens non-privilégiés, imposèrent à ces biens des charges réelles, et cela quand bien même ils étaient possédés en pleine propriété. Vu la nature de l’avouerie, la justification de ces charges se liait souvent au fait de la juridiction.
Mais les tenures de paysans, les plus nombreuses de beaucoup, avaient pour base une possession incomplète et soumise à un vrai droit de propriété (grund, ou gutsherrschaft).
Quelquefois, les deux principes d’assujettissement ont pu être en fait confondus, mais, en droit, ils étaient entièrement distincts. Comme on le comprend, cette confusion ne put qu’être fort nuisible aux droits des paysans propriétaires.
Autrefois, le territoire d’une marche était divisé en un certain nombre de domaines (hœfe, mansi), qui avaient tous un droit égal à la jouissance de la portion des biens de la marche restés en communauté. Les établissements agricoles qui ne jouissaient pas de ces droits à la part commune, se nomment kathe (cot, cottage, casa, casati).
Lorsqu’une hof primitive a été subdivisée par vente ou héritage, elle donne naissance à une classe de propriétaires appelés demi-paysans (halbbauern, halbmeiern, halbhübner) dans le nord de l’Allemagne; dans d’autres contrées, par exemple, en Bavière, on nomme les demi-paysans sœldner, hintersiedler, neubauern; ceux qui n’ont dans la contrée qu’une habitation sans train d’agriculture sont appelés häuslinge, gärtner (jardiniers), büdner; l’expression sœldner, d’après Eichorn, s’appliquerait aussi à cette dernière classe.
Les services (dienste, frohnden, corvées) comprennent tous les services personnels imposés au propriétaire d’un bien de paysan en faveur d’un tiers, comme charge réelle. Ces /395/ services peuvent être dus, soit au seigneur du territoire (landherr), et se nomment alors landfolge, soit au seigneur de la terre (grundherr), soit à la commune. Cependant, les services communaux ne pesaient pas exclusivement sur les biens de paysans; des biens libres (freigüter), et même des biens nobles (rittergüter), y étaient aussi soumis, pour autant du moins que ces biens retiraient des avantages de la commune. Ces services se perdaient par non-usage; la transformation, très commune, d’un service en nature contre une rente ou une somme d’argent, ne pouvait avoir lieu qu’au moyen d’un contrat; l’aliénation d’un service à un autre est permise au possesseur, pourvu qu’elle ne change, ni n’aggrave la nature du service. Dans la règle, les services, même indéterminés, ne pouvaient supposer une habileté particulière chez celui dont on les exige, et ils ne pouvaient être exigés qu’aux jours ouvriers, du lever au coucher du soleil. On appelle censes (zinzen) toutes les impositions qui pèsent comme charges réelles sur un bien de paysan; elles sont payées au grundherr, si le possesseur n’a pas la pleine propriété; elles sont en argent ou en nature, rachetables ou nonrachetables. La plus répandue, en Allemagne, était la dîme, qui paraît provenir de la dîme ecclésiastique; mais beaucoup de dîmes n’avaient pas cependant une telle origine.
D’après le droit commun, les charges réelles en faveur du fonds d’un tiers ont pour cause le droit féodal, ou l’emphytéose; mais au droit féodal se rattachent exceptionnellement nombre de charges qui n’appartiennent pas au service de chevaliers. Ces inféodations inférieures, portant sur des biens de paysans, présentent du reste, en Allemagne comme ailleurs, d’infinies variétés.
/396/
§ II.
Du franc-alleu.
Dans son sens primitif, l’alleu (alod) est le terme germanique qui désigne la propriété pleine et entière, la propriété dans laquelle se trouvent réunis le domaine utile et le domaine direct; dans ce sens, l’alleu est l’opposé des fiefs et des censives, tout comme, dans un sens plus spécial, la censive est opposée au fief 1 .
Nous avons vu, en traitant de la formation du système féodal, que déjà les anciens Germains avaient des propriétés particulières, celle du terrain cultivé qui entourait la demeure de chaque famille; ces terres cultivées formaient la /397/ partie appropriée du territoire de la marche; l’autre partie, consistant en forêts et en pâturages, était l’objet d’une jouissance commune de la part des membres de la communauté.
Les terres particulières des Germains étaient la propriété commune de la famille, administrée par le chef de celle-ci, mais dont il ne pouvait disposer sans le consentement de ses agnats; l’alleu était donc, par rapport à la famille, la terra aviatica, l’hereditas paterna (stammgut), quelquefois même alode parentum, et, sous ce rapport, il est opposé aux acquêts ou conquêts, dont le possesseur pouvait disposer librement. C’est là le germe de la distinction coutumière entre les propres et les acquêts qui a traversé tout le moyen âge. C’est par ce motif aussi que, dans la législation féodale, on trouve presque toujours la propriété immobilière appelée héritage, hiretage, en Allemagne erbe; de sorte qu’héritage, dans Beaumanoir, par exemple, est l’opposé de meubles. Lorsque les fiefs et les censives furent devenus héréditaires, et par conséquent hiretages ( « tam de alode quam de comparato, » disent les chartes et les formules), cette double acception du mot alleu, d’où il résulte que, dans un sens, l’alleu est opposé aux bénéfices et aux censives, tandis que, dans un autre sens, il les comprend, ne tarda pas à donner lieu à de fort grandes confusions.
On a vu que, lors de la conquête, les terres romaines restèrent, en général, assujetties à l’impôt romain, mais qu’il n’en fut pas de même à l’égard des terres que se répartirent les vainqueurs.
Nous avons rappelé ce fait, que la tentative que les Mérovingiens firent de soumettre les Francs à l’impôt, dans un moment où les distinctions de races tendaient déjà à s’effacer, fut une des principales causes de la chute de leur /398/ dynastie. Les alleux des Barbares furent donc, dans le principe, exempts du cens, on n’en saurait douter.
Les alleux dont nous venons de parler sont l’alleu germanique, qui, à nos yeux, est l’alleu primitif.
La propriété romaine avait, par sa constitution propre, tous les caractères de la pleine propriété, de l’alleu, sauf l’exemption du cens; mais cela suffit pour qu’on ne puisse pas la considérer comme alleu. L’idée du comte de Montlosier (de la Monarchie française), qui prétend que l’alleu fut, dans le principe, la propriété des Gaulois, tandis que le bénéfice aurait été la propriété germanique, ne mérite guère qu’on entreprenne de la réfuter.
Peu après l’établissement territorial, il se forma cependant des alleux romains, et, dans les documents de l’époque barbare, on trouve cette sorte de possession indiquée et opposée aux alleux germaniques.
Cette espèce d’alleu se rencontre dans les provinces des Gaules qui furent occupées par les Burgondes et par les Wisigoths. On a dit ailleurs que ces peuples s’étaient introduits sur les terres de l’empire plutôt en alliés qu’en conquérants, par suite d’un traité plutôt que par une invasion violente, et qu’ils s’étaient d’abord établis, dans les provinces occupées par eux, de la manière usitée pour les armées romaines qu’on y plaça en quartiers. Les possesseurs de terres durent leur livrer l’annona, qui était une contribution en nature, et leur fournir le logement (hospitatura).
Cette condition primitive de l’établissement fit place à un partage, dans lequel le Barbare prit une part des terres, et laissa l’autre à l’ancien possesseur.
La part du Barbare était libre de l’impôt, parce qu’elle lui appartenait; celle du Romain le fut-elle aussi? Quelques-uns /399/ le pensent, et disent que cet affranchissement était le but du partage; mais le but du partage était l’affranchissement des charges de l’hospitature, et non l’affranchissement de l’impôt ordinaire. Il faut aussi observer qu’une partie des provinces des Gaules où le partage eut lieu, ainsi la Provence, le Languedoc, le Dauphiné, le Lyonnais, et quelques contrées adjacentes, étaient du nombre de celles qui, sous la domination romaine, jouissaient du jus italicum; or, le principal privilége de ces provinces était d’être exemptes du cens. Ainsi, les alleux bourguignons et la partie orientale des alleux wisigoths durent être exempts du cens, par cela seul que, déjà avant la conquête, les terres qui les composaient n’y étaient pas soumises.
Ces diverses circonstances nous expliquent pourquoi, dans le territoire des anciens royaumes burgonde et wisigoth, les alleux ont toujours été beaucoup plus nombreux que dans le nord, l’ouest et le centre, occupés par les Francs, et pourquoi c’est aussi dans ces contrées surtout que l’on rencontrera plus tard les alleux dits roturiers, qui, bien que libres des liens féodaux, ne l’étaient pas de la justice justicière.
En effet, par le partage, la terre laissée au Romain n’était affranchie que des droits dérivant de l’hospitalité, savoir, l’annona, ou le tribut foncier; et même, dans les pays de droit italique, l’exemption, fort variée d’ailleurs, ne comprenait pas non plus toute espèce d’impôt. Les alleux romains ne pouvaient du reste échapper en aucun cas au pouvoir justicier, sous le rapport du service militaire et de la justice elle-même.
Ainsi, sans adopter le moins du monde l’opinion de M. de Montlosier, on conçoit pourquoi, dans les pays qui, plus tard, furent appelés les pays de droit écrit, les alleux furent, dès /400/ l’entrée, beaucoup plus nombreux; de sorte qu’ils ont formé la règle, tandis que, dans les pays coutumiers, le fief était la règle et l’alleu l’exception.
En Italie, il était généralement admis, comme dans la France méridionale, que l’alleu était de droit commun; en conséquence, toute possession foncière qu’on ne démontrait pas affectée de fief ou d’emphytéose, était présumée alleu.
Nous avons indiqué, en traitant des origines du système féodal, les causes diverses qui, durant la période barbare, déterminèrent la transformation d’un grand nombre d’alleux en bénéfices ou en censives. Nous avons vu, entre autres, comment, du VIIe au Xesiècle, les propriétaires d’alleux, en butte à la violence, aux usurpations, et aux mille moyens d’oppression qui étaient dans les mains de la puissance justicière, n’eurent d’autre ressource que de chercher dans l’association féodale un appui que la société générale ne leur fournissait plus, et n’évitèrent d’être dépouillés de tous leurs droits qu’en en sacrifiant une partie, soit au profit du seigneur qui les opprimait, soit au profit de quelque autre homme puissant, qui, à cette condition, se chargeait de les protéger.
Ces causes n’agirent pourtant pas partout avec la même intensité. Dans les pays purement germaniques, où la conquête n’avait pas bouleversé toute la société, la constitution ancienne de la propriété ne se transforma que petit à petit, et même, dans les temps féodaux, elle subsiste encore à côté de la constitution féodale.
En Italie et dans la France méridionale, où, dès le principe, les alleux étaient plus nombreux, puisqu’ils comprenaient les alleux germaniques et les alleux romains, l’esprit de la loi romaine, qui, dans ces pays, forme l’élément /401/ dominant de la législation, était trop conforme au système de l’alleu et trop étranger à celui du fief, pour ne pas agir fortement dans le sens de la conservation du premier de ces modes de possession. Ici, la loi romaine protégea la propriété germanique contre les tendances générales de la société barbare, et, on peut le dire, contre l’esprit germanique lui-même. C’est dans ce sens qu’on doit répéter avec Hauteserre cet adage célèbre: « Lex romana allodiorum parens. »
Dans le nord de la France, au contraire, dans les pays situés à droite de la Loire, où le flot germanique se succéda continuellement, les alleux disparurent presque complétement. Mais, dans le temps même où les alleux primitifs disparaissaient, les bénéfices et les honneurs des hommes puissants composant l’aristocratie carlovingienne acquéraient l’hérédité; et voilà comment il a pu arriver qu’au moment où une plainte générale s’élève sur la destruction des alleux, les Capitulaires s’élèvent, au contraire, avec tant de vivacité contre ceux qui s’efforcent de transformer en alleux leurs bénéfices.
Ces deux faits, contradictoires en apparence, concordent en réalité; d’un côté, l’aristocratie écrase la petite et la moyenne propriété; de l’autre, elle cherche à se rendre indépendante de la couronne.
M. Guizot, qui a remarqué que l’on ne parla jamais tant d’alleux qu’après la mort de Charlemagne, c’est-à-dire juste au moment où ils vont disparaître comme propriété privée dans une partie notable de l’empire franc, observe aussi, avec sa perspicacité habituelle, que le mot alleu se trouva alors appliqué fréquemment à des possessions qui étaient de véritables bénéfices. Cette observation avait déjà été faite par Bacquet (Traité des francs-fiefs), qui dit qu’on /402/ confondait, dans le Xesiècle, les fiefs avec les véritables alleux; qu’on employait, dans les chartes, le terme d’alleu pour signifier toutes sortes de possessions, et que l’on appelait souvent alleux les terres tenues en fief. Il y a plus, Charles-le-Chauve, dans un diplôme recueilli par Baluze, appelle lui-même alleux des terres qu’il donne en bénéfice.
Il ne faut pas s’y méprendre; il y a une révolution cachée dans le double emploi que l’on a fait de ce mot alleu durant la période carlovingienne. Lorsque Charlemagne défend aux grands de son empire de convertir les bénéfices en alleux, le bénéfice n’est pas encore héréditaire, mais tend à le devenir, et l’alleu primitif, qui exclut l’idée du bénéfice, a encore son véritable sens.
C’est donc un tort évident que l’on fait au concédant, lors qu’on transforme un bénéfice en alleu; mais, lorsque Charles-le-Chauve donne le nom d’alleu à un bénéfice, le bénéfice est déjà devenu héréditaire, la révolution est accomplie, et alors alleu n’est plus l’opposé de bénéfice; au contraire, il comprend le bénéfice, parce qu’il signifie tout simplement héritage, terre de famille.
A la question de l’alleu se rattache la controverse animée qui s’est élevée au sujet de la terre salique.
La loi corrigée des Francs saliens, au titre de l’alleu, contient cette disposition, fameuse dans l’histoire du droit féodal: « De terra vero salica nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terræ hereditas perveniat. » Quelques auteurs, tels que Dubos, Boulainvilliers, etc., prenant pour point de départ uniquement la fausse application qui a été faite de ce passage à la succession des fiefs, pensent que les terres saliques ne sont pas autre chose que les bénéfices militaires donnés par Clovis aux Francs saliens. /403/ Mais il est évident, par la place même qu’occupe ce passage, qu’il n’a pas trait aux bénéfices, qui, s’ils existaient aux premiers temps de la conquête, n’étaient, en tout cas, pas objet de succession dans la famille du détenteur.
Guizot, suivant en cela l’opinion de Ducange, rejette l’erreur consistant à faire de la terre salique un bénéfice, mais, prévenu par la conformité des mots, continue à rapporter l’expression terre salique à la nation des Saliens; de sorte qu’il considère cette terre comme l’alleu primitif échu aux Saliens. Perreciot, partant du même point de vue, ajoute que la terre salique est spécialement l’alleu du Franc, tandis que celui des autres races retient le nom générique d’alleu. Eckard, le premier, a proposé une étymologie différente. D’après lui, la terre salique n’est point, malgré la ressemblance des mots, la terre du Salien; loin de là, le mot salique viendrait de sala, mot germanique qui signifie maison; la sala est la maison du maître, la terre salique est donc la terre qui entoure la maison du maître. Cette étymologie, qui a été suivie déjà par Montesquieu, a pour elle l’opinion unanime des savants allemands les plus aptes à décider une question pareille, Grimm, Eichorn, Mittermeyer; elle a été mise hors de contestation, à ce qu’il nous paraît, par la solide discussion à laquelle s’est livré à ce sujet M. Guérard. Cet auteur a montré, entre autres, que, dans le Breviarium de Charlemagne, une maison royale est appelée sala regalis, et que, dans la loi des Allemands, sala désigne le logement particulier du maître 1 ; puis, que les termes de terre salique ne sont point appliqués exclusivement aux Francs saliens. /404/ Au contraire, la mention de cette terre est beaucoup plus fréquente chez les autres peuples, par exemple, chez les Ripuaires et chez les Allemands. Enfin, dans la loi des Ripuaires, comme dans celle des Saliens, la terre de la famille est réservée aux hommes, à l’exclusion des femmes; mais, dans cette loi, elle est appelée hereditas aviatica, et non terra salica.
L’opinion d’Eckard a donc triomphé; seulement, il reste à savoir si la terre salique comprend tout l’alleu familial, ainsi que le pense Pardessus, ou seulement la partie de cet alleu qui n’a pas été transférée à des tenanciers colonaires ou serviles, le mansus dominicatus ou la curtis dominicata, comme le veut Guérard. Sur ce point, d’après l’analogie des autres lois germaniques, je penche à croire que la loi salique entend par terre salique tout l’alleu paternel, ou, en d’autres termes, l’hereditas aviatica de la loi ripuaire. Cette opinion est d’autant plus probable que, chez les Francs, en ce qui concerne les successions, l’ancien droit germanique s’était conservé plus pur que chez la plupart des autres peuples conquérants; elle s’appuie d’ailleurs sur un document du commencement du XIIesiècle, rapporté par Eckard, où des dîmes perçues, dans le Palatinat, sur des manses (hubæ) dépendantes d’une seigneurie, sont nommées decimationes salicæ; ce qui montre qu’elles faisaient partie intégrante de la terre salique.
Mais il faut observer que si les filles étaient exclues de l’alleu paternel par leurs frères, d’après les lois barbares, elles n’étaient pas toutefois exclues définitivement; car, à défaut de frères, elles héritaient. C’est peut-être aussi dans ce sens qu’il aurait fallu interpréter l’exclusion prononcée par la loi salique; mais il était écrit que cette disposition, /405/ qui, en elle-même, n’avait rien de particulier, donnerait lieu à toutes sortes d’erreurs 1
.Au commencement de l’époque féodale, les bénéfices étaient devenus des alleux, en ce sens qu’ils étaient devenus héréditaires, comme l’alleu, qu’ils suivaient la loi de l’alleu, et qu’ils faisaient partie du patrimoine; mais ils n’étaient pas pour cela de véritables alleux, en ce sens qu’ils n’étaient pas propriété indépendante.
Guérard, en supposant une terre donnée à titre d’alleu, et qui pouvait cependant tomber en commise pour violation de la fidélité due à celui de qui on la tient, admet, selon nous, une contradiction juridique, et prolonge à plaisir la confusion dans laquelle l’ignorance et des troubles continuels avaient jeté toutes les notions, durant l’époque intérimaire.
Mais, dans ce temps-là, et dans les cas particuliers, la confusion des idées produisit beaucoup d’interversions dans les droits des individus. Si nombre de grands bénéfices, et surtout d’honneurs, se transformèrent en seigneuries allodiales /406/ par la chute du pouvoir royal de qui ces bénéfices et ces honneurs dépendaient; si un nombre infiniment plus grand de petits et de moyens alleux furent convertis en bénéfices, en précaires ou en censives, par l’avidité et l’usurpation des puissants et des forts: en ce qui concerne les principes mêmes, il ne sera pas difficile de démontrer que la confusion des mots n’avait pas empêché de conserver la conscience de la différence des choses. Ainsi, on persista à distinguer du mieux que l’on put, dans les documents, les terres affranchies du service et du cens, c’est-à-dire les véritables alleux, de celles qui n’étaient pas possédées dans de telles conditions. Et, malgré que les usurpations justicières fussent bien plus faciles encore à l’égard des alleux que les usurpations féodales, qui supposent le fait d’un contrat conclu à un moment donné, néanmoins, dans les premiers siècles de l’époque féodale, la franchise à l’égard des redevances justicières se trouve aussi indiquée dans les actes, comme caractère essentiel de ces véritables alleux 1 . /407/
La préoccupation des idées féodales était telle pendant un certain moment, que, pour distinguer l’alleu du fief, on lui donna le nom de franc-fief, comme si toute possession immobilière avait dû nécessairement être un fief. Plus tard, on a réservé l’expression de franc-fief pour les fiefs qui étaient tenus par hommage simple, et non par hommage lige 1 .
Cependant, la désignation qui prévalut, et qui s’est conservée dès lors, fut celle de franc-alleu, qui réunissait l’idée de franchise, sur laquelle il fallait insister depuis qu’alleu tout seul avait été appliqué aux propres de tous genres, et l’ancienne notion d’alleu, qu’on voulait retenir.
Le franc-alleu, dans le système féodal, est donc absolument la même possession que l’alleu de l’époque barbare et la franchisia de l’époque intermédiaire.
Toutefois, sous le régime seigneurial, les envahissements des justiciers sur les droits des possesseurs d’alleu continuèrent à avoir lieu, et cela d’autant plus aisément que là où le possesseur d’alleu n’était pas lui-même seigneur justicier, c’est-à-dire à l’exception des seigneuries allodiales, les alleux /408/étaient soumis à la juridiction justicière; à l’abri de la juridiction, les redevances justicières avaient moyen de s’introduire. Les anciens jurisconsultes français et la plupart des coutumes maintiennent ces trois règles:
1° L’alleu exclut tout service, soit féodal, soit tributaire.
2° L’alleu exclut la soumission aux redevances justicières.
3° L’alleu est soumis à la juridiction publique, tant royale que seigneuriale 1 .
Mais ces coutumes distinguent deux espèces de franc-alleu, /409/ le noble et le roturier, et, dans chaque espèce, les règles précitées se modifient plus ou moins dans leur application.
L’alleu noble est, dans les pays de coutumes, celui dont le propriétaire est seigneur justicier, féodal, ou censuel, des terres qui le composent. L’alleu roturier est celui qui ne comprend ni justice, ni fief 1 . Mais, dans les pays de droit écrit, on appelle alleu noble tout héritage possédé en propriété directe et utile, qui est exempt de la contribution aux tailles, c’est-à-dire des redevances justicières; l’alleu roturier est celui qui paie la taille.
Comme dans les pays coutumiers les tailles sont personnelles, disent les jurisconsultes des pays de droit écrit, il a fallu distinguer le franc-alleu noble et le roturier à l’aide de la possession d’une seigneurie. Cette explication n’est pas la vraie, selon nous; mais elle se conçoit, en raison de l’oubli dans lequel était tombée l’histoire des usurpations justicières. Le franc-alleu, en principe, n’était ni noble, ni roturier, car il existait avant la noblesse et la roture; il était la propriété libre de l’homme libre. Lorsque la noblesse a été attachée à la seigneurie, il a été conforme à la nature des choses d’appeler noble l’alleu qui renfermait des seigneuries; car il était certes aussi noble que le fief, dominant d’un côté, mais dominé, de l’autre, par un fief supérieur. Quant au franc-alleu noble des pays de droit écrit, il est tout simplement l’alleu primitif, qui s’est maintenu dans son intégrité, tandis que l’alleu roturier, c’est l’alleu qui n’a pas résisté complétement aux envahissements de la puissance justicière. /410/
Des renseignements intéressants sur les destinées diverses de l’alleu, dans sa lutte avec la féodalité, se trouvent dans le manuscrit de Wolfenbuttel. Ce manuscrit, qui se compose d’aveux, ou déclarations, donnés, en 1273, à Edouard Ier, roi d’Angleterre, par les habitants du duché de Guyenne, nous montre diverses classes de propriétaires d’alleux.
Il en est qui déclarent qu’ils ne tiennent rien du roi, qu’ils ne lui doivent rien, ni l’hommage, ni la justice. D’autres se reconnaissent débiteurs d’une rente, d’une redevance, d’un service militaire; d’autres reconnaissent devoir, non l’hommage, mais le serment de paix ou d’alliance 1 . Il en est enfin qui déclarent ne savoir si leur terre est alleu ou fief 2 . « Quant aux redevances, » disent les éditeurs de ce remarquable document, MM. Delpit, « il paraît résulter de l’enquête de 1236, qu’elles ne remontent qu’à une époque peu éloignée. Habitants des campagnes, isolés et sans défense au milieu de la féodalité, constamment pillés et harcelés par des ennemis auxquels ils ne pouvaient résister, les hommes libres de l’entre deux mers furent obligés de s’adresser à un protecteur puissant, qui, selon les circonstances, leur fit payer plus ou moins cher. »
La trace du changement opéré de cette façon dans la liberté des hommes francs apparaît d’une manière frappante dans les termes dont ils se servent dans leurs déclarations 3 .
La franchise des habitants de la Guyenne à l’égard de tout seigneur justicier, constatée par le manuscrit de /411/ Wolfenbuttel, est d’ailleurs conforme au rapport d’un très ancien commentateur de la Coutume de Bordeaux 1 , Arnold Ferron, qu’a cité Caseneuve, dans son Traité du franc-alleu.
Vis-à-vis des alleutiers de Guyenne, la justice, telle qu’elle ressort des documents indiqués, n’est pas cette puissance indépendante et s’imposant elle-même que nous connaissons; ici, celle du duc elle-même est conventionnelle, comme ailleurs l’obligation féodale; c’est une protection achetée à un certain prix, et contre laquelle on prend des garanties 2 .
Une preuve que la justice du roi et de ses officiers n’était pas encore envisagée comme une conséquence d’un pouvoir supérieur, c’est que tout prévôt royal, à son entrée en fonctions, devait promettre, par serment prêté, non au prince, mais aux alleutiers eux-mêmes, qu’il exécuterait fidèlement les conditions du contrat 3 .
Il y a plus, les alleux qui ne reconnaissent pas d’obligations conventionnelles, telles que les rentes et redevances, n’étaient pas soumis à la justice du roi ou de ses officiers. Ici, l’alleu a conservé toute sa franchise primitive. On trouve, dans le nombre, des alleux tellement libres, que leurs possesseurs ne se croient pas tenus de les faire connaître au roi, et refusent formellement de répondre aux questions qui leur sont faites. D’autres déclarent qu’ils ne doivent rien au roi, ni à personne qui vive; un d’eux réclame contre le droit de /412/ juridiction, et dit: « Quand je comparais devant le roi, c’est par violence, comme lorsque je lui ai prêté serment de fidélité. » On voit que, sans être lui-même seigneurie, l’alleu peut être, et fut réellement, pendant un assez long laps de temps, indépendant même de la justice. Mais des conditions de telle nature ne pouvaient subsister qu’à l’aide d’une puissance capable de les faire respecter. On a vu que les alleux roturiers furent soumis aux redevances justicières, par exemple, à la taille, dans le sud, et quant à la juridiction, elles’étendit même sur les alleux nobles, dont la justice, s’ils en avaient une, fut censée relever du roi, à défaut d’autre suzerain, et n’était pas exercée d’ailleurs par son possesseur en raison de son alleu, mais en raison des fiefs, censives, ou droits de justices, qui peuvent appartenir à cet alleu; car, suivant l’expression de Pocquet de la Livonière, « la justice n’est pas allodiale. »
Bacquet a prétendu qu’il n’y avait anciennement qu’une espèce d’alleu, qui était le noble, et que ce fut lors de la réformation de la coutume de Paris (1510) qu’on introduisit la distinction de l’alleu noble et roturier, pour la forme des partages seulement. Le but de cette assertion, dans la bouche du plus ardent défenseur du domaine royal, est facile à reconnaître et rend l’allégation suspecte. Bacquet voulait soumettre les alleux roturiers, comme les alleux nobles, au droit de franc-fief. Cette opinion fut généralement repoussée, et elle est combattue, entre autres, par Brodeau.
Or, c’était dans l’intérêt de la thèse du fisc de faire remonter le droit de franc-fief, qui lui est payé par le roturier acquéreur d’un fief, à une époque où tous les alleux auraient eu à payer ce droit. L’alleu roturier étant devenu le mode de possession habituel du tiers état, la question ne laissait pas que d’avoir pour le fisc un fort grand intérêt. /413/
Mais si le droit de franc-fief a pu être exigé des alleux nobles, c’est seulement par le motif qu’ils comprenaient des seigneuries ou des fiefs; or, il est, historiquement, suffisamment établi, non-seulement que tous les alleux n’en comprenaient pas, mais, dans la règle, les alleux primitifs n’en comprenaient pas. Il serait donc plutôt vrai de dire que l’alleu primitif était roturier dans le point de vue où se place le droit coutumier, tandis qu’il était noble, au contraire, au point de vue du droit écrit.
Les alleux nobles se partageaient; ce qui revient à dire qu’on y succédait suivant la loi des fiefs. Les alleux roturiers, au contraire, sont soumis à la loi de succession roturière, ainsi au partage égal entre frères et soeurs.
Les jurisconsultes distinguaient encore les alleux en alleux naturel et de concession. Là où l’alleu est naturel, le seigneur doit prouver son droit; mais lorsqu’il s’agit d’un alleu de concession, c’est au possesseur de l’alleu à montrer le titre de son exemption, ou le remplacer par des actes énonciatifs de l’allodialité, accompagnés d’une possession ancienne et immémoriale.
La maxime « nulle terre sans seigneur » a cette portée de faire envisager tout alleu comme alleu de concession, dans le lieu où elle est admise. Cette maxime était rejetée dans tous les pays de droit écrit, où l’alleu est, au contraire, envisagé comme naturel, et dans les pays dont les coutumes furent par ce motif nommées coutumes allodiales, ainsi la Bourgogne, la Franche-Comté, la Bresse, le Bugey, le pays de Gex, tous pays où les alleux roturiers se trouvaient en nombre, une partie de la Champagne, Troyes, Chaumont, Vitry, Auxerre, le Nivernais, etc. Dans le nord-ouest et le centre de la France, la maxime « nulle terre sans seigneur » /414/ régna très généralement. Déjà du temps de Beaumanoir, l’alleu n’existait pas dans le Beauvoisis, et, dans l’Anjou, on pourrait bien en dire autant, puisque Pocquet de la Livonière nous apprend que les possessions de ce titre étaient soumises aux droits de lods et ventes.
Au fur et à mesure que l’on avance, la maxime « nulle terre sans seigneur » tend à prendre un sens plus absolu; l’histoire de la marche qu’elle a parcourue, n’est pas sans intérêt. Nous la résumerons en renvoyant, pour plus de détails, à Championnière, qui l’a retracée admirablement.
D’abord, cette maxime se produit sur le terrain de l’enclave. Lorsque le temps eut détruit les titres primitifs et que des conventions de toutes sortes eurent démembré le domaine du seigneur dominant, des prétentions opposées s’élevèrent concernant les terres enclavées dans d’autres, ou reconnues pour en avoir été détachées. Le possesseur de l’enclave soutenait sa liberté, sa franchise; le seigneur, au contraire, prétendait qu’une telle terre était censuelle, ou féodale, ayant été distraite de ses possessions comme toutes celles qui l’entouraient. Fort souvent, des détenteurs de terres réellement engagées dans les liens de la féodalité avaient réussi à se dégager par l’effet d’une longue possession, et peu de seigneurs eussent pu produire des contrats pour toutes leurs tenures; la contestation était donc non moins importante que difficile; la lutte fut longue, et les solutions diverses. Là où les alleux étaient l’exception, le principe de l’assujettissement présumé de l’enclave prévalut.
Dumoulin, dans son commentaire de la coutume de Paris, admet l’assujettissement présumé de l’enclave 1 , et, /415/ toutefois, il repousse la maxime « nulle terre sans seigneur » dans l’extension qu’elle a prise dès lors, estimant au contraire que la maxime qui fait présumer tout héritage libre, doit être observée dans tout le royaume 1 . Il va même jusqu’à dire que la maxime « nulle terre sans seigneur » est fausse, entendue du seigneur direct, et n’est juste qu’eu égard à la domination et à la juridiction du roi ou du seigneur qui la tient de lui, parce que la justice n’est pas allodiale 2 .
Touchant l’enclave, le principe opposé à celui de Dumoulin était admis dans les pays où l’alleu est censé naturel 3 , et l’on tint pour règle la franchise de la terre, même enclavée, dont l’affectation féodale ne se démontre pas.
Jusqu’ici, la présomption de féodalité ne s’applique qu’aux terres enclavées dans un domaine limité; celles qui n’étaient que voisines ou contiguës d’un territoire féodal ne sont pas présumées en faire partie. On suppose seulement que celui dont la possession est déterminée par des tenants et /416/ aboutissants fixes, est propriétaire au même droit de toute la terre comprise dans les limites de la seigneurie.
Mais on développa le principe posé en l’appliquant aux droits de justice; voici de quelle façon. La limitation précise du domaine était une condition essentielle du fief, mais non de la justice, dont le territoire, au contraire, n’est marqué que par des indications vagues, tel pagus, telle villa; de sorte que tout seigneur bien limité fut présumé féodal, si ce seigneur était en même temps justicier. On en conclut que, possédant à la fois la justice et le fief, il avait droit aux prérogatives propres à chacune de ces qualités 1 .
Cette observation explique les dispositions des coutumes qui semblent attribuer au justicier la directe du territoire soumis à sa justice; cela n’a lieu que pour le territoire limité. Ce n’est pas à la justice que la directe est affectée; on suppose seulement un droit de fief au justicier, par suite de la limitation du territoire.
L’ambition des seigneurs, non plus que celle du fisc royal, n’étaient pas encore satisfaites.
On a vu que la règle « nulle terre sans seigneur » était reconnue vraie partout, même par ses contradicteurs, en supposant qu’il s’agisse d’un seigneur justicier. Les droits de justice étaient donc exigibles partout, à moins d’immunités particulières. Or, il est de règle générale, dans le système féodal, que l’affranchissement de la personne exempte ses possessions, mais que celui de la possession n’affranchit /417/ pas la personne. Ainsi, le noble, immune à raison de sa personne, a affranchi de toutes redevances justicières les terres qu’il possédait, quelle que fût leur nature, et son exemption s’étend à tous fiefs, arrière-fiefs, ou censives, qu’il a constitués. En revanche, l’alleu, qui est l’immunité du sol, a affranchi la terre du cens justicier; mais cette immunité ne s’est pas étendue à la personne. C’est pourquoi les polyptiques de l’époque intermédiaire parlent souvent d’alleu, dont les possesseurs sont astreints à des redevances personnelles, ou même sont rangés dans la catégorie des colons, circonstance que Guérard a déjà remarquée. Sous le régime féodal, le roturier, l’homme de poëte, purent également posséder des alleux, et n’en rester pas moins, pour leur personne, soumis aux exactions des seigneurs justiciers.
Dans les rapports avec la justice, la règle « nulle terre sans seigneur » a eu pour objet de formuler deux principes bien différents.
L’un est la nécessité pour toute possession de reconnaître une juridiction à laquelle elle est subordonnée; ceci est un principe d’ordre public. L’autre, c’est le droit pour tout seigneur justicier d’exiger un cens de son sujet, de son justiciable, à raison de ses possessions; ceci est une règle fiscale qui est un héritage, comme nous le montrerons plus loin en traitant des justices, du système de l’impôt romain, et qui a traversé tout le moyen âge en se transformant de diverses façons.
La première de ces règles était une conséquence inévitable de la reconstitution du pouvoir social; la seconde était historiquement fausse, en ce qui concerne l’alleu, et cependant, déjà avant le XVIesiècle, elle fut généralement reçue, en ce qui concerne les alleux roturiers. /418/
Au XVIesiècle, on alla bien plus loin encore. A cette époque, les seigneurs justiciers travaillaient à convertir leur droit de justice en droit de fief; leurs efforts avaient pour but d’abord d’étendre partout la règle qui soumettait l’alleu à la production d’un titre, ensuite d’attacher au paiement d’un cens quelconque la présomption de la directe.
Le droit d’appliquer un cens à toute terre non féodale fut reconnu par les coutumes des localités où l’alleu n’existait qu’à l’état d’exception.
C’est le sens qu’on attacha à la règle « nulle terre sans seigneur » dans ces coutumes, lors de leur première rédaction. Lors de la seconde rédaction, on lui donnait déjà une autre signification. Les seigneurs demandaient que, par mesure générale, toutes les terres non justifiées allodiales fussent déclarées appartenir à la directe du seigneur censier.
Cette demande fut rejetée; le véritable sens de la règle était encore trop présent à tous les esprits pour qu’on pût accueillir une aussi grave innovation. Bien plus, plusieurs coutumes, notamment celle de Bretagne, qui avaient d’abord accueilli la maxime « nulle terre sans seigneur, » la rayèrent dans la crainte d’une fausse interprétation.
Mais, lors de la rédaction définitive des coutumes, qui eut lieu seulement au XVIIesiècle, la nouvelle interprétation avait fait des progrès; la doctrine qui rattachait tous les cens au contrat de bail à cens avait obscurci l’histoire et les origines du cens justicier; une fois dans ce point de vue, il n’était plus possible de soutenir que le cens ne supposait pas la directe. La règle « nulle terre sans seigneur » prévalut dans sa nouvelle acception, et toutes les terres censuelles perdirent leur liberté.
L’effet de cette règle nouvelle fut immense, on le /419/ comprend bien, dans l’intérêt des justiciers; ils devinrent seigneurs féodaux de toutes les terres sur lesquelles auparavant ils n’avaient que des droits de district; ils acquirent le domaine direct, c’est-à-dire la propriété du sol, là où ils ne l’avaient pas; leurs droits utiles en reçurent un caractère de féodalité qui les rendait beaucoup moins contestables, qui les mettait surtout à l’abri des prétentions de la couronne, laquelle, en prenant de plus en plus la juridiction aux seigneurs, tâchait de leur enlever aussi les profits de justice autant que faire se pouvait.
Les seigneurs féodaux perdirent en proportion de ce que gagnèrent les justiciers. Dans leur lutte avec ceux-ci, ces derniers excipaient désormais d’un droit égal au leur; ils combattirent les seigneurs féodaux, non plus en tant que justiciers, mais en tant que féodaux, et comme on les voyait propriétaires d’une portion de leur territoire justicier, on en conclut qu’ils l’avaient été originairement du tout. Loiseau émet cette opinion, Henrion de Pansey l’émet également.
Par là, on tendit de plus en plus à confondre le fief avec la justice. Ce fut une profonde perturbation dans la hiérarchie féodale; car tel possesseur de fief situé dans une justice autre que celle de son seigneur dominant, se trouva exposé à deux prétentions de directe que les circonstances pouvaient rendre incertaines.
Les seigneurs de fief perdirent encore, sous ce rapport, que la supposition d’une directe sur des terres qui avaient été de tout temps la propriété de leurs possesseurs, qualifiés de propriétaires par les coutumes, amoindrit nécessairement l’énergie et la puissance qu’on attribuait à ce droit. La tendance de tous les détenteurs du domaine utile à convertir leur droit sur la chose d’autrui en propriété principale et /420/ seulement affectée d’une sorte de servitude, fit un pas des plus importants.
Mais, dans le procès du franc-alleu et de la maxime « nulle terre sans seigneur, » le plus grand profit revint à la couronne. Ce fut en sa faveur qu’on proclama la directe universelle; ce fut pour elle qu’on proclama le roi souverain fieffeux du royaume.
Cette nouvelle règle, historiquement non moins fausse que la règle « nulle terre sans seigneur, » lorsqu’on la prend dans son sens absolu, n’en a pas moins porté de notables fruits. Longtemps elle fut contestée formellement. Pour parvenir à l’introduire, les juristes domaniaux commencèrent aussi par l’amoindrir en la formulant dans des termes restrictifs qui paraissaient la rendre sans danger. Ils dirent que le roi était propriétaire des terres de son royaume, non specialiter, sed in universo 1 . L’assertion passa; ils ajoutèrent que le roi n’était pas propriétaire dans son intérêt particulier, mais pour le bien commun, et l’on n’y vit pas d’objection sérieuse 2 .
A l’aide de telles concessions, on fit admettre que la couronne comprend dans sa directe toutes les possessions féodales du royaume, supposition évidemment chimérique, puisqu’elle implique qu’à une époque donnée, la couronne aurait été propriétaire réel de toutes les terres inféodées.
Malgré cela, cette maxime, introduite dans les coutumes /421/ par les agents royaux, enrichit le fisc des droits d’amortissement et de franc-fief, ainsi que de celui que le roi prélevait sur les affranchissements de serfs, sous prétexte que son droit de seigneur suzerain était appetitié. Et c’est peut-être à l’existence des droits d’amortissement et de franc-fief que la règle « nulle terre sans seigneur » dut son succès; car il était de l’intérêt du domaine que toutes les terres fussent considérées comme féodales, puisque ces droits étaient perçus seulement à raison du fief. Nous avons vu que la prétention de les étendre aux alleux avait été élevée inutilement; sans l’appui des légistes royaux, les prétentions des justiciers n’auraient pas eu plus de succès. Les propriétaires d’alleux trouvèrent dans la couronne un adversaire plus redoutable que tous ceux qu’ils avaient rencontrés jusqu’alors. Sous Louis XIII, une ordonnance en vint à déclarer « que tous héritages ne relevant d’autres seigneurs, sont censés relever de nous, tant en pays coutumiers qu’en pays de droit écrit, et sont, en conséquence sujets aux lods, ventes, quints et autres droits ordinaires, sinon que les possesseurs des héritages fassent apparoir de bons titres qui les en déchargent. » Dès lors, les justiciers qui n’étaient pas encore saisis du cens se trouvèrent hors de cause, et le roi fut seul intéressé dans le litige. Cette guerre, évidemment abusive, faite par le fisc aux alleux, fait comprendre comment un si grand nombre de terres de peu d’importance se sont trouvées relever du roi, sans qu’il soit possible d’entrevoir comment la concession avait pu en être faite. Ainsi, dans la Guyenne, dont l’allodialité générale est démontrée, on enjoignit aux possesseurs d’alleux de produire leur titre justificatif, à défaut de quoi ils seraient imposés sur le pied des terres voisines. En Provence, la même chose eut lieu, et le Recueil de /422/ jurisprudence à l’usage de cette province, en rapportant deux arrêts du conseil d’Etat, où la directe universelle est déclarée appartenir au roi dans cette province, les blâme implicitement.
Les agents domaniaux contestèrent de plus en plus l’existence des alleux. Le Dictionnaire des domaines, cité par Championnière, définit cette propriété « une espèce de tenure, dont l’origine est inconnue, et qui, vraisemblablement, n’existe pas en France. » Un siècle encore, la féodalité était abolie, et l’allodialité devenait la condition normale pour toute espèce de possession.
En Allemagne, l’alleu était resté la forme normale de la propriété, laquelle est réglée par le droit national (landrecht). Le lehnrecht et le hofrecht, qui régissent, l’un les fiefs, l’autre les terres des classes non-libres, sont plutôt l’exception, au point de vue du droit civil tout au moins; en ce qui concerne le droit public, c’est la forme féodale qui a prévalu. Le nom d’alleu est du reste plutôt usité pour indiquer l’opposition entre la propriété complète et le fief, et par une sorte d’importation, le terme ordinaire est propriété (eigen, eigenthum), ou encore proprium, hereditas, erbe, au point de vue de la famille et de la succession: « Allodium dicitur hereditas, quam vendere, vel donare possum, est mea propria, » dit un glossateur cité par Goldast. Bien entendu que cette hérédité ne peut être aliénée que conformément aux règles et aux restrictions que le droit germanique établit. Struvius rapporte que, dans quelques provinces du nord, entre autres en Frise, presque toutes les terres étaient des alleux, et queles fiefs y étaient à peu près inconnus; les sonnenlehen, dont il est question, en Allemagne, au moment où le système féodal s’y établissait, ne sont pas de simples alleux, mais /423/ bien des seigneuries allodiales. Cette expression fief du soleil correspond assez à la formule: « Ne tenir que de Dieu et de son épée. » Quelques-uns pensent qu’elle provient du paganisme.
/424/
§ III.
Des biens vacants.
La propriété des vacants a été constamment disputée durant le régime féodal. Cela tient, d’un côté, à ce qu’il existait diverses espèces de terres incultes ou vacantes, naturellement réglées par des principes différents, et que l’on a toujours cherché à ramener le droit des unes à celui de l’une d’entre elles; de l’autre, à ce qu’il n’est pas de matière sur laquelle le système admis par chaque jurisconsulte sur la nature des institutions féodales ait exercé plus d’influence.
Les espèces principales de terres incultes sont:
1° Les terres fiscales. L’existence de terres fiscales incultes, sous la domination romaine et durant la période barbare, est constatée surabondamment. Dans les temps féodaux, ces terres restèrent souvent incultes, tout en cessant d’être propriété du fisc, puisque le fisc public n’existait plus 1 .
2° Les terres abandonnées. La dépopulation est un fait qui /425/ s’est souvent renouvelé dans le cours de l’histoire; une multitude de causes, les guerres, les exactions, forçaient les laboureurs à déserter leurs cultures. Si le cultivateur n’avait qu’un droit subalterne, sa fuite le faisant évanouir, il se réunissait à celui du propriétaire; si la terre abandonnée appartenait à celui qui l’abandonnait, elle devenait un vacant.
3° Des terres incultes faisaient aussi partie de la propriété privée, soit par défaut de bras pour les cultiver, soit parce que les grands propriétaires consacraient une partie de leur fonds à la chasse, à la pâture et à la culture des bois. Les actes désignent ces espèces de terres sous les noms de vasta, inculta, inviæ, sylvæ, pascuæ. Souvent ces terres privées, laissées vacantes, furent occupées par des voisins, et plus tard envisagées comme biens communaux.
4° Une autre catégorie de terres incultes se compose de biens véritablement communaux. Dans les pays germaniques, où la marche existait autrefois, ces biens remontent à l’origine même de la propriété. Dans les pays de conquête, des forêts et des pâturages furent aussi quelquefois laissés en jouissance commune dans les partages entre Barbares et Romains. Là même où, la terre étant déjà entièrement répartie, on n’avait pu créer des terrains communaux, il s’établit assez généralement le système de la vaine pâture. Toute terre ouverte était livrée au pâturage commun; le propriétaire qui voulait interdire ses propriétés, devait les fermer. Telle était la règle dans la plupart des coutumes. Loisel la formule dans cette sentence: « Qui ferme, ou bouche, empêche, garde et défend; pour néant plante qui ne clôt. » On rencontre déjà une règle pareille dans la loi des Wisigoths, et cette loi, suivie en cela par certaines coutumes, ajoute que celui qui se clôt ne peut pas faire paître son /426/ bétail sur les possessions de ceux qui n’ont pas clos. D’autres coutumes, comme celle du Boulonnais, ne permettaient d’enclore qu’une partie aliquote de son terrain; mais cette restriction à la propriété paraît être de droit nouveau, car, pendant un temps, on considéra l’exercice de la vaine pâture comme chose digne de grande faveur, et Basnage, au XVIIesiècle, la défend, en alléguant que l’intérêt public a prévalu sur le droit des particuliers.
5° Une dernière classe de terres incultes sont ces espaces immenses, que la passion des seigneurs pour la chasse avait enlevés à l’agriculture dès les temps qui suivirent la conquête, et frappés du ban seigneurial. Ces terres, arrachées aux populations en vertu du droit de garenne, couvraient souvent des régions entières; les habitants, expulsés de leurs possessions, cherchaient quelquefois à en utiliser une partie, autant que l’exercice du droit de chasse le permettait. Souvent aussi, ils tentèrent de reprendre par la force un fonds que la violence leur avait enlevé; mais ils durent céder; des forêts giboyeuses s’élevèrent, et, après quelques siècles de possession contestée, les justiciers s’en déclarèrent propriétaires exclusifs. D’après quelques coutumes, notamment celle d’Anjou, il était de règle que le justicier doit avoir une forêt, « comme si, dit Championnière, la marque essentielle de la justice devait être l’effet le plus terrible de la conquête et de la désolation. »
La jouissance des terres incultes provenant du fisc fut louée, contre un certain cens, aux habitants riverains, qui y envoyaient leur bétail; ce cens fut plus tard payé au seigneur justicier. Quant aux terres désertes possédées par des particuliers, les propriétaires en jouissaient seuls originairement; mais si le propriétaire ou ses terres n’étaient pas /427/ immunes, on en payait un cens proportionné à leur valeur, qui fit aussi partie des droits utiles de la justice seigneuriale.
Les terres communes des villes et des villages furent également soumises à ce tribut.
Enfin, l’exercice de la vaine pâture fut, dans quelques localités, assujetti à des redevances modiques, destinées à l’entretien des gardiens des troupeaux et des terres en défense; c’est le droit de blairie, dont s’empara aussi le seigneur justicier.
Ainsi, la plupart des terres désertes produisaient des cens au justicier, mais à des titres très différents; tantôt comme prix d’un bail, tantôt comme impôt, tantôt comme contribution perçue dans un intérêt de police privée. Cependant, certains usages étaient gratuits; par exemple, les jouissances des anciens propriétaires dépossédés par l’usage du droit de garenne, et celui des communs dans les pays d’alleux.
Assez longtemps, la propriété des terres incultes ne fut pas un objet envié; les terres communes et la vaine pâture suffisaient à l’entretien de bestiaux en petit nombre, et celui qui voulait défricher ne manquait pas d’espace où s’établir.
D’ailleurs, l’agriculture était presque entièrement concentrée dans des mains serviles ou de condition inférieure. Aussi, les premières contestations au sujet des terres incultes portent-elles sur le cens qu’on en retirait, et non sur la propriété.
Au XVIesiècle, à l’époque où les coutumes commencèrent à être rédigées, les jurisconsultes distinguent les terres vacantes par défaut de prise de possession des terres abandonnées après culture, et des terres vagues des communaux proprement dits; mais, dans la pratique, tout était confondu. On envoyait le bétail sur toute possession non close, sans s’inquiéter du motif de la jouissance qu’on s’attribuait. Les /428/ seigneurs, de leur côté, prélevaient des droits à raison de ces jouissances souvent sans en connaître l’origine.
Quand la question de la propriété des vacants prit de l’intérêt par l’accroissement de la population et les progrès de l’agriculture, les seigneurs s’efforcèrent de rattacher leurs prétentions à la propriété au titre le plus favorable, savoir, la concession à charge de redevance; à leur point de vue, la possession même des habitants est une preuve que leurs droits ne sont que précaires, car elle a lieu contre paiementd’un cens. Dans ces procès, les villageois avaient pour juges leurs adversaires, et les jurisconsultes vinrent encore en aide au seigneur; chaque cause gagnée par un seigneur fut un progrès pour tous; les ouvrages des feudistes en font foi.
Lors de la première rédaction des coutumes, les droits des communautés étaient encore généralement reconnus, et les coutumes constatèrent l’existence de propriétés communales. Mais déjà les seigneurs se faisaient reconnaître la faculté de disposer des vacants, c’est-à-dire des terres sans maître; alors, leurs efforts tendirent à faire confondre les terres communes avec les terres vagues ou vacantes, et ils y parvinrent plus ou moins lors de la révision des coutumes. La règle « nulle terre sans seigneur, » dont nous avons déjà parlé à propos des alleux, étendit son application à toutes les terres incultes, ou appropriations particulières; puis, on retrancha des coutumes les dispositions qui distinguaient les terres communales ou privées, quoique incultes, des terres vacantes 1 . /429/
Dans les pays de droit écrit, où la règle « nulle terre sans seigneur » n’a pas prévalu, les anciens principes sur les vacants furent au contraire maintenus 1 .
Ce fut maintenant aux seigneurs justiciers et féodaux à se disputer, dans les pays coutumiers, les dépouilles des communautés. Ainsi, contestation pour savoir à qui appartiendra le vacant compris dans l’enclave d’un fief et dans le territoire justicier d’un autre que le possesseur du fief. Ce procès n’a jamais reçu de solution définitive. Dumoulin soutient la cause du féodal et le principe de l’enclave; sa doctrine fut admise par d’Argentré, Dunot, Hevin et Henrion de Pansey. Les justiciers avaient pour eux Loyseau, Chopin et les feudistes domaniaux; ils s’appuyaient sur le droit de blairie et les divers autres cens qu’ils avaient toujours perçus pour réclamer la propriété des vacants; la confusion des droits de justice et des droits de fiefs les aida fortement. Déjà au XIIIesiècle, ils avaient réussi à se faire reconnaître propriétaires des chemins et voies publiques dans beaucoup de contrées.
L’analogie décida peut-être les rédacteurs des coutumes; car, là où le justicier avait les chemins, on lui accorda la propriété des vacants, et là où il avait succombé sur la question des chemins, il succomba pour les vacants 2 . /430/
En général, les justiciers eurent le dessus; ils étaient puissamment aidés par la circonstance que, presque partout, le roi était intéressé à la question en qualité de premier justicier, et que ce fut entre le roi et les seigneurs féodaux que la plupart des procès relatifs aux vacants furent jugés.
A la théorie des biens vacants se rattache celle de l’épave, c’est-à-dire des choses mobilières perdues ou abandonnées. L’épave fut, en général, attribuée au seigneur haut justicier; le roi se réserva la fortune d’or; la fortune, ou le trésor en argent, restait au justicier. Cette décision se trouve dans les Etablissements, et Bouteiller la rappelle.
Ce fut également par suite de la décision adoptée par la majorité des coutumes sur les biens vacants que les justiciers furent saisis des successions en déshérence par la coutume de Paris et quelques autres. Ce résultat produisit une certaine perturbation dans le système féodal; car, régulièrement, l’extinction de la famille du vassal faisait revenir le fief au seigneur; aussi ne le voit-on se produire qu’au XVIesiècle, époque où le système du fief commençait à tomber en oubli. Mais, ici, les justiciers eurent affaire à un adversaire plus fort et plus habile qu’eux, le fisc; les gens du roi contestèrent aux seigneurs justiciers le bénéfice des déshérences, et portèrent la décision devant les bureaux des finances.
Le fisc réussit encore plus complétement à dépouiller les seigneurs justiciers du droit de succéder aux bâtards et aux aubains, ou étrangers. Déjà sous le règne de Philippe-le-Bel, les seigneurs faisaient des plaintes à cet égard, et ils firent bonne résistance jusqu’au XVIesiècle, époque des grands progrès du pouvoir royal 1 . /431/
En Allemagne des terres incultes, renfermées dans un territoire limité, appartiennent, selon les circonstances à la commune ou à l’Etat. Quant aux choses mobilières, sans maître, qui ne rentrent pas dans la catégorie des régales, telles que le trésor; on suit les règles du droit romain.
/432/
SIXIÈME SECTION.
DES OBLIGATIONS FÉODALES DANS LES TEMPS POSTÉRIEURS A LA FÉODALITÉ.
Le système des droits et des obligations résultant du contrat féodal, ce qui est plus particulièrement droit privé dans le droit féodal survécut en partie à la féodalité elle-même, non toutefois sans avoir subi d’assez notables changements.
En France, depuis que le régime de la monarchie absolue eut remplacé le gouvernement féodal, l’obligation du service militaire, qui a été la base du rapport féodal primitif, n’existe plus; au prince seul appartient le droit de déclarer la guerre et de convoquer les milices nationales. L’hommage n’est donc plus que la reconnaissance solennelle que le vassal fait de son seigneur; de là, plusieurs conséquences essentielles.
Ainsi, contrairement à l’ancien droit, un vassal peut désormais rendre l’hommage lige à plusieurs seigneurs, et il n’existe plus guère de différence entre l’hommage lige et l’hommage simple, si ce n’est dans la forme; cependant le vassal par simple hommage avait, de plus que le vassal lige, la faculté de se faire substituer dans l’accomplissement de ses devoirs féodaux.
Ainsi encore, une femme, primitivement incapable de tenir un fief, selon la généralité des coutumes put cependant en recueillir par succession, sauf lorsqu’il s’agissait de la /433/ couronne, des apanages des enfants de France, des duchés, comtés et marquisats. A égalité de degrés, certaines coutumes préféraient les mâles en ligne collatérale.
La foi étant un acte essentiellement personnel, est encore renouvelée à chaque mutation, soit de seigneur, soit de vassal; et, en commémoration du droit de parage, l’aîné peut porter l’hommage au seigneur au nom de ses frères puînés. Une exception au principe de la prestation personnelle de l’hommage est encore établie en faveur de l’usufruitier du fief et des créanciers du vassal, qui ont le droit de rendre l’hommage dans le cas où, par fraude, le nu-propriétaire, ou le débiteur, néglige de remplir cette obligation.
Sous l’ancien droit, lorsque l’hommage n’avait pas été rendu en temps opportun, le seigneur reprenait le fief sans autre formalité. Depuis le XVIesiècle, les formes judiciaires prirent la place de l’autorité privée; l’intervention du juge et le ministère d’un huissier sont exigés même là où les coutumes reconnaissent au seigneur le droit d’agir seul.
La saisie avait encore lieu pour omission du dénombrement ou défaut de paiement des droits de quint et de rachat.
Le vassal privé de son fief pendant la saisie peut être délogé par le seigneur; la coutume recommande toutefois à celui-ci d’user de ménagement.
La peine de commise, encourue pour félonie ou désaveu, existe toujours; mais on applique à ce droit la maxime odiosa restringenda.
La jurisprudence, adoucissant encore la doctrine de Dumoulin, rejette la commise, en cas de désaveu extra-judiciaire.
D’Argentré admettait la résolution de tous les droits réels, en cas de commise; mais l’avis de Dumoulin l’emporta, /434/ selon lequel les créanciers ne peuvent perdre leurs droits par la faute de leurs débiteurs.
De plus, la commise pour félonie fut prescrite par un an et non plus par trente. Cette importante restriction aux droits des seigneurs est postérieure à Dumoulin, qui, malgré ses tendances romanistes, n’avait point osé la proposer.
Comme les seigneurs abusaient quelquefois de leur autorité pour exiger, dans le dénombrement, la reconnaissance de devoirs plus onéreux que ceux qui étaient imposés par le titre primitif, il fut reçu que ce qui était contraire au titre d’inféodation ne sortirait aucun effet.
Les droits utiles, ou profits du fief, étaient les droits de quint, de rachat et de retrait, dont nous avons déjà parlé.
La jurisprudence en restreignit l’application, en ce sens qu’aucun profit n’était dû quand la vente était résolue, et que tout acte mettant fin à l’indivision est un simple partage déclaratif du droit de propriété, et non une mutation. Diverses personnes privilégiées furent encore exemptées de payer les profits, soit comme acquéreurs, soit comme vendeurs, et là où elles intervenaient au contrat, le profit n’était pas même payé par l’autre contractant, si c’était à lui de le payer d’après l’usage.
Enfin, les droits de mutation furent supprimés à peu près dans toutes les coutumes pour les successions en ligne directe.
Le droit de rachat, qui consistait dans une année de revenu dont profitait le seigneur à chaque changement de vassal, était estimé par deux experts qui, avant le XVIesiècle, devaient être nobles, parce qu’un roturier ne pouvait témoigner en matière de fief. Depuis lors, on n’observa plus cetterègle. /435/
Dans l’ancienne jurisprudence, le retrait féodal reposait sur le droit qu’avait le seigneur de réunir à ses domaines le fief relevant de lui, en cas d’aliénation, et pouvait être considéré en cela comme un fruit du fief rentrant dans le rachat; en conséquence, il n’était pas cessible. La nouvelle jurisprudence du parlement de Paris ne vit plus dans le retrait féodal que la faculté de profiter d’un bon marché; dès lors, réduit à un droit purement pécuniaire, il fut cessible; cependant, il ne pouvait être exercé par les gens de mainmorte, même par l’intermédiaire d’un tiers.
Le contrat de bail à cens, qui réservait au cédant la seigneurie directe et une redevance annuelle, différait du contrat de rente foncière en plusieurs points. Dans la rente foncière, point de réserve de seigneurie; le cens était imprescriptible, tandis que la rente était sujette à prescription. On tenait encore que cens sur cens ne vaut, c’est-à-dire que celui qui détenait à cens ne pouvait pas faire de concession semblable à celle qu’il avait reçue; il en était encore autrement de la rente foncière. Enfin, le cens étant récognitif de la seigneurie, ne se compensait pas; ce principe est aussi étranger à la rente foncière.
Outre ces modifications intérieures, le droit féodal en subit d’autres, qui provinrent de l’extension du droit civil, ou coutumier, et des principes du droit romain par lesquels cette branche du droit est surtout informée. La distinction entre le droit féodal et le droit civil subsiste; mais le premier, qui était la branche principale et prédominante au XIIIesiècle, devient la branche secondaire. Du reste, l’un et l’autre droits sont de plus en plus soumis à l’action puissante des légistes, dont les idées se propagent, dans la pratique, par des arrêts et des traités juridiques, dans la /436/ législation, par les ordonnances royales dont ils sont les rédacteurs. L’esprit philosophique prend un ascendant incontestable dans toutes les branches des connaissances humaines; c’est à lui qu’il est réservé de détruire l’édifice juridique élevé par la tradition, dans un temps où les rapports sociaux reposaient sur de tout autres bases.
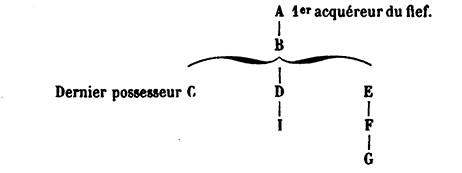 D’après le système de la succession purement linéale, I et G succèdent conjointement à C; car ils auraient eu le fief à son défaut. D’après le système de la succession linéale et graduelle, I succède seul, parce qu’il est d’un degré plus près de C.
D’après le système de la succession purement linéale, I et G succèdent conjointement à C; car ils auraient eu le fief à son défaut. D’après le système de la succession linéale et graduelle, I succède seul, parce qu’il est d’un degré plus près de C. 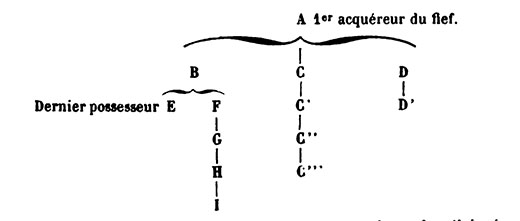 E, dernier possesseur, étant mort, I lui succède, quoique plus éloigné en degré que C; car il est de la première ligne; mais si I et le reste de la ligne n’existent plus, D’ succèdera de préférence à C’’’ et à C’’, parce qu’il est, à lignes égales, dans un degré plus rapproché.
E, dernier possesseur, étant mort, I lui succède, quoique plus éloigné en degré que C; car il est de la première ligne; mais si I et le reste de la ligne n’existent plus, D’ succèdera de préférence à C’’’ et à C’’, parce qu’il est, à lignes égales, dans un degré plus rapproché.