INTRODUCTION A L’HISTOIRE DU COMTÉ DE GRUYÈRE
CHAPITRE PREMIER.
Etablissement des Alamanni et des Bourgondes en Helvétie. — Défrichement et colonisation de la Gruyère.
L’Helvétie, habitée par les Helvètes, peuple celte ou gaulois d’origine, ayant été subjuguée par Jules-César, les Romains y fondèrent plusieurs colonies, dont il subsiste des vestiges, et y introduisirent leur langue, leurs institutions, leur culte. Bientôt les Helvètes apprirent à connaître le christianisme. Ils demeurèrent soumis aux Romains jusqu’à la chute de l’empire d’occident.
Au commencement du Vme siècle de notre ère, les Alamanni, association de peuplades germaines, après avoir été /2/ plus d’une fois repoussés par les Romains, se réunirent en un essaim formidable qui franchit sur plusieurs points le fleuve qui les avait séparés de la Gaule. Les Romains, hors d’état de résister aux hordes nombreuses qui pénétraient dans leur empire, retirèrent leurs garnisons, abandonnèrent aux Alamanni et aux Bourgondes l’Alsace, la Séquanie, l’Helvétie, la Savoie et le Vallais 1 . Les Alamanni s’avancèrent en conquérants le long de la rive occidentale du Rhin, mais battus en 496 par Chlodovech, qui brisa leur orgueil, et leur arracha une grande partie de leurs conquêtes, les uns se soumirent au vainqueur, d’autres repassèrent le Rhin, d’autres encore obtinrent de Théodoric, roi des Ostrogoths, la permission de s’établir dans les Alpes rhétiennes, où ils pouvaient servir de rempart à ce prince contre la puissance toujours croissante des Franks 2 . De là les Alamanni et les Suèves, leurs alliés, vinrent occuper les régions élevées de l’Helvétie. Ils furent les premiers colons des hautes Alpes, où ni Celtes ni Romains n’avaient pénétré, et ils se répandirent successivement dans les cantons où leur langue est aujourd’hui vivante. Ces nouveaux conquérants, dont l’Alamannie ou la Souabe prit le nom, étaient un peuple sauvage et grossier. Ennemis de toute culture, les Alamanni montrèrent longtemps de l’aversion pour le christianisme 3 . Ils /3/ réduisirent en servitude les peuples qui avaient échappé à leur glaive, et leur imposèrent leur idiome et leurs usages.
Quant aux Bourgondes, commandés par leurs rois ou hendins, et enflammés par leurs prêtres, dont le chef, nommé Siniste, était perpétuel, et inviolable comme les rois 1 , ils franchirent le Rhin au commencement du Vme siècle et entrèrent dans la Gaule, où les généraux de Rome, trop faibles pour repousser ces bandes guerrières, les laissèrent former leur premier établissement, qui date de l’an 413. Les Bourgondes occupaient les quartiers de Mayence, de Worms et de Spire. C’est là qu’ils se convertirent à la foi chrétienne. Les Niebelungen nous ont transmis les poétiques souvenirs du séjour des Bourgondes dans ces contrées. Inquiétés dans leurs cantonnements, ils voulurent entrer plus avant dans la Gaule. Le général romain Aëtius fit échouer leur projet, par une victoire qu’il remporta sur eux, en 435, et qui remit les Romains en possession du territoire qu’ils avaient dû leur céder. Cependant Aëtius, craignant les excursions des Bourgondes, leur assigna (443) des terres dans la Savoie, qu’ils devaient partager avec les indigènes 2 . Dans l’espoir de trouver en eux de fidèles auxiliaires, Aëtius songeait à leur donner des établissements permanents. A la mort de ce grand capitaine, que le misérable Valentinien fit exécuter (454), sacrifiant à d’injustes soupçons l’unique appui d’un empire ébranlé jusque dans ses fondements, les Gallo-romains, inquiets, agités, traitèrent avec les Bourgondes d’un /4/ partage équitable du sol, et ce fut ensuite d’une convention que cette tribu germaine s’établit dans les contrées qu’on appela depuis la Bourgogne, la Franche-Comté, le Lyonnais, le Dauphiné, la Savoie et la Suisse romane 1 .
Les historiens contemporains portent à quatre-vingt mille le nombre des guerriers bourgondes qui franchirent le Rhin au commencement du Vme siècle et pénétrèrent dans la Gaule 2 . Ceux qui périrent dans les combats furent en partie remplacés par une nouvelle génération. En comptant les femmes et les enfants, on arrivera peut-être à plus de deux cent mille âmes. Cette multitude dut s’ajouter à la population déjà existante. Comment une telle agrégation s’est-elle opérée? Quelle part fut faite à ces étrangers dans la possession de la terre qui, avec les serfs, composait presque exclusivement la richesse de ces temps?
L’érudition de nos jours a facilité la solution de ce problème si longtemps agité entre les publicistes et les savants, et qui nous intéresse d’autant plus qu’il se lie étroitement à la question des origines de la Suisse romane et en particulier du comté de Gruyère.
Marius, évêque de Lausanne au VIme siècle, dit dans sa chronique, sous l’an 456, que cette année les Bourgondes /5/ occupèrent une partie de la Gaule et en partagèrent le territoire avec les sénateurs gallo-romains 1 .
Transplantés dans la partie de la Gaule qui comprenait entre autres l’Helvétie romane, et associés aux Romains, les Bourgondes vécurent d’abord sur les terres des indigènes sans qu’on leur en eût attribué une partie. Bientôt il fallut compter avec ces nouveaux hôtes, et en venir à un partage des terres de chaque domaine où ils avaient été cantonnés. Un tel partage était le meilleur moyen d’éviter un bouleversement, d’établir des rapports durables entre les Romains et les Bourgondes, et d’opérer à la longue la fusion des deux peuples. Ce serait une erreur de croire qu’on assigna certains cantons aux Bourgondes à l’exclusion des Romains, et que ceux-ci furent forcés d’abandonner les districts qu’ils avaient possédés jusqu’alors 2 . Le territoire occupé par les Gallo-romains et les Bourgondes fut divisé par lots, sortes. Il faut entendre par ces lots non-seulement des portions de terre, mais encore la population agricole, les serfs attachés à la glèbe. La loi Gombette est explicite à cet égard: « Le peuple bourgonde, dit-elle, reçoit les deux tiers des terres et le tiers des serfs 3 . »
Suivant l’auteur de l’Esprit des lois 4 , cette disposition s’expliquerait par le fait que la nation bourgonde, qui faisait paître ses troupeaux, avait besoin de beaucoup de terres et de peu de serfs. Selon d’autres écrivains, elle semblerait /6/ indiquer que, dans ce partage, la loi du plus fort fit pencher la balance du côté du vainqueur 1 .
Les Bourgondes s’établirent dans la Gaule non par droit de conquête, mais ensuite d’une cession que leur firent les Gallo-romains, en leur imposant entre autres obligations celle du service militaire.
Il ne s’agit donc ici ni d’une violente usurpation de barbares, ni de désordres, ni de communauté forcée de vainqueurs et de vaincus. Si le partage dont il est question n’eût été qu’un insolent caprice de conquérants, que signifieraient les rapports d’hospitalité entre les deux nations et la qualification d’hôte qui est donnée au Bourgonde et au Romain dans la loi de Gondebaud 2 ?
Toutefois, on ne saurait douter qu’il n’y ait eu souvent des collisions entre les indigènes et les étrangers. Nous croyons ne pas nous tromper en disant que le roi Gondebaud, ami de l’équité, protecteur des Gallo-romains, voulant régulariser le partage des terres entre les deux peuples, imita son beau-frère Théodoric, le célèbre chef et législateur des Ostrogoths; que tout en assurant à ses guerriers la part qui devait leur revenir dans la possession du territoire où ils s’étaient fixés, il intervint pour substituer l’ordre à la violence, et amener une transaction amiable par laquelle les Gallo-romains devaient céder aux Bourgondes les terres et les serfs qui leur étaient nécessaires. Si on considère que la population indigène, diminuée par des guerres sanglantes et par /7/ les ravages de l’invasion, était nécessairement peu nombreuse, et que les propriétés étaient concentrées dans un petit nombre de mains, on comprendra que ce partage, qui ne s’appliqua que dans certaines localités, ait pu s’effectuer sans causer le bouleversement et la désolation qu’il entraînerait de nos jours.
« 1 Il est singulier cependant que ce grand déplacement, même dans ces limites, avec ces tempéraments, n’ait pas amené plus de résistance et de collision. L’explication de ce fait peut se trouver dans l’examen attentif d’une circonstance particulière à cette époque. Le petit nombre de propriétaires fonciers avait introduit nécessairement dans toutes les provinces le système de la culture par colons, inquilini. Les colons payaient au maître une redevance annuelle; leur sort ne fut que très-peu changé par l’attribution faite aux chefs bourgondes des terres prises sur quelques patriciens romains, senatores. Le bouleversement fut donc moins réel qu’apparent; il se fit dans les titres de propriété plus que dans la terre même; chaque colon resta dans sa chaumière, continuant à travailler la même terre, seulement pour de nouveaux maîtres, ou plutôt pour de nouveaux hôtes, novis hospitibus 2 . »
Sur tout le territoire occupé par les Ostrogoths, les Visigoths et les Bourgondes, des lois furent faites pour maintenir strictement le partage primitif entre les Barbares et les Romains, et arrêter les invasions et les spoliations ultérieures 1 . Gondebaud assimila les Gallo-romains aux Bourgondes, sous le rapport de la dignité personnelle, et il donna à ces derniers des lois plus douces pour protéger les premiers: « Burgundionibus leges mitiores instituit ne Romanos opprimerent, » dit Grégoire de Tours.
Devenus étrangers au culte grossier de leurs pères, et convertis au christianisme peu de temps après leur entrée dans les Gaules, les Bourgondes subirent l’influence irrésistible de la doctrine évangélique. Elle amollit peu à peu la dure écorce des vieilles mœurs germaines et transforma les farouches païens en disciples soumis. Lorsqu’ils furent en possession des terres que les Romains ne pouvaient leur refuser, et que ceux-ci leur cédèrent avec d’autant plus d’empressement qu’ils pouvaient les opposer, au besoin, à des invasions d’autres nations, les nouveaux fidèles, loin d’asservir le peuple qui se les était associés, firent avec lui une transaction amiable. Ce n’est pas à dire que les Gallo-romains n’aient été en butte à aucune vexation. Quelque docile que fût le peuple bourgonde aux exhortations des ministres de la religion chrétienne, il dut conserver assez longtemps cet instinct de sauvage rudesse qui caractérisait les tribus de la Germanie. Les décrets de Gondebaud avaient pour but de protéger les indigènes, d’assurer l’ordre public et de faire respecter les propriétés. Les Bourgondes étaient intéressés à la défense et à la prospérité de leur nouvelle /9/ patrie: ils étaient d’ailleurs subjugués par la civilisation romaine. Il est permis de croire qu’à tout prendre ils vécurent en bonne intelligence avec les anciens habitants. Nous sommes confirmés dans cette opinion par le témoignage de Paul Orose, écrivain du Vme siècle, qui fait un bel éloge de cette nation. « Maintenant, dit-il, les Bourgondes sont chrétiens … Mêlés aux Gaulois, ils les traitent non en sujets, mais en frères dans le christianisme, menant au milieu d’eux une vie douce, innocente et tranquille 1 . »
A l’époque de la chute de l’empire romain d’occident et de l’invasion des Barbares, toutes les Gaules, jusqu’au Rhin, partant l’Helvétie conquise et colonisée par les Romains, se servaient de la langue latine. C’était la langue de la religion, des lois, de la guerre, des actes publics, des contrats. Les Romains, beaucoup moins nombreux que les Gaulois, leur imposèrent cependant la langue et les lois de Rome, parce qu’ils étaient supérieurs par l’intelligence et la civilisation.
Non-seulement les Bourgondes étaient moins nombreux que le peuple gaulois, au milieu duquel ils s’établirent; mais, relativement aux Gaulois et aux Helvètes transformés en Romains, ils n’étaient que des barbares. Incapables de renverser la civilisation récente qui venait d’être élevée dans les Gaules, et de substituer leurs mœurs et leur langage aux usages et à l’idiome que les Romains y avaient introduits, ils occupèrent le pays sans le transformer, ils reçurent la religion des prêtres gallo-romains 2 , ils adoptèrent la culture /10/ de la contrée qui devint pour eux une nouvelle patrie, et, perdant peu à peu la langue qu’ils avaient apportée, ils apprirent l’idiome populaire enté sur la langue latine qui s’altéra progressivement, et, à la longue, ils se confondirent dans le peuple plus nombreux et plus éclairé auquel ils avaient été agrégés 1 .
Cette transmutation des Bourgondes par les anciens habitants du pays s’accomplit sous la puissance de la civilisation romaine aidée par la prédication de l’Evangile.
L’idiome vulgaire du peuple qui s’associa les Bourgondes, idiome formé du latin corrompu, s’est conservé, sous des formes diverses, dans toutes les parties de l’Helvétie romane. Il est dans cette intéressante contrée une foule de noms de lieux, de rivières, d’usages même, qui révèlent une origine romaine, et qui servent à indiquer les localités où les Romains ont formé des établissements ou fondé des colonies.
Et non-seulement les Bourgondes n’abolirent point la langue du peuple indigène, mais ils respectèrent ses droits et la législation sous laquelle il avait vécu jusqu’alors 2 . Le code de Gondebaud, particulièrement destiné à résoudre les difficultés qui pouvaient naître entre les Gallo-romains et les Bourgondes, ce code qui demeura en vigueur sous les rois de race franke, s’est écarté à plusieurs égards des principes /11/ de l’ancien droit germanique. Il est composé en partie de décrets et d’ordonnances appropriés aux besoins des deux peuples et aux rapports qui s’étaient établis entre eux 1 .
L’esprit de l’Evangile, pénétrant les institutions et les lois des Barbares, dégagea leur ancien droit national des éléments païens dont il était entaché.
Les Bourgondes, quoique soumis à l’Evangile, ne se convertirent pas de sitôt aux arts de la civilisation, notamment à l’agriculture, le plus précieux de tous. S’il n’y avait eu que des Bourgondes pour cultiver la terre dont ils avaient pris possession, le pays n’aurait pas tardé à devenir sauvage et à se dépeupler.
Les Germains, passionnés pour la chasse et principalement pour la guerre, livrés en temps de paix à l’intempérance et à l’oisiveté, remettaient aux faibles de la famille, aux prisonniers, aux esclaves, les soins de la maison, des troupeaux et des champs 2 . Les mœurs des Germains de Grégoire de Tours ressemblent beaucoup à celles des Germains de Tacite. Conquérir et jouir, telle est en deux mots la vie de tout peuple barbare et guerrier. Dominé par son instinct naturel pour le pillage et la destruction, il n’a nul goût pour les travaux paisibles des champs. Comment se prêterait-il au pénible labeur des défrichements? Percer des forêts, combler des lacs ou dessécher des plaines marécageuses, mettre en valeur des terrains incultes, ouvrir des voies de communication, ce sont là des ouvrages qu’exécute une race de cultivateurs dès longtemps endurcis aux rudes travaux /12/ de la glèbe, ou bien un peuple que la Providence a doué d’une certaine prédilection pour les pays de montagnes, pour la culture des contrées alpestres. Mu par une heureuse impulsion, quelquefois par l’inexorable loi de la nécessité, le pâtre, le colon pénètre dans une région inconnue; il s’intéresse et s’attache à chaque lieu où il trouve du bois pour se chauffer, pour construire une cabane, de l’eau pour désaltérer sa famille et le troupeau qui la nourrit, de l’herbe pour l’entretien de son bétail. Heureux de sa découverte, il fonde une petite colonie dans ce lieu solitaire. L’espoir de retirer quelque fruit de sa peine l’encourage et lui fait entreprendre avec ardeur les travaux les plus fatigants. — Tel n’était pas l’homme du Nord. A la vérité, les tribus sédentaires se prêtèrent à la culture du bétail et des terres. On sait que les Germains se sont mis, dans certaines circonstances, à cultiver le sol qu’ils avaient envahi et dévasté; mais c’était une exception, et ils ne tardaient pas à retomber sous le joug de leurs mauvais penchants. D’ailleurs, à l’époque où les Barbares s’établirent dans la Gaule et dans l’Helvétie romane, rien ne les forçait d’user leurs corps et leurs bras à fertiliser les creux vallons et les versants des Alpes. Les Romains avaient pris soin de la culture des terres; leurs produits suffisaient à l’entretien des indigènes et de leurs hôtes. Bientôt les moines s’établirent dans les déserts et travaillèrent à défricher et féconder le sol. C’est à eux et aux colons gallo-romains que la Gruyère doit sa transformation en une fertile et riante contrée. Les Bourgondes, peuple mou, paresseux, sans énergie en temps de paix, ne furent assurément pas les premiers qui s’aventurèrent dans ce quartier. Avaient-ils quitté les marécages et les forêts de la Germanie, et parcouru la Gaule au milieu des périls, pour venir défricher un /13/ pays de montagnes, couvert de bois et de marais? Le partage qu’ils firent avec les Gallo-romains répond négativement à cette question.
La contrée alors déserte que traverse la Sarine, ne fut visitée et cultivée que plus tard, à la longue, soit que les terres et les pâturages des vallées basses ne fournissent plus à l’entretien des hommes et du bétail, soit qu’en effet une désolation des plaines de l’Helvétie occidentale par des hordes dévastatrices fit émigrer dans les montagnes plusieurs familles qui, chassées de leurs demeures, vinrent chercher à l’abri des rochers un refuge assuré contre les bandes qui suivaient les routes tracées par les Romains, et ravageaient le plat pays 1 . Toutefois les Alpes n’eurent pendant longtemps qu’une population flottante de pâtres qui, à l’approche de la mauvaise saison, redescendaient dans la plaine avec leurs troupeaux. Peu à peu il s’y fit des établissements réguliers et permanents, lorsque l’inégalité des fortunes commença à faire de rapides progrès, que la propriété, longtemps incertaine, mobile, passant de l’un à l’autre, tendit à se fixer dans les mêmes mains et à se régler, lorsque le fort opprima le faible et força le simple homme libre à rechercher la protection d’un homme puissant, la tutèle d’une église ou d’un monastère; ou bien lorsque le simple homme libre dut opter entre l’émigration et le recours à quelque riche propriétaire qui voulût bien lui céder, dans un lieu écarté, un coin de terre à la charge de cens et de rente. Ce dernier moyen lui offrait plus de chance de conserver une liberté mal assurée que s’il se fût établi dans la /14/ plaine populeuse avec les serfs des hommes puissants, qui tendaient à établir une aristocratie territoriale, et créaient cette organisation hiérarchique qui aboutit au régime féodal.
Telles furent les causes principales de la plupart des établissements et des colonies agricoles et pastorales dans les Alpes.
Nous verrons plus tard que la basse Gruyère fut d’abord habitée par des colons romans, et la partie haute par des Alamanni.
Unis aux Suèves, leurs voisins, les Alamanni avaient étendu leur domination de l’Alsace jusque dans les hautes régions de la Rhétie. Ils occupaient une partie considérable des vallées des Alpes, notamment les trois pays qu’on appela depuis les cantons primitifs, Lucerne, l’Oberland bernois, le Haut-Vallais et la partie du canton de Fribourg où leur idiome a prédominé jusqu’à notre temps. Ils se prêtèrent à la culture des terres et du bétail, forcés par la nécessité, et encouragés par l’exemple des religieux, qui se transportaient dans les lieux incultes, au milieu d’une population encore païenne, et là, missionnaires et laboureurs à la fois, accomplissaient leur double tâche avec autant de péril que de fatigue.
Les Alamanni et les Suèves donnèrent leur nom à l’Alamannie ou Souabe, qui se composait des pays que nous venons de nommer.
Les pays cédés aux Bourgondes formèrent, sous la suzeraineté de l’empire des Franks, un royaume qui subsista jusque vers le milieu du VIme siècle sous des princes bourgondes, dont le plus célèbre fut Gondebaud, l’auteur du code qui de lui prit le nom de « Lex Gondobada, » dont on a fait la Loi Gombette. Sa nièce Chlotechildis (Clotilde) épousa le roi frank Chlodovech (Clovis), et cette princesse, qui était /15/ chrétienne, disposa son mari à renoncer au paganisme. On sait par quelle circonstance ce prince fut amené à se faire baptiser.
Chlodovech ayant trouvé dans les Gaules les restes vigoureux de l’administration impériale, essaya de les faire servir à sa nouvelle situation: il conçut un projet que le génie de Charlemagne seul pouvait réaliser, nous voulons dire qu’il eut l’idée de l’unité territoriale, de la concentration de tous les pouvoirs. C’est pourquoi il voulut s’emparer des états de Gondebaud, dont le frère Godegisèle lui avait promis une partie. Il attaqua brusquement le roi bourgonde. Celui-ci fut battu, et il n’obtint la paix qu’en cédant au vainqueur les provinces qui lui avaient été promises 1 . Après la mort de Chlodovech, ses fils continuèrent la lutte que ce prince avait engagée contre la royauté bourgonde, et ayant mis en fuite le roi Godemar, ils s’emparèrent de ses états (534). Ainsi finit le premier royaume des Bourgondes 2 .
De même que les Franks enlevèrent aux Visigoths la plus grande partie de leurs possessions dans la Gaule, qu’ils conquirent la Provence et une portion de l’Italie, de même ils soumirent les pays de la Germanie jusqu’aux Alpes, partant la Suisse. Au VIme siècle, tout ce pays était sous leur domination.
Les Franks donnèrent d’abord des rois de leur race aux /16/ Bourgondes, puis ils leur imposèrent des chefs ou ducs nommés patrices. La patriciat était un office de la haute administration romaine. Le titre de patrice subsista en Bourgondie jusqu’à la fin de la race mérovingienne 1 et même au delà. Les Franks n’occupèrent point eux-mêmes les pays nouvellement soumis à leur empire. Ils se contentèrent de les administrer par des commissaires royaux, dont les charges ne tardèrent pas à devenir héréditaires. Ils laissèrent aux peuples vaincus le libre usage de leur idiome, leurs coutumes, leurs lois, et même aux plus dociles des officiers ou magistrats indigènes, se bornant à leur imposer des tributs et des troupes. Les Bourgondes prirent part aux expéditions guerrières de leurs nouveaux maîtres, mais en corps distincts, commandés par des chefs nationaux 2 .
Cependant la monarchie mérovingienne suivait mollement une pente fatale. L’empire croulait de toutes parts. Le désordre et la confusion régnaient en tout lieu à l’avénement de la seconde race. Celle-ci fit une révolution dont la nécessité de maintenir le pouvoir royal contre les usurpations des grands fut le principe. Le génie de Charlemagne arrêta le règne de la décadence et commença l’ère d’une régénération sociale. L’inégalité était partout, dans les personnes et dans les choses. Rien qui ne fût dégénéré, corrompu. Charlemagne rétablit l’ordre et anima d’une nouvelle vie les restes de la civilisation. Il accoutuma à vivre sous la loi commune des peuples qui n’avaient ni la même langue, ni les mêmes idées, ni les mêmes mœurs. Il sut maîtriser les ambitions particulières, imposer et maintenir l’obéissance /17/ dans son vaste empire, créer à tous ses sujets une communauté d’intérêts, faire fleurir les lettres, les arts et les sciences, faire prospérer le commerce, l’industrie et particulièrement l’agriculture 1 .
Avec les débris du monde ancien et des éléments nouveaux, cet homme extraordinaire construisit un immense empire. Il reconstitua le pouvoir central, créa une grande unité nationale, et consacra son siècle à l’admiration de la postérité 2 .
L’œuvre de Charlemagne n’a pas eu plus de durée que celle de Clovis et de Théodoric. La couronne est héréditaire, le génie est personnel. Charlemagne ne le transmit point à ses descendants. « A sa mort, la décomposition du vieux monde reprit sa marche et aboutit à la féodalité, c’est-à-dire à la décentralisation organisée, au morcellement du territoire et du pouvoir, à l’érection de petites souverainetés locales prenant la place de la grande souveraineté telle que Rome l’avait conçue, » que Clovis, et surtout Karl-le-Grand avaient eu la pensée de la réaliser.
L’histoire présente peu d’hommes qui eussent été plus propres que Louis Ier, à hâter, à provoquer en quelque sorte le déclin d’un grand empire. Le trait qui domine dans le caractère de Louis, c’est son attachement à l’Eglise, disposition qu’il avait héritée de son père; mais la foi fortifiait le caractère de Charlemagne, elle stimulait son énergie et lui inspirait de grandes choses; dans Louis, elle dégénérait en /18/ piétisme, ce qui n’est pas la vraie piété. Jouet de l’ambition du clergé, qui lui donna le nom de Pieux, il méritait avec plus de raison d’être appelé le Débonnaire, c’est-à-dire le faible et le dévot 1 . Les institutions de Charlemagne s’altérèrent promptement sous le règne de son fils. Etablis pour inspecter les provinces et surveiller l’administration des comtes, les envoyés du prince ou commissaires royaux (missi dominici) n’existèrent bientôt plus que de nom. Les comtes usurpèrent des droits et s’arrogèrent le pouvoir aux dépens de la royauté et au préjudice de la nation. Ils favorisèrent le développement de l’aristocratie territoriale, et tandis que, de leur côté, les prélats augmentaient leurs richesses et leur crédit, la misère du peuple faisait de rapides progrès.
« Louis le Débonnaire renversa de fond en comble l’édifice majestueux élevé par son père, il remit la division partout, dans les hommes comme dans le territoire, et rendit, par la faiblesse et l’inconstance de son esprit, par son manque de foi et de prudence, tout individuel et local, comme /19/ anciennement. La confusion devint générale, et le droit fut remis à la force 1 . »
Le vaste empire de Charlemagne se décomposa en corps nouveaux qui demandaient à être organisés. Ainsi se forma, en 879, de parties incohérentes, le royaume de Bourgogne cis-jurane, dont le premier roi fut Boson, beau-frère de Charles le Chauve, et environ dix ans plus tard, en 888, le royaume de Bourgogne transjurane, dont l’auteur fut Rodolphe, comte et marquis de cette province sous le règne de Charles le Gros 2 . Ce grand dignitaire de l’empereur, s’élevant au rang de souverain, se fit couronner à St.-Maurice en Vallais. Les deux royaumes de Bourgogne réunis, l’an 930, en un seul, dont la Suisse fit partie, passèrent aux descendants de Rodolphe II, à Conrad, son fils, et à Rodolphe III, son petit-fils. Celui-ci, n’ayant pas d’enfants, transmit ses états à Conrad II (le Salique), qui en prit possession en 1032.
Au milieu du XIme siècle se forma le duché ou Rectorat de la Bourgogne transjurane, entre le Jura et les Alpes, duché dont la partie bornée par l’Aar et la Reuss s’appelait la Bourgogne alamannique ou la Petite-Bourgogne, et la partie entre l’Aar et le Jura, le Comté de Bourgogne. Ce Rectorat fut administré par les comtes de Rheinfelden, qui furent également investis de la régence du pays situé de l’autre côté de la Reuss. Les Zæringen, héritiers des domaines allodiaux de la maison de Rheinfelden, ayant vainement disputé la dignité de duc de Souabe à Frédéric de /20/ Hohenstaufen, furent dédommagés de leur échec en obtenant de l’Empire une partie de l’Alamannie, savoir le vicariat impérial du pays enfermé par la Reuss et le Rhin.
Dès cette époque le nom de Souabe ne servit plus qu’à désigner le duché dont un prince de la maison de ce nom, Frédéric de Hohenstaufen, s’était établi le chef. Le nom d’Alamannie cessa d’être appliqué à la Suisse depuis que les ducs de Zæringen eurent obtenu le vicariat impérial du pays limité par la Reuss et le Rhin, pays qu’ils administrèrent conjointement avec le territoire baigné par l’Aar et la Reuss, et, de plus, avec la contrée située entre l’Aar et le Jura, c’est-à-dire avec le Comté de Bourgogne, qui comprenait entre autres le district qu’on nomma dans la suite le Comté de Gruyère.
Mais, si les noms d’Alamannie et de Souabe ne figurèrent plus comme dénomination politiques, cependant ils ne s’effacèrent pas de la mémoire du peuple. Ils vivent encore aujourd’hui dans le souvenir des deux races qui se touchent sur les confins des cantons de Berne et de Vaud. Ils leur rappellent l’origine des premiers défricheurs de cette contrée jadis sauvage et déserte, aujourd’hui si populeuse et si belle. Demandez, en sortant de Rougemont, le nom du quartier que vous allez traverser: on vous dira qu’on l’appelle aux Alamans. Plus loin, à quelques minutes de Gessenay, le campagnard complaisant vous indiquera une colline cultivée, au pied de laquelle coule le Kaufliesbach: elle est connue sous le nom de Schwabenried. Il est évident que ce quartier fut colonisé par ces hommes robustes auxquels on donnait indifféremment les noms d’Alamans ou de Suèves et de Souabes. Ces Germains, transplantés dans nos montagnes et convertis par les moines au christianisme et au plus précieux /21/ des arts de la civilisation, se prêtèrent à la culture des terres et à l’éducation du bétail.
« Il advint, dit une légende, que des pâtres romans, après avoir franchi le pas de la Tine et conduit leurs troupeaux en remontant le cours de la rivière (la Sarine), voulurent se frayer un passage à travers l’épaisse forêt, et qu’ils rencontrèrent des pâtres d’une autre langue. » — Cette tradition est confirmée, en ce qu’elle a d’essentiel, par la charte de fondation du prieuré de Rougemont. Ce précieux document de la seconde moitié du XIme siècle, ne laisse subsister aucune incertitude au sujet de la nation à laquelle appartenaient ces pâtres inconnus. Le fondateur de ladite église lui donne entre autres tout ce qu’il y a de dîmes au delà de l’un des deux ruisseaux ou Flendrus, « du côté qui touche la limite des Alamanni 1 . »
Quand bien même on n’aurait pas là-dessus des renseignements précis, on pourrait inférer des deux langues qui partagent la Gruyère, que la population y est entrée par les deux extrémités de la grande vallée; la partie haute, ou le pays de Gessenay, qui s’étend des sources de la Sarine au château du Vanel, parle allemand; la partie inférieure, du Vanel à Bulle, parle français, ou plutôt un patois dérivé du roman. Les premiers colons de la partie supérieure dûrent naturellement y arriver les uns du Vallais, par le pas du Sanetsch, les autres des bords du lac de Thoune, en remontant la Simmen et en traversant les monts qui séparent le Simmenthal du pays de Gessenay. Ceux de la basse Gruyère /22/ y vinrent de l’Helvétie romane, qui faisait partie de la Bourgogne transjurane 1 .
Anciennement comme aujourd’hui, celui des deux Flendrus ou torrents qui dans l’idiome allemand se nomme Griesbach, séparait les deux langues et les deux races à l’endroit qu’on appelle « aux fenils » (ad fines), où commence la vallée du Griesbach 2 ; mais les deux peuples étaient soumis au même maître. Toujours ils obéirent au même comte. Le Vanel, construit sur cette limite, dominait la contrée. Au pied du roc ou du mont que couronnent les ruines imposantes de ce château-fort, une borne indique l’immuable frontière de l’Oberland bernois et du Pays d’Enhaut roman 3 .
CHAPITRE II.
Fondation de l’église de Château-d’Œx et d’autres paroisses.
La conversion des Germains au christianisme est assurément le résultat le plus considérable des grandes émigrations qui ont eu lieu du IIIme au VIme siècle.
Déjà à cette époque reculée il existait dans plusieurs contrées de la Gaule et de la Germanie des institutions ecclésiastiques, des siéges épiscopaux fondés par les Romains. Les uns, échappant aux désastres de l’invasion, eurent une suite non-interrompue d’évêques et de prêtres; d’autres, détruits par les hordes envahissantes, furent rétablis lorsque la doctrine de l’Evangile eut dompté les cœurs des farouches conquérants; d’autres encore furent institués par les nouveaux habitants convertis à la foi chrétienne.
Des moines d’Irlande, un Colomban, un Gallus, entreprirent des voyages longs et périlleux pour amener dans la bergerie du Seigneur ce qu’il y avait encore de brebis égarées dans la Gaule et la Germanie. Ces saints hommes, prédicateurs de la parole divine et instituteurs de peuples /24/ ignorants et grossiers, élevèrent des chapelles, des églises, des monastères, et jetèrent dans des régions sauvages les fondements de la civilisation. Ces nouvelles institutions ne tardèrent pas à devenir l’objet de la sollicitude et de la munificence des rois franks et bourgondes, qui, mus par un instinct de progrès, et initiés aux mystères du salut, secondèrent l’œuvre des pieux missionnaires.
Ces fidèles apôtres de Christ, associant l’agriculture à la prédication, pénétraient dans les déserts en défrichant le sol, et construisaient pour chaque colonie de pâtres et de laboureurs, un petit temple où elle pût s’acquitter de ses devoirs religieux.
Depuis la colonisation du Pays-d’Enhaut, le premier événement remarquable qui ait eu lieu dans cette contrée est la fondation de l’église de Château-d’Œx, bienfait que l’opinion vulgaire attribue à St.-Donat, fils de Vandelène 1 , duc ou patrice de la Bourgogne transjurane, et de Flavie, sa femme, qui, romaine d’origine et née dans le paganisme, s’était convertie à l’Evangile. Né à Orbe, St.-Donat, disciple de Colomban, fut élevé par son mérite à la dignité d’archevêque de Besançon, en 625; il mourut en 652.
Comme toute tradition tend à se développer et revêt de nouveaux ornements, celle dont le héros est St.-Donat prétend que cet homme de Dieu administra pendant quelques années l’évêché de Lausanne, que ce fut alors qu’il introduisit le christianisme dans les Alpes occidentales, qu’il s’y transporta lui-même et fit bâtir l’église qui a porté son nom; que cette église conserva longtemps la statue en bois de son patron, avec celle de Colomban, qui l’avait secondé /25/ dans cette œuvre apostolique; et pour dissiper toute espèce de doute à cet égard, la foi populaire ajoute à ce récit que le rocher sur lequel on croit que fût bâtie l’église primitive de Château-d’Œx a perpétué le souvenir du missionnaire irlandais, en conservant dans les mots patois lo sè colomb le non altéré de Saxum Columbani.
Le spirituel auteur du Conservateur suisse a propagé cette tradition dans sa belle patrie 1 . Vingt ans plus tard, il avait modifié son opinion. Quoique passionné encore pour les légendes, les fables pieuses et les poésies populaires, le patriarche de Montreux ne laissait pas de les soumettre quelquefois à la critique. Lorsqu’il entreprit l’histoire des comtes de Gruyère, il conçut des doutes sur l’authenticité de la tradition que le charme de son style avait accréditée. Il ne crut plus pouvoir attribuer à l’église de Château-d’Œx une si haute antiquité, « Ne serait-ce point anticiper », dit-il, « que de fixer au septième siècle l’introduction du christianisme dans cette partie des Alpes, qui ne portait pas encore le nom de Gruyères? Ces montagnes, séparées du reste du monde par une barrière de rochers escarpés: ces longs défilés, où serpentait à peine quelque sentier étroit et périlleux, connu des seuls naturels du pays; ces profondes vallées à moitié couvertes de marais sans écoulement et de forêts ténébreuses, qui servaient de retraite aux loups, aux lynx et aux ours … toutes ces causes rendaient aussi rares que difficiles les communications avec les habitants des contrées inférieures, dont les doctrines /26/ ne purent pénétrer qu’assez tard chez cette peuplade à demi-sauvage 1 . »
La construction de l’église de Château-d’Œx, au VIIe siècle, supposerait l’existence d’une population assez considérable à cette époque, dans la vallée qui se prolonge du pas de la Tine jusqu’au Vanel. Mais nous verrons bientôt que cette contrée était encore inculte. Il est même probable que le sol de la basse Gruyère ne fut pas défriché avant le VIIIe siècle. Il faut descendre jusqu’au IXe avant de trouver un acte qui mentionne, outre quelque petits villages ou hameaux, une église paroissiale dans cette partie du comté; la plus ancienne est celle de Bulle 2 . Il est donc permis de croire que le Pays-d’Enhaut ne fut ni peuplé ni cultivé aussitôt qu’on le pense communément.
Comme l’église dite de Château-d’Œx fut sans contredit la plus ancienne de ce district, c’est indubitablement dans la vallée où elle fut bâtie que se forma le premier établissement colonaire du Pays-d’Enhaut. Le seigneur de ce quartier le choisit pour centre de son domaine ou de son petit empire, à cause du rocher qui domine la vallée, et sur ce rocher, dont l’église actuelle couronne le sommet, il fit construire une tour de défense et d’observation. Cette tour, « turris, » portait aussi le nom de Castrum in Ogo (c’est-à-dire du Pays-d’Enhaut) d’où est venu le nom de Château-d’Œx. Sur l'emplacement qu’occupe aujourd’hui ce bourg se trouva dans l’origine une villa, c’est-à-dire une terre avec des habitations plus ou moins rapprochées, plus ou /27/ moins nombreuses, formant un village qui, avec son territoire dépendait du château, ou du fonds principal du seigneur (hoba indominicata): cette villa, dotée d’une église, forma une paroisse rurale. Circonstance remarquable! un lieu qui semble être une dépendance du bourg, s’appelle à l’heure qu’il est villa d’Œx; il a conservé le souvenir de l’établissement primitif dans la vallée d’Ogo, soit du Pays-d’Enhaut, laquelle paraît au XIe siècle sous le nom de vallis de Oyx et d’Oix, dans la charte de fondation du prieuré de Rougemont.
La villa d’Œx fut donc le centre de l’établissement des seigneurs d’Ogo, ou comtes de Gruyère. C’est de là qu’ils agrandirent leur domaine par des défrichements successifs et par les colonies de vassaux qu’ils établirent peu à peu dans les vallons qu’arrosent la Sarine et ses affluents. La construction de chapelles et d’églises à des époques diverses annonce que la colonisation des hautes vallées fut lente et progressive, que la civilisation, fruit de l’agriculture et de la religion, n’y pénétra qu’à la longue et par degrés; que les pâtres et les colons parvinrent difficilement à dessécher les marais, à éclaircir les bois, à conquérir un sol labourable sur une nature sauvage, et à convertir ces tristes solitudes en riantes campagnes. Ce que nous disons n’est point une simple conjecture. Le quartier où s’éleva au XIe siècle l’église de St.-Nicolas de Rougemont, est appelé dans l’acte de fondation de ce temple un désert, heremus: il n’y avait qu’un seul homme ou chef de famille, apparemment un pâtre.
Comment supposer, d’après cela, que l’église de Château-d’Œx date en effet du VIIe siècle?
Il importe de bien étudier ce point d’histoire nationale /28/ parce qu’il se lie étroitement à la question des premiers établissements dans les Alpes occidentales, et en particulier à celle des origines du comté de Gruyère.
La légende qui fait de St.-Donat le fondateur de l’église dont il ne fut que le patron, paraît avoir sa source dans un passage de la Vie de Colomban, par le moine Jonas, son disciple. Il est démontré que ce passage, qui fut altéré peut-être ou mal appliqué par une mémoire infidèle, se rapporte à la nouvelle fondation du monastère de Romainmotier, au pied du Jura, par le patrice Ramnelène, frère de St.-Donat, qui s’acquitta de cette œuvre pieuse en mémoire de Saint-Colomban 1 .
Nous avons dit que le rocher qui soutient aujourd’hui l’église dont la fondation est faussement attribuée à St.-Donat, était anciennement couronnée d’un château. Cette maison-forte passe pour avoir été détruite dans une guerre privée du moyen-âge. Sur ses ruines s’éleva le temple auquel une vieille tour sert de clocher. Voici comme cet événement, dont le souvenir se transmit de père en fils, est raconté par les prudhommes de Château-d’Œx, dans un acte de 1438, où ils exposent au curé nouvellement élu l’origine et les franchises de leur église:
« Nous avons appris de nos pères qu’autrefois notre église paroissiale était au lieu dit le Chanoz, et que le château de notre seigneur, le comte de Gruyère, était alors sur le mont dit la Motte, où est maintenant notre église. Or, en ce temps-là, il y avait grande guerre et contestation entre notre seigneur le comte de Gruyère /29/ et le seigneur de Corbières. Cette guerre ayant duré quelque temps, ils s’accordèrent enfin et arrangèrent l’affaire comme il suit, savoir que notre seigneur le comte de Gruyère démolirait la tour (turrim) qu’il avait sur la Motte, et des pierres de ladite tour édifierait l’église de St.-Donat, qui existe maintenant, et donnerait la Motte avec ses dépendances, ainsi que les libertés et franchises de ladite église, au curé, pour lui, ses successeurs et les habitants … Tant que l’église fut au lieu dit le Chanoz, le curé de ce lieu s’appela curé d’Oyes (d’Œx), mais depuis sa transformation sur la Motte, le curé se nomma curé de Château-d’Oyes, et la villa attenante à la Motte ayant été donnée au curé, fut dès lors appelée villa de l’Eglise, nom qu’elle a conservé. … »
La vérité de ce récit fut attestée par des hommes notables et dignes de foi, est-il dit à la fin de l’acte intéressant dont nous venons de traduire la partie essentielle.
Il résulte de la relation qu’on vient de lire que l’église primitive du Pays-d’Enhaut fut construite non sur le rocher tapissé de verdure et boisé qu’on appelle la Motte, mais au lieu dit lo Chanoz ou le Chêne, sur une petite colline à quelques minutes du château, où est le hameau qu’on nomme la Frasse, et que jusqu’à l’époque où le château d’Ogo fut métamorphosé en un temple auquel l’antique beffroi sert de clocher, elle porta le nom d’Eglise d’Œx 1 . C’est ainsi qu’elle est appelée au XIe siècle (dans l’acte de fondation du prieuré de Rougemont), et à la fin du XIIIe, dans les « Extentes » ou rôles-censiers de Château-d’Œx, qui n’ont /30/ pas été consultés jusqu’ici, et qui méritaient de l’être, car ils offrent quelques détails précieux, et confirment ce qui a été dit ci-dessus de la position et du nom de la plus ancienne église des Alpes occidentales 1 .
De ces divers renseignements nous concluons, d’une part, que la fondation de l’église actuelle de Château-d’Œx remonte à peine au delà du XIVe siècle 2 ; de l’autre, que l’église d’Œx existait au XIe et que vers la fin de ce siècle elle était la seule église paroissiale qu’il y eût dans le Pays-d’Enhaut. Elle avait alors des dîmes et des revenus dans les environs, preuve qu’à cette époque la vallée d’Œx était habitée et que la culture des terres et l’éducation du bétail y avaient déjà fait des progrès.
La fondation de l’église d’Œx fait supposer un accroissement de la population d’alentour, ainsi que le désir de poursuivre l’œuvre de la civilisation. Ces deux circonstances concoururent à la construction d’un nouvel édifice consacré à la religion. L’église paroissiale dédiée à St.-Donat, laquelle comprenait les laboureurs et les pâtres du val d’Ogo, fut la mère de l’église de St.-Nicolas de Rougemont, qui comprit à son tour les paysans d’un autre quartier, et donna naissance à celle de Gessenay.
Partout où s’établissait une corporation religieuse, où s’élevait une chapelle, une église, un monastère, il y avait nouveau défrichement, nouvelle culture, nouvelle vie. /31/
Les sons redoublés de la hache et de la pioche, les cris du bétail animaient tour à tour la contrée où durant des siècles avait régné le silence du désert. Celui-ci construisait une habitation, l’entourait d’un enclos, soignait sa chenevière; un autre labourait ses novales, fécondait ses guérêts, ou menait paître un troupeau. A certains jours, à certaines heures, pâtres et laboureurs se réunissaient en un lieu saint pour célébrer ensemble les louanges de l’Eternel. Si on en croit la tradition, ce peuple, bien que soumis à la loi du servage, passait une vie paisible et champêtre, que ne venaient troubler ni le tableau affligeant de la misère, ni l’aspect des richesses qui excitent l’envie.
Au delà du Vanel et à l’autour étaient les Alamans. A cette race appartenaient les premiers défricheurs des contrées que baignent le lac de Thoune, la Simmen et la Kander, ainsi que les premiers colons et les premiers pâtres de la partie orientale du comté de Gruyère. Mais la date présumée de certaines fondations religieuses dans l’Oberland bernois, en donnant une opinion trop avantageuse du progrès de la culture des terres dans cette partie de la Suisse, ferait conclure à un défrichement précoce du territoire situé entre l’Aar et la Sarine. En effet, si on consulte la tradition ou le rapport fabuleux de quelque chronique, les églises de Spiez et de St.-Béat, au lac de Thoune, auraient été fondées en 662; celle de Scherzligen en 763. L’église qui passe pour la plus ancienne de la contrée est l’église d’Einigen, dont la tradition fait remonter l’origine au delà du VIIe siècle. Le chroniqueur Anshelm et, après lui, plusieurs historiens ont attribué la fondation de l’église d’Amsoldingen à la reine Berthe, femme de Rodolphe II, roi de la Bourgogne /32/ transjurane, qui l’aurait consacrée en 933. Le roi, son époux, aurait annexé à l’antique église d’Einigen douze églises filiales, dont voici les noms: Frutigen, Leuxingen, Eschi, Wimmis, Uttigen, Thierachern, Scherzligen, Thun, Hilterfingen, Sigriswyl, Amsoldingen et Spiez 1 . Suivant une légende rapportée par Gruner, chaque année avant la Réformation, à certains jours, une voix faisait entendre, dans l’église de Könitz, ces mots: « Nous célébrons l’anniversaire du roi Rodolphe et de la reine Berthe, fondateurs de cette église. 2 »
Ce n’est pas sans raison que, de nos jours, on a révoqué en doute l’authenticité de ces relations, qui, loin d’être appuyées de preuves positives, semblent devoir leur naissance à la supposition gratuite que l’Oberland bernois fut le berceau des souverains du second royaume de Bourgogne 3 .
L’église de St.-Etienne, dans le Haut-Simmenthal, date peut-être de l’an 1040. Environ quarante ans plus tard, celle de Rüggisberg venait d’être fondée. Le monastère d’Inlerlaken et l’église voisine de G’steig sont cités dès le XIIe siècle, et le prieuré de Daerstetten dès la première moitié du siècle suivant. Admettons que ces dates permettent d’attribuer à ces églises une origine moins moderne, nous ne sommes cependant nullement autorisés à les croire aussi anciennes que plusieurs écrivains l’ont pensé. Tout /33/ annonce, au contraire, que les bords du lac de Thoune ne furent pas défrichés aussi tôt qu’on l’a dit. La culture s’avança plus lentement encore vers les montagnes. Sur la fin du XIe siècle, la contrée du Montcuchin (Guggisberg) était un désert. Ce fut alors seulement qu’on se mit à la défricher.
Le Cartulaire du chapitre de Lausanne mentionne comme paroisses qui, en 1228, faisaient partie du doyenné d’Ogo, les églises de Bellegarde et de Gessenay 1 . A cette époque l’église de G’steig ou du Châtelet et celle de Lauenen n’existaient pas: elles ne furent fondées que beaucoup plus tard. Dans la première moitié du XIIIe siècle, les doyennés d’Ogo et de Berne comprenaient l’un vingt-huit, l’autre vingt-neuf paroisses; d’où nous inférons qu’à cette époque, non-seulement la Basse-Gruyère, mais tout le pays entre l’Aar et la Sarine était défriché et peuplé. /34/
En ce temps-là le comté de Gruyère comptait plusieurs églises paroissiales, dont les plus anciennes furent: dans la Haute-Gruyère, celles de Château-d’Œx, de Rougemont et de Gessenay; dans la Basse-Gruyère, celles d’Albeuve, de Broc et de Bulle. La paroisse de Bulle est la plus ancienne de la Gruyère.
Les autres églises de ce pays sont mentionnées dans la partie de notre ouvrage qui a pour objet la topographie du comté de Gruyère.
CHAPITRE III.
Les Châteaux.
Tandis que la piété consacrait des chapelles et des églises, que la civilisation naissante trouvait un asile dans les cloîtres, la terreur, la guerre et l’ambition bâtissaient des maisons fortes. — Les tours et les châteaux ne sont point une invention due à l’art militaire des Germains. Bien avant les invasions des Barbares, la Gaule et l’Helvétie étaient munies de forts (turres, castra, castella). Les Romains en avaient construit dans les provinces conquises, afin de tenir dans la soumission les peuples qu’ils avaient subjugués par les armes, ou par la politique. Lorsque les peuplades germaines s’ébranlèrent pour envahir l’empire d’occident, les Romains élevèrent de nouvelles forteresses, afin de ralentir la marche de ces redoutables ennemis. Tel fort gardait l’entrée d’un défilé, tel autre défendait le passage d’une rivière ou barrait un chemin. Dans plusieurs contrées, on voyait une ligne de fortifications, une suite de tours d’observation, de défense ou d’agression, d’où les gardes attentives communiquaient entre elles, et, au moyen de signaux, annonçaient l’approche d’une horde envahissante, ou quelque autre événement, et appelaient à leur poste les hommes armés pour la défense /36/ du pays. Ces forts, construits pour la plupart le long des voies militaires des Romains, furent occupés par les conquérants venus du Nord. Il est assez probable que sous la domination des Franks, toute habitation où s’établit un comte était une maison forte. La prudence voulait qu’il en fût ainsi. Les chefs des Alamanni et ceux des Bourgondes s’établirent de même dans des châteaux anciens, ou firent restaurer ceux qui tombaient en ruine. D’autres furent élevés dans des quartiers abandonnés jusqu’alors et nouvellement défrichés 1 .
Ce serait toutefois une erreur de croire que les Germains transplantés dans la Gaule allèrent aussitôt chercher les montagnes, les lieux escarpés et sauvages pour s’y construire des demeures avec des tours et des remparts. Etablis sur les domaines que les anciens maîtres avaient dû leur céder ou partager avec eux, ils occupèrent d’abord de préférence les villæ, espèce de métairies, grands bâtiments servant à l’exploitation des terres et à la demeure des colons et des esclaves qui les cultivaient. La situation de ces édifices était plus conforme aux habitudes nationales des Germains. Les invasions continuant, le désordre et le pillage se renouvelant sans cesse, les habitants des campagnes, anciens ou nouveaux venus, sentirent le besoin de se garder et de se tenir constamment sur la défensive. On vit les villæ s’entourer peu à peu de fossés, de remparts de terre, de quelques apparences de fortifications. Plusieurs châteaux du moyen-âge ne sont point situés dans des lieux escarpés, /37/ lointains, mais au milieu de riches plaines, dans les vallées, sur l’emplacement que des villæ occupaient sans doute auparavant: plus d’une villa gallo-romaine, en se fortifiant et après bien des vicissitudes, a fini par se métamorphoser en château 1 .
D’autres forts s’élevèrent soit au milieu des cités, soit sur les débris d’anciens camps romains, castra. Au reste, dans les basses régions comme dans les contrées élevées, la féodalité se fortifiait sur tous les points où elle pouvait prendre une position à son avantage.
On attribue volontiers à l’effroi qu’inspirèrent au Xe siècle les bandes sauvages des Magyares, la construction d’une quantité de tours et de châteaux suisses. Les populations épouvantées, quittant subitement la plaine que ravageaient les Barbares en suivant les routes tracées par les Romains, se réfugièrent, dit-on, dans les lieux déserts, cherchèrent un asile dans les montagnes, et s’y retranchèrent. Ce qui est plus certain, c’est que les châteaux qui ont couvert le sol de l’Europe, et dont les ruines y sont encore éparses, ont été construits par la féodalité. « Leur élévation a été, pour ainsi dire, la déclaration de son triomphe 2 . » Ce fut surtout pendant l’anarchie qui suivit le règne vigoureux de Charlemagne qu’on vit s’élever une multitude de tours et de châteaux. La plupart durent leur origine au besoin qu’eurent les possesseurs de bénéfices de pourvoir à leur sûreté personnelle, de protéger et de défendre leurs propriétés contre les incursions de bandes guerrières, ou /38/ contre les attaques de leurs voisins. Bientôt les lieux d’abri devinrent des lieux d’offense. Dans ces temps de désordre et de confusion, des chevaliers ou cavaliers de guerre, hommes intrépides, désireux d’aventures, avides de butin, impatients de repos, s’élançaient à chaque instant de ces châteaux construits au sommet des collines, sur le penchant de montagnes escarpées, hérissées de rochers, sillonnées de ravins et de précipices, pour dépouiller les marchands, rançonner les voyageurs, ravager la campagne, piller les monastères, répandre dans la plaine la terreur et la misère, et laisser partout des traces de leur violence. Déjà au IXe siècle on voit le territoire se couvrir de ces repaires; ils devinrent bientôt si nombreux, les calamités qu’entraînaient les guerres privées et locales, le goût du pillage et les vexations des chevaliers et des seigneurs, causèrent de si cruelles alarmes, que Charles le Chauve, dans l’intérêt de l’ordre public comme de son autorité, crut devoir tenter de détruire ces retraites d’aventuriers et de petits despotes. On lit dans les capitulaires rédigés à Pistes, en 864:
« Nous voulons et ordonnons expressément que quiconque, dans ces derniers temps, aura fait construire, sans notre aveu, des châteaux, des fortifications et des haies, les fasse entièrement démolir d’ici aux calendes d’août; attendu que les voisins et habitants des environs ont à souffrir de là beaucoup de gênes et de déprédations. Et si quelques-uns se refusent à démolir ces travaux, que les comtes, dans les comtés desquels ils ont été construits, les fassent démolir eux-mêmes 1 . /39/
L’injonction était précise, mais Charles le Chauve était incapable de faire exécuter ses ordres. Le capitulaire de Pistes, témoignage irrécusable du prompt déclin de la monarchie carolingienne, de la détresse et de l’impuissance de la royauté, n’eut d’autre effet que celui d’enhardir les ambitions, et d’augmenter le désordre, qui bientôt fut universel. Le roi Charles terminait son ordonnance en disant que si les comtes négligeaient de lui obéir, il les manderait auprès de lui, et établirait dans leurs comtés des hommes qui eussent la volonté et le pouvoir de faire exécuter ses ordres. Vaine menace! Les comtes, non moins ambitieux, non moins indociles que les autres officiers royaux et les possesseurs de fiefs, tendaient à s’établir maîtres dans leurs comtés, à exercer à leur profit, en leur propre nom, le pouvoir dans l’étendue de leurs juridictions. Les grands dignitaires ne songeaient qu’à s’emparer des membres d’un empire qui se décomposait, et à se constituer souverains indépendants. C’est au IXe siècle, nous l’avons vu, que se formèrent, entre autres nouveaux Etats, les deux royaumes de Bourgogne.
Le nombre des châteaux, loin de diminuer, s’accrut avec une prodigieuse rapidité. Nulle puissance humaine ne pouvait /40/ enchaîner l’ardeur chevaleresque des seigneurs, ni dompter l’ambition des possesseurs de fiefs. La lutte était engagée entre les grands feudataires et le chef de l’Empire, entre les vassaux et leurs suzerains, entre les possesseurs de fiefs eux-mêmes, entre les barons et les habitants des villes et des campagnes, entre l’esprit féodal et l’esprit de la vieille ghilde qui puisait une nouvelle énergie dans le christianisme. Cette lutte terrible se prolongea pendant quelques siècles. La guerre était en tout lieu, dans tous les rangs de la société. Noble ou roturier, on naissait l’homme de quelqu’un, et comme aucun lien n’unissait les hommes à un centre commun, que personne ne voulait reconnaître un plus puissant que soi, tout, dans cette épouvantable anarchie, était remis à la force. Cependant les invasions n’avaient pas cessé: aux anciennes bandes de barbares succédèrent des bandes nouvelles. Ce fut le temps des châteaux, des tours et des fortifications de tout genre, le temps où chacun, afin de pourvoir à sa sûreté, de mettre à couvert sa famille, son bien ou les fruits de son brigandage, de repousser les vengeances de ses adversaires, ou de résister aux magistrats qui essayaient de maintenir quelque ordre dans le pays, se cantonna et se retrancha du mieux qu’il put. La guerre étant partout à cette époque, partout devaient être aussi les monuments de la guerre, les moyens de la faire et de la repousser. Les seigneurs et les prélats, obligés de demander leur salut et leur force au territoire, occupèrent les lieux de difficile accès, y construisirent des tours, des maisons défensives, des châteaux forts. On éleva des remparts autour des églises, on creusa des fossés autour des monastères. Le territoire fut bientôt hérissé de manoirs et de repaires féodaux. Les habitants des villes firent /41/ comme les seigneurs et les chevaliers. Sans cesse menacés, ils se fortifièrent et se gardèrent assidument. Partout la société faisait le guêt et se tenait, pour ainsi dire, en embuscade 1 .
C’est à l’époque de la fondation des petites souverainetés locales formées des débris de l’empire carolingien, à l’époque de l’établissement du régime féodal, qu’il convient de rapporter la construction de la plupart des tours et des châteaux forts qui couvrirent le territoire roman, et en particulier le sol de la Gruyère. Il est assez probable qu’à la fin du XIe siècle, au plus tard, chacun des sires de la maison de Gruyère avait pris sa place et son poste, et défendait sa seigneurie. Au centre du comté, la Tour d’Ogo couronnait la Motte. A deux lieues de là, sur les confins du pays roman et de l’Alamannie, le Vanel, bâti sur un rocher au-dessus de la jonction de deux torrents impétueux, gardait un passage étroit et dominait la contrée. A l’ouest, en deçà du défilé de la Tine, dans la Basse-Gruyère, fut construit sur une haute colline le manoir des comtes de Gruyère: la Tour de Trême et la Maison de Broch lui servaient d’avant-postes. Le premier de ces deux forts fermait l’entrée de la Basse-Gruyère du côté de Bulle, le second gardait le passage de la Sarine du côté de Corbières. Au-dessus de Broch, près du confluent de la Jogne et de la Sarine, s’élevait, sur un affreux précipice, le château de Montsalvens; il barrait le chemin de Charmey et menaçait de dangereux voisins. Les seigneurs de la noble maison de Gruyère avaient eu soin d’occuper des postes pour ainsi dire inaccessibles, d’où ils commandaient tout le pays. Il est assez probable que le /42/ comte, supérieur féodal, occupa d’abord le château de la vallée d’Ogo, situé au centre du pays, et que dans la suite il transféra son siége à Gruyère.
Les châteaux de la Gruyère, comme tous ceux qui furent construits à la même époque, répondaient aux besoins d’un siècle de guerre et de barbarie. Ces forts n’étaient souvent qu’une énorme tour, ronde ou carrée, ou un assemblage informe de murs épais, hérissés de tourelles, percés de meurtrières, entourés de fossés profonds, ou bordés de torrents et de précipices, destinés à braver la fureur des guerres ou le courroux de la tempête. « Toute idée d’art ou de commodité était étrangère à leur construction; ils n’avaient aucun caractère de monument, aucun but d’agrément. La défense, la sûreté, telle était l’unique pensée qui s’y manifestait. On choisissait les lieux les plus escarpés, les plus sauvages; et là, selon les accidents du terrain, la construction s’élevait, uniquement destinée à bien repousser les attaques, à bien enfermer ses habitants 1 . » Ces bâtiments avaient tous le même caractère; c’étaient des repaires ou des asiles, des lieux de refuge ou des lieux d’offense.
CHAPITRE IV.
Origine des comtes et du comté de Gruyère.—
Recherches sur l’Ogo.
I.
Il n’est peut-être aucun peuple dont l’histoire primitive ne soit entourée du prestige de la poésie, et enveloppée d’un voile mystérieux que l’esprit le plus sagace ne saurait entièrement pénétrer. Il n’en est, pour ainsi dire, aucun dont l’établissement ou l’organisation première ne s’enfonce dans la nuit des siècles, et n’ait sa racine à une époque insaisissable même pour l’érudition de nos jours. La fiction s’est partout introduite dans l’histoire. Les chroniqueurs, dans leur partialité naïve, ont recueilli avec soin les menteries patriotiques qui circulaient dans leur temps. Ils ont adopté de bonne foi l’extraordinaire et le merveilleux, tout ce qui pouvait faire impression sur les esprits ou flatter l’orgueil national. Ils ont puisé une foule de récits dans les poésies populaires. Les peuples, séduits par les illusions de la vanité humaine, ont attribué l’origine des villes, des cités, des empires à des êtres fabuleux; ils ont personnifié leur propre nom, et se sont représenté dans cette personnification un illustre guerrier, un héros, un dieu. Erreur commune /44/ aux peuples modernes et à ceux de l’antiquité. Dans l’opinion vulgaire, les Hellènes prenaient leur origine et leur nom d’un fils de Deucalion et de Pyrrha; Italus était père de la race italienne; les Celtes ou Galates descendaient de Galatès, fils d’Hercule; les Teutons de Teut, les Francs de Francus, fils de Priam.
Mais il n’est pas besoin de chercher des exemples loin de nous. Suivant la tradition, un dieu ou demi-dieu Barus, inconnu dans la mythologie, serait l’auteur de Montbary 1 . La Chronique apocryphe du pays de Vaud nous dit qu’Yverdun, Eburodunum, doit son origine à « Ebrodunus, capitaine et chef de la septiesme partie et compagnie des Vandales, Viflisburg (Avenches) à un héros nommé Vivilo, que la terre de Neufchastel fut inféodée au VIe siècle à Neuphus par Alchisedech, premier roi dit de Bourgogne. » Une légende attribue la construction d’Estavayé-le-lac, Staviacum ad lacum, à un personnage nommé Stavius, prétendu chef d’une horde de Vandales, qui l’aurait bâti en 512. Et quant à la Gruyère, c’était, dans un temps, une opinion généralement accréditée, que le château et la ville de ce nom furent fondés par Gruérius, capitaine de la sixième légion des Vandales, qui choisit cet endroit pour y faire sa résidence, en 436. On cite même un Gruérius II ou III, auquel le roi de Bourgogne aurait inféodé la terre ou le pays de Gruyère, en 510.
Autour de ces héros imaginaires sont venus, suivant l’antique usage, se grouper des traditions historiques et des fables, qui composent une espèce d’épopée, un mélange de vérités et de fictions qu’il n’est point facile de discerner. Il /45/ convient toutefois de faire un effort, car le plus souvent il y a un fond de vérité dans les récits qui ont passé de père en fils. La tradition reflète l’image d’êtres réels ou supposés, dont chacun représente un principe, une situation, un fait que le temps a plus ou moins altéré.
Nos observations sur l’établissement des Bourgondes dans la Gaule, sur le défrichement et la culture du pays qui reçut un jour le nom de Gruyère, ont fait pressentir la fausseté des récits qui attribuent au peuple de Gundioch et de Gondebaud l’occupation de cette contrée qui était alors couverte de bois, de marais, stérile et inhabitée.
Nous avons essayé de montrer comment et à quelle époque des religieux et des cultivateurs travaillèrent à défricher et à féconder le sol de ce désert. Abordons maintenant la question de l’origine du nom de Gruyère et des comtes qui l’ont porté.
Les traditions de l’Helvétie romane ont gardé le souvenir de l’établissement de bandes vandales ou bourgondes dans cette partie de la Gaule 1 . De là on a conclu que la région autrefois inhospitalière qu’arrose la Sarine échut à quelque chef de cette tribu, et qu’il s’y établit avec sa bande « Il serait possible, dit l’auteur anonyme d’une histoire des comtes de Gruyère 2 , que suivant l’usage des peuples germains, ce chef, que la légende nomme Gruérius, eût porté sur son casque ou sur son bouclier, ou que sa bande eût porté sur sa bannière une grue, symbole d’un peuple errant, et que l’un et l’autre en eussent pris le nom 3 . » Mais cette /46/ hypothèse ne s’accorde guère avec la tradition qui dit que « tel était l’amour de la liberté chez les Bourgondes, qu’ils avaient peint un chat sur leurs enseignes pour la figurer 1 .» On sait que les armes de Gruyère étaient la grue sur champ de gueule. Cette circonstance aura donné lieu à la conjecture de l’auteur inconnu dont nous venons de rapporter les paroles 2 .
L’opinion de cet écrivain n’est point fondée; non-seulement elle ne se peut appuyer d’aucune preuve positive, mais elle n’a pas même la vraisemblance en sa faveur. Il faut chercher ailleurs l’origine du nom de Gruyère.
Jadis les habitants des campagnes et les bergers des Alpes, hommes simples et superstitieux, croyaient volontiers ce qui paraît incroyable. Dans les villages et les hameaux on racontait de merveilleuses histoires du vieux temps. On disait, entre autres, qu’à une époque bien éloignée, certaines cavernes ou grottes du pays de Gruyère 3 , étaient fréquentées par des enchanteurs et des magiciens. Cette tradition se rattache évidemment à un ancien culte, dont il subsiste quelques vestiges, au moins sous forme de souvenirs et de légendes. Or, chez les Germains, de même /47/ que chez les peuples de la Scandinavie, certaines contrées étaient particulièrement consacrées à des temples. Hommes et animaux trouvaient la paix dans ces lieux saints, à l’exception toutefois des oiseaux de proie, des bêtes carnassières, des victimes et des criminels qu’on immolait sur l’autel des sacrifices. Lorsque le christianisme eut pénétré dans la Germanie, les temples des faux dieux furent abandonnés ou détruits, les contrées où on les avait élevés furent converties en domaines royaux, et les forêts qui entouraient ces temples devinrent des forêts royales, Bannforste, que le chef de l’Empire commit à des officiers de la couronne. — C’est un fait bien élabli par les capitulaires que, sous le règne de Charlemagne, parmi les envoyés du roi 1 il y avait des grands-forestiers, forestarii. L’inspection et la conservation des bénéfices de la couronne rentraient dans les attributions de ces commissaires royaux 2 . Dans plus d’une contrée, par exemple en Flandre, les forestiers royaux, Waldboten, exerçaient le pouvoir judiciaire du comte; ce qui explique pourquoi ces officiers furent appelés comites silvestres, ou comtes-forestiers, Wildgrafen.
L’archevêque Hincmar (840) nomme deux comtes-forestiers, seigneurs hauts-justiciers sous Louis le Débonnaire. On sait que Baudouin Bras-de-fer était grand-forestier de /48/ Flandre lorsqu’il fut créé comte de ce pays par Charles le Chauve, en 863.
Au moyen-âge le comte-forestier était l’un des hauts seigneurs de l’Empire. Parmi les grands dignitaires ecclésiastiques et séculiers qui accompagnèrent le roi Rodolphe Ier à Spire, quelques semaines après son couronnement (1273), se trouvait « nobilis Emicho, comes silvester 1 . »
Il était naturel que l’Helvétie, pays de montagnes, de rivières et de forêts, fût soumise à la garde et à la juridiction de grands-forestiers revêtus d’un pouvoir judiciaire. On en trouve au moins un exemple sous le règne de Rodolphe, premier roi de la Bourgogne transjurane. Dans une charte intéressante, de l’an 908, sont nommés des commissaires de ce prince, missi domini regis, des veneurs et hauts-forestiers, supersilvatores, exerçant leur office dans une contrée de l’Helvétie romane qui avait pris son nom de ses forêts, savoir dans le pays de Vaud, pagus Waldensis, où ils décidèrent du droit de possession des forêts des Râpes et de Dommartin, droit que Bozon, évêque de Lausanne, disputait au roi de Bourgogne 2 .
Dans les chartes et les chroniques, l’office de forestier royal est mentionné sous diverses dénominations locales 3 . /49/ A ce titre répondait le mot gruier, ou gruyer, qui, dans les pays de langue romane, désignait un officier juge des eaux et forêts, des délits commis dans les bois et les rivières 1 . Il y avait recours de ce juge à un juge supérieur nommé grand-forestier, supersilvator, ou grand-gruyer.
La gruerie 2 fut érigée en fief comme les autres offices. On donnait particulièrement dans la Bourgogne, dont la Gruyère fit partie, le titre de grand-gruyer à l’officier royal investi de cette sorte de fief, qui ailleurs était appelé vénerie 3 .
Nos observations confirment l’opinion qu’a exprimée M. de Gingins dans son mémoire sur l’établissement des Bourgondes dans la Gaule 4 . « Les comtes de Gruyère, a dit ce judicieux écrivain, descendaient probablement de l’un de ces hauts officiers des derniers rois de Bourgogne, /50/ qui étaient investis de la charge de grand-gruyer de la couronne. »
Le mot Gruieria, qui servit d’abord à désigner l’office et la dignité de Gruier, devint plus tard le nom propre d’une famille et, de plus, signifia le territoire où le chef de cette famille exerçait son autorité. Cette dernière signification fut d’un usage général depuis que l’office de comte-forestier ou de grand-gruyer se transforma en seigneurie héréditaire à l’époque où le régime féodal s’établit 1 .
C’était en effet, comme le prétend la fable, d’un Gruierius, c’est-à-dire d’un gruyer du royaume de Bourgogne, que le petit empire pastoral dont nous écrivons l’histoire, avait pris son nom, et que ses princes avaient hérité leur pouvoir.
Telle fut, on n’en saurait douter, l’origine de la noble et puissante maison de Gruyère, que la tradition, mélange d’erreur et de vérité, fait descendre d’un capitaine vandale ou bourgonde.
II.
Dans la charte de fondation du prieuré de Rougemont, le plus ancien seigneur de la haute vallée qu’arrose la Sarine est appelé comes, comte, sans autre désignation. La dénomination de comte ou de comté de Gruyère ne se présente dans aucun document antérieur au XIIe siècle. La contrée qu’on appela de ce nom formait, comme division civile ou territoriale de l’Empire, un district ou canton, Gau, que l’addition d’un nom qualificatif servait à distinguer d’autres cantons. Dans les plus anciennes chartes, ce quartier porte le nom de Hogo 1 ou d’Ogo, corruption du mot composé Hoch-Gau, dont la première moitié signifie haut, élevé, et la seconde pays. Ce dernier mot vient de pagus, qui, chez les auteurs latins répond au mot Gau des Germains. Le mot Hochgau, que le peuple roman, peu habitué à écrire et à prononcer correctement les mots teutons, a changé en Ogo, signifie le Pays-d’Enhaut, nom que l’on donne encore aujourd’hui au district de Château-d’Œx, castrum in Ogo, le plus élevé de cette contrée montagneuse 2 . /52/
Le pays d’Ogo, comme la plupart des pagi, constitua d’abord un comté (Gaugrafschaft) de même nom, que remplaça dans la suite le nom de Gruyère. Dans le nécrologe d’Hauterive, Agnès de Glane, qui épousa Rodolphe Ier, est dite femme du comte d’Ogo 1 ; ailleurs, dans une charte de 1170, elle est appelée comtesse de Gruyère 2 . Dans l’acte d’une donation, faite vers l’an 1160, à l’abbaye de Hautcrêt, le même Rodolphe paraît comme témoin sous le titre « comes de Ogga » 3 , mais dans un document de l’an 1162, il est qualifié « comes de grueres » 4 , et dans une charte de ce comte, de l’an 1177, en faveur de l’abbaye de Théla, soit de Montheron, il se nomme « comes gruierensis » 5 . C’est donc, à ce qu’il paraît, au commencement de la seconde moitié du XIIe siècle que le comte d’Ogo prit le titre de comte de Gruyère, le seul qui se présente depuis cette époque.
On parla longtemps du pays d’Ogo 6 . Ce nom s’est conservé dans plusieurs localités, dont l’indication peut servir à faire connaître, au moins en partie, l’étendue de ce pays. Nous nommerons d’abord Château-d’Œx, qui dans un acte /53/ de l’an 1040, est appelé simplement Osgo 1 , au lieu de « Castrum in Ogo », comme on écrivait ordinairement. [Voyez la note corrective à ce sujet dans MDR Tome XXII, note2, p. 6.] — Dans une charte de 1234, il est question des bois du comte de Gruyère, dès le château de Pont (en Ogo) dans toute la terre d’Ogo jusqu’à la Tine 2 . Ce territoire constituait le val d’Ogo proprement dit 3 , il porta ce nom, dans les actes publics, jusqu’au siècle dernier 4 . Plusieurs documents des XIIIe, XIVe et XVe siècles indiquent, comme étant situés dans le pays d’Ogo, les chartreuses de la Val-Sainte 5 , et de la Part-Dieu, le prieuré de Broc, et l’abbaye d’Humilimont; Albeuve, Charmey, Montbovon, Escuvilens, Farvagny, la Roche, Pont, Vuippens, Bulle, Riaz, Vuisternens, qu’on appelle encore aujourd’hui « Vuisternens en Ogo ». Deux chartes, l’une de 1228, l’autre de 1348, mentionnent « l’église d’Echallens (Echarlens) en Ogo ». Le nom de la commune d’Ogens (dans le district de Moudon), où le comte de Gruyère avait un domaine 6 , n’aurait-il pas conservé /54/ l’empreinte du pagus Ogensis ou pays d’Ogo, dont cette localité faisait partie? Plus d’une fois il est question des « vignes d’Ogoz au Désaley ». Il existait, il y a quelques années, près de St.-Saphorin, une chapelle qui était connue sous le nom de « la chapelle d’Ogo », nom qu’elle porte dans des actes de 1328 et 1419 1 ; selon toute apparence elle servait jadis aux moines à l’époque des vendanges. Le beau « domaine d’Ogoz », situé sous les vignobles des communes de « St.-Saphorin, de Puidoux et de Chardonne », ne semble-t-il pas indiquer que dans un temps le pays d’Ogo touchait au Léman?
Enfin, ce pagus s’étendait vers le Nord au moins jusqu’à trois lieues en deçà de Berne. Le village de Ruggisberg 2 entre la Singine et l’Aar, était dans les limites du pays d’Ogo. Une charte du 27 mars 1076 nous apprend que Henri IV, roi des Romains, confirma la donation que noble Luthold, du château de Rümlingen, avait faite à Dieu, aux apôtres St-Pierre et St.-Paul et à l’abbé Hugues, de l’église de Ruggisberg, ainsi que d’un alleu, pour y fonder un couvent de l’ordre de Cluny, que la dite église était située dans le royaume du roi Henri, dans l’évêché de Lausanne, dans /55/ le pagus dit Vffgow 1 , dans le comté de Bargen. A cette confirmation le prince ajouta le don d’une forêt royale et d’un territoire inculte et désert, dit Guchau 2 , pour le défricher 3 .
Le comté de Bargen avait pris ce nom du village de Bargen, /56/ situé sur la rive gauche de l’Aar, en aval de sa jonction avec la Sarine, en face d’Aarberg. Ce village figure, sous le nom de Barges, comme paroisse du doyenné d’Avenches, dans le Cartul. du chap. de Lausanne 1 .
Le titre de comté avait passé soit au château, soit au village de Bargen, comme il passa, au milieu de l’anarchie féodale, des territoires à de simples villes, bourgs et château forts 2 . Il indique une juridiction. Könitz 3 , Rüggisberg, Lengnau ou Longeau 4 étaient du ressort de ce comitat ou comté. Il ne s’étendait que sur une partie du Hochgau, dont une autre portion, notamment Château-d’Œx, ressortissait au comté de Vaud 5 . Le Hochgau était un pays ou territoire qui dépendait, on le voit, de plusieurs juridictions. Compris dans le comté de Bourgogne (Landgrafschaft Burgund), qui constituait le diocèse de Lausanne, il était limité par l’Aar. Cette rivière séparait le comté de Bourgogne du duché de ce nom, et l’évêché de Lausanne de celui de Constance.
D’une étendue beaucoup moins considérable que l’évêché de Lausanne, le Hochgau ou pays d’Ogo était un pagus minor ou petit pays par opposition au pagus maior, qui répondait au territoire de la cité ou du diocèse, et il formait une subdivision diocésaine de cet évêché. /57/
Chaque diocèse était subdivisé en archidiaconés et en doyennés. Les premiers, dont l’institution paraît dater du temps de Charlemagne, ont été composés en grande partie avec les pagi minores, dont ils représentent assez généralement l’ancienne circonscription romaine 1 ; les seconds se sont formés de territoires qui s’étendaient sur une moindre fraction du diocèse.
Les archidiaconés du diocèse de Lausanne sont inconnus. J’incline à penser que le pays d’Ogo en était un, bien qu’il ne pût représenter la circonscription d’un territoire cultivé et administré autrefois par les Romains. Le Cartulaire du chapitre de Lausanne, de l’an 1228, nous apprend que le diocèse de ce nom était subdivisé en neuf doyennés, dont l’un était le doyenné d’Ogo. Or, celui-ci ne comprenait pas tout le territoire du Hochgau. Une partie de ce territoire, détachée du pagus par une église-mère, avait servi à former un autre doyenné, sans cesser pour cela, je le présume, d’appartenir à l’archidiaconé.
Le doyenné d’Ogo comprenait au commencement du XIIIe siècle, l’abbaye de Marsens, les prieurés de Rougemont, de Broc, de Pont-la-Ville, d’Avril-devant-Pont et de Farvagny; les églises de Bulle, Riaz, Grandvillars, Albeuve, Château-d’Œx, Gessenay, Bellegarde, Charmey, Villars-Volar, Hauteville-de-Corbières, Vuippens, Treyvaux, Vuisternens-devant-Pont, Autigny, Estavayé-le-Gibloux, Orsonens, Villa—St.-Pierre, Berlens, Vuisternens vers Romont, Sales près Vaulruz, Echarlens, Mézières vers Romont, Villarimboud 2 . /58/
Toutes ces paroisses, à l’exception de Château-d’Œx, de Rougemont et de Gessenay, sont situées dans la partie du comté de Gruyère qui fut incorporée au canton de Fribourg. Elles forment un rayon qui ne répond pas à l’ancienne circonscription du Hochgau. A une époque indéterminée, lorsque la population des Alpes bernoises se fut accrue, il fallut y élever des chapelles et des églises, puis instituer un nouveau doyenné, et, dans ce but, détacher une portion du Hochgau. L’église de Ruggisberg qui, suivant la charte de 1076, fut construite dans le pays d’Ogo, figure un siècle et demi plus tard dans le doyenné de Berne. Celui-ci comprenait en outre le prieuré de Dærstetten, les églises de Wimmis, d’Erlenbach, de Boltigen, d’Oberwil, de Zweisimmen, et d’autres, dans le Simmenthal, qui dépendait plus ou moins des anciens comtes de Gruyère ou d’Ogo.
Faute de renseignements plus complets, nous bornons ici nos recherches sur l’Ogo. /59/
Les comtes de ce nom, qui depuis la seconde moitié du XIIe siècle ne se montrent plus que sous celui de comtes de Gruyère, paraissent avoir d’abord administré le Hochgau, dont nous regrettons de ne pouvoir indiquer avec certitude toutes les limites de manière à reconstituer ce canton.
Le comté de Gruyère comprenait une partie assez considérable de l’ancien Hochgau, dans la Bourgogne transjurane. Il s’étendit un jour des sources de la Sarine ou du mont Sanetsch, qui le séparait du Vallais, jusqu’au delà du château de Simmeneck 1 , qui en fit partie; le long de la Sarine jusqu’au territoire d’Arconciel, à deux lieues de Fribourg, et à l’ouest jusque vers Romont. Les seigneuries de Corbières, de Charmey et de Bellegarde formèrent un jour le cinquième mandement militaire de ce comté.
Au midi, le Val d’Ormont fut pendant quelque temps sous la juridiction des comtes de Gruyère. A l’occident, ils comptaient au nombre de leurs possessions les seigneuries /60/ d’Oron et de Palézieux; ils furent dans un temps barons d’Aubonne et co-seigneurs de Coppet. Borjod, la Bâtie, Mont-le-Grand étaient cités avec orgueil parmi leurs châteaux forts. Il est vrai que le chapitre de l’Eglise de Lausanne possédait de grands domaines dans le comté de Gruyère, que les monastères d’Hauterive et de la Part-Dieu y avaient des droits et des revenus qu’ils devaient à la munificence des comtes. Mais si d’un côté, les biens patrimoniaux de ces princes furent diminués par des cessions, par des fondations pieuses et des dons faits à des corporations religieuses, de l’autre, leur fortune s’accrut de diverses acquisitions faites par achat, par alliance et par héritage. Le vidomnat de Vaulruz échut à la maison de Gruyère. Elle avait des terres et des droits seigneuriaux dans diverses localités, à Vuadens, à Surpierre, à Pallier, à Vuarens, à Pully, dans le val de Lutry, à Villette, au Désaley, à St.-Saphorin, à Corsier, à Chardonne, à Grandcour. — La Grue apparaissait jusqu’aux rives du Léman.
Les comtes de Gruyère étaient de hauts et puissants seigneurs. Leurs richesses, les fondations dues à leur piété, leur esprit chevaleresque, leur vertu guerrière et d’autres brillantes qualités leur assignèrent de bonne heure une place au premier rang de la noblesse bourguignonne. Ne relevant que du roi des Romains, ou de son vicaire, ils avaient eux-mêmes de nombreux vassaux. Ils étaient princes de leur comté, exerçant tous les pouvoirs de la souveraineté.
Au milieu du XVIe siècle, d’environ cinquante maisons souveraines en Helvétie, celle de Gruyère était seule debout. Mais l’heure suprême allait sonner pour elle. En face d’idées nouvelles, dont l’influence était irrésistible, placée entre les /61/ deux villes impériales de Berne et de Fribourg, dont la politique tendait comme un réseau pour l’envelopper, l’illustre maison de Gruyère, d’autant plus incommode à ses voisins qu’elle était dévouée à la maison de Savoie, et d’autant plus faible qu’une mauvaise administration avait épuisé ses ressources, subit sa destinée et tomba sous les coups que l’esprit mobile et l’incapacité d’un Michel ne pouvaient parer. Les bienfaits et les revers des comtes de Gruyère, de ces nobles chefs d’un peuple aux mœurs pastorales, leur acquirent des titres au souvenir de la postérité. Ils sont encore aujourd’hui l’objet d’une popularité romanesque et d’un intérêt pieux qui poétise leur infortune dans la mémoire des Gruériens.
CHAPITRE V.
Topographie du comté de Gruyère.
Je n’ai pas le dessein de faire le tableau de cette admirable contrée, qui est un des témoignages les plus éclatants de la puissance, de la sagesse et de la bonté du Créateur. Pour comprendre la nature de ce beau pays et en rendre dignement les scènes sublimes, il faudrait le génie et le pinceau d’un Calame 1 .
La tâche que je m’impose est plus modeste. Je voudrais faire connaître le territoire de l’ancien comté de Gruyère, dans le but de faciliter l’intelligence des chartes qui se rapportent à cette partie intéressante de la Suisse.
J’adopterai en général, dans le texte, l’orthographe moderne ou officielle des noms de lieux, de montagnes, de ruisseaux et de torrents, et je réunirai les variantes dans un glossaire qui donnera l’explication des principaux noms /63/ géographiques de la Gruyère. Ce petit travail de linguistique aura quelque importance, attendu qu’il éclairera des points de détail qui se rattachent à la question des premiers établissements dans la contrée qu’arrose la Sarine.
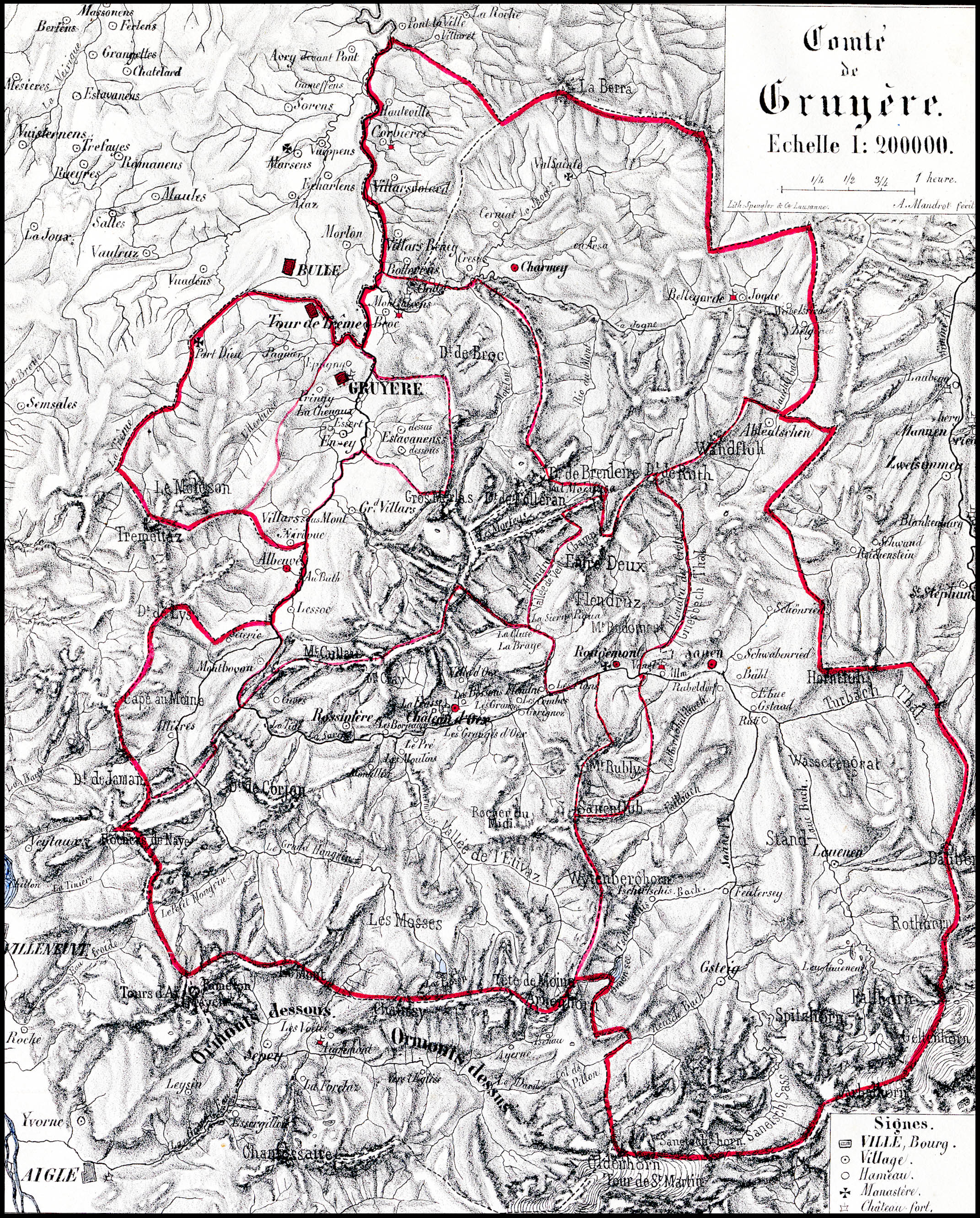
I.
La circonscription du comté de Gruyère est tracée en quelque sorte dans une charte du XVe siècle, où il est dit que ce comté s’étendait de la Trème jusqu’aux seigneuries de Bellegarde et du Sibenthal, et de là, le long du Vallais, des Ormonts et des marches ou frontières occidentales jusqu’à la Trème 1 . Pour parler plus exactement, nous dirons que le comté de Gruyère était borné au N.-O. par la Trème, qui limitait de ce côté le territoire du chapitre de l’Eglise de Lausanne; au N. par les seigneuries de Corbières et de Bellegarde; à l’E. par la chaîne des Alpes qui séparent le pays de Gessenay du Haut-Simmenthal; au S. et à l’O. par le mont Senin ou Sanetsch, le Pillon, les Ormonts, les rochers de Naye, Jaman, les Verraux, la Dent de Lys, celle de Niremont, et le torrent de la Trème.
Lorsque, dans la seconde moitié du XVe siècle, les seigneuries de Corbières, de Bellegarde et de Charmey furent devenues la possession de la maison de Gruyère, le comté de ce nom se prolongea au Nord jusqu’à la Berra, au N.-E. jusqu’à la Singine froide, c’est-à-dire jusqu’à la frontière /64/ qui sépare encore aujourd’hui les cantons de Berne et de Fribourg.
La nature avait eu soin de fixer les limites de ce petit empire pastoral, en l’enveloppant d’une chaîne de montagnes, entre lesquelles il était encadré. Au nord-ouest, où cette vaste enceinte laissait une lacune, s’élevait le Moléson pour protéger le pays qu’il décore, tandis que la Trémettaz, offrant son tribut, versait de son sein un torrent sauvage, la Trème, destinée avec la Tour de ce nom, à barrer le passage aux hommes d’armes de l’Evêque qui seraient tentés d’attaquer le comté de Gruyère.
La Sarine ou Sane, se précipitant des hauteurs du Sanetsch, et suivant les sinuosités des montagnes, traverse tout le territoire du comté. Courant d’abord vers le nord, elle se replie bientôt vers l’ouest, puis se recourbe vers le nord, reçoit la Singine à Laupen, et se jette dans l’Aar non loin de Güminen. Ce fleuve impétueux, qui doit à sa chute le nom qu’il porte et qu’il communique au beau village de Gessenay, reçoit dans son lit le tribut de tous les torrents et de tous les ruisseaux du comté de Gruyère. Ses principaux affluents dans ce pays sont, à l’ouest. le Reuschbach, la Tschertschis, le Fallbach, le Kalberhöhnlibach, le Rublibach, la Torneresse, l’Hongrin et la Trème; à l’est, la Lauen, la Tur, les deux Flendrus et la Jogne. Celle-ci sort du mont Schlündi, passe à Ablenstschen, arrose la vallée de Bellegarde et de Charmey, où elle reçoit, d’un côté, le Javro, qui prend sa source dans des forêts antiques et obscures, de l’autre, le Rio du Mont, qui traverse la plaine du Mont et va se perdre dans le torrent principal.
A quelque distance de Rossinière, deux montagnes, l’une appelée Corjeon, l’autre Cullan, se rapprochant, resserrent /65/ le lit profond de la Sarine et semblent s’unir pour opposer à son cours un obstacle invincible. La rivière, faisant de violents efforts pour se frayer un passage, se précipite en mugissant entre les rocs qui se groupent en cet endroit pour l’arrêter. Sur les deux rives s’élèvent d’énormes arbres, dont les branches s’entrelacent et forment un vaste ombrage qui rend plus terrible l’aspect de ce défilé. Cette gorge, sorte d’impasse, ouverte seulement sur le penchant de la montagne de Corjeon, était infranchissable avant que l’industrie humaine fût parvenue à y pratiquer d’abord un sentier au moyen de gros arbres, puis un chemin plus large, qu’il faut sans cesse réparer. Ce redoutable défilé, qu’on appelle d’une expression fort juste le Pas de la Tine, en allemand Bocken ou Bokten, a de temps immémorial divisé le pays en haute et basse Gruyère, soit en Gruyère au-dessus et au-dessous de la Tine 1 .
Avant que d’intrépides défricheurs eussent éclairci les /66/ noires joux 1 ou les forêts obscures, desséché les marais et les lacs formés par les nombreux ruisseaux, dompté la fureur des torrents qui entraînaient la dépouille des montagnes, le pays qu’on appela dans la suite le comté de Gruyère était en bonne partie une contrée de terres abreuvées d’eaux stagnantes. Ces terres basses et bourbeuses, ces marécages portent dans le patois roman le nom de mosses, emprunté de l’allemand moos ou moor. Les flaques ou mares pleines d’eau dormante sont désignées sous le nom de gollies. L’un des lacs fangeux les plus connus dans la haute Gruyère était le lac Mocausa, non moins célèbre que le lac d’Arnon dans les souvenirs du peuple. Le Mocausa ou Moscousa des vieux documents est une montagne, c’est-à-dire un haut pâturage, auprès duquel était jadis l’amas d’eau croupissante qui a fait place à un plaine d’un millier de pas de long sur une largeur de quatre à cinq cents pas 2 .
Les torrents grossis par la fonte des neiges sortaient de leur lit, submergeaient la plaine, rongeaient le pied des Alpes, minaient les rochers; les terres s’éboulaient et étaient emportées par le courant. Sans l’industrie de l’homme toute la Gruyère eût été couverte de lacs et de marais, parce que la Sarine et d’autres eaux sauvages, s’échappant du sein des Alpes et rencontrant de la terre, s’y creusaient un lit profond bien plus facilement qu’elles ne se fussent ouvert un passage à travers les monts. Aussi après avoir pénétré dans les sinuosités des montagnes, les premiers colons de cette contrée inhospitalière percèrent les forêts, firent écouler les eaux, desséchèrent les marais, continrent la Sarine et ses /67/ affluents dans leur lit au moyen de digues, et firent sur les cours d’eaux des conquêtes précieuses.
Grâce à ces divers travaux, cette contrée sauvage prit insensiblement un aspect plus riant; la population s’accrut, les troupeaux devinrent plus nombreux; l’aisance et le bonheur, fruits du travail, succédèrent à la misère du désert. Les vallées les plus reculées furent successivement découvertes, occupées, et converties en campagnes fertiles.
Cependant les habitants de la haute Gruyère furent toujours essentiellement un peuple pasteur; ainsi le voulait la nature du pays. Les plaines, comme les montagnes, sont couvertes de beaux pâturages. Déjà très-anciennement, un bétail nombreux était répandu sur les Alpes et dans les prairies. Autant de montagnes, autant on y compte de petites colonies de pâtres et de bergers; ces montagnards changent plusieurs fois de demeures dans l’année; de là le grand nombre de chalets et d’autres habitations pastorales qu’on remarque dans les Alpes gruériennes. Le bétail fut de tout temps une source de richesse pour la Gruyère. On ne connaît pas de plus belle espèce, aussi il en passe beaucoup à l’étranger. L’exportation des fromages, le tressage des pailles et le commerce de bois flotté ont beaucoup contribué à la prospérité du pays. La Sarine, quoique innavigable, rend cependant un très-grand service aux habitants; depuis des siècles elle transporte des bois confiés à son courant.
La Gruyère fut de bonne heure un état florissant. Les pâtres et les agriculteurs dûrent leur bien-être moins au gouvernement paternel des comtes qu’à leur propre industrie, à leur vie laborieuse et à leur économie. Point de concession, point de franchise qu’ils n’aient chèrement payée /68/ du travail de leurs mains et du produit de leur bétail. On ne peut se faire une idée juste de l’activité et de la richesse des habitants de la Gruyère, et particulièrement du Gessenay, qu’à la vue de certaines chartes où sont mentionnées les sommes considérables que ce peuple pasteur a payées à ses maîtres pour l’acquisition de nouveaux droits. L’histoire détaillée des vallons de la Gruyère et du Gessenay, est d’autant plus instructive qu’elle montre comment de simples colons se sont élevés du plus bas degré de l’échelle sociale à la condition de propriétaires, et de celle-ci à l’état de liberté; comment ces pâtres et ces paysans, marchant de conquête en conquête, ont fini par former des communes libres et florissantes. Les Gruériens n’ont été gratifiés d’aucun droit. Il est vrai de dire que la plupart des comtes de Gruyère ont contribué, par leur régime patriarcal et leurs vertus privées, au bonheur de la famille nombreuse au milieu de laquelle ils vivaient.
Les vigoureux montagnards de la Gruyère étaient non-seulement par leur intelligence et la beauté de leur taille, mais aussi par leur candeur, leur droiture, leur hospitalité, et leur amour de la liberté, une des peuplades les plus intéressantes que l’on connût. Leurs descendants n’ont pas dégénéré.
La Sarine arrose quatre grands bassins, ceux de G’steig ou du Châtelet, de Gessenay, de Château-d’Œx et de Gruyère. La vallée de Senin ou du Sanetsch, les vallées latérales de la Tur, de Lauenen, des deux Flendrus, de Rossinière, de la Reusch, de la Tschertschis, de l’Etivaz, de la Trème, les vallons reculés de Vertchamp, de Motélon, et /69/ le val de Charmey formaient avec les quatre grands bassins l’empire pastoral de Gruyère.
Cet état n’était accessible au sud que par deux sentiers ou passages faciles à défendre, celui du Sanetsch, appelé le Pas de la montagne, passus montis, dans un document du XIVe siècle 1 , et le Col du Pillon. Ces deux voies de communication aboutissaient au Châtelet, et conduisaient, l’une dans la vallée de Savièse en Vallais, l’autre aux Ormonts.
La partie méridionale du comté de Gruyère était couronnée par le Geltenhorn, le Wildhorn, l’Arbelhorn et le Sanetschhorn ou Montbrun. Le lieu où se joignent les deux passages que nous venons de nommer était sans doute protégé par une maison forte, qui, dans cette hypothèse, aurait donné son nom au village du Châtelet. L’entrée ou l’issue de chacun des autres grands bassins était défendue non-seulement par les montagnes latérales et par l’impétueuse Sarine, mais encore par un château fort, comme on le verra ci-après.
Les comtes de Gruyère ne furent pas seulement de vaillants hommes de guerre et de puissants seigneurs féodaux préoccupés des soins de couronner les hauteurs de tours et de forts. La Gruyère dut à la piété de ces preux chevaliers la fondation de plusieurs édifices consacrés à la religion. Au cœur du pays s’éleva, sur la fin du XIe siècle, le prieuré de St.-Nicolas de Rougemont, de l’ordre de Cluny, qui dut sa naissance au comte Guillaume. En 1307 Willermette de Grandson, veuve du comte Pierre III, fonda la chartreuse de la Part-Dieu, dans un site sauvage, à une lieue au-dessus /70/ de Bulle. A l’endroit où la Jogne se jette dans la Sarine fut construit, à une époque inconnue, le monastère de St.-Omar de Broc, prieuré de Bénédictins. En 1254 le comte Rodolphe, dit le Jeune, fonda la belle église paroissiale de Saint-Théodule, à Gruyère. D’autres églises ou chapelles durent leur origine à la piété et à la munificence de la noble maison de Gruyère. Ces diverses fondations furent richement dotées par leurs auteurs.
Les comtes de Gruyère et leur famille furent encore les bienfaiteurs des monastères d’Hautcrêt et d’Hauterive, de l’ordre de Citeaux, fondés, l’un en 1134, l’autre en 1137; de l’abbaye d’Humilimont, près de Marsens, de l’ordre des Prémontrés, instituée en 1136, et du couvent de la Val-Sainte, de l’ordre des Chartreux, fondé en 1295 par Girard Ier, seigneur de Charmey, dans la vallée sauvage dite précédemment de Tous-les-Saints 1 .
On peut dire sans exagération que les comtes de Gruyère furent, sous tous les rapports, les promoteurs de la civilisation dans l’étendue de leurs domaines, et même au delà des limites de leur petit empire. /71/
Depuis que les comtes de Gruyère possédèrent les seigneuries de Corbières, de Bellegarde et de Charmey, leur état comprit cinq mandements militaires, soit bandières ou bannières, dont trois « dès la Tine en bas jusqu’à la Trème », savoir les bannières de Gruyère, de Montsalvens et de Corbières, et deux dès la Tine jusqu’aux frontières du Simmenthal et du Vallais, savoir celle de Château-d’Œx et du Vanel ou du Gessenay. Chaque mandement était aussi désigné sous le nom de patria ou pays, en allemand Land ou March 1 .
Les bannières de Montsalvens, de Corbières et de Château-d’Œx formaient chacune un mandement civil ou une châtellenie, soit ce que l’on appelle ressort ou juridiction. La bannière du Vanel ou de Gessenay était subdivisée en deux châtellenies, celle du Vanel ou de Gessenay et celle de Rougemont: la bannière de Gruyère comprenait les deux châtellenies de Gruyère et de la Tour-de-Trème.
De plus, chaque châtellenie était subdivisée en mestralies: je citerai comme exemples les mestralies de Charmey, de Lessoc et de Rossinière.
Les hommes d’une châtellenie formant un mandement militaire suivaient la bannière de ce mandement, et les ressortissants de deux châtellenies composant un mandement militaire se réunissaient sous une bannière commune. Ainsi les hommes d’armes de Rossinière, de Cuve, de la vallée de l’Etivaz, se rangeaient sous le drapeau de Château-d’Œx; les gens de Rougemont et du territoire entre /72/ les deux Flendrus suivaient avec ceux du pays de Gessenay la bannière du Vanel, et les soldats des châtellenies de Gruyère et de la Tour marchaient ensemble sous la bannière de Gruyère.
II.
Mandements et châtellenies du comté de Gruyère.
I. La Bannière du Vanel comprenait, avons-nous dit, deux châtellenies, celle de Gessenay et de Rougemont 1 .
1° Les principales localités de la première étaient, du sud au nord: le Châtelet, en allemand G’steig, on plus exactement Steig, comme on lit dans les Visitationes ou visites pastorales de 1453 2 . — A cette époque ce village n’avait encore qu’une chapelle, qui fut fondée ou restaurée, dit-on, en 1416, dédiée à St.-Théodule, et consacrée par l’évêque de Grenade à l’occasion de la visite pastorale de 1453 3 . G’steig est situé à l’endroit où commence le pas du Sanetsch, circonstance à laquelle ce village doit son nom. — Lauinen ou Lauenen, village dans la vallée qu’arrose le torrent du même nom; G’stad, où la Tur et la /73/ Lauenen coulent dans la Sarine; die Ebne, plaine aux vertes prairies, parsemée d’habitations qui annoncent l’aisance; le beau village de Gessenay ou Sanen, sur la rive droite de la Sarine, avec l’église paroissiale de St.-Maurice, située sur une colline, dans un des plus beaux sites de la contrée. Cette église, mentionnée dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne, fut pendant quelques siècles la seule église paroissiale de tout le pays de Gessenay. En 1453 elle dépendait du prieuré de Rougemont, en vertu du droit de patronage que Jean de Rossillon, évêque de Lausanne, avait conféré en 1330 à ce prieuré, à la demande de Pierre IV, comte de Gruyère 1 . Il y a, de plus, à Gessenay, une vieille tour, qui sert de prison.
On remarque dans les environs de Gessenay — outre les Alpes ou montagnes tapissées de verdure, telles que l’Oberberg, le Rudolfsberg ou Rüdersberg, — les Pâturages communs, Allmende, dont il est question dans les chartes de la contrée, au N.-E. le Schönried, comme qui dirait le Bel-Essert, et le Schwabenried, c’est-à-dire l’Essert des Souabes ou des Suèves, dont le nom rappelle que les premiers colons de cette partie du comté de Gruyère appartenaient à la race germanique. Enfin, à l’extrémité septentrionale du Gessenay, est le village d’Ablentschen (Afnentschen, dans les chartes du 7 septembre 1457 et du 12 juin 1459), au fond d’un vallon sauvage, près du torrent de la Jogne.
Non loin de Gessenay, la Sarine, suivant la sinuosité des Alpes, se replie tout à coup vers l’ouest, et se trouve bientôt /74/ resserrée entre deux montagnes qui ne laissent qu’un passage assez étroit. Dans un angle que forment en cet endroit le grand Flendru et la Sarine, s’élève un roc escarpé, qui domine d’un côté la vallée de Gessenay, de l’autre celle de Rougemont, et qui de temps immémorial a marqué la limite entre le Pays-d’Enhaut roman et la contrée alamannique, et séparé les deux idiomes et les deux races.
Dès le XIe siècle, sinon plus tôt, les comtes de Gruyère, maîtres du pays, voulant affermir leur autorité et garder un passage important, soit pour pénétrer dans le Simmenthal par les Mosses ou marais de Gessenay (Sanenmöser), qui s’étendent vers Zweisimmen, soit pour entrer dans le Vallais par le Sanetsch, ou dans le val d’Ormont par le col du Pillon, couronnèrent de tours et de remparts ce haut rocher, qui leur offrait d’ailleurs un asile assuré. Le seul chemin praticable passait nécessairement dans l’enceinte de ce fort, qui défendait l’entrée des deux vallées que nous venons de nommer. C’est évidemment ce chemin étroit, serré, ardu, qui fit donner à ce château le nom de Vanel 1 . On dit qu’une voie souterraine laissait pénétrer l’eau de la Sarine dans cette redoutable fortification. Peut-être les prisons étaient-elles par dessous le château. Quoi qu’il en soit, à l’abri sur ce rocher, qui n’était accessible qu’aux oiseaux et aux reptiles, les sires du Vanel, de la branche cadette de Gruyère 2 , /75/ pouvaient à l’époque des guerres privées, fondre à l’improviste sur leur proie, surprendre l’ennemi, attaquer leurs voisins, et faire le gast, comme on disait alors, c’est-à-dire faire un dégât ou dévaster le pays.
La tradition qui attribue faussement aux Romains la construction du Vanel n’en est pas moins un fait remarquable: elle prouve que l’origine de cette fortification remonte fort haut dans le passé, et que dans l’opinion populaire la construction de ce fort, aussi hardie que solide, était un ouvrage digne des anciens maîtres du monde.
Le château du Vanel, dont les pierres séculaires paraissaient unies par un ciment indestructible, dut céder, comme tant d’autres, aux vives attaques de la bourgeoisie et des paysans armés contre la féodalité. Les deux lourdes portes d’entrée furent enfoncées, le redoutable manoir pris de force et détruit, les uns disent en 1350, d’autres, avec plus de raison, en 1406, année probable de la destruction du fort d’Ogo, qui partagea la destinée du Vanel. Les ouvrages qui barraient le passage et gardaient le défilé furent rasés. On élargit le sentier, on établit entre le pays roman et le Gessenay une communication, qu’une route moderne a rendue plus facile. Telle était la solidité du fort du Vanel que ses ruines résistent depuis environ cinq siècles à la fureur de la tempête et au poids des sapins qui croissent à leur sommet.
2° La châtellenie de Rougemont comprenait « les communes /76/ entre les deux Flendrus », le village ou hameau (villa) de ce nom, plusieurs autres localités, particulièrement Rougemont, situé dans une agréable vallée entre les monts Rubli et Rodomont. Ce village, déjà considérable au XVe siècle, se prolongea à peu près jusqu’au Vanel. Toute la contrée du fond de la vallée jusqu’au sommet des collines est tapissée d’un vert gazon, et parsemée d’habitations rustiques. Dans la plaine, au milieu d’une grande et belle prairie, s’élève un édifice dont le style et l’éclatante blancheur contrastent avec la simplicité des maisons rembrunies des villageois et des humbles chalets des pâtres. Ce bâtiment est le château de Rougemont, qui fut construit en 1577 pour servir de résidence aux baillis bernois. Il n’occupe point, comme on le croit généralement, la place de l’ancien prieuré de St.-Nicolas. Celui-ci, d’après une découverte récente, était situé à une demi-lieue au-dessus du village paroissial, entre les deux ruisseaux ou torrents qu’on appelle Flendrus, dans un lieu alors inculte et désert, qui, défriché par les religieux venus de Cluny, se peupla promptement de colons, qui construisirent les maisons éparses dont se compose le hameau du Flendru. L’auteur à qui nous devons ce renseignement y a reconnu les vestiges d’une ancienne fondation qu’il rapporte au monastère 1 .
Au delà du hameau que nous venons de nommer est la plaine appelée Sierne piqua, vers la jonction du Rio de Vert-champ et du Rio de Béviaux; de là s’étend au nord la vallée étroite qui, de ses vertes prairies, a pris le nom de vallée de Vert-champ, et à l’extrémité de cette vallée est la /77/ plaine dite la Verda, nom qui a remplacé l’ancien nom de Mocausa 1 .
Vis-à-vis du château de Rougemont, des prairies verdoyantes et de gras pâturages s’élèvent en amphithéâtre jusqu’au pied de la couronne qui orne le front du roi des monts de la contrée. A l’heure où la nuit vient envelopper la campagne de son voile funèbre, la cime du Rubli est encore éclairée: telle qu’un corps lumineux, elle renvoie ses reflets sur les prairies et les troupeaux, qui semblent recevoir les baisers d’adieu du soleil couchant 2 . Comme le mont Rose 3 , le géant des montagnes gruériennes est frappé des premiers rayons de l’aurore. Sept fois le jour, en hiver, on voit, derrière le Rubli, le soleil paraître et disparaître tour à tour 4 . C’est à ces phénomènes que cette montagne doit son nom.
Les habitants du petit territoire entre les deux Flendrus étaient hommes du Prieur. Le comte en était le supérieur féodal; il prenait le titre de seigneur de Rougemont.
Le prieuré de St-Nicolas, fondé par un comte de Gruyère sur la fin du XIe siècle, avait des possessions et des revenus considérables. S’il acquit une certaine célébrité, il ne la dut pas, à coup sûr, à des actes de générosité envers ses sujets; car de tous les habitants de la Gruyère, ceux qui dépendaient du monastère de Rougement furent les derniers affranchis /78/ de la servitude de la main morte; et encore durent-ils ce bienfait au jugement arbitral du comte François Ier 1 . Le plus beau titre de ce monastère à la reconnaissance des hommes serait une œuvre civilisatrice, s’il était avéré que la seconde imprimerie de la Suisse fut établie au prieuré de Rougemont. Une opinion qui s’est accréditée en vieillissant, parce qu’elle flatte l’orgueil national, attribue à un moine de Rougemont l’honneur d’avoir réimprimé, en 1481, l’ouvrage qui a pour titre Fasciculus temporum. Je voudrais pouvoir dire que peu après l’invention de la typographie il y a eu une imprimerie dans le prieuré de Rougemont, d’où est sortie, non pas la deuxième, mais la dixième édition du Faisceau des temps, dont on connaît quelques exemplaires; mais ce fait, dénué de preuves et fondé sur l’interprétation arbitraire d’un passage de ce livre, doit être contesté 2 . /79/
II. Bannière et châtellenie de Château-d’Œx.
Ce mandement comprenait plusieurs villages et hameaux, parmi lesquels nous citerons en premier lieu la « villa d’Oex », 1 ou « villa de monte doez » 2 , et le « burgum castri d’Oex », 3 ainsi nommé « du Chastel d’Ogo », ou Château-d’Œx, 4 qui a donné son nom à toute la commune. Le village ou bourg paroissial, incendié en 1800, a été reconstruit avec plus d’élégance et de goût. Le site de cet endroit, dans un amphithéâtre que forment les Alpes tapissées d’un vert gazon, est un des plus beaux et des plus pittoresques de la haute Gruyère. Au centre du bassin est une verte colline, détachée des monts: elle est connue sous /80/ le nom de la Motte. Dès le XIe siècle, au plus tard, elle était couronnée d’un château fort, appelé château d’Ogo. Au pied de cette éminence et sous la protection du fort s’étendaient les habitations pastorales des vassaux du seigneur de Gruyère. Telle fut l’origine du bourg qui est aujourd’hui le chef-lieu du Pays-d’Enhaut. Le château fort d’Ogo, au centre de la vallée, qu’il dominait de toutes parts, fut démoli dans le même temps que ceux du Vanel et de Bellegarde: on n’en laissa subsister que la grande tour, turris de Ogo, dont les murs ont sept pieds d’épaisseur, et qui depuis le commencement du XVe siècle sert de clocher à l’église de St.-Donat.
Ce temple, construit avec les débris du vieux manoir, remplaça l’ancienne église paroissiale d’Oiz (d’Œx), qui avait été bâtie, comme nous l’avons dit ailleurs, sur une petite colline à quelques minutes et en-dessous de la Motte, et qui est citée dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne avec les églises de Gessenay, de Bellegarde et de Charmey 1 .
On aperçoit de loin l’église de la Motte, dont les murs d’une blancheur éclatante brillent à travers les arbres dont elle est entourée.
La place d’armes du château d’Ogo fut convertie en cimetière, et l’enceinte du rempart en une terrasse, d’où la vue plane sur les hameaux qui entourent Château-d’Œx, et se promène agréablement sur les nombreux chalets construits sur la pente des montagnes et des coteaux qui environnent la vallée.
Dans un rayon plus rapproché se dessinent autour du /81/ lieu principal, sur les deux bords de la Sarine, plusieurs groupes d’habitations, ou des hameaux, savoir la Villa-d’Œx, la Frasse, les Borgeaux, les Granges, les Combes, les Coulaies ( « terra de culaes », 1238), la Grange-d’Œx, les Moulins, Montilier (« Montelyer, » en 1276), le Pré, les Bossons, Gérignoz 1 , dans un vallon latéral, et d’autres petites colonies. Au sud-est se présente le village de l’Etivaz, dans la belle vallée de ce nom, qui a une bonne lieue de longueur, et que la Tourneresse arrose et féconde, en se hâtant d’atteindre les Moulins, qu’elle met en mouvement avant de verser ses ondes dans le sein de la Sarine. A l’ouest, sur la rive droite de la Sarine, on remarque le village de Rossinière, dans un bassin que la Sarine traverse en mugissant, et Cuves ( « villa de Cuves » ), ainsi nommé du creux vallon où on a bâti ce hameau. La place qu’il occupe est la seule de cette localité que le soleil d’hiver éclaire de sa pâle lumière.
Au commencement du XVIe siècle (en 1518), on remarquait encore près de Rossinière une vieille tour, dont il n’est plus fait mention dans la suite.
C’est entre Rossinière et Château-d’Œx, près d’un moulin et d’un pont hardi jeté sur la Sarine, que jaillit la source remarquable connue sous le nom de Chaudannaz 2 .
Lorsque après avoir quitté les rives de la Sarine, l’ami de la belle nature gagne les collines qui encadrent au N.-E. le bassin de Château-d’Œx, il voit, à mesure qu’il s’élève, se déployer devant lui le large plateau de la Braye, le vallon de la Clusa, à la tête duquel est le mur de rocher qui le /82/ ferme et lui donne son nom; la plaine dite Sierne piqua, la plaine de Mocausa, ancien nom de la Verda, bel alpage à l’extrémité de la vallée de Vertchamp 1 .
Toutes les localités que nous avons nommées ci-dessus formaient jadis la paroisse de Château-d’Œx, car le temple de St.-Donat fut jusqu’après l’introduction de la réformation la seule église paroissiale du mandement de Château-d’Œx. Le village de Rossinière n’avait qu’une chapelle, dédiée à St.-Antoine.
III. Le Mandement et châtellenie de Montsalvens s’étendait sur la rive droite de la Sarine, dès le Pas de la Tine jusque sur la rive droite de la Jogne et du Javro.
Le château de Montsalvens, siége des seigneurs de ce nom, issus de la maison de Gruyère, et connus dès le XIIe siècle, était situé un peu plus bas que le village de Châtel-sur-Montsalvens, non loin du confluent de la Jogne et de la Sarine. Il reposait au bord d’un affreux précipice, sur une colline ou Motte, au-dessus de la gîte, c’est-à-dire du pâturage à mi-côte, dit de Bataille. Ce nom, loin de rappeler le souvenir d’un combat qui aurait eu lieu en cet endroit, servait à désigner une fortification. Il était commun à beaucoup de châteaux forts flanqués de tours, qu’on appelait aussi Bastilles. Un document du mois de juin de l’an 1281 nous apprend que les Fribourgeois s’étant emparés de cette forteresse, elle échut à Richard de Corbières, seigneur de Bellegarde, /83/ qui en reçut l’investiture pour sa part 1 . On a conclu des ruines éparses d’anciennes constructions à l’existence de deux châteaux de Montsalvens 2 , dont l’un au bord d’un précipice, sur la droite du chemin qui conduit de Broc à Charmey, aurait été le fort pour lequel Richard de Corbières fit hommage aux Fribourgeois en 1281; l’autre un peu plus élevé, sur la hauteur dite de Bataille, aurait été le château qui donna son nom à la châtellenie de Montsalvens, et qui ne sortit de la maison de Gruyère qu’en 1555. Cette hypothèse créé une difficulté qu’on ne peut résoudre. Je ne crois point à l’existence de deux châteaux de Montsalvens qui auraient appartenu à deux seigneurs différents. Il est beaucoup plus probable qu’il y eut en cet endroit une grande fortification composée de deux forts ou châteaux, l’un supérieur ou Monsalvens-dessus, au delà du torrent de la Jogne, à gauche du chemin qui conduit de Broc à Charmey, sur la hauteur qu’on appelle la gîte de Bataille, l’autre inférieur, ou Montsalvens-dessous, à droite du chemin, sur un roc coupé à pic; là il fallait s’arrêter, rétrograder ou se précipiter. Une muraille d’enceinte, flanquée de tours, aboutissait à la bretêche élevée sur le bord du ravin qui sert de lit à l’impétueux torrent 3 . L’un de ces deux châteaux qui dans notre opinion formaient ensemble une forteresse, commandait /84/ la vallée de Charmey, l’autre, celle de Corbières, et (de même qu’au Vanel) le chemin étroit, ardu, qui conduisait de Broc à Charmey, passait sous les portes ou dans l’enceinte de cette vaste construction, laquelle barrait le passage, défendait le défilé, et protégeait la Gruyère contre les incursions des sires de Corbières et contre les attaques des Fribourgeois, qui cependant parvinrent à s’en rendre maîtres en 1281. Ce château fut bientôt rendu à la maison de Gruyère. Il est certain qu’elle le possédait en 1289, puisque cette année, le comte de Gruyère et son neveu firent hommage lige au comte de Savoie pour les châteaux de Gruyère, de Montsalvens, du Vanel et d’Œx 1 , hommage qui s’étendit en 1404 à la Tour de Trème 2 .
Dans la partie inférieure de cette vaste enceinte on reconnaît un fossé très-large et des vestiges de fortifications. Il reste de la partie supérieure une tour carrée, apparemment celle d’où l’une des dernières comtesses de Gruyère, dame de Montsalvens, put suivre d’un œil inquiet son infidèle époux chevauchant du côté de la Monse.
En 1556 (28 sept.), le gouvernement de Fribourg fit examiner et couvrir la tour de Montsalvens; en 1671 (11 décembre), il la fit revêtir d’un toit plat: devenue inutile, elle fut abandonnée aux injures du temps 3 . Cette imposante ruine, comme celle du Vanel, a bravé les orages des siècles. On devine à son aspect ce que dut être un jour la Bataille élevée contre les turbulents voisins de la maison de Gruyère. /85/
La châtellenie de Montsalvens comptait plusieurs villages, entre autres celui de Broc, situé dans l’angle méridional que forme la jonction de la Jogne et de la Sarine et que domine la Dent de Broc. Le véritable nom de ce joli village, tel qu’il se présente dans la plupart des documents, est Broch, « villa de broch ». Il est déjà question de Broc dans un acte de l’an 998 1 . La paroisse de Broc est une des plus anciennes du pays. Suivant une tradition, l’église paroissiale de ce village, dédiée à St.-Blaise, fut consumée vers l’an 1001, année d’une grande sécheresse, par un incendie qui n’épargna que le prieuré et la maison forte près du pont. Elle ne fut pas rebâtie, faute d’argent. Dès lors les offices de paroisse se firent dans l’église de St.-Omar 2 . Nous ne pouvons établir la vérité de ce fait par des preuves certaines. Nous avons déjà dit que le prieuré bénédictin de St.-Omar de Broc, dépendant de celui de Lutry, fut annexé en 1577 au chapitre de St.-Nicolas de Fribourg. On n’a que peu de détails sur ce prieuré. Ses archives qui, d’après un document du XVe siècle, devaient être réunies et conservées dans une caisse 3 , sont très-probablement devenues la propriété du chapitre de St.-Nicolas, où elles restent enfouies au détriment de la science historique. Le vieux bâtiment adossé au pont 4 et connu dans les anciennes chartes sous le nom de maison forte ou de château de Broch 5 , appartint /86/ primitivement aux nobles de Broc 1 et dans la suite aux seigneurs de Montsalvens 2 , puis aux comtes de Gruyère. Quand l’état de Fribourg vendit les fonds du comte Michel, un bourgeois de cette ville, nommé Fruyo, qui fut ensuite bailli de Gruyère, fit en 1557 l’acquisition de cette maison forte 3 , qui subsiste encore aujourd’hui. Les seigneurs de Broc avaient droit de justice, des fourches patibulaires hors des terres du prieuré, près du village de Botterens. Ce droit passa ensuite à la seigneurie de Montsalvens, et depuis à celle de Gruyère 4 .
La châtellenie de Montsalvens comprenait, outre Broc, les villages de Châtel et de Crésus, du moins en partie; et plus au sud, le Grand-Villars, appelé autrefois Vilar 5 , avec l’église paroissiale de St.-Jaques: près de ce village on admire la cascade du torrent de la Taouna, « dont les eaux écumantes tournoient dans les cavités d’une coquille avant de hasarder le saut 6 . » — Le Buth est un hameau entre Grand-Villars et Lessoc, village dont le site est un des plus riants de la Gruyère. A une demi-lieue de cet endroit on remarque un pont couvert, d’une construction hardie, qui /87/ faisait communiquer les communes de Lessoc, du Grand-Villars et d’Estavanens avec la rive gauche de la Sarine 1 . Aujourd’hui, un beau pont d’une arche facilite le passage de la rivière entre Grand-Villars et Villars-sous-Mont, et l’ancien chemin étroit et dangereux qui conduisait d’Albeuve à Montbovon, a été converti en une belle route, qui est un bienfait pour la contrée. Enfin, nous indiquons comme ayant fait partie de la seigneurie de Montsalvens les beaux pâturages du mont et de la vallée de Motélon 2 , arrosés par le ruisseau du même nom, et l’intéressante montagne de Morteys, sur laquelle on peut consulter l’auteur de la Course dans la Gruyère 3 .
IV. La Bannière de Gruyère était divisée en deux châtellenies, celles de Gruyère et de la Tour de Trème.
1°. La châtellenie de Gruyère comprenait, sur la rive droite de la Sarine, la commune d’Estavanens-dessus et dessous, et s’étendait, sur la rive gauche de la Sarine et de l’Hongrin, jusqu’à Jaman. Toutefois le territoire de la commune d’Albeuve dépendait du chapitre de l’Eglise de Lausanne, à qui le comte de Gruyère l’avait définitivement cédé au commencement du XIIIe siècle. Cette commune, située entre la Marivue, la Sarine, l’Hongrin et les Alpes, qui la dominent au couchant, est assez étendue, surtout dans les montagnes. Elle formait anciennement une portion considérable du comté de Gruyère. Les habitants d’Albeuve parlent avec orgueil de leurs belles prairies. /88/ Le principe de la propriété et l’esprit de commune se sont depuis longtemps bien établis dans cette localité. Albeuve, nommé Alba aqua dans les vieilles chartes, tire son nom de l’eau blanchâtre et savonneuse qui coule auprès: les gens du pays l’appellent la Marivue. Le village d’Albeuve eut de bonne heure une église paroissiale, dite de Sainte-Marie. Jusqu’à la fin du XIIIe siècle cette église ne dépendait que du prévôt et du chapitre de Lausanne, dès cette époque, l’évêque en eut la collation 1 .
La châtellenie de Gruyère était composée, en 1388, de six communes:
a) Montbovon, au fond d’une gorge, avec les sciernes, et des pâturages en Allière: le village de Montbovon n’eut pendant longtemps qu’une chapelle, dédiée à St.-Grat.
b) Nérive, qui tire son nom de l’eau noirâtre, nigra aqua, qui l’arrose. Cet endroit est remarquable par la source mystérieuse de son ruisseau et sa fameuse gorge de l’Evi 2 .
c) Villars-sous-Mont (appelé improprement Villars-sur-mont, V. symon et V. symont, dans plusieurs documents), endroit intéressant, au pied du Graou, montagne de la /89/ chaîne du Moléson, laquelle est appelée communément le Mont.
d) En-Ey, avec les hameaux de la Chenaux, la Grange d’Afflon et l’Essert, « villa de Esserto ». Le village d’En-Ey a été souvent menacé par un torrent (le rio d’En-Ey), qui a failli l’engloutir, et par la Sarine, qui a de plus en plus empiété sur son territoire. Le grand travail de rectification du lit de cette rivière est une des plus utiles entreprises tentées dans le canton de Fribourg.
e ) La commune d’Estavanens-dessus et dessous, de la paroisse de Broc, avec la chapelle de Sainte-Marie-Madelaine, filiale de l’église de Broc, érigée en 1578 en église paroissiale.
f) Les hameaux ou villages de Pringy 1 et d’Epagny 2 , au-dessous de Gruyère, formaient avec cette ville la commune de Gruyère. A un quart de lieue de là, sur un petit monticule appelé Montbari, sont les bains de ce nom, près du torrent dit l’Erbivue, qui descend du Moléson.
Gruyère est dans une vallée qu’entourent les Alpes fribourgeoises, le Gibloux, la Berra, la Dent de Broc, celles de Brenleire, de Follieran, et « le majestueux Moléson devant qui s’abaissent tous ces géants de la nature. » Cette petite cité féodale s’élève sur une haute colline détachée des monts, aux lieux où ceux-ci laissent la vallée s’ouvrir /90/ et se déployer. A droite, « la Sarine roule en ondoyant tantôt sur une rive argentée, tantôt sur un lit du plus vert gazon. » Au pied du monticule sont, à l’est et à l’ouest, les deux villages d’Epagny et de Pringy, qui formaient, avons-nous dit, une commune avec la capitale du petit empire gruérien. Deux chemins étroits, l’un pavé, l’autre pierreux, pratiqués dans les deux flancs de la colline, conduisent de ces deux endroits à la ville et au plateau qui supporte le château et les bâtiments contigus. Tout annonce que ce sont les mêmes sentiers que suivaient jadis en chevauchant les preux chevaliers, les seigneurs et les dames de la cour de Gruyère.
Du haut de la colline on jouit d’un beau coup d’œil. La vue plane sur le magnifique bassin de la basse Gruyère, parsemé de villages et de hameaux, couvert de champs fertiles et de vertes prairies qu’arrosent la Sarine et divers torrents ou ruisseaux, et couronné de montagnes entre lesquelles ce riant paysage est encadré. Quand le soleil l’éclaire de ses rayons, la jolie ville de Bulle avec ses brillants clochers, Broc avec sa maison forte et son pont sur la Sarine, les ruines de l’antique manoir de Montsalvens, et la cime altière du Moléson s’offrent tour-à-tour aux yeux du spectateur.
Gruyère, cet endroit remarquable et intéressant par les souvenirs historiques qui s’y rattachent, était divisé en deux parties, entourées de remparts et de tours, avec quatre portes. L’une était la cité, l’autre le bourg ou le village muré. Cette partie, qui n’a qu’une seule rue, très-large, bordée de maisons peu élevées, telles qu’on les bâtissait au moyen-âge, s’étend de ce qu’on appelait la porte de St.-Germain jusqu’à la place dite de la Chavonne. Un document de 1550 indique la place de « la Chavonnaz » comme étant hors des murs de Gruyère. Le château et ses /91/ dépendances, assis sur le sommet uni du monticule, formaient la cité. Ici demeuraient les gentilshommes, tandis que les bourgeois habitaient le bourg, et que les autres membres de la commune, d’une condition inférieure à celle des nobles et des bourgeois, composaient la population d’Epagny et de Pringy.
Même en temps de paix, les habitants de la cité et ceux du bourg fermaient chaque nuit les portes de leur enceinte, et faisaient le guet sur les murailles qui défendaient la ville du côté de la plaine. Je ne sache pas que sous le régime paternel des comtes de Gruyère, les habitants du bourg et ceux de la cité se soient jamais fait la guerre, comme il arrivait quelquefois dans d’autres villes, ni qu’en aucun temps ils aient ouvert à l’ennemi les portes de leur ville qui, bien gardée, pouvait passer au moyen-âge pour imprenable.
L’ancien manoir des comtes de Gruyère était, sans doute, comme la plupart des vieux châteaux, lourd, massif et sombre, garni de tourelles, hérissé de créneaux, percé de meurtrières, entouré de murailles épaisses, environné d’un fossé large et profond. Détruit par un incendie vers la fin du XVe siècle, pendant la régence de la comtesse Claudie de Seyssel, il fut remplacé par un château plus commode, mieux approprié aux mœurs du temps, plus digne que le premier de servir de résidence à un souverain.
Dans une position superbe, le château de Gruyère couronne le sommet de la colline escarpée, et domine toute la vallée. Les autres bâtiments du plateau, et les petites maisons construites sur le plan incliné du monticule, contrastent avec le château et en font ressortir la grandeur. La Sarine /92/ semble s’écarter avec respect; elle fait un demi-cercle à ses pieds.
La cité était séparée du bourg par une haute muraille, dont la porte se présentait ornée de la grue aux ailes éployées. Il fallait passer deux enceintes, deux fossés, deux ponts-levis avant de pouvoir entrer au château.
On pénétrait par le premier pont dans une grande place d’armes, qui a conservé le nom de place de St.-Jean. Cette place, entourée de maisons, a été convertie en partie en jardins. Au centre est une citerne, à gauche et à droite sont la belle chapelle de St.-George, fondée en 1390 par Cathérine condame de Corbières 1 , un pavillon, ou une espèce d’observatoire, un ancien corps-de-garde, et les écuries où les chevaliers logeaient leurs coursiers, et les dames leurs haquenées. De là on passait un second mur d’enceinte, couvert d’un toit en saillie et flanqué de tourelles, un fossé, un pont-levis, et on avait à gauche une grande cour, à droite le vaste château à deux étages, construit en grosses pierres de taille et garni de huit tourelles octogones. La grue au-dessus de la porte d’entrée annonçait à l’étranger qu’il se trouvait devant le palais des princes qui présidèrent longtemps aux destinées d’une famille nombreuse et dévouée.
Comparé aux châteaux des XIe et XIIe siècles, le château de Gruyère, refait à neuf, a quelque chose de léger, de frais, d’élégant. On y monte par un large escalier en limaçon. On admirait naguère au corridor du premier étage deux vitraux magnifiques, l’un aux armes de Savoie, à la croix simple, avec le collier de l’Annonciade contournant, deux /93/ lions servant de supports, et l’année 1534; l’autre, aux armes de France, trois fleurs de lis, avec le collier de l’ordre du St.-Esprit contournant, deux cerfs ailés pour supports, et l’an 1534; de plus, quatre petites vitres coloriées, représentant les armoiries d’anciens préfets de Gruyère, et dans une salle, un autre beau vitrail de petite dimension, portant la grue, couleur d’argent sur champ de gueules. Ces précieux monuments ont été transportés en 1848 au château de Bulle, en attendant qu’on pût les placer dans un musée.
Le corridor du second étage avait pour ornement les armoiries des maisons de Gruyère et de Monthénard, et la porte de l’escalier du donjon présentait celles des maisons de Gruyère et de Seyssel. Dans la chambre du comte était une chaise à dôme sculpté, portant les armoiries de Gruyère et de Menthon, et le millésime 1505. C’était le siége du comte Jean II.
Une chambre sombre où le soleil ne pénètre que par une fenêtre grillée, et où se trouvait un lit, reste remarquable d’un ameublement antique, était le cabinet de Luce des Albergeux 1 , maîtresse du comte Jean III. Les chants et la tradition du pays ont conservé le souvenir de cette belle gruérienne. « On ne pouvait lui comparer aucune femme chez l’un des peuples les plus remarquables de la terre pour la noblesse des formes et l’union de la forme aux grâces naïves et à la finesse des traits 2 . »
Dans une vieille tour ronde qui fait partie du château, et dont les murs ont huit pieds d’épaisseur, est une cheminée /94/ qui attire l’attention des visiteurs. L’âtre avait été construit de manière à ce qu’on pût y rôtir un bœuf entier, qu’on tuait dans un abattoir attenant. On prenait place au banquet, offert par l’hospitalité bien connue des comtes de Gruyère, dans la grand’salle des chevaliers, où les joyeux convives avaient pour sophas des bancs de pierre hauts de trois pieds, adossés aux murailles, qui ont jusqu’à quinze pieds d’épaisseur.
Non loin de là est une autre vieille tour isolée, que les chroniques appellent Supelbarbe ou Supplebarbe.
Auprès du château était une seconde place d’armes que protégeaient autrefois deux tours, et qui a été convertie en jardin potager. C’était là que le comte assistait aux fêtes militaires où ses compagnons d’armes s’exerçaient au combat; c’était là qu’il tenait ses lits de justice, qu’il prenait part aux jeux et aux plaisirs des heureux villageois qu’il avait invités à un repas champêtre, ou que, après un festin, il s’asseyait à deviser avec ses chevaliers sur la pelouse.
La cour de Gruyère était brillante: elle se composait des seigneurs et des dames de la famille régnante, de plusieurs gentilshommes et chevaliers, vassaux du prince. On y voyait les d’Everdes, les Vuippens, les Cléry, les St.-Germain, les de Pringy, les de Villars, les de Broc, les Corpasteur, les d’Aigremont, les Corbières, et d’autres gentilshommes.
Au pied du manoir des comtes, au-dessous de la ville, est la belle église paroissiale de St.-Théodule, fondée en 1254 par le comte Rodolphe dit le Jeune. /95/
Il y avait au château une chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste 1 , à l’usage de la cour, et une autre, dédiée aux XII apôtres, sur un plateau, au-dessous de Gruyère. Elles étaient desservies par plusieurs altariens ou chapelains, et dépendaient de l’église de St.-Eusèbe de Bulle. La chapelle des XII apôtres servit de chœur à la nouvelle église paroissiale 2 , qui, fondée du consentement de l’évêque de Lausanne, fut placée sous le patronage du prévôt et du chapitre de Notre-Dame. La paroisse de Gruyère comptait au milieu du XVe siècle cent quatre feux 3 . /96/
2°. La châtellenie de la Tour de Trème 1 , peu étendue, comprenait les villages ou hameaux dits le Pâquier, les Albergeux 2 , les Carys, et le joli bourg de la Tour de Trème, qui doit son nom à une tour carrée et au torrent de la Trème qui coule auprès et va rejoindre la Sarine au-dessous de Broc. Cette tour, bâtie sur un roc appellé la Motte, bien conservée et surmontée d’une horloge depuis 1683 3 , faisait partie d’un château fort, domus fortis ou Castrum Turris 4 , qui s’élevait au-dessus de la porte du bourg ou du village muré 5 , et qui avec la Trème et la Sarine devait protéger la Gruyère contre les hommes d’armes de l’évêque et du chapitre de Lausanne. Cette forteresse fut prise dans une guerre et démolie avec les murs d’enceinte. Tout comme à Château-d’Œx, la tour carrée, qui repose solidement sur la Motte, resta seule debout.
La Tour de Trème ou la Tour, comme on dit ordinairement, est un joli bourg, ou si l’on veut une charmante villette, dans une belle plaine à un quart de lieue de Bulle et à trois quarts de lieue de Gruyère. La Tour n’eut pendant longtemps qu’une chapelle, dédiée à St.-Denys 6 , filiale de l’église de Gruyère, et qui ne devint paroisse que plus /97/ tard. Une autre chapelle, dite de Notre-Dame, au nord de la Tour, fut fondée le 1er mai 1520 par Amey Charles 1 .
A quelques minutes de la Tour, sur la route, on remarque un tertre surmonté d’une croix. C’est la croix monumentale du Pré des Chênes, plantée au milieu du champ de bataille, où en 1349 deux hommes de Villars-sous-Mont, Clarimbold et Ulrich de Berne, surnommé Bras-de-fer, se signalèrent par leur bravoure et leur dévouement au comte de Gruyère, leur seigneur.
V. Mandement et châtellenie de Corbières.
Selon Bourquenoud et d’autres écrivains, les anciennes armoiries de Corbières étaient de gueules à croix d’argent, ou bien, l’écusson de Corbières était partie aux armes de Savoie et de Gruyère, d’où on a conclu que la maison de Corbières descendait de celle de Savoie, ou qu’elle était une branche de la maison de Gruyère. La première de ces opinions est contestable, la seconde est erronée. Le seul écusson connu de l’antique maison de Corbières, dont l’origine est distincte de celle de Gruyère, est de gueules à bande d’argent, chargé d’un corbeau de sable.
Le mariage de Pierre de Gruyère, seigneur du Vanel, avec Marguerite de Corbières, au commencement du XIVe siècle, fut la source des droits de la maison de Gruyère sur les terres qui constituèrent la baronnie de Corbières.
Vers la fin du XIIIe siècle l’ancienne et noble maison de Corbières divisa son territoire en deux seigneuries, l’une appelée Corbières, l’autre Charmey; bientôt Bellegarde et /98/ ses dépendances formèrent l’apanage d’un troisième membre de la même famille. Au XVe siècle, les trois seigneuries devinrent la possession presque exclusive de la maison souveraine de Gruyère.
1° La seigneurie de Corbières comprenait: le village de Hauteville, alta villa, avec l’église paroissiale de St-Etienne, mentionnée dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne 1 , autrement dite de Corbières, sans doute parce que le seigneur de ce lieu en avait le patronage 2 , circonstance à laquelle je crois devoir attribuer le nom de Hauteville de Corbières, que porte le village où était cette église; — le bourg ou la ville de Corbières, villa Corberiarum, avec la chapelle de Ste.-Marie, située hors des murs, près de la porte du bourg 3 , filiale de l’église d’Hauteville; — le village de Villar-Volar, avec une église paroissiale 4 , dépendante de l’abbaye d’Humilimont ou de Marsens 5 , — Villars Beney ou plutôt Villarbenoit (?), et Botterens, « auprès des fourches anciennement illec élevées » 6 . Dans un document du 22 mai 1500, Villars-Beney et Botterens sont indiqués comme dépendant de la paroisse de Broc, « perrochie de Broc. »
Ces cinq endroits sont situés sur une ligne, entre une chaîne de montagnes et la Sarine, qui séparait Corbières du domaine des seigneurs d’Everdes 7 , qui de leur château /99/ élevé, dont les ruines sont masquées par une forêt de hêtres, faisaient en vrais chevaliers brigands de fréquentes excursions dans la plaine.
Une tradition vague porte à quatorze le nombre des bouchers qui pouvaient s’établir à Corbières: la loi du pays n’en tolérait pas davantage. En admettant que cette défense s’appliquât à toute la seigneurie, ce serait faire une assez belle part à la tradition. Si on considère que Corbières ne paraît point dans le catalogue des paroisses du décanat d’Ogo, dont cet endroit faisait partie, et qu’en 1335, 1376, 1453, il n’avait qu’une chapelle, filiale de l’église d’Hauteville, on pensera que Corbières ne fut pas, même au temps de sa splendeur, un bourg ou une ville aussi considérable que la tradition le ferait présumer.
Cependant, comme l’église paroissiale d’Hauteville est dite autrement de Corbières, il se peut que, dans un sens, on ait donné à Corbières une plus grande étendue, en y comprenant certaines dépendances.
On parle aussi d’une ancienne et d’une nouvelle ville de Corbières, et pour appuyer la tradition on cite un passage qui contient les mots in veteri villa, ce qui signifie aussi bien un ancien village qu’une ancienne ville. Au reste, Corbières ayant beaucoup souffert d’une guerre dans la seconde moitié du XIVe siècle, on répara ses murs, et on put dès lors parler du vieux et du nouveau bourg, ou de la vieille ville et de la ville moderne.
Un fait incontestable, c’est qu’il y avait jadis à Corbières un château plus ancien que celui qu’on voit aujourd’hui sur le plateau qui domine la Sarine. Un document de l’an 1323 /100/ fait mention de l’antique château de Corbières 1 . Cette ville était défendue du côté méridional par un fossé, des remparts et le château qui, restauré en 1753 (1560?), est encore debout, et au nord, par une autre fortification, soit Bataille ou Bastille, dont on reconnaît les vestiges au lieu qui a conservé jusqu’à nos jours le nom de Bastillon.
2° Le Val et Pays de Charmey, qui a neuf à dix lieues de long, consiste presque tout en pâturages, depuis la montagne des Morteys, sur les confins de la châtellenie de Rougemont, jusqu’à la paroisse de Plafayon, dans la partie allemande du canton de Fribourg. Il est arrosé par la Jogne et le Javro. Très-anciennement le nom de Charmey était réservé, dit-on, à toute la vallée. Celle-ci comprenait les villages ou les hameaux suivants: Féguières, nom qui fit place à celui de Charmey (?); les Arses, Lederrey 2 , Praz ou le Pré, tous de la paroisse de Charmey; Cerniat, Crésus, et, du moins en partie, Châtel-sur-Montsalvens; ces trois derniers de la paroisse de Broc 3 . Charmey eut de bonne heure une église paroissiale: elle est citée dans le Cartulaire du chapitre /101/ de Lausanne. Le prieur de Lutry en avait la collation 1 ; ce qui prouve qu’en effet, comme on le dit, Charmey appartint d’abord à la paroisse de Broch, dont il ne tarda pas à se détacher.
« Les habitants du Val de Charmey, séparés du reste du monde, ont dans le caractère et la physionomie des traits qui les distinguent » 2 . Si on en croit la tradition, cette contrée était anciennement plus peuplée qu’elle ne l’est aujourd’hui, « preuve, dit Bourquenoud, que la formation des grands domaines, soit dans les Alpes, soit dans le plat pays, nuit à la population, en mettant entre les mains d’un seul ce qui suffirait à l’entretien de plusieurs familles. » Le goût de l’émigration, naturel aux Suisses, a gagné à son tour le Val de Charmey, et contribué pour sa part à diminuer le nombre de ses habitants.
Un des plus beaux sites de la Gruyère est celui du riche et beau village de Charmey, dont le séjour est délicieux pendant la belle saison 3 . On montre, au sud de ce village, un chemin qui a conservé jusqu’à nos jours le nom de la Charrière de Crève-cœur, que lui donna l’épouse de l’un des derniers comtes de Gruyère, qui, de la tour du château de Montsalvens, voyait son infidèle époux, monté sur un cheval blanc, suivre un chemin détourné pour aller en bonne fortune à Charmey, dont les femmes ont toujours passé pour être vives, gentilles et spirituelles. Ce chemin est à la Monse, endroit qui ne compte aujourd’hui que quelques maisons et une chapelle. /102/
Le seigneur de Charmey avait jadis son château fort; celui-ci était bâti sur une éminence ou sur un rocher qui commandait la vallée, et qui a conservé, comme la colline de Château-d’Œx et beaucoup d’autres, le nom de la Motte. Un document nous enseigne que ce château existait encore en 1328 1 . Les derniers restes de ce fort ont disparu, dit-on, en 1824. Plus bas était le manoir des seigneurs de Pré, de prato: il a depuis longtemps cessé d’exister, ainsi que la famille de Pré, qui possédait des fiefs et des domaines considérables dans la contrée.
Au nord de Charmey, sur la rive droite du Javro, on voit les restes du monastère de la Val-Sainte, fondé en 1295 dans une contrée inculte, que les laborieux solitaires eurent bientôt défrichée.
3° A l’extrémité de la vallée que ferme l’étranglement ou le passage étroit appelé Clus, est le village de Bellegarde, situé sur une pente rapide, entouré de monts sourcilleux, tantôt nus, tantôt couverts de verdure et de sapins, qui donnent au défilé un aspect plus redoutable. Cet étroit passage était trop important à l’époque de la féodalité pour qu’on négligeât de le garder et d’en tirer parti. On y bâtit une forteresse sur un rocher affreux qui commande le défilé. Le nom de ce château, qui passa au village, était Bellegarde: en allemand on lui a donné le nom du torrent (Jaun) qui le traverse. Ce lieu d’agression et de défense, assiégé en 1407 par les gens de Thun, de Frutigen et du Simmenthal, fut forcé et détruit à peu près dans le même /103/ temps que ceux d’Œx et du Vanel, et ses restes abandonnés aux oiseaux et aux reptiles. La tour ruinée de cette bretêche est masquée par des sapins sur une pente boisée qui domine la route de Weibelsried, à un quart de lieue au delà du village de Bellegarde.
N’oublions pas de dire que ce village avait au commencement du XIIIe siècle une église paroissiale, dont le seigneur de Bellegarde avait la collation 1 . Cette paroisse comprenait, entre autres hameaux, Im Fang, Zur Eich, et la population de diverses habitations éparses dans la plaine et sur les montagnes.
Ormonts.
Si les Ormonts figurent sur la carte et dans la topographie de la Gruyère, c’est parce que les comtes de Gruyère eurent pendant le XVe siècle des possessions et des droits considérables dans cette intéressante contrée. Ils furent avec les Pontverre, seigneurs de St.-Tryphon, avec les de Vallaise 2 et les d’Illens, coseigneurs d’Aigremont et du Val d’Ormont 3 , comme on disait alors. Les Bernois y avaient aussi quelques droits. La branche bâtarde de la maison de Gruyère reçut le nom d’Aigremont, qu’elle conserva comme nom de famille jusqu’à son extinction. /104/
Cette contrée, l’une des plus élevées et des plus remarquables des Alpes, que l’on distingue en Ormont-dessous et Ormont-dessus, s’étend, d’un côté, le long de la Grande-Eau qui la traverse dans toute sa longueur, jusqu’au col du Pillon, de l’autre, depuis la montagne dite la Charbonnière, et des Mosses, jusqu’au Sex-rouge et aux Diablerets. Sa longueur, égale à sa largeur, est de quatre lieues. La vallée principale, proprement dite le Val d’Ormont, et plusieurs vallons latéraux, dont le plus grand est celui d’Essergilloz, forment cette ancienne seigneurie, dont l’entière possession eût été l’un des plus beaux fleurons de la couronne de Gruyère.
Les Ormonts sont bien connus par le Conservateur suisse 1 . Nous n’en citerons que peu d’endroits: dans la vallée d’Ormont-dessous, les villages de Sepey, le Seppetum des vieilles chartes, des Voètes et de la Forclaz; dans celle d’Ormont-dessus, le lieu dit Vers l’Eglise, autrefois nommé la Chapelle, où se rassemblent, comme jadis, les ouailles des hameaux et des habitations pastorales des environs.
La seule éminence d’où l’on pût dominer en quelque sorte le Val d’Ormont était occupée par un château fort, dont les restes attestent la solidité. Ce château, élevé dans l’angle obtus que forment la Grande-Eau et le torrent de la Rionzettaz, sur un roc escarpé, pour ainsi dire inaccessible, s’appelait le château d’Aigremont, Acrimontis, nom qui répondait à la situation de cette redoutable forteresse. Le village des Voètes était à ses pieds. Aigremont commandait la vallée principale, et barrait les passages ou chemins étroits qui conduisaient l’un, par les Mosses, à la vallée de /105/ Château-d’Œx, l’autre, par le col du Pillon, dans le pays de Gessenay, et il interceptait toute communication avec le pays d’Aigle ou du Chablais. On conçoit que cette position avantageuse convenait aux comtes de Gruyère, et il y a lieu de croire que la tradition qui leur attribue la construction de ce fort n’est pas erronée.
Le château d’Aigremont était-il destiné à protéger les pâtres du pays ou à les opprimer? La réponse est facile. Comme telle autre forteresse féodale, Aigremont était un double symbole de la domination et de la servitude, un lieu d’attaque et de défense. Il ne reste aujourd’hui de cet antique manoir que trois pans de murs et les débris d’une tour. Ces ruines sont masquées par une forêt. Telle tradition raconte, qu’impatients du joug qui pesait sur eux, les Ormonins le secouèrent, qu’ils attaquèrent bravement cet odieux repaire de la tyrannie, et y mirent le feu. Telle autre rapporte un fait mémorable qui s’est conservé dans le souvenir du peuple. Une dame d’Aigremont se trouvant seule dans ce château, exposée à un grand péril, les habitants du village de la Forclaz accoururent à son secours 1 . Touchée de /106/ cette preuve de dévouement, la noble dame fit don à ses libérateurs d’une montagne aux gras pâturages, sous la condition expresse que les femmes en auraient à toujours une part égale à celle des hommes. Aujourd’hui même toute paysanne de la Forclaz qui se marie hors de sa commune, retire sa part des fromages et autres produits de la montagne de Perche, dont la moitié fut jadis réservée à son sexe.
GLOSSAIRES DES PRINCIPAUX NOMS GÉOGRAPHIQUES DU COMTÉ DE GRUYÈRE.
Observations.
Les noms de lieux, de torrents et de montagnes du pays de Gessenay, jusqu’au Vanel, ou sur la rive droite de la Sarine jusqu’au « Flendru des Crêts », sont allemands; les noms de propriétés, ceux de familles, et la plupart des documents de cette contrée appartiennent à la même langue; d’où il suit que les anciens habitants du Gessenay étaient de race germaine, et que, conformément à la tradition, les premiers colons de ce pays furent des Alamanni. Dès le Vanel, les noms appartiennent à un autre idiome: ils sont dérivés du latin. La langue parlée dans cette partie de l’Helvétie occidentale, c’est-à-dire le dialecte roman, offre des éléments presque tous latins, un peu de grec, ou plutôt du latin formé du grec, point de celtique, quelques mots teutons, dont il est facile d’expliquer la présence. A cela près, on ne trouve que des noms romans dans la Basse-Gruyère; ce qui prouve, non-seulement que les Gallo-romains ont pénétré dans cette contrée, mais encore que les Bourgondes s’étaient familiarisés promptement avec le vocabulaire de la langue romane ou rustique, et que leur idiome maternel disparut devant celui de la population indigène, tout comme au premier contact avec les Romains, leur culte grossier avait fait place à la religion chrétienne. /108/
Je ne puis, à la vérité, faire connaître la signification de tous les noms de la Gruyère romane. Il faudrait, pour cela, bien connaître le patois qu’on y parle, trouver la véritable orthographe des noms altérés, afin de pouvoir en indiquer la racine; il faudrait étudier avec le plus grand soin non-seulement la langue et les mœurs de la contrée, mais aussi la nature et le caractère de chaque localité, et pouvoir se représenter chaque endroit tel qu’il était avant qu’il eût subi une transformation. D’autres difficultés se présentent: il faut compter les mutilations, les déplacements de lettres, les contractions et les additions qui ont défiguré les mots, bref ces changements bizarres dont notre glossaire offre plusieurs exemples 1 .
Il me suffit, pour le but que je me propose, de donner l’étymologie et le sens d’un assez grand nombre de noms géographiques de la partie allemande et de la partie romane de l’ancien comté de Gruyère: ils donnent des indications historiques assez précieuses. D’autres amis du vieux langage découvriront le sens de plusieurs vocables que je ne saurais expliquer. Il n’est point nécessaire pour cela de recourir aux étymologies les plus savantes, ni d’interroger les débris du langage celtique. Mon essai montre que, loin d’emprunter des dénominations à une langue qui jamais ne fut entendue dans la Gruyère, les anciens habitants des montagnes et ceux de la plaine ont pris chacun dans la langue de leur race, c’est-à-dire les uns dans l’idiome germain, les autres dans le roman, les mots propres à désigner les terres, les eaux, les diverses localités de leur nouvelle patrie.
I.
Glossaire des noms allemands
Almend 1 , Allmende, Allmeinde, de al ou all, qui signifie tous, à tous, en commun, et mend, que l’on retrouve sous les différentes formes du frison made, de l’anglais meadow, du teuton mad, mat et matte, très-usité dans la Suisse allemande, où ce mot, comme ceux de la même famille, désigne une prairie. Un document du XVe siècle, relatif au pays de Gessenay, présente le mot meder 2 , plur. de med ou mad. — Le composé allmende servait à désigner les pâturages communs 3 , les « usages », c’est-à-dire les terrains vagues, qui appartenaient à une commune, et où tous les membres de la commune pouvaient faire paître leurs bestiaux.
Alp, Alpe, Alb, Alban, signifiait primitivement une hauteur, une montagne; de là vient que la Haute-Ecosse a /110/ porté le nom de Scotia albiensis 1 . Ce mot a conservé son ancienne signification, comme nom propre au pluriel: il se dit particulièrement des montagnes qui séparent la France et la Suisse de l’Italie.
Dans une note sur le vers 474 du IIIe chant des Géorgiques, le grammairien Servius remarque qu’en donnant aux Alpes l’épithète d’aériennes, aërias Alpes, le poète a exprimé le sens du premier de ces mots par un équivalent, le mot Alpes signifiant hautes montagnes dans la langue des Gaulois, c’est-à-dire en celtique. — Les Romains ayant adopté ce vocable étranger, le transmirent avec leur langue à d’autres peuples. Dans l’idiome alamannique et dans le roman, Alp ou Alpe (au singulier) sert à désigner particulièrement un pâturage élevé, ce qu’on appelle vulgairement une montagne. De Alpe se sont formés, dans le moyen-âge, les mots alpare, alper, faire paître les bestiaux à la montagne, et alpagium, alpage, c’est-à-dire haut pâturage. — Le mot alpage s’emploie, de plus, en jurisprudence, pour le droit de faire paître des troupeaux dans les Alpes.
Bac. Ce mot, qui signifie un ruisseau, un torrent, sert à composer une quantité de noms. Je ne cite que Rubli-bac, nom du ruisseau qui descend du mont Rubli et se jette dans la Sarine, au-dessous de Rougemont. Je fais choix de ce nom, parce qu’il offre un exemple de l’existence de dénominations teutones dans le pays roman. Le mot bac, aujourd’hui bach, de même que becher (coupe), appartient à l’idiome des Germains; il a du moins une origine commune avec le mot bec (holl. beek), que les hommes du Nord ont transporté dans certaines contrées, et qui termine plusieurs noms français, /111/ tels que Caudebec-en-Caux, Foulbec, Bolbec, Corbec. (Cp. Corbach, ville de la principauté de Waldeck et Pyrmont.) De bac vient le prétendu mot roman bay ou baye, qui indique un ruisseau, un torrent. Baye est le nom d’un ruisseau du cercle de Villeneuve, qui passe à Noville et se jette dans le Léman. On appelle encore de ce nom un torrent bien connu, qu’une ancienne charte désigne sous le nom de « la baye de Mustruz », c’est-à-dire de Montreux, et, près de Clarens, une autre eau sauvage, que l’art est parvenu à dompter, en contenant dans son lit cet impétueux torrent, jadis si funeste à la contrée.
Bocken, Bokten ou Botken, noms de la Tine dans l’idiome allemand. Les deux premiers paraissent être des formes altérées de Bucht, qui désignerait le cours sinueux de la Sarine, qui à cet endroit forme un angle ou sinus. Peut-être conviendrait-il de donner la préférence à la forme Botken, que l’on rencontre aussi dans l’une ou l’autre charte 1 ; cette forme se rapproche de Bottich (cuve, tonneau), et rend plus exactement le sens du mot Tine.
Broc, Broch (plus fréquent), Broth (faute de copiste, pour Broch), Brok (sur la carte de Samuel Loup), broyc (dans un vidimus de l’an 1115), Bruck. Ce dernier vocable indiquerait que le village de Broc a pris son nom du pont jeté sur la Sarine en cet endroit. Il est beaucoup de lieux qui doivent leur nom au pont jeté sur la rivière qui coule auprès: tels sont, par exemple, Bruck ou Brugg en Argovie, Pont en Ogo, Sarrebruck, Innsbruck. — Le mot Broch, qui, quant au sens, ne diffère peut-être de Broc (pour Bruck) que par un signe d’aspiration, peut donner lieu à plus d’une /112/ conjecture, suivant qu’on le considère: 1° comme ayant la même origine que brach, qui se dit d’une terre en friche, en jachère, d’où vient brachen, jachérer, labourer les jachères 1 ; 2° comme venant de brechen, qui signifie rompre la terre, et tirer des pierres d’une carrière (de là Steinbruch). On pourrait aussi dire que le nom de Broch semble indiquer qu’en cet endroit la Sarine s’est frayé avec violence un passage au pied de la montagne qui domine ce village, et qui lui doit son nom. Quoi qu’il en soit, l’origine germaine de ce nom est incontestable.
Clus ou Klus. Voyez le mot Cluse au Glossaire des noms romans.
Ebni, pour Ebne, Ebene, répond au mot Plan, si commun dans le roman pour plaine. On trouve aussi les formes Èbi, Èbe, abrév. de Ebeni, Ebani dans l’ancien allemand; En der Èbe, in der Èbi, et « in der Ebni », signifie dans la plaine, et désigne spécialement dans la Haute-Gruyère, la plaine parsemée d’habitations près de Gessenay.
Greiers, Greierz, Griers, formes alamanniques du mot Gruyère.
Griesbach, — plus correct que Grieschbach, — nom de plusieurs localités 2 , est composé de Gries, gravier, et bach, ruisseau. Ce nom sert, dans la haute Gruyère, à désigner le grand Flendru, c’est-à-dire un torrent sauvage, qui charrie du gravier, des pierres, etc.
G’stad ou G’stade, pour Gestad (comme porte la carte /113/ de Samuel Loup) ou Gestade. On dit aussi am G’stad. — Gestade est formé de Stad, comme Gefilde est formé de Feld. Stad ou Stade, et Statt, Stætte, désignent une place, un lieu, un endroit; Gestade indique en particulier un bord, un rivage. Tel est le sens de ce mot, par exemple, dans le nom de Stanz-Stad, qui sert de port à Stanz. Le village gruérien de G’stad doit son nom à sa situation au bord de la Sarine, qui reçoit près de ce lieu les eaux réunies de la Lauenen et de la Tur.
G’steig, pour Gesteig (comme on lit sur la carte de Samuel Loup), formé de Steig, de Stege ou de Steg, qu’on trouve dans les noms de plusieurs villages suisses, situés à l’entrée ou près d’un passage de montagne, etc., tels que Am-steg, Kander-steg, etc. On connaît un G’steig près d’Inlerlaken, appelé Stega dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne, p. 26; un autre G’steig près du Simplon, en Vallais; G’steig dans le pays de Gessenay, appelé Steig dans les Visites pastorales de 1453. (V. Abhandl. ou Mém. de la Société d’histoire de Berne, T. Ier, p. 342). Le mot Stege sert encore aujourd’hui à désigner un sentier, un passage, une montée; il répond assez exactement au mot Col. Comp. στἐγος culmen (Kulm). On sait que le Châtelet est situé à l’endroit où se joignent les deux passages du Sanetsch et du Pillon, circonstance à laquelle ce village doit le nom allemand de G’steig.
Jaun. Voy. Jogne, au Glossaire des noms romans.
Lauenen ou Lauinen (Lawinen) nom d’un village et d’un torrent qui tire son nom soit des masses de neige (Lawinen, lavanches, avalanches) qui roulent des montagnes et grossissent son lit, soit plutôt de la chute impétueuse de ses eaux (avalaison, avalasse). /114/
Moos ou moor, au pl. möser, désigne un marais, une plaine marécageuse, par exemple, das grosse Moos, le marais d’Anet. Cp. Bannmoos; Ennemöser; Hahnenmoos, près d’Adelboden; Rormoos, près de Bourgdorf; Moos-ried; Moos-bad, près d’Uri; Sanenmöser, les marais près de Gessenay; Moorgarten, etc. De moos est venu le mot mosse, usité dans la Suisse romane, en particulier dans la Gruyère, où on remarque les Mosses et la Mossetta, entre Ormont-dessous et Château-d’Œx.
Ogo. Voyez p. 51.
Rublibac, ruyblibac. Voyez bac et rubli au Glossaire des noms romans.
Sanen et Sannen, dans les documents allemands et parfois dans les documents latins; autrement Gessenay (en français), Gessanei, Geceney, Gissani, Gissany, Gisinay, Gisneys, Gisseney, Gissinai, Gissinay; Gissine, Gissineis, Gissiney, Gissineys; Gissiniacum; Gysseneys, Gyssinei, Gyssineis, Gyssiney. Ce nom, sous ses diverses formes, emprunté à l’ancien allemand Giessinen, qui désigne des cascades ou chutes d’eau, et dérivé de giessen, verser, répandre, convenait au torrent qui, s’échappant des monts, se précipite dans la vallée qu’il traverse dans son cours sinueux 1 — On peut considérer comme une abréviation de ce nom les mots Senin, nom de la vallée du mont Sanetsch, Sanen, nom du grand bassin de Gessenay et du village principal; « de là (c’est-à-dire de Giessenen) vient Sanen », dit Muller, ibid., et de là vient encore apparemment Sanetsch, nom de la montagne d’où le torrent s’élance en écumant. /115/
De Bonstetten 1 a dit que dans le nord de l’Allemagne Sane est usité pour Rahm, qui signifie de la crême; en sorte que, d’après cette étymologie, qui est évidemment fausse, le Sanenland aurait désigné à peu près le pays
« où des ruisseaux de lait serpentaient dans les plaines. »
De Bonstetten, en proposant cette étymologie, pensait moins à la nature du pays de Gessenay qu’aux produits du bétail, dont la culture fait la principale occupation du peuple pasteur qui l’habite.
Le nom allemand du torrent principal qui arrose ce pays et qui lui a donné son nom est Sane, dont paraît s’être formé le mot latin Sanona (dans le Cartul. du chap. de Lausanne), d’où sont venus, par altération, Saruna ou Serona, Serunaz, Sorona, en roman ou en français Sarine, et parfois Sérone, et même Seroye (pour Sérone?), dans les chartes.
Schœnried, composé de schœn, beau, et ried, essart ou essert. Voyez ce dernier mot au Glossaire des noms romans. La « villa de Syonnerrier, ou plutôt de Syonneriet », comme a lu M. Cibrario (Sigilli et monete, Tor. 1833, p. 224 et suiv.) n’est pas autre chose que la terre de Schœnried, 2 , nom qu’une bouche romane a défiguré jusqu’à le rendre méconnaissable.
Schwabenried (le Chawenried, mot barbare, de la carte de Sl. Loup), signifie l’essert des Souabes ou des Suèves 3 .
Sense, en français Singine, qui vient probablement de Sense, nom allemand de cette rivière: elle le doit peut-être à sa forme, qui est celle d’une faux.
II.
Glossaire des noms romans.
Aigremont. Ce château porte d’ordinaire dans les documents latins le nom d’acrimontis, rarement celui d’agrimontis, qui ne diffère du premier que par l’emploi d’ailleurs fréquent du g pour le c. — Acrimontis est formé de mons, mont, et de acer, acris, acre, d’où sont venus nos mots âcre, aigre, aigu, et aiguille, dans le sens de pic ou piton. Aigremont désigne un mont escarpé, un rocher aigu, élevé, et, de plus, le château-fort construit à son sommet. — Cp. les mots ἄχρος et ἄχρα
.
Il y avait d’autres châteaux de ce nom, par exemple, un dans le comté de Montbéliard, un autre qui a donné son nom à la ville d’Aigremont-le-Duc, Agramontium, (Haute-Marne), un troisième dans les Pays-Bas. Aigremont est encore le nom d’une éminence vis-à-vis du village Villars-les-Luxeul, sur laquelle on voit les vestiges du camp que César y dressa dans la guerre contre Arioviste. V. Bull. de l’acad. des sciences de Besançon, du 24 août 1845, p. 99.
Albergioux, Albergeux, signifie une terre ou des terres et des habitations données en abergement, soit à bail emphytéotique. Ce mot, de même que le verbe alberger, et auberge, héberger, etc., vient du roman alberga; en allem. herberge. Le mot abergieux (pour albergieux ) est employé, dans un document du 20 janvier 1528, pour abergataire. /117/ Albergieux est devenu, comme abergement, un nom de localité.
Albergariæ, albergue, se disait du cens annuel que payait l’abergataire, appelé aussi albergensis.
Albeuve, Albaigue, Albègue, Arbègue; Albeue (albève), Arbevi; Erbivue; Albevue (Albeuve), Albaui (albavi), du latin alba aqua, nom que cet endroit porte dans les vieilles chartes et qu’il a tiré de l’eau blanchâtre et savonneuse qui coule auprès. Du mot aqua sont venus ève, ive, comme dans Nérive (voyez ce mot), aigue (et ègue), comme dans Aigue-belle, aqua bella (en Savoie), Aigue-perse, aqua sparsa (Puy-de-Dôme), Chaudes-aigues, aquæ calidæ (Cantal ); Aigues-mortes, aquæ mortuæ (Gard), Aigues-vives, c’est-à-dire Eaux-vives, aquæ vivæ (Gard); Aygas-sec (en patois), aquœ siccæ, en France; Noire-aigue, nigra aqua (canton de Neuchâtel), Roge-ègue, pour Rogive et Rogivue, pour lequel on trouve aussi Rogevuyt, rubea aqua (district d’Oron). De là nous est aussi venu le mot aiguière, aquarium.
Arbègue pour Albègue, ou Arbevi pour Albevi, offre un exemple de la mutation ancienne et fréquente de la lettre l en r, et réciproquement. On trouve, dans les documents et les chroniques, arbo castra pour albo castro, Weissenbourg, ou Blankenbourg; almaliolum pour armariolum, diminutif d’armarium, armoire 1 ; alma pour arma; almaille pour armaille 2 , /118/ (d’armentum), d’où est venu le mot aumailles 1 , qui sert en France à désigner les bêtes à cornes; arpium pour alpium, arpare pour alpare; barma pour balma, la Baume; Echallens pour Echarlens; Willermus pour Willelmus, et l’inverse. On a remarqué naguère, dans le dialecte vénitien, canarreggio pour canal reggio, et dans l’antiquité, lilium (lis), de λεἰριου, Latiaris pour Latialis, Parilia pour Palilia, etc.
Alpe. Voyez au Glossaire des noms allemands.
Arsa ou les Arses, du latin arsus, a, um, conservé dans le français arse du verbe ardoir, qui signifie brûlée. Je ne sais à quelle circonstance le hameau des Arses doit son nom. — Le nom du bourg d’Ars, dans l’Ile de Ré, paraît venir du même verbe.
Ausorensis vallis. Voyez au mot Oex.
Bataille, bastille, Bastillon. Voyez p. 82 et 100. Comp. Bastie, nom de plusieurs châteaux forts, dont l’un, la Bastie ou Bâtie près de Genève, « en la terre (ou dans la baronnie) de Gex », docum. du 18 déc. 1550; bastion et tour bastionnée; adopté par les Allemands, dans le mot Bastei.
Bay et Baye. Voyez le mot bac, au Glossaire allemand.
Bellegarde, Bellagarda, Bellawarda, lieu facile à garder et à défendre, de bella, belle, et garda, garde, dans la basse latinité guardia (d’où guardianus, guardiator et guardio, gardien), autrement warda, qui, dans le patois roman, se prononce vouerda ou vouarda, et signifie garder.
Le mot garde ou warda répond à l’allemand warte, qui indique une tour d’observation, et à l’anglais ward, qui a, pour ainsi dire, le même sens. L’emploi de v ou w pour g, /119/ et réciproquement, est bien connu. On pourrait dire que ces mots sont d’origine germanique. Dans ce cas Bellegarde serait un nom composé d’un mot latin ou roman et d’un mot germain; ce qui ne doit point surprendre, si l’on considère que ce château et le village qui lui doit son nom étaient situés sur les limites du pays roman et du pays allemand, c’est-à-dire dans l’une de ces nombreuses contrées dont la population est mixte et se sert des deux idiomes, qu’elle mélange. La Suisse romane offre d’autres exemples de noms hybrides ou tirés de deux langues, tels que Bubenberg et Rublibac.
Les Suisses allemands donnent au village et au château de Bellegarde le nom du torrent (Jaun, Jogne), qui coule auprès.
Les Celtomanes paraissent avoir défiguré le nom de Bellegarde en écrivant Balla guarda, qu’ils expliquent en disant qu’en celtique bal signifie rempart et château, et garth, un lieu élevé, une montagne. « Credat Judæus Apella. Non ego. »
Charmey, Charmay, Charmeis, Charmex, Charmeys, Charmyn. Ce nom ne vient pas du prétendu celtique « carmaës, belle prairie », comme on l’a répété depuis Bridel. Il est facile de prouver qu’il appartient à l’idiome roman. L’orthographe la plus ancienne et la plus authentique du nom de ce village est Chalmeis, pour lequel on trouve quelquefois Chalmex, et, pour l’un et l’autre, Charmeis et Charmex 1 . Au lieu de Chalmeis, les Suisses de langue allemande disaient Galmes ou Galmis, en donnant au G un son guttural /120/ assez semblable à celui du Ch aspiré 1 . Il n’est donc pas exact de dire qu’en allemand Charmey s’appelle Galmis, ou Galmitz, ou même Gulmitz, comme on lit dans la 14e lettre de M. de Bonstetten. Dans Chalmeis et Charmeis la lettre h a été ajoutée au c, comme dans mille autres mots dérivés ou formés du latin: la lettre r a remplacé la lettre l, suivant un usage antique et bien connu 2 . Chalmes ou Chalmis vient de calma ou calmes, mots de la basse latinité, fréquents dans les vieilles chartes, et qui viennent du latin calamus, d’origine grecque (χαλἀμη - χἀλαμος
), qui signifie roseau, tuyau de blé (all. halm), chaume, et dont s’est formé par syncope calmus, puis culmus (seul usité), qui servit à désigner plus particulièrement le chaume dont on couvre les chaumières.
Il n’est pas toujours facile de déterminer le sens du mot calma ou calmes. Ducange cite des passages tirés de chartes du VIIe et du VIIIe siècle, où calma paraît indiquer tantôt le chaume, tantôt un champ de blé 3 . Suivant le Supplément à son Glossaire, calma signifierait, au contraire, une terre maigre, inculte, couverte de bruyères, « bruarium ». Dans un passage d’une charte de l’an 1035, le mot calma semble, en effet, désigner une lande, un terrain désert 4 . /121/
Dans l’arrêt donné par Louis le Jeune, en 1153, au profit de l’évêque de Langres contre le duc de Bourgogne, celui-ci exige de l’évêque « ut destruat michi calmam et fossatum quod factum est apud Mussi. »
Il est évident que les définitions de calma, dans le Glossaire de Ducange et dans le Supplément, ne conviennent point au passage qu’on vient de lire, et que, suivant la remarque de Brussel en cet endroit, « calma signifie une grange munie de quelques fortifications », ainsi que le prouve la réponse de l’évêque à la prétention du duc: « Calmam destruere nolo, tum quia frater meus eam ædificavit … tum quia in vagio Sancti Mammetis facta est, et ad eum nichil pertinet, et alia munitio in finagio eius prius fuit et propior Castellioni 1 ».
L’opinion de Brussel est fondée sur une preuve positive, à laquelle nous ajoutons un passage plus explicite, tiré d’une charte de 1405, et cité dans le Supplément au Glossaire de Ducange: « … Johannes de Foresta valletus advouhom … (?) unam calmam, sitam ante portam dicti mei arbergamenti; quæ quidem calma est appellata Gardia ».
Calmes paraît avoir la même signification dans quelques documents du XIIIe siècle, rassemblés dans le cartulaire inédit de la chartreuse d’Oujon. Il y est plus d’une fois question d’une calmes ou chalmes rotunda, longa, etc.; ce qui ne peut s’entendre d’une terre soit inculte, soit défrichée et labourable 2 . /122/
Calama, soit calma, calmes ou chalmes, signifie chaume, et calmaria, chaumière: le premier de ces vocables a servi, sous ses diverses formes, à désigner un champ couvert de chaume, la partie d’un bois en friche qu’on ne peut cultiver, la paille du toit, ou simplement le chaume, et, de plus, au figuré (comme le mot chaume), une chaumière, une habitation 1 ; puis une maison environnée d’un mur et d’un fossé; enfin un assemblage de maisons, un hameau 2 , désigné par la dénomination de chalmes, galmis, soit de chaume ou de chaux 3 , noms que portent encore de nos jours plusieurs localités, telles que la Chaux, dans le district de Cossonay, la Chaux-de-Fonds, la Chaux d’Arlier 4 , Chaumes (« Calamæ »), ville du département de Seine-et-Marne; Galmis, au nord du lac de Morat; Galmis, de Chalmes, d’où Charmey, dans la Gruyère.
Chenaux, Chenaul, Chinaul, Chinaulx, Lachinauz: c’est /123/ le nom de plusieurs villages ou hameaux, dits la Chenaux, pour Chenau ou Cheneau. Ce nom, qui est dû sans doute à quelque accident du sol, à quelque circonstance locale, a été formé de chenal, qui vient de canalis, tout comme Chesaux ou Cheseaux, autre nom de lieu, s’est formé de chesal, qui vient de casalis ou casale.
Cluse (Clus ou Klus dans la Suisse allemande), passage étroit entre des montagnes, ou le long d’une rivière, tel que celui qui conduit du canton de Fribourg dans le Simmenthal; étranglement d’une vallée, tel que celui que forme la Cluse de Gex, ou la ville de Cluse en Faucigny, qui resserre la vallée de l’Arve. — Le château de la Cluse, dont il n’existe plus de vestiges, et qui couronnait la montagne de Larmont, vis-à-vis du fort de Joux 1 , défendait un chemin ou gardait un défilé. Maint château féodal dut à une situation analogue le nom de Clausura ou de Clusura, que lui donnent les écrivains du moyen-âge. — Citons encore les Francorum Clusæ, appelées par Cassiodore 2 Augustanæ clausuræ ou clusuræ, c’est-à-dire la Cluse et la route étroite ou serrée de la vallée qui conduit d’Aoste (Augusta Prætoria) à l’hospice du St.-Bernard.
L’origine du mot Cluse et de son dérivé est latine. Les Anciens disaient clusura pour clausura, tout comme ils disaient clusus pour clausus. Cluse, de Clusa (via), de cludo (claudo), je ferme, signifiait un passage étroit, un chemin barré. Cp. le mot Forclaz.
Combes (doc. de 1312), Cumbes (doc.de 1238), Combaz, dimin. Combettaz (cp. Comballaz). Le nom de Cumbes ou /124/ de Combes (plus fréquent), donné à beaucoup de localités, se retrouve dans « catacumbæ », qui est un mot de la basse latinité, ainsi que le singulier Cumba, qui se présente, par exemple, dans Alta-cumba, Haute-combe. Il vient, soit de χὐμβη, cumba, cymba, nacelle creuse, dimin. cumbila, cymbula, canot, soit de χὐμβος, cavité, grotte, vallée profonde. Tous les lieux appelés Combes doivent ce nom à leur situation dans un enfoncement, ou dans une vallée. Ce dernier mot était remplacé dans le vieux langage par celui de combe. Cp. Combs-la-ville (pour Combes, de Cumbæ), dans le Polyptique d’Irminon, p. 861.
Corbières, Corberia ( Corberiæ ), d’ordinaire Corberiæ (Corberiarum); Corberes (« castrum de Corberes »), Corbers; Gorbiers, dans un document de l’an 1292, pour Corbières. Il y a plusieurs endroits ou localités de ce nom: Corbières sur la Sarine; un château de Corbière, « situé au bord du Rhône, sur la rive droite, à trois lieues en aval de Genève » 1 ; la vallée de Corbières en Languedoc. On appelle aussi les Corbières une chaîne calcaire du Roussillon.— Cp. Corbeyrier, hameau entre Roche et Yvorne.
L’origine du nom de Corbières m’est inconnue, quoiqu’elle ne soit peut-être pas difficile à découvrir. A coup sûr, le siége des sires de Corbières ne devait pas son nom au corbeau qui figurait dans leur écusson, pas plus que Gruyère ne devait le sien à la grue. Chacun de ces symboles, armes parlantes, exprimait le nom de la terre et du seigneur qui l’avait adopté.
Crésus, Cresut; Croset (dans un doc. de 1291). Un ami /125/ du celtique rapprocherait peut-être de ces noms le mot Cruzye, qui, dans Walter Scott, est le nom d’une montagne d’Ecosse. — Cruzy est le nom d’une ville du département de l’Hérault, et Cruzy-le-châtel, qui offre une analogie frappante avec Crésus près de Châtel-sur-Montsalvens, est le nom d’un endroit (d’un château?) du départem. de l’Yonne. On pourrait nommer encore le Creuzot, village connu par ses mines de charbon, dans le département de Saône-et-Loire. Croset, ancien nom de notre village gruérien, est aussi le nom d’une montagne de la Gruyère. — Ne pouvant donner l’étymologie des mots Croset, Crésus, etc., je préfère renoncer à des conjectures dont le résultat ne serait pas concluant.
Cuves (doc. de 1276), du latin cupa, lequel vient du grec χύπη, qui signifie cavité, caverne, et qui servait aussi à désigner une sorte de vaisseau, tout comme l’adj. cybea ou cybæa (navis), qui vient de χυβἠ. A ces deux vocables grecs répondent le latin cupa, le français coupe et cuve, l’allemand Kufe, Kuffel, Kübel, l’anglais cup, le hollandais kuip. Tous ces mots ont la même origine. Cuves indique un lieu situé dans un creux vallon. Il y a plusieurs endroits de ce nom, par exemple, notre Cuves, près de Rossinière, et le bourg de Cuves dans le département de la Manche.
En-Ey. Le nom de ce village se présente, dans les documents et sur les cartes, sous les diverses formes de Enney, Ennez; Eye, Eys et Ez; Heney; Heyz et Nay. — En-ey est composé d’une préposition et d’un nom substantif, dont l’orthographe la plus correcte serait eis, qui vient du latin insula, en italien isola, et qui signifie une île. En-eis (ou en-eys, en-ey) indiquerait donc un endroit situé dans une île. Cette dénomination convenait parfaitement au village /126/ qui nous occupe, lequel est arrosé à l’est par la Sarine, au nord par le torrent d’En-ey, et au sud par le rio (ruisseau) d’Afflon, qui font de cet endroit en quelque sorte une île, qui a failli être engloutie par ces eaux sauvages.
Le nom d’un autre endroit de la Suisse s’offre à l’appui de l’étymologie que je viens de donner. Près de Cerlier est un village à l’entrée d’un grand marais, qui, à l’époque des pluies ou de la fonte des neiges, l’environnait d’eaux, et en faisait une île. Ce village a pris de là le nom soi-disant allemand de Ins, abréviation d’Insel ou d’insula; en patois Eis. Les Welches ou Romans l’appellent Anet. Ce nom, mal orthographié, est composé de la préposition an pour en, et du nom substantif et pour es ou eis. La preuve de la justesse de notre remarque se trouve dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne, de l’an 1228, p. 15 et 33, où on lit An-es, et dans les Visites pastorales de 1453, où on lit plus d’une fois An-es, An-ez, mot que l’auteur a rendu par Inns. Voy. « Abhandlungen » ou Mémoires de la Société d’histoire de Berne, T. Ier, p. 308, 309, 310 et 375. On trouve Hanes dans un document de 1265. Voy. Kopp, Geschichte der eidg. Bünde, L. IV, p. 77, note 4. Cp. ibid., p. 76, note5.
Erbivue. Voyez au mot Albeuve.
Essert. Essertum, «villa de Esserto »; autrement Essart (par exemple, les Essarts, en Vendée). Ces mots indiquent une terre défrichée: le premier, qui vient de exsero, exsertum, arracher, défricher en arrachant les bois, les épines, est plus correct que le second (essart), qu’on dérive de exsarcio, exsartum, qui a un sens bien différent. — Essert répond à Ried, mot fréquent dans la Suisse allemande, de la même origine que les diminutifs rüti, g’rütli, qui viennent du bas allemand rüten pour reuten, dont le composé ausreuten signifie extirper, déraciner, défricher. Remarquez que ce verbe est formé du latin eruere, erutum, qui a la /127/ même signification, par exemple, dans un passage de Virgile, Géorg. II, v. 207-210.
Estavanens, « de stavanens », Extavanens (doc. de 1231 et 1245). Il suffit de rapprocher ce nom du mot estevenante pour se persuader qu’ils ont une origine commune. Or, la livre estevenante est dite ainsi du nom de Stephanus (archevêque de Besançon au XIIIe siècle) 1 , que l’on rendait en français par Estienne (Etienne), Estève, Estevène, en allemand par Stephan et Steffen, en anglais par Stephen, en hollandais par Steven. — On dirait que le village d’Estavanens, comme celui de St.-Stephan dans le Simmenthal, fut ainsi nommé en l’honneur de St.-Etienne.
Etivaz (vallée et village de l’Etivaz), « communitas vallis de leytivaz, parochie de Oyez », doc. de l’an 1514; « la vault de Leytiva », doc. du 6 mars 1528: dans une charte du 20 août 1478 on lit Lestivaz. — Ce nom vient du latin æstiva (neut. pl.), qui servait à désigner tantôt la saison de l’été, æstiva-tempora, tantôt un campement d’été, æstiva-castra, ou bien les bestiaux qu’on mettait pendant l’été dans les pâturages, æstiva-pecora, enfin les pâturages d’été, æstiva-loca, pascua. Du verbe æstivare nous est venu notre estiver (opposé à hiverner), qui signifie demeurer dans un endroit, à la montagne, pendant l’été, y mettre ou y entretenir le bétail 2 . Le nom d’Æstiva (Etiva) convenait tout à fait à /128/ la vallée rude et sauvage en hiver, qu’arrose la Tourneresse, et qui n’était habitable qu’en été pour les pâtres et les troupeaux, qui, dans cette saison, y trouvaient d’excellents pâturages.
Fenil, Fenix, Feny, ne vient pas de fenum, quoiqu’on appelle fenil un lieu où on serre les foins; mais, comme Fin (par exemple, « la Fin du Plan »), de finis, limite, fin; au moyen-âge finis et fenis. Fenil est le nom de localités nombreuses. Le prétendu mot allemand Vinelz ou Vingelz, n’est autre chose que le nom mal prononcé ou altéré de Fenil, village près de Cerlier, au lac de Bienne.
Flendru. Flandru, Flendruz; rio du Flendru ou Fleindru. On appelle ainsi deux torrents de la châtellenie de Rougemont, dont le plus considérable, qui coule dans la Sarine, au pied du Vanel, est appelé le grand Flendru, et « le Flendru (ou rio) des Crêts ». — Flen ou Flein se dit en patois pour le vieux mot roman fléon, qui signifie ruisseau. Ce mot paraît sous la forme de Flon dans le canton de Vaud, où il désigne en particulier un ruisseau ou torrent qui traverse Lausanne: dans les anciennes chartes latines cette eau est nommée fluvius, mot qui vient de fluo, je coule, et se dit de tout ruisseau d’eau vive. — Dru, qui signifie vif, fort, gros, indiquerait que le Flendru était un torrent sauvage. Les chroniques et la tradition racontent que ce ruisseau des montagnes (le grand Flendru), grossi par l’orage ou par la fonte des neiges, sortait de ses bords, et entraînait des arbres et des quartiers de rocs dans son cours impétueux. /129/ Le grand Flendru est appelé en allemand Griesbach. Voyez ce mot.
Forclaz, contraction de fores clausæ (porte close), qui servait à désigner un passage entre deux montagnes, un ravin ou chemin creux, un défilé qu’il est facile de garder et de défendre. Voyez au mot Cluse.
Gessenay. Voy. Sanen, au Glossaire des noms allemands.
Gruyère. Voyez page 49 et suivante.
Humilimont, humilis mons. Ce monastère était situé, suivant l’expression d’un document de 1289 « en la Fosse d’Ogoz ». Il a tiré son nom de sa situation dans une vallée solitaire, à une demi-lieue de Marsens, d’où vient qu’on l’a souvent appelé « l’abbaye de Marsens. »
Jogne, Jonia (dans des chartes lat.), Jôn et Joune (dans plusieurs doc. all.), Youn, et Yonn (sur la carte de Samuel Loup), noms du torrent qui traverse la vallée de Charmey. Les Suisses de langue allemande donnent le nom de Jaun au torrent et, de plus, au village et au château de Bellegarde. J’incline à penser que les vocables Jogne et Jaun ou Jôn, Jön ne sont que deux prononciations différentes (l’une romane, l’autre tudesque) d’un même mot, et qu’ils ont une origine commune que je crois découvrir dans le mot roman ivoue, iauve, yaue, eauve, qui signifie eau. A mon sens, on aurait donné au torrent qui traverse le val de Charmey le nom d’Eau, tout comme on a donné le nom de Grande-Eau à celui qui traverse le val d’Ormont.
Lessoc, autrement Le Soc, Le Sol, Lessoz (doc. de 1237), et souvent Lessot. Je suis tenté de croire que le vrai nom de ce village est l’Essot. Ce mot, dont j’ignore la signification, existait autrefois. On lit dans une charte de l’an 1223: « terram … apud Liniers (Lignières, canton de Neuchâtel), /130/ iugerum unum apud fontem Essot. » Kopp, Gesch. der eidgen. Bünde, L. IVe, p. 58, note 5. — On a pu écrire Lessot pour l’Essot, tout comme on a écrit Lesser (dans les Ext. de Château-d’Œx ) pour l’Essert, et Leytivaz pour l’Etivaz.
Marive (la) signifie la mère eau 1 , soit l’eau principale, ou le plus grand ruisseau de la commune d’Albeuve.
Mocausa. — « Le mot Mockawsa ou Mackawsa », a dit l’auteur du Conservateur suisse (T. IVe, p. 170), « signifie en celtique le pré de l’eau, de moc, mog, ou mac, mag, un pré, une plaine, et awde, aü, aüw, de l’eau » 2 . On lit dans l’ouvrage d’Alb. Schott, sur les colonies allemandes du Piémont, p. 68, que mac est l’équivalent de bach (ruisseau) et signifie en celtique une grande eau 3 . Comment concilier deux opinions si diverses?
« Au delà du hameau dit Flendru, bien avant dans les Alpes de Rougemont, du côté de la Dent de Brenleire, à l’extrémité de la vallée de Vertchamp, est « un bel alpage» d’environ mille pas de long sur une largeur de quatre à /131/ cinq cents. On l’appelle aujourd’hui la Verda, nom qui a remplacé celui de Mocausa. Chaque printemps, à la fonte des neiges et quelquefois après de longues pluies, cette plaine se transforme en un lac de cinq à six pieds de profondeur, qui n’existe qu’environ quinze jours; les eaux s’en écoulent par un grand nombre de conduits souterrains, et il se change alors en vertes prairies qui donnent sous la faux un pâturage abondant. »
Voilà, à peu près, ce qu’on lit dans des ouvrages modernes 1 , concernant Mocausa.
La tradition prétend que jadis ce lac n’était pas temporaire mais permanent. Sur la carte de Sl. Loup, de Rougemont, publiée en 1755, figure non une plaine, mais un lac Mocausa, à l’extrémité de la vallée de « Verchamp ». Dans les Extentes ou les vieux rôles-censiers de Château-d’Œx on lit: « ad montem de mocousa », — « in monte de mocausa », — « in monte de moscousa » (bis). Ainsi, les anciens documents appellent de ce nom une montagne, c’est-à-dire une alpe, un alpage, soit un pâturage plus ou moins élevé. Dans des actes plus récents, par exemple dans les « Délimitations de 1663 et de 1727 », il est question de la montagne et des siernes (prés qu’on ne fauche qu’une fois) de Mocausaz, ou de Maquausa et Maucausaz. Ce nom servit donc autrefois à désigner un pâturage à mi-côte, au moins; il s’étendit apparemment au lac temporaire et aux belles prairies qui le remplacent, lesquelles paraissent avoir été appelées les « siernes de Mocausa ».
Quoi qu’il en soit, un connaisseur des patois romans, /132/ M. Moratel, pense que le nom mocausa ou mocousa vient du latin mucosus, et que les habitants de la contrée ont voulu désigner par ce qualificatif la plaine morveuse, laquelle aurait dû ce nom au phénomène dont nous avons parlé.
Moléson (dans un doc. de 1237); Moleyson; Molleson (doc. de 1319). Il est assez probable, comme on le croit, que cette montagne majestueuse, devant laquelle les satellites qui lui servent de cortége semblent s’incliner avec respect, a tiré son nom du latin moles summa, qui signifierait la montagne la plus élevée, dans un sens relatif.
On pouvait appeler moles summa cette montagne, dont la cime altière s’élève au-dessus des autres qui l’environnent, aussi bien qu’Horace a pu dire du belvédère de Mécène:
« Molem propinquam nubibus arduis. »
Od. L. III, 39, 10.
Montbovon. On prétend que ce nom s’est formé de mons boum, et l’apparence plaide en faveur de cette étymologie; mais d’où vient qu’il ne se trouve pas dans les documents? que ceux-ci, au contraire, présentent Montbovon? Ce village, dit-on, s’appelle en allemand Bubenberg, et c’est en effet le nom qu’il porte dans un acte du 3 mai 1500, mais c’est à tort qu’on rattache ce nom à une famille célèbre de Berne. Entre cette famille et le village gruérien, il n’y a d’autre rapport que le nom; c’est une rencontre fortuite. Si Montbovon signifie la montagne des bœufs, Bubenberg, loin d’avoir le même sens, signifie le mont des garçons. Il est difficile, à coup sûr, de voir quelque analogie entre ces deux noms, à moins qu’on ne veuille la chercher dans le mot juvencus, qui signifie un bouvillon, et quelquefois en poésie un jouvenceau. Admettrons-nous que Bubenberg répond /133/ à bubus mons? mais quelle bizarrerie que ce moi hybribe, mi-latin, mi-allemand 1 ! Pourquoi ne pas dire Ochsenberg?
Si le nom du village de Montbovon, qui est au fond d’une gorge, a réellement le sens qu’on lui attribue, il faut qu’il ait été emprunté à la montagne de Jaman, où paissait apparemment un bétail nombreux.
Montsalvens. Dans une charte de l’an 1453 on lit huit fois Montsalvens et sept fois Montservens, preuve que l’orthographe de ce nom composé n’était pas fixée. En effet, les documents que nous avons recueillis offrent les variantes nombreuses qui suivent: Monsalven, Monsarven, Monsalvens, Monsarwayn, Monsarwens, Monservens, Monservyn, Monserwin; Montsalvain (doc. de 1177), Montsalvan, Mont Salvany (doc. de 1289), ou Montsalvey (ibid.) Montsalveyn, Montsalvin, Monsarven, Montsarvens, Montsarwayn, Montservains, Montservans, Montservein, Montservien, Montservin, Montservyn; Monsalverii, Mons servani, Montis servini; Münzelvan, prononciation tudesque de Montselvan.
Dans l’origine, ce château fort était appelé en latin, soit Mons silvanus (ou sylvanus), c’est-à-dire M. silvester, le mont des forêts, expression qui désignait le château des bois ou de la colline boisée, « die Waldburg », comme J. de Muller l’a nommé 2 ; soit mons silvani, le mont silvain, du nom du dieu des forêts ou du génie des bois. — A une époque où la seigneurie de Montsalvens n’appartient plus qu’aux /134/ seigneurs-comtes (au XVIe siècle), on remarque que leur écusson a pour supports deux faunes ou silvains, emblême parlant, qui semble rappeler les génies protecteurs des gruyers, et l’origine de la maison de Gruyère.
On rencontre silvana, pour silva, dans une charte du 9 novembre 1319: « cum tota silvana ».
Comp. le mot Salvent, nom d’un village sur une montagne boisée, en Vallais, du côté du Trient.
L’emploi de la lettre r pour l, dans Monservens etc., n’offre rien d’extraordinaire. Voy. au mot Albeuve.
Mosses (« eis Mosses », c’est-à-dire es, ou aux Mosses). Voy. Moos au Glossaire des noms allemands.
Motte, Motta, est apparemment une forme contracte de montanea, qui signifie une montagne, une montagnette. Ce nom servait à désigner non-seulement une butte, un tertre, mais en général un monticule, une colline, un roc élevé. On appelait de ce nom les éminences sur lesquelles étaient assis les châteaux forts de Charmey, de Château-d’Œx, de la Tour de Trème, de la Lance, ainsi que la colline de Châtel-sur-Montsalvens. La Motte est encore le nom de la petite île près de celle de St-Pierre au lac de Bienne, et du château du marquis de Costa près de Chambéry. Le même nom se présente dans plusieurs cantons de la Suisse, par exemple, dans ceux de Glaris et des Grisons, et, sous une forme altérée, dans le nom de la vallée de la Mutta (Muotta), nom qui, mal interprété et confondu avec le suédois mætta et l’anglais meeting, a fait dire que la dite vallée a tiré son nom de la première colonie qui, venue de la Scandinavie, s’établit dans le pays de Schwyz, et que c’est de ce prétendu lieu de rassemblement général que les pays /135/ d’Uri, d’Unterwalden et du Hasli reçurent leurs premiers habitants 1 .
Le nom de la Motte est commun en France et en Italie, bref dans tous les pays de langue romane, et il s’est conservé même dans les cantons suisses où cet idiome avait pénétré. Le mot teuton qui correspond à celui de la motte est le mot bühl, (bühel, büel, biel), mot très-usité dans la Suisse allemande.
La Motta, qui en Italie, comme en d’autres contrées, signifie un lieu élevé, et, de plus, un château 2 , servit dès le XIe siècle à désigner une faction, une confrérie ou corporation ambitieuse et puissante à Milan, qui tendit à s’élever et à dominer. Pour expliquer ce mot par une expression analogue, je dirais, sans confondre les temps, les personnes et les choses, que la Motta italienne pourrait se traduire par la Montagne. — Quelques érudits ont eu tort de changer l’orthographe de ce nom en mota, et d’en chercher l’origine et le sens dans le teuton mod ou mot, gemot, qui signifie meute, émeute, sédition populaire. La Motta était autre chose qu’une foule insurgée.
Nérive ou Nérivue, nom composé de ner (nero, qui vient de niger) noir, et ive ou ivue, qui signifie eau. Le village de Nérive a tiré son nom de l’eau noirâtre 3 qui passe auprès. Dans les documents il s’appelle tantôt Nigra aqua (« parochia seu villa de nigra aqua »), tantôt Nérigue, Nuriua (mieux neriva), Neirewe, Noire eve, Noyre ewe. Eve ou /136/ ive, igue, comme aigue, vient de aqua et signifie eau, comme dans Evian (en latin Aquianum), les eaux, les bains. On disait aussi îvoue, iauve, ieuua, yaue, eauve, eauwe et eaue, dans le vieux langage.
Oex (Château-d’), Hays, heyz (de). Oeyz, Oez (dœz). Ogga, Ogo, Ogoz, Oit, Oix, Oiz, Ooiz, Osgo (ofgo?), Ougo, Oyes. doyes, des oyes, eis oyes. Oyex, Oyz. Voyez l’étymologie du nom de Château-d’Œx, p. 51.
Le prétendu nom allemand Oesch n’est que la prononciation teutonne du mot Oex ou Oes.
Château-d’Œx apparaît quelquefois sous le nom de Chastel doyes ou des oyes. On a cherché l’origine de ce nom dans Oga, dont on a fait auca, synonyme d’anser, qui signifie une oie; de telle sorte que Château-d’Œx, qui tire son nom de Hochgau, a été métamorphosé en bourg des oies. Il est nommé le « bourg des gazons », dans le Conservateur suisse, T. XIII, p. 413. L’auteur de cette explication, due à un caprice de l’imagination, l’a abandonnée depuis.
La vallée de Château-d’Œx porte dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne, un nom qui n’a pas été expliqué jusqu’ici. On y lit, à la p. 5: « Salierius dedit sancte Marie lausannensi et Eginolfo episcopo in valle ausorense id est Ogo in villa Sotringes (id est Soutens) casale unum, » etc. Le texte du Cartulaire, en cet endroit, est défectueux. Les mots id est Soutens sont une « note marginale du premier écrivain », a dit l’éditeur; de même, les mots id est Ogo sont évidemment une glose. Mais l’auteur n’indique pas l’objet qu’il a donné, dans la vallis ausorensis, à l’église de N.-D. Le texte est donc incomplet; ne se pourrait-il pas, qu’il fût, de plus, incorrect? Je n’en doute nullement. Un /137/ copiste maladroit, déplaçant quelques lettres, a écrit ausorense (ansorense?) pour saronense.
L’auteur du passage précité a parlé de la vallée de la Sarine (Sarona), qui est expliquée par Ogo, soit la contrée ou la vallée de Château-d’Œx.
Ormonts, Ormund, dans la bouche des Suisses de langue allemande. Les érudits ne sont pas d’accord sur l’origine et le sens de ce nom. L’auteur anonyme d’un opuscule allemand 1 qui n’est connu que de quelques personnes, le considère comme désignant le val des Ormeaux, Ulmenthal. Mais l’ormeau ne réussirait pas dans le pays des Ormonts. Un autre écrivain prétend que « dans un très-ancien document Ormont est appelé ursi mons, d’où l’on aurait pu faire Ormont, parce qu’en patois or signifie un ours »; et pour donner plus de poids à cette étymologie, il ajoute que « le plus ancien sceau de la communauté portait un ours pour armoiries 2 ». Cela revient à dire que Corbières a pris son nom d’un corbeau, et Gruyère, d’une grue. Le château d’Ormont dans les Ardennes, aurait-il aussi tiré le sien d’un ours? Ce qu’il y a de certain, c’est que dans les chartes que j’ai vues, le pays des Ormonts est souvent appelé vallis de Ormont (par exemple dans un doc. de 1433), quelquefois vallis aureimontis (1496) ou de aureomonte (1502), c’est-à-dire la vallée du mont d’or. On trouve aussi, m’a-t-on dit, auromont dans un document de l’an 1014, qui fait partie du recueil de Guichenon, à Grenoble.
Faut-il ajouter que le vulgaire disait en latin orum pour aurum? ce qui donnerait orimons pour aurimons. /138/
Oron 1 , Horon (doc. de 1475 et de 1514), Horons (doc. de 1484), Horuns (doc. de 1221), Oirons (doc. de 1243, dans le cart. d’Oujon), Orons (ibid.), Oruns (doc. de 1291). Oro, Oron, Orus, est aussi le nom d’une petite rivière qui prend sa source au-dessus de Beaurepaire, et sépare le Viennois du Valentinois et de la terre de la Tour. (Histoire du Dauphiné, T. II, p. 56, citée par M. Kopp, Gesch. der eidgen. Bünde, L. IVe, p. 467, note 6.)
Je ne puis rien dire avec certitude quant à l’origine de ce nom.
Palésieux. Baleseux, Palaiçu, Palaiseaux (moins incorrect que le nom officiel), Palaisuel, Palasuel, Paleixioux, Palessuex, Palessuez, Palexieulx, Palexiou, Palexiux, Palexue, Palexus, Paleysiu, Paleysoul, Palleisieux, Pallesu, Pallexieulx, Pallexieux, Pallexiouz, Pallexu, Pallexuez, Palleysieu, Palleysiou, Prallexeul.
Le nom de Palésieux indique qu’il y avait un petit palais, palatiolum, en cet endroit, bien longtemps avant que ce village eût été élevé au rang de bourg ou de ville 2 et doté de statuts par Humbert de Billens, seigneur de Palésieux.
Les rois mérovingiens habitaient de préférence les nombreuses villæ qu’ils possédaient dans toutes les parties de l’Empire, et où ils avaient leurs palais, palatia. Ils s’y réunissaient avec leurs fidèles, pour se livrer au plaisir de la /139/ chasse et banqueter. Souvent même ils y tenaient les assemblées des grands et des évêques. C’était un honneur d’être admis aux fêtes et aux banquets des rois.
Dans les anciens documents, le mot palatium est employé alternativement avec les mots Villa et fiscus 1 . C’est ainsi, par exemple, que le bourg de Palaiseau, chef-lieu du canton de l’arrondissement de Versailles, était jadis un fisc, ou une terre royale, que le roi Pépin donna à l’abbaye de St.-Germain en 754 2 .
Il est assez probable que Palésieux, aujourd’hui village paroissial du district d’Oron, était anciennement un domaine royal ayant son petit palais 3 . Il vaudrait la peine de s’enquérir si ce lieu a servi de résidence soit à quelque roi de la première ou de la deuxième race, soit aux souverains de la Bourgogne transjurane; s’il reste quelque vestige de l’ancienne construction, soit du palais qui donna son nom à la terre; si le château fort, « fortalicium », élevé par Humbert de Billens vers le milieu du XIVe siècle, fut construit avec les ruines de l’ancien palais et sur l’emplacement qu’il avait occupé.
Il ne reste du château construit par Humbert de Billens qu’une tour et quelques pans de murs.
Payet (?) Cp. la Poya, château moderne, sur une hauteur près de Fribourg; le Poye de Bertigny, à une lieue d’Hauteville-de-Corbières; le Poyez, éminence près de Romont.
Ce nom, sous ses diverses formes, vient du latin podium; /140/ en voici la preuve: « in podio de Romont, in quo edificio nunc demoror », dit Pierre de Savoie, qui venait de s’établir au château fort de Romont 1 . De podium se sont formés, par la suppression du d, les mots suivants, usités dans le vieux langage, poia et poya, d’où appoiare 2 , appuyer, poy, lieu élevé, montagne, pui ou puy (dans Puy-de-Dôme), puye, appui, puyer, monter, gravir; l’italien poggio; le vieux fr. pec (pech et pecq, pour pic), usité dans le nom du village du Pec, près de Paris, et l’espagnol
.
Il y a d’autres mots analogues, avec la signification de hauteur ou d’élévation, tels que:
Pigno, qui, dans le Bas-Vallais, désigne une cime de montagne; le fr. pignon, l’esp. el penon (pron. pégnôn) et la pena (pégna), qui signifie roc, falaise 3 et dérive, de même que le vieux mot fr. penne, du latin pinna (qui signifie une aiguille, c’est-à-dire un rocher aigu, très-élevé), dimin. pinnaculum, pinacle; piton, pointe arrondie d’une montagne, par exemple, « le Pelvoux de Vallouise, piton des Alpes cottiennes. »
L’origine latine ou romane du mot poia et de ses analogues est certaine. On ne peut en dire autant des mots pignon, et de ses correspondants. Depuis Tite-Live, on admet que le mot pennin (dans « les Alpes Pennines ») vient du celtique penn, qui doit signifier une hauteur, un sommet 4 . Il se peut que Tite-Live ait raison, que penn soit en effet celtique: il n’en est pas moins vrai que ses dérivés sont venus d’un mot penninus latinisé, et que les Gruériens, /141/ comme leurs voisins romans, l’ont reçu des Gallo-romains.
Riaz (déjà dans un doc. de 1136) paraît sous les noms de «villa de Rota in Ogo » (dans un autre doc. du XIIe siècle), « Rua in Ogo » (Cart. du chap. de Lausanne, p. 23), « Rota in Ogo, » (ibid., p. 205), ou simplement Rota, (ibid., p. 208), et Rotha (doc. de 1221). Les noms de Rota villa et de Riaz sont employés indifféremment dans les Visites pastorales de 1453 pour désigner le même village 1 . On évitait de confondre Riaz près de Bulle avec Rue près de Romont, qui en latin portait aussi le nom de Rota villa, en disant Rua ou Rota in Ogo, parce que Riaz faisait anciennement, avec Bulle, partie de l’Ogo, soit du comté de Gruyère, dont ces deux endroits furent détachés. Les chroniqueurs et les interprètes de chartes les ont souvent confondus. Les armes de Riaz, de même que celles de Rue, sont une roue, en latin rota. Suivant M. de Gingins 2 , « Ruaz, anciennement Roda » ( pour Rota, ) « viendrait de reuten, extirper ». — Je dirais plutôt qu’il vient, comme reuten, rüten, du latin eruere, erutum, dont on aurait fait ruta, rota, qu’on aurait pris dans le sens de roue, tandis que, dans sa première forme, ce mot devait répondre au mot Ried, en roman Essert. (Voyez ce mot.) — Il se pourrait aussi que la roue représentât la charrue et fût l’emblême de l’agriculture.
Rossinière, arsonyere, arssonyere, la rassoneri, Larsonyere, Ransonery (doc. de 1115), Rassonerye, Rassoniera, /142/ Rensoneire, Rensonière, Ressonnyere, Rosière, Rosseinieyri, Rosseneire, Rossoneria, Rossonniere, Russenaire.
A l’orient de ce village, « au Crest », c’est-à-dire sur la crête ou cime d’un rocher, était une tour, que mentionnent des chartes de 1370 et 1518: elle portait le nom de la Tour de Rossinière. « Au lieu où était cette tour (dit Combaz, dans son Histoire inédite de la Gruyère, p. 586), est un cabinet, — un pavillon ou une espèce de belvédère, — d’où la vue plane sur tout le bassin: ce cabinet a conservé le nom de la Tour.» Le roc sur lequel cette tour forte était bâtie et la tour même s’appelaient peut-être en latin Rochia 1 nigra, la roche noire, « la rotse neire » dans l’idiome de la contrée. C’est de là que, dans cette hypothèse, le village de Rossinière aurait tiré son nom 2 . Il est facile de remarquer dans les variantes plus d’une leçon qui se rapproche de rotse neire, et qui aide à établir l’étymologie que je crois devoir adopter.
On sait d’ailleurs que la Roche est le nom de plusieurs châteaux forts, d’où il a passé à des villages.
Rougemont, de rubeus mons (dans les chartes latines). On rencontre les formes Rogemont, Rogomons, Rongemont, orthographe vicieuse pour Rougemont; Röschmont, prononciation tudesque du nom roman, ainsi que Rossmont et Rottschmont; Rothberg et Rottenburg (incorrect), traduction allemande du mot Rougemont.
Rubli, Rebloz, Reublo, Rubloz, mots patois venant de rubeus (mons), rouge(-mont). /143/
Sarine, Saruna, Serona, Serone ou Seroye, Serunaz, Sorona, Sanona. Voy. Sanen, au Glossaire des noms allemands.
Saxe rouge, de saxum rubeum (pour rubrum), la roche rouge. Plusieurs monts et rochers ont conservé le nom latin saxum, sous une forme plus ou moins altérée, telle que saxe, saix, (sé) sexe et sas (qu’on retrouve dans sasiema, formé de saxum imum, roche inférieure). De saxe ou saxum vient le dimin. saxet, rocher, en latin saxetum, qui signifie une contrée rocheuse.
Sepey, dans les documents en langue latine Seppetum, de septum ou de sepes, qui signifie une haie, faite de bois, de branches d’arbres ou d’épines, pour enclore une propriété.
Singine. Voyez Sense au Glossaire des noms allemands.
Tine (la), en patois la Tinaz. Ce mot, de même que l’italien tina ou tino, vient du latin tina ou tinum et signifie un grand vase d’une forme particulière, ou une espèce de tonneau. Il servit à désigner l’étranglement ou le resserrement du lit de la Sarine, et la gorge ou le défilé qu’on nomme le Pas de la Tine. (Voyez p. 65). Quiconque a vu la Tine de Montbovon et la Tine de Conflens (près de La Sarra) admettra l’explication que je donne de ce nom. J. de Muller 1 et d’autres après lui ont prétendu que la montagne derrière Gruyère (dont le nom est Cullan) s’appelle en allemand Bokten, et en français la Tine. Je n’ai rencontré dans aucun document ces noms comme désignant une montagne. Je ne crois pas non plus que le gouffre de la Sarine ait tiré /144/ son nom d’une montagne. La Tine, dont l’origine est latine ou romane, a été rendu en allemand par Bocken ou Bokten. Voyez ce mot.
Cp. la Taouna près de Grandvillars, et la Tinière.
Torneresse, vient de tornare, tourner, mettre en mouvement, et resse, ou raisse (dans un doc. de 1550), qui, en patois, signifie une scie.
Vanel « lo vanel », « del vanel », n’est pas plus celtique que Charmey et d’autres mots de la Gruyère et de la Suisse romane en général. Il n’est pas exact de dire que ce mot n’a probablement pas d’autre origine que le mot ven ou van, si commun, dit-on, dans les idiomes celtiques où il aurait la même signification 1 . Ce serait également une erreur de croire que d’un prétendu mot celtique Vanel nous est venu le français venelle 2 . Vanel est un mot que la langue romane revendique de plein droit, et qu’il faut lui restituer. Je ferai d’abord observer que le patois a changé, dans une foule de mots, l’e en a, et réciproquement. C’est une affaire de dialecte, qui ne doit pas nous arrêter. Venel, ou Venelle (plus usité) signifie une petite rue, (on dit enfiler, prendre la venelle), un chemin étroit, serré, ardu (comme était celui qui conduisait au château du Vanel et dont une partie subsiste encore). C’est ainsi que l’explique le Glossaire de Ducange: « Venella et venula, viculus, angiportus, via strictior, Gallis venelle. » Dans l’acte de fondation du monastère de Norwich, cité par Ducange, on lit: aquæ quidem terra S. Michaelis incipit ad caput eiusdem venellæ quæ quondam /145/ iacuit inter cimeterium … et mansum … ». Il se peut qu’aujourd’hui le Gruérien désigne par lo vani le pic de ses montagnes 1 , mais je doute que ses ancêtres aient entendu par là autre chose qu’un passage en général, un sentier ou chemin étroit, difficile, qui conduisait au sommet d’un mont, d’une colline, ou d’un rocher.
Remarquez que le mot Vanel n’est point la propriété exclusive du dialecte gruérien. On le rencontre dans plusieurs quartiers de la Suisse romane, où il n’a pas pu avoir la signification d’une éminence ou d’une cime de montagne. Ainsi, par exemple, dans un document de 1382 2 , il s’agit de la vente d’une « vigne sise au vanel ». On appelle encore aujourd’hui de ce nom un terrain ou quartier attenant à la ville de Cully; ce ne pouvait être autrefois qu’un chemin ou sentier étroit. Il y a près de Bex un vanel, qui n’est ni un roc ni un sommet de montagne; il en est un autre dans le pays de Gex. Mais voici des détails plus curieux et plus concluants.
On lit dans une charte du 9 juin de l’an 1242 que Rodolphe, comte de Neuchâtel, vendit à l’abbaye des Bénédictins de Cerlier la pêcherie ou le droit de pêche qu’il avait au Vanel, — « piscina de Vanel » —; de plus, « omnia iura que habebam in Thela maiori ab eius exitu, quo profluit a lacu Novicastri usque ad alveum collateralem, ubi influit in maiorem predictam Telam » 3 .
Une autre charte, du 29 septembre 1249, enseigne que le comte Berchtold (de Neuchâtel) et son fils Rodolphe cédèrent /146/ à l’abbaye susdite le droit qu’ils avaient de pêcher dans la Thièle dès le lac de Neuchâtel à celui de Nugerol (appelé dans la suite lac de Bienne), « in piscaria de Thela a lacu Novicastri usque ad lacum de Neural » 1 , afin que la navigation de la Thièle ne pût être aucunement empêchée à l’avenir.
Le rapprochement de ces deux passages montre qu’il s’agit du droit de pêche dans la Thièle, de la pêcherie dite du Vanel. Or, quiconque a vu la contrée qu’arrose la Thièle entre les deux lacs nommés ci-dessus, dira que le mot très-commun de Vanel n’indique pas une éminence, et qu’il ne peut avoir d’autre signification que celle que nous avons établie.
Je ne puis m’empêcher de citer encore un passage du Supplément au Glossaire de Ducange, au mot Vanella. Il est tiré d’une charte de 1344: « Item creant … dicti consules … curatores seu gardiatores operum et ædificiorum, parietum, vanellarum, aygueriarum, stilicidiorum … » Il est évident qu’ici, comme en d’autres endroits, vanel ne peut désigner qu’un passage ou chemin.
Enfin, je trouve que, dans la haute Gruyère, le mot vanel avait conservé, au XVIIe siècle, sa signification primitive: je doute qu’il l’ait perdue depuis. Dans la « Délimitation des deux châtellenies de Château-d’Œx et de Rougemont faite le 12 mai de l’an 1663 », il est dit que la limite va « par l’arête de la montagne de Tissinivaz à un autre crêt, et de là contre les rochers et hauts vanels à une roche noire devers la montagne des Champs … » /147/ Ces hauts vanels ne sont ni des rochers ni des montagnes, soit saxes ou saxets, comme on disait encore, mais les hauts passages ou les sentiers élevés, étroits, ardus, qui servaient de lignes de démarcation.
D’où vient le mot vanel, vanelle ou venelle? « Les uns, dit Ducange, le font dériver de venire ». Lui-même pense qu’il vient de vena. Je partage l’opinion du savant Ducange. On sait que vena (veine) se disait au figuré de toute raie, de tout méat, conduit, passage ou canal étroit. Par analogie on a bien pu donner au diminutif venella, qui est notre venelle, le sens de petite rue, de passage étroit et serré.
Le mot de veine, ou petite veine (vena, venella) était une expression très-propre à désigner l’un ou l’autre de ces mille sentiers et chemins étroits qui traversent en serpentant nos monts et nos vallées.
Le mot allemand, très-usité en Suisse, qui correspond à vanel ou venelle, est Steg. Voyez G’steig.
Vaulruz, signifie « rio de la vault », ruisseau de la vallée, vallis rivus, que l’allemand rend exactement par Thalbach.
Villa; Villar, Villard, Villars (seul bon), noms de localités nombreuses dans les pays de langue romane; wil, wyl, wiler, wyler, weiler, plus usités dans les contrées allemandes. Dans un document de la Suisse romane se trouvent ces mots: « près dou wilere », pour du villars.
La villa désigne, dans un temps: 1° l’habitation romaine ou gallo-romaine au milieu des campagnes et de la population agricole; 2° un centre d’exploitation des grands domaines 1 . Ces terres comprenaient des habitations plus ou moins rapprochées, plus ou moins nombreuses, dont les /148/ différents systèmes formaient, suivant les cas, une villa, une villula, un villaris. M. Guérard 1 pense que, dès le VIIIe siècle, on doit entendre en général par villa un village avec son territoire, et par villaris, un hameau avec les terres qui lui appartenaient. — Ces deux noms paraissent plus tard dans la Gruyère. — Il n’était pas rare que la villa eût une église et formât une paroisse rurale; ainsi, par exemple, alta villa, Hauteville, dans la seigneurie de Corbières. Cependant on trouve en tout temps une quantité de lieux qualifiés villa, qui n’étaient pas des paroisses. On donnait encore le nom de villa, comme ceux de castrum et de burgum, à un lieu muré, ceint d’ouvrages de défense, muni d’un château fort, dont les habitants, qualifiés burgenses, formaient une commune urbaine, qui avait sa constitution, soit coutume ou loi municipale; ce qui n’était pas le cas des habitants de la campagne, des villageois ou villains, villani, qui — leur nom l’indique — habitaient des villæ. Quelquefois, dans les chartes, la villa est distinguée du villagium. De ces deux noms viennent ceux de ville et de village. — Le villaris ou villare — d’où viennent wiler et weiler, — n’était dans l’origine qu’un écart ou une dépendance de la villa, un hameau, ou un petit nombre de maisons champêtres écartées l’une de l’autre et de la paroisse. Cependant certaines villæ ne formaient pas une paroisse, tandis que des villars dont la population s’était augmentée, avaient une église paroissiale, tels que Grandvillars, Villarvolar, et d’autres.
Le mot villa s’est conservé dans une foule de noms qui se terminent par ville, ou wil (wyl), et le mot villaris se /149/ présente dans un grand nombre de localités romanes et allemandes qui se terminent les unes par villiers, les autres par weiler, wiler ou wyler.
Voètes (les). Ce village, situé au pied du château fort d’Aigremont, était protégé par ce manoir, et le défendait à son tour. Les habitants étaient apparemment tenus d’observer ce qui se passait aux environs, de faire le guêt, la waiti 1 , wacta (en vieux allemand), die wacht, ou, comme on disait encore, les gaytes, guêtes, ou waites 2 . De là, si je ne me trompe, le nom de ce village.
CHAPITRE VI.
De l’état des personnes.
A l’époque où le comté de Gruyère prend sa place parmi les états constitués, à l’époque où commence son histoire politique, nous sommes, pour ainsi dire, dans un monde nouveau. Le règne des mœurs et des lois romaines n’a laissé çà et là que de faibles traces, les temps des Franks mérovingiens et des Bourgondes sont loin de nous, le siècle de Charlemagne est passé, les institutions de ce prince sont dès longtemps tombées en désuétude, l’œuvre de la centralisation et de la fusion des peuples, hardiment conçue par son puissant génie, s’est convertie à sa mort en une œuvre de dissolution, et de l’édifice magique élevé par l’habile architecte qui pensait recomposer et consolider le monde romain, il ne reste que des ruines. La décomposition du vieux monde a repris sa marche, elle aboutit à la décentralisation organisée, au morcellement du territoire et du pouvoir, à l’érection d’une foule de petites souverainetés locales. Toute l’économie sociale est changée. Hâtons-nous de le dire: Nous sommes en pleine féodalité. Les lois des Barbares, d’abord modifiées par les lois romaines ou fondues avec elles, ont été remplacées par les Capitulaires, qui, à /151/ leur tour, ont disparu devant les lois et les coutumes féodales. De même, les différentes classes de personnes non libres tendant à se confondre, finissent par tomber ensemble dans le servage et à former, pour ainsi dire, une seule classe de personnes, celle des villains, ou mainmortables. Depuis longtemps il ne s’agit plus de leudes ou d’antrustions, ni de rachimbourgs et de scabini, ni de lètes ou de lides. Nous allons nous trouver tour à tour au milieu des serfs, des colongiers, qui perpétuent la classe des colons, des affranchis et des colliberts, des hôtes et des prudhommes, des chevaliers et des bourgeois. Au degré supérieur de cette échelle apparaît la noblesse aventureuse et guerrière, quelquefois généreuse, plus souvent insolente. Ici la terre sert la terre, et la personne sert la personne: jusqu’au faîte de la hiérarchie sociale, chaque membre a au-dessus de soi quelqu’un dont il est l’homme.
Malgré ses défauts, la société féodale vaut mieux que celle qui l’a précédée. Il y a une amélioration sensible, il y a progrès. Déjà l’homme n’est plus réduit à l’état de chose, il a revêtu sa personnalité. Le surnom qui servait à le distinguer de son voisin homonyme est devenu un nom propre. C’est ainsi que les noms de familles percent et se multiplient, gage certain d’un progrès dans la propriété et, par celle-ci, dans la liberté. L’élément qui prédomine dans la société féodale est germanique, nommément dans la Suisse romane, et, en particulier, dans le pays qui fait l’objet de nos recherches. Cependant tout n’est pas entièrement nouveau dans les temps où nous allons pénétrer. On y remarque, dès l’entrée, comme un mélange confus des siècles précédents. Les vestiges des temps antérieurs ne sont pas tous effacés.
Les documents nombreux que nous avons recueillis pour /152/ la composition de l’histoire du comté de Gruyère présentent beaucoup de faits analogues à ceux qui ont été si bien expliqués par l’auteur des Prolégomènes du Polyptique d’Irminon et de ceux des Cartulaires de St.-Père de Chartres et de St.-Bertin; aussi aurons-nous souvent recours à l’érudition profonde et à la sagacité de ce guide, sans négliger toutefois de nous entourer des lumières d’autres hommes dont l’érudition et la perspicacité honorent la France, l’Allemagne et la Suisse. Mais nos chartes nous offrent aussi un bon nombre de faits qui n’ont pas encore été remarqués, ou du moins signalés et appréciés comme ils méritaient de l’être. Ces faits sont de nature à combler mainte lacune dans le domaine de la science historique, et à jeter du jour sur diverses institutions du moyen-âge. Cette considération justifiera le travail que nous allons entreprendre.
On pourrait, à la rigueur, diviser en deux classes principales les personnes dont se composait la société du moyen-âge, savoir les libres et les serfs. Si les nobles jouissaient de certains priviléges refusés aux hommes libres ordinaires, en revanche il y avait aussi beaucoup de nobles soumis à des obligations qui les rapprochaient de la condition servile. Toutefois, le noble qui possédait un fonds en propre appartenait à la classe des hommes libres; il exerçait les mêmes droits que ceux-ci. La propriété seule conférait les pleins droits politiques. Or, comme les hommes libres n’étaient pas tous propriétaires, tandis que les seigneurs possédaient des terres auxquelles étaient attachés divers droits, il faut nécessairement faire de la noblesse ou plutôt de l’aristocratie territoriale une classe à part. Nous distinguerons donc, avec M. Guérard, trois ordres de personnes, les nobles, les libres /153/ et les serfs. Entre ces classes sont des personnes de condition intermédiaire, qui ont droit à notre attention. Nous commencerons au plus bas degré pour nous élever jusqu’au degré supérieur de l’échelle féodale.
I.
Des Serfs.
La servitude du moyen-âge n’était pas l’esclavage tel qu’il existait chez les Romains. En principe, l’esclave était un instrument, un être sans nom, sans droit, sans personnalité, sans âme, sans Dieu. L’esclave était sous la dépendance absolue d’autrui. Sa condition était la servitude de corps. L’esclave ne s’appartenait pas, il appartenait à son maître, partant, il ne pouvait rien posséder en propre. Seulement, comme dans toutes les sociétés à esclaves, ainsi à Rome, l’usage universel admettait que l’esclave pourrait posséder à titre précaire certains objets mobiliers et même de l’argent, soit qu’il les eût obtenus par don, soit qu’il les eût acquis par l’exercice de quelque profession tolérée par le maître, soit encore qu’il eût fait quelques économies sur sa ration en trompant son appétit. C’est ce qu’on nommait pécule, peculium. L’esclave ne possédait son pécule que par la tolérance du maître, afin qu’il pût acheter sa liberté de ses propres deniers.
Cet état malheureux constituait l’esclavage pur, le premier des trois âges dans la servitude. Il se prolongea jusqu’après l’invasion des Barbares et leur établissement dans /154/ l’empire d’occident. Depuis cette époque jusqu’à la fin du IXe siècle, c’est-à-dire jusqu’au déclin de la race carolingienne et à la fondation des royaumes de Bourgogne cis- et transjurane, l’esclavage proprement dit est remplacé par la servitude, esclavage adouci par les Germains, tempéré par l’influence de la doctrine chrétienne et par les progrès de la civilisation religieuse et morale. « Alors la condition humaine est reconnue, respectée, protégée, sinon d’une manière suffisante par les lois civiles, au moins plus efficacement par celles de l’Eglise et par les mœurs sociales. » L’Eglise admet le serf dans son sein, comme les autres brebis de son troupeau. Il participe au culte des fidèles; il a un Dieu. La loi lui reconnaît l’aptitude à posséder; elle l’estime habile à jouir de certains droits civils. A la vérité, le serf est toujours en la puissance d’autrui, mais il n’est plus réduit à l’état de chose, il n’est plus sous l’entière dépendance du maître. « Alors le pouvoir de l’homme sur son semblable est contenu généralement dans certaines limites; un frein est mis à la violence; la règle et la stabilité l’emportent sur l’arbitraire. Le pécule, consistant en argent ou en biens meubles et immeubles, ne peut plus être ravi à l’homme qui l’a acquis par son travail et ses économies; bref, la propriété et la liberté, comme les rayons bienfaisante du soleil, pénètrent par quelque endroit dans la cabane du serf. »
Enfin, pendant le règne de la féodalité, la servitude se transformant en servage, le serf retire sa personne et son champ des mains de son seigneur; il doit à celui-ci, non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus: il a cessé de servir; il n’est plus qu’un tributaire, sous les divers noms d’homme de corps /155/ (Leibeigene), d’homme de poote (de poeste ou de pôté, homo potestatis), de mainmortable, de taillable, de serf ou de villain 1 .
Tels sont les traits généraux qui caractérisent les trois époques de la sujétion de l’homme du commun peuple à plus fort que lui. La distinction entre les trois espèces de servitude, surtout entre les deux dernières, n’est pas toujours facile à faire au milieu des grands désordres qui bouleversèrent la société. Le passage de l’une à l’autre fut lent, incertain, embarrassé. A chaque époque de tradition d’un état de choses à un autre, la masse sociale conserve des préjugés, des erreurs et des vices du passé. Il y eut pendant le moyen-âge plus d’une espèce de condition servile: l’esclavage, la servitude et le servage existèrent simultanément, mais alors ces trois conditions furent dans des proportions très-différentes. C’est donc seulement la condition de la classe la plus nombreuse qui décide du caractère de la servitude pendant le moyen-âge 2 .
Des chartes des Xe, XIe, XIIe et XIIIe siècles, relatives à l’Helvétie romane, principalement à une partie du comté de Gruyère, prouvent qu’il y avait alors dans cette contrée, outre les colons, des serfs des deux sexes, servi et ancillæ, mancipia, famuli.
Le mot servus servit longtemps à désigner l’homme d’une condition inférieure à celle du libre. Ainsi, par exemple, dans un acte de l’an 1234, il est dit que défense est faite de recevoir à St.-Prex aucun homme d’un seigneur /156/ quelconque, sans l’aveu de celui-ci, soit serf, soit libre, nec servus, nec liber 1 .
Au XIIIe siècle il y avait encore beaucoup de serfs 2 dans /157/ le comté de Gruyère, si du moins on doit considérer comme tels les taillables, c’est-à-dire les hommes propres du seigneur, mentionnés dans les Extentes 1 .
Le mot mancipium, très-usité chez les Anciens, devient de plus en plus rare au moyen-âge. Dans une acception moins restreinte il s’applique non-seulement aux serfs, mais encore aux colons, en général à toutes les personnes d’une condition plus ou moins servile 2 . Le maître pouvait aliéner ces personnes avec la terre qu’elles occupaient, en transférant /158/ la propriété de celle-ci par échange, par vente ou par donation 1 .
On s’est aussi servi du mot famulus, serviteur, en parlant d’un homme engagé dans la servitude 2 ; mais on l’a /159/ quelquefois appliqué au serf agricole, et même à l’homme libre 1 .
Le serf est encore appelé bonus homo 2 , ou simplement homo, et la serve femina, mais la dénomination de homo, comme celle de famulus, s’applique pareillement aux vassaux, ainsi qu’aux domestiques libres 3 .
C’est aux serfs agricoles ou de la glèbe qu’on doit rapporter:
1° Les servi mansuarii, appelés massarii en Italie, et hobarii en Allemagne, qui sont les serfs occupant des manses, appelés mas dans le dialecte roman, et huben ou hufen (huba, hoba, hova, hof) en allemand;
2° Les servi casati, ou serfs établis sur un fonds de terre, casata (casalis, plus souvent casale, et même /160/ casalicum 1 , dont l’habitation portait le nom de casa. Les serfs de cette espèce faisaient corps avec les immeubles, tandis que les non casati faisaient partie du mobilier 2 .
Nous supprimons d’autres mots employés pour désigner une même condition sociale, une même classe d’hommes non libres, livrés à la culture des terres. Nous verrons que la différence qui séparait les colons des serfs agricoles était réelle, et cependant ils ont été souvent confondus avec les servi. Dans les temps de troubles et d’anarchie, la distinction entre les diverses espèces d’hommes non libres n’était pas bien observée; on comprend qu’elle ait échappé aux érudits, que la confusion ait passé dans les livres, et qu’il ne soit guère possible de saisir des nuances subtiles et difficiles à déterminer. La dénomination de servi était la plus propre à désigner cette masse de non libres attachés à la glèbe, dont ils faisaient partie, de telle sorte qu’ils ne pouvaient la quitter, et qu’ils étaient vendus avec le fonds comme les bestiaux employés à le mettre en valeur.
Les divers serfs agricoles, se confondant sous le régime de la féodalité, composèrent la nombreuse classe des laboureurs connus sous les noms de taillables, de censitaires (censerii), ou de villains 3 et de manants 4 , comme on disait au /161/ moyen-âge, sans attacher d’abord à ces mots le sens d’une injure, pas plus qu’au nom de vassal, qui n’eut rien de honteux quand la féodalité fut devenue un principe. Seulement, comme chez les Germains le métier des armes était réputé plus noble que l’agriculture, le plus utile et le plus précieux des arts, et que l’élément germanique dominait au moyen-âge, la culture des terres étant abandonnée par les hommes libres à ceux qui ne l’étaient pas, il arriva, sous le régime de la féodalité, ce qui avait eu lieu chez les Romains dégénérés, que l’homme d’épée conçut du mépris pour l’homme des champs. La population guerrière et souveraine regarda d’un œil superbe la population agricole et sujette. De même que les soldats romains s’appelaient milites pour se distinguer des paysans, pagani, et des bourgeois 1 , de même les chevaliers du moyen-âge, adoptant le mot romain qui avait un caractère exclusivement guerrier, s’appelaient milites, par opposition aux villains. La chevalerie gardait ses préjugés même sur les champs de bataille, avec une force inconcevable. Ainsi, dans le mémorable combat de /162/ Courtrai (1302), où les habitants des villes et des campagnes de Flandre, secouant bravement le joug de l’étranger, se présentèrent avec d’énormes bâtons et des hoyaux, de brillants escadrons de chevaliers, tout bardés de fer, se laissèrent assommer sans se défendre, plutôt que de tirer l’épée contre des villains sans armes. La tuerie des chevaliers français, qui valut le nom de Bataille des éperons d’or à la journée qui assura l’indépendance des intrépides Flamands, est le fait le plus caractéristique du point d’honneur chevaleresque, qui ne permettait pas aux preux de déroger jusqu’à se battre contre de tels assaillants.
Lorsque les Barbares se furent définitivement établis sur le territoire romain, ils trouvèrent presque tous les habitants de la campagne réduits à l’état de colons ou de serfs agricoles et tributaires. Les propriétaires donnaient à ces personnes leurs terres à bail pour de longues années, ou même à perpétuité. Telle fut l’origine de l’emphytéose, qui se conserva sous la domination des Germains, et se multiplia non-seulement par l’abandon que les hommes libres firent de leurs propriétés aux hommes puissants dont ils recherchaient la protection, mais encore par cet usage qu’adoptèrent les riches de concéder leurs terres aux pauvres à titre emphytéotique. Ces cultivateurs, qui devenaient ainsi des espèces de fermiers, étaient quittes envers leurs maîtres après leur avoir payé certaines redevances annuelles et fixes, nommées canon ou canonica, qui consistaient en fruits, quelquefois en argent ou en d’autres objets 1 , suivant /163/ les conventions ou suivant l’usage. La servitude de ces emphytéotes était presque entièrement réelle, c’est-à-dire restreinte au service de la glèbe 1 .
Cette institution, comme le colonat, se maintint après l’invasion, non toutefois sans subir quelque modification sous le régime féodal, au profit de la population agricole. Les serfs laboureurs étaient encore des emphytéotes, mais tandis qu’autrefois ils ne possédaient rien en propre, pas même leur pécule, ils s’approprièrent leurs tenures, dont ils n’avaient été que les usufruitiers ou baillistres, et le progrès fut si rapide qu’au Xe siècle ils se montrent, en France, en pleine jouissance des droits de succession et de propriété 2 . Toutefois, il ne faut pas donner à ces expressions un sens trop large. Dans les contrats de vente et dans les chartes de franchises accordées à ces laboureurs, il est toujours question de leurs successeurs ou héritiers, ce qui permet de supposer l’existence des droits que nous venons de nommer. Cependant, ils étaient plutôt capables de propriété qu’ils n’étaient de véritables propriétaires. La propriété dont ils jouissaient n’étaient ni complète ni vraiment indépendante. Ils la transmettaient à leur famille, mais ils ne pouvaient en disposer à leur gré. Ils possédaient, mais non en toute propriété 3 , l’héritage censuel, soit le fonds qu’ils /164/ avaient reçu du seigneur à la charge de s’y établir, de le cultiver, et d’acquitter les redevances annuelles en acquérant la possession et l’usufruit de ce fonds avec un droit de succession /165/ plus ou moins étendu, soit à perpétuité, soit pour un temps déterminé par une espèce de contrat ou d’engagement personnel conclu avec le seigneur 1 . Le censitaire était donc un fermier à bail perpétuel et héréditaire, un emphytéote jouissant du droit de propriété. Après même qu’il eut acquis ce droit, il ne lui fut permis d’aliéner ses biens qu’aux personnes de sa condition et de sa seigneurie. Son maître, vrai propriétaire du sol, en conservait le domaine direct, dominium directum, soit la seigneurie avec le droit de justice. Si l’emphytéote mourait sans postérité, son héritage était dévolu à son seigneur, mais s’il laissait des héritiers directs, son seigneur n’avait droit, dans sa succession, qu’au meilleur meuble, au meilleur vêtement du défunt, à la robe la plus précieuse de la femme, à la meilleure tête de bétail, au meilleur catel 2 , suivant la dernière expression en usage 3 .
Tel était le droit nouveau, depuis l’abolition du formariage et du droit de suite, dont nous parlerons. Le droit ancien était beaucoup plus rigoureux.
« Les lois des Barbares, de même que les lois romaines, /166/ refusaient au serf la faculté de vendre, de donner, d’échanger, de louer, d’emprunter, et en général de contracter, sans l’autorisation de son maître. » 1
Cette défense passa dans les coutumes féodales et ne fut modifiée qu’à la longue. Dans les terres de Romainmotier, il ne fut bien longtemps permis au serf agricole de vendre, d’engager ou d’acenser son héritage, en tout ou en partie, qu’à une personne de sa condition et de sa seigneurie, sans préjudice au droit et aux coutumes du monastère ou du prieur 2 . Au XVIe siècle les possesseurs de biens de condition mainmortable, de la terre de Romainmotier, étaient « en puissance et faculté de les vendre, engager, eschanger et ailliéner à leur bon plaisir et volonté sans charge de lods nî ventes, à personnes de leur condition seulement. » 3 Les serfs payaient ordinairement à leurs maîtres une capitation, nommée plus tard capage ou chevage (l’un de caput, l’autre de chef). En général on nommait capatici toutes les personnes soumises à ce tribut 4 .
Le serf n’avait pas le droit d’établir sa demeure où il voulait, ni de quitter la terre de son maître ou seigneur pour passer dans une terre étrangère. Homme de pôté, en la puissance d’autrui, il était, suivant une désignation plus moderne, homme de suite ou de poursuite 5 , c’est-à-dire que /167/ son seigneur pouvait le réclamer et le reprendre. — Nous reviendrons sur ce droit.
Celui qui voulait quitter la terre de Romainmotier devait en obtenir la permission du prieur, après quoi il pouvait disposer de tous ses biens meubles, et partir avec son avoir, conduit un jour et une nuit aux frais du prieur; mais son héritage demeurait la propriété de l’église, et son plus proche héritier avait droit de reprise, suivant la coutume. Cette faculté était refusée aux enfants de celui qui avait quitté la seigneurie sans permission, à moins que le prieur ne consentît à la leur accorder. Mais si la guerre ou la misère étaient la cause du départ du serf agricole, celui-ci pouvait rentrer sans obstacle, et l’héritage qu’il avait abandonné lui était rendu pour lui et ses héritiers 1 .
Si le serf laboureur était attaché au sol par un lien pour ainsi dire indissoluble, en revanche, il avait une garantie contre la tyrannie du propriétaire, en ce que celui-ci ne pouvait le séparer du domaine. La vente personnelle des serfs agricoles était interdite: le seigneur ne pouvait les aliéner sans la terre qu’ils tenaient de lui, et la terre ne pouvait être vendue sans eux. Lorsque, au commencement du XIIIe siècle, le comte de Gruyère céda an chapitre de Lausanne toutes ses possessions et tous ses droits rière 2 Bulle et ses dépendances, en hommes, femmes, terres, forêts, etc., il agit conformément à la loi, qui ne permettait /168/ pas d’aliéner la terre sans les serfs qui la cultivaient, et réciproquement 1 .
Dans la société romaine les esclaves ne se mariaient pas légalement. Le serf du moyen-âge, bien différent de l’esclave romain, contractait un mariage parfait et légitime; ce mariage était valable même lorsque les époux appartenaient à des maîtres différents. Néanmoins il ne pouvait avoir lieu sans le consentement des maîtres, et le défaut de cette formalité suffisait pour lui ôter le caractère de légalité et le rendre nul 2 . De plus, le délinquant payait une amende de trois sols 3 . Le serf obtenait de son seigneur la permission de se marier, moyennant une redevance annuelle appelée maritagium ou droit de mariage, lorsque les époux appartenaient au même maître, et forismaritagium ou droit de formariage, quand la fiancée n’appartenait pas au seigneur du serf qu’elle prenait pour mari 4 . On donnait encore le nom de formariage à l’amende que le serf devait payer pour avoir épousé à l’insu de son maître une personne appartenante à un seigneur étranger, et à l’alliance d’un serf ou d’une serve avec une personne de condition libre. Dans ce cas, l’époux le mieux né était abaissé à l’état de serf ou puni d’une autre manière.
Lorsqu’un seigneur avait plusieurs vassaux, et que les serfs des uns épousaient les serves des autres, les époux n’en étaient pas moins soumis au formariage. /169/ Cependant le seigneur suzerain pouvait dans certains cas les en exempter 1 .
Dès les XIIe et XIIIe siècles, les serfs ne furent plus soumis à l’obligation de solliciter de leurs maîtres la permission de se marier entr’eux 2 .
De même que les enfants nés de parents libres étaient libres, de même ceux qui naissaient de parents soumis à l’état de servage étaient serfs.
La condition des enfants issus de mariages mixtes n’était pas réglée partout d’après une législation uniforme. Telle coutume leur assignait la condition de celui des deux époux qui était serf, conformément à la loi des Barbares, partus peiorem manum sequitur. Dans la Bourgogne, la condition de l’enfant était réglée sur celle du père. Or, si le père, libre avant son mariage, était plongé dans la servitude pour avoir épousé une femme serve, l’enfant, né depuis la dégradation de son père, ne pouvait être que serf. La coutume de Bourgogne n’était guère plus favorable à la liberté que ne l’était la loi des Barbares; seulement sa sévérité paraît avoir eu pour but d’empêcher les mariages mixtes et l’abaissement des hommes libres.
Mais c’était, dans plusieurs pays, sur la condition de la mère et non du père que se réglait celle des enfants, d’après cette maxime du droit romain que le fruit suit le ventre, partus sequitur matrem 3 . Dans les contrées où cette maxime /170/ prévalut, l’enfant né d’un père serf et d’une femme libre était acquis à la liberté; le nombre des personnes libres se grossissant, contrebalança en quelque sorte le nombre toujours croissant des hommes libres qui, incapables de protéger leur liberté, l’engageaient pour un temps déterminé, ou recevaient un fonds servile, et tombaient dans une condition qui se rapprochait de la servitude.
Il est bon de remarquer que, d’un côté, les serfs entrant dans le droit de propriété et améliorant ainsi leur sort, et, de l’autre, un grand nombre d’hommes libres, pressés par le besoin, acceptant des fonds de terre à charge de cens et de rente, ou des manses serviles, les deux conditions se rapprochèrent insensiblement pour vivre, en quelque sorte, sous l’égide d’un droit commun, et tendirent à se confondre en une seule classe de personnes, celle des mainmortables. Il était naturel et nécessaire que la loi qui interdisait les mariages mixtes s’adoucît de plus en plus, qu’elle fléchît devant l’usage, et que les alliances entre serfs, colons et libres, fussent tolérées. C’est, en effet, ce qui arriva. Or, les conditions personnelles tendant incessamment à s’élever, l’homme en se mariant hors de sa caste, prenait le plus souvent une femme au-dessus de lui, et comme, en général, la condition des enfants se réglait beaucoup plus sur celle de la mère que d’après celle du père, il s’en suivait que les lignées qui avaient leur pied dans la servitude montaient continuellement vers la liberté. Ainsi la faculté laissée à /171/ l’homme de se marier à plus libre que soi 1 , fut une cause très-efficace de l’affranchissement des serfs. Ce fait d’une grande portée n’a point échappé à l’attention de l’interprête du Polyptique d’Irminon, qui l’a révélé au public 2 .
Le précieux avantage qui vient d’être signalé n’est point dû à la générosité des seigneurs, mais à la persévérance des laboureurs, aux efforts constants qu’ils firent pour se soustraire au pouvoir arbitraire de leurs maîtres. De même que la population des villes, la population agricole, à mesure qu’elle grandissait et prospérait, cherchait à s’affranchir. La faculté de se marier à plus libre que soi servit aux serfs à faire une autre conquête, qui devait marquer un grand progrès dans les droits de propriété et de liberté, et que nous signalerons après avoir parlé du partage des enfants nés de personnes d’une condition servile.
En général, dans les mariages entre personnes de conditions différentes, les enfants, dans l’origine, appartenaient au maître de celui des époux qui était de condition servile; mais plus tard ils furent soumis à une législation moins rigoureuse 3 .
Les enfants qui avaient pour parents des serfs appartenant à deux maîtres différents, n’étaient pas soumis partout à la même loi. Dans telle contrée, ils étaient la propriété du seigneur de leur père, dans telle autre, ils étaient partagés également entre le maître du père et celui de la mère. /172/ L’enfant unique, ou celui qui restait du nombre impair, suivait la mère 1 . Dans le comté de Gruyère et dans les terres du chapitre de l’église de Lausanne, ainsi que dans la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier et dans les domaines des sires de Grandson, les enfants issus du mariage des serves de l’une de ces seigneuries avec les serfs étrangers, appartenaient tous au maître de la mère 2 . La même coutume existait, sans doute, dans les autres parties de la Suisse romane: elle s’observait même dans la Suisse allemande 3 , ainsi que dans la terre de Longvic, près Dijon, appartenante au monastère de St.-Bénigne 4 .
Nous avons dit plus haut que le serf qui abandonnait la terre de son seigneur pour passer dans une terre étrangère était homme de suite ou de poursuite. Ce droit, qui avait sa source dans le fait que l’homme manquait à la terre bien plus que la terre à l’homme, accompagnait ordinairement celui de formariage, c’est-à-dire que les serfs ou les serves qui, après s’être mariés, s’établissaient hors de leur /173/ seigneurie, pouvaient être réclamés et repris par leurs maîtres, avec leurs enfants et tout ce qu’ils possédaient 1 .
Le droit de suite donnait lieu à de fréquentes contestations, à des guerres privées qui entraînaient des calamités. Le monastère de Romainmotier eut à ce sujet beaucoup de débats avec ses voisins, avec Guy, du château de Siccon en Bourgogne, et surtout avec les seigneurs de Grandson, qui réclamaient des serfs de leurs seigneuries établis sur les terres du monastère 2 . Les querelles au sujet du droit de poursuite étaient les plus fréquentes entre les seigneurs laïques et les seigneurs ecclésiastiques. On n’en sera pas étonné si on considère que des serfs appartenant à des laïques s’efforçaient de passer dans la classe des serfs des monastères, et même d’obtenir leur liberté pour se mettre aussitôt dans la dépendance de l’Eglise, parce que les serfs de l’Eglise, de même que ceux du roi, jouissaient d’un meilleur sort que les autres serfs 3 .
Le droit de suite, qui fut longtemps en vigueur dans le comté de Gruyère, sur les terres du chapitre de l’église de Lausanne, et ailleurs, avait des conséquences graves. Ce qui est bien digne de remarque, c’est que né, pour ainsi /174/ dire, d’un décret émané du chef de l’Eglise 1 , ce droit fut aboli par l’Eglise même.
En effet, à la fin du XIIe siècle, le droit de suite fut modifié à l’égard des femmes, dans le comté de Gruyère et dans la seigneurie de Bulle, cédée depuis peu de temps à l’Eglise de Lausanne. Le comte de Gruyère et l’évêque de Lausanne firent, en 1195 ou 1196, une convention par laquelle ils renoncèrent pour l’avenir, l’un à poursuivre celles de ses femmes serves qui passeraient dans la terre de Bulle en deçà de la Trème, l’autre à poursuivre celles de ses femmes serves qui s’établiraient sur le territoire du comte. Celui-ci tiendrait dès lors les dites femmes serves en fief 2 de l’évêque, et celles qui repasseraient dans la terre de l’église de Notre-Dame seraient à l’abri de toute poursuite.
Cet accord fut le prélude d’un traité plus parfait, d’un concordat définitif, dont quelques observations préliminaires feront pressentir l’importance.
Nous avons dit qu’en Suisse les enfants nés de parents non libres, ou de serfs agricoles ayant des maîtres différents, appartenaient tous au maître de leur mère. En conséquence, à la mort du serf qui avait épousé une serve appartenante à un seigneur étranger, celui-ci pouvant réclamer /175/ et reprendre cette femme et ses enfants, l’avoir du défunt eût passé aux mains de l’étranger, s’il n’y avait pas eu droit de dévolution ou échute en faveur du seigneur naturel du serf décédé. L’échute avait lieu en effet: elle variait suivant les coutumes locales; ici elle comprenait la totalité, ailleurs la moitié ou les deux tiers de la succession du serf 1 , et ses enfants, suivant leur mère, étaient privés au moins de la meilleure part du bien de leur père 2 . Ce bien, après déduction faite de la portion du seigneur, passait aux collatéraux du défunt, ses seuls héritiers légitimes, ainsi que son héritage, c’est-à-dire le fonds de terre que son seigneur lui avait concédé à charge de redevance. Ses enfants tombaient dans la pauvreté, et de la misère dans l’esclavage; et si leur maître, seigneur naturel de leur mère, leur concédait un autre fonds, ils n’en étaient pas moins obligés de recommencer leur fortune, et d’arroser la terre de leur sueur pour acquérir quelque bien en propre.
Le droit de suite fut une des principales causes de la fréquence des guerres privées et des nombreuses insurrections des serfs contre leurs seigneurs. Enfin, sous l’influence de la religion chrétienne, cet usage odieux fut aboli, et sa suppression fut un des plus grands bienfaits pour l’humanité souffrante. Des seigneurs ecclésiastiques firent entr’eux, ou /176/ avec des seigneurs laïques, des concordats par lesquels les enfants issus du mariage de deux personnes de condition servile, dépendantes de seigneurs différents, appartiendraient au maître de leur père. Il s’en suivit, d’une part, qu’à la mort du père, ses biens meubles et immeubles passèrent de droit par héritage à ses enfants, tandis qu’auparavant son avoir et son héritage passaient à ses collatéraux de même condition que lui; de l’autre, que le seigneur naturel put dès lors se contenter de l’échute de la mainmorte, c’est-à-dire de quelque objet de la dite succession, du meilleur catel, simple reconnaissance et symbole du droit que lui conférait le domaine direct ou la seigneurie.
On connaissait depuis quelque temps un pareil concordat, passé au XIIIe siècle, entre sept monastères de la Suisse allemande, dont les possessions s’étendaient sur une partie considérable du territoire helvétique, à savoir: Seckingen, St-Gall, Schænnis, Einsiedeln ou Notre-Dame des Ermites, Notre-Dame de Zurich, Reichenau et Pfæffers 1 .
Mais ce qu’on a ignoré ou ce qu’on n’a pas signalé jusqu’ici, c’est un acte du même genre et du même siècle, relatif à l’Helvétie romane, qui donna l’impulsion à la Suisse alamannique, après l’avoir reçue peut-être de la France 2 .
Il s’agit du concordat que firent, le 23 février 1237, Rodolphe le Jeune, comte de Gruyère, et le chapitre de l’église de Notre-Dame de Lausanne, traité qui fut le complément de celui de l’an 1210 ou environ 3 . Le dit comte Rodolphe continuait de tailler les hommes d’Albeuve, qu’il /177/ réclamait parce qu’ils étaient nés de femmes serves à lui appartenantes qui avaient épousé des serfs d’Albeuve, dans la seigneurie du chapitre de Lausanne. Après une longue et vive querelle, le comte fit avec le chapitre un accord par lequel il consentit à renoncer, pour lui et ses héritiers, au droit de formariage et de poursuite contre les personnes de condition servile attachées à sa seigneurie, et contre les enfants de ces personnes qui s’établiraient à Albeuve et sur les autres terres du chapitre. Celui-ci, à son tour, promit de ne plus réclamer ni reprendre à l’avenir, avec leurs enfants, les serfs et les serves de sa seigneurie qui s’uniraient à des personnes de même condition, appartenantes au comte et à ses héritiers. Cet accord fut déclaré obligatoire pour les chevaliers (milites) du comte et de ses successeurs, ainsi que pour ceux de la seigneurie du chapitre. Le comte promit solennellement d’engager ses vassaux à respecter et observer l’accord qu’il venait de passer 1 . Il pouvait les y obliger en sa qualité de supérieur féodal ou de seigneur suzerain.
L’accord de 1237, le concordat passé entre les sept monastères nommés ci-dessus, ainsi que tous les traités semblables, sont des actes qui marquent dans l’histoire. Ils ouvrent une ère nouvelle; ils préparent l’émancipation de la race agricole; ils signalent le passage de l’ancien droit servile au droit nouveau; ils établissent, à l’insu de leurs auteurs, un principe fécond, qui, se développant et traversant les diverses /178/ phases de la société, aboutira à la révolution de 1789. Chacun de ces traités, qui au premier aspect semblerait n’avoir eu d’autre but que celui de faire cesser entre des seigneurs voisins et jaloux ces guerres privées, fléau du moyen-âge, ces fréquentes et fâcheuses querelles qui naissaient d’un droit introduit par une législation barbare, fut un événement mémorable, qui améliora promptement le sort de la population des campagnes, une des causes les plus efficaces du progrès des serfs laboureurs dans le droit de propriété et dans la liberté civile 1 /179/
Dès lors, les serfs agricoles deviennent de plus en plus rares, et avant la fin du XIIIe siècle, ils ont fait place, dans la Gruyère et ailleurs, à une seule classe de personnes ou de cultivateurs jouissant du droit de propriété, d’une liberté plus ou moins limitée, et de divers droits civils. Ils sont élevés d’un degré. Ils entrent dans la commune, ou plus exactement, ils forment les communes rurales. On ne les appelle plus du nom de serfs, bien qu’ils soient encore soumis à des services onéreux. On les désigne, au moins dans la Suisse romane, par une dénomination particulière, qui exprime bien leur nouvelle condition. Non comprise jusqu’ici, la dénomination de prudhommes a donné lieu à des conjectures et à des débats qui ont laissé ce problème à l’état de question. Nous lui consacrerons bientôt une place à part.
II.
Du Colonat.
Quoique, à partir du IXe siècle, le colon devienne de plus en plus rare dans les documents et qu’il ne figure plus dans notre cartulaire, nous aurions cependant grand tort de le passer sous silence, attendu que, bien loin de disparaître sans laisser de trace, le colon ne fait que changer de costume, et continue d’exister durant tout le moyen-âge.
« D’après les codes de Théodose et de Justinien, le colon est l’homme qui, inséparablement attaché à la culture d’un fonds étranger, en fait les fruits siens, moyennant une redevance fixe qu’il paye au propriétaire. Vivre et mourir sur le sol où il est né, c’est là son destin, comme celui de la plante; mais esclave par rapport à la terre, il est libre à l’égard des personnes, et, quoique placé ainsi dans une condition intermédiaire entre la liberté et la servitude, il est, en définitive, mis au rang des hommes libres par le droit romain » 1 .
Le colonat 2 , comme les autres institutions romaines, s’altéra plus ou moins depuis la conquête. « Ce qui distingue surtout le colonat romain du colonat du moyen-âge, dit encore M. Guérard, c’est que, sous les empereurs, le colon n’était soumis qu’à des redevances envers le maître, /181/ tandis que sous la domination des Franks et des autres peuples germains, le colon, qui descendit au rang des non-libres, fut, en outre, assujetti à des services connus plus tard sous le nom de corvées » 1 .
Toutefois, il ne faut s’exagérer ni les avantages du colon romain, sous l’empire, ni les désavantages du colon qui passa sous la domination des peuples qu’on appelle communément les Barbares. Bien que peu disposé à juger favorablement les Germains, le savant que nous venons de nommer avoue cependant que, à tout prendre, la condition des colons, chez les Franks, n’était pas mauvaise.
A l’époque de l’établissement des Germains dans la Gaule et en Italie, le sort des colons, qui formaient la plus grande partie de la population agricole, ne fut que légèrement modifié par l’attribution faite aux chefs étrangers des terres prises sur les patriciens romains. Leur condition sociale, leur existence ne fut point changée; elle se maintint à travers les destinées diverses du territoire. Chaque colon resta dans sa chaumière, continuant à cultiver la même terre, aux mêmes conditions, seulement pour de nouveaux maîtres. Il conserva la liberté personnelle dont il avait joui jusqu’alors. Et non-seulement le colon ne fut pas réduit en esclavage, mais d’après la loi des Allemands, il était assimilé aux hommes de cette nation. « Que celui (dit cette loi) qui tuera un homme libre de l’Eglise, qu’on nomme colon, paye la composition comme pour un autre Allemand » 2 . /182/
Le colon romain était tributaire 1 ; il le fut encore sous la domination germaine. « Que les hommes libres de l’Eglise, qu’on appelle colons, comme les colons du roi, payent le tribut à l’Eglise », dit la loi des Allemands 2 . Dans les temps mérovingiens, les colons sont assimilés aux libres cultivateurs qui payaient un tribut annuel, ou plutôt ils sont confondus avec les tributaires 3 , et désignés indifféremment sous ces deux noms, de même que les terres qu’ils cultivent 4 . Ils sont distingués et des serfs et des hommes libres. Ils contractaient de véritables mariages, un mariage légal, tandis que le serf ne se mariait pas légalement 5 . Mais déjà sous la domination romaine, le colon, quoique assimilé, sous plusieurs rapports, à l’homme libre, ressemblait cependant au serf, à plusieurs égards. Sa condition était un état mixte, composé moitié de liberté, moitié de servitude. On l’appelle tantôt liber pour le distinguer de l’esclave, tantôt servus terræ pour l’opposer à l’homme libre 6 . — Les colons formaient, pour ainsi dire, une caste à part. Le mariage, d’une femme libre avec un colon était une mésalliance 7 : /183/ les enfants nés d’une telle union étaient colons 1 . Les hommes de cette condition restèrent, comme dans l’origine, attachés à perpétuité à la terre qu’ils fécondaient, et avec laquelle ils étaient légués, donnés ou vendus. Ceux qui prenaient la fuite devaient être restitués à leurs maîtres, à moins qu’il n’y eût prescription en leur faveur. On avait le droit de transférer des colons d’un fonds sur un autre 2 . Le colon romain n’était que le possesseur et non le propriétaire du sol qu’il mettait en valeur: il possédait son fonds colonaire à titre de fermier héréditaire et perpétuel. Il jouissait cependant du droit de propriété, c’est-à-dire qu’il était capable de posséder en propre. Le pécule du colon était vraiment à lui, il pouvait en disposer à son gré, mais non à l’insu de son maître 3 . Celui-ci avait la faculté de détacher le colon de la glèbe; de maître il devenait son patron 4 .
Lorsque le colon fut descendu au niveau de l’homme /184/ non libre, on le confondit avec le serf agricole, et le mot colonus devenu, pour ainsi dire, l’équivalent de servus terræ, fut souvent remplacé par celui de mancipium qui, dans une signification plus étendue, servit à désigner toute personne d’une condition plus ou moins servile 1 . Cependant, encore au XIe siècle, on distinguait quelquefois les coloni des servi 2 .
Il y avait proprement deux espèces de colons, suivant qu’on les distinguait en libres et non libres. Les premiers, coloni liberi, payaient des redevances, et, de plus, la capitation 3 , mais ne faisaient pas de services corporels, ou ils en faisaient moins et de plus doux que les autres colons. Les colons non libres faisaient des services corporels, moins durs que ceux des serfs, toutefois encore pénibles et nombreux 4 . Non-seulement ils devaient exécuter divers travaux sans recevoir aucun salaire, mais le maître pouvait leur infliger des peines corporelles, même d’après le droit romain 5 .
D’après ce qui précède, il n’est point surprenant que les colons aient été considérés quelquefois comme des serfs 6 , /185/ et que les serfs qui possédaient quelque bien en propre aient été assimilés aux colons 1 .
Messieurs Guérard et Guizot ont traité avec le talent qui les distingue, la question du colonat. Le premier dit qu’à partir du IXe siècle, le colon devient de plus en plus rare dans les documents qui concernent la France, que vers le déclin du Xe, le colonat s’éteignit tout à fait, et que le nom de colon ne servit plus à désigner qu’un homme livré à la culture des terres; que les colons et les serfs, devenus au Xe siècle de véritables propriétaires, de simples possesseurs qu’ils étaient jadis, furent, ainsi que les autres hommes non libres, confondus avec les serfs pour ne composer avec eux qu’une seule classe de personnes, celle des mainmortables 2 . M. Guizot, au contraire, cherche à démontrer la persistance de la distinction entre les colons et les serfs; il affirme que cette distinction est reconnue par les jurisconsultes, que c’était par le mot de villani qu’ils désignaient ordinairement les colons 3 . Les deux savants s’accorderaient à reconnaître des colons dans la classe des mainmortables, des villains ou des paysans.
La révolution ou la réforme que l’on dit s’être accomplie dans l’état des colons, est plus apparente que réelle; assurément elle ne fut pas aussi générale qu’on le pense. Quelles que soient les opinions des érudits concernant la classe des colons, il est un fait qui jusqu’ici n’a pas été remarqué, ou du moins apprécié, ni recommandé à l’attention du /186/ public, je veus dire la permanence et l’état stationnaire du colonat dans la Bourgogne transjurane.
On a déjà fait observer qu’en Allemagne il n’y avait guère de colons que sur les terres de l’Eglise et dans les domaines royaux 1 . C’est aussi sur ces deux espèces de domaines qu’au XIe siècle nous avons trouvé les colons dans la Bourgogne transjuranne et ailleurs 2 . — Le colonat s’est maintenu dans cette contrée à travers les siècles et les destinées diverses du territoire, notamment dans les seigneuries ecclésiastiques. La distinction entre la condition des colons et celle des autres hommes non libres est si réelle qu’elle a passé dans le langage. C’est un fait que nous pouvons établir par des preuves positives.
Le fonds possédé par le colon était appelé colonia, ou colonica 3 . Le premier de ces mots a longtemps servi à désigner un fonds colonaire; il s’est conservé, ainsi que le mot colonus, dans les contrées allemandes de la Suisse 4 . Mais dans les pays où le latin, se corrompant, est devenu la langue romane, les mots colonica et colonus ou colonarius se sont altérés: l’un a pris la forme de colungia et colongia, /187/ dont on a fait colonge; l’autre, subissant une transformation semblable, est devenu colongiarius; en sorte qu’au moyen-âge, dans les pays romans, on appela colongier le cultivateur qui jadis était connu sous le nom de colon 1 . Le mot de Colonge, ou Collonge, est encore aujourd’hui le nom de localités nombreuses; on en trouve, par exemple, dans les pays de Gex, de Genève, de Vaud, etc.; elles occupent toutes la place d’un ou de plusieurs anciens fonds colonaires ou colonages 2 .
Au XIIIe siècle, les possesseurs des colonges que le chapitre de Lausanne avait à St.-Prex, acquittaient aux chanoines des redevances en argent et en bétail, volaille, avoine, pains blancs et vin; ils devaient, au temps des vendanges, préparer les vases à vin de leurs maîtres, dominorum, après la moisson, battre le blé au jour fixé par leurs seigneurs. Au nombre des services corporels qu’on leur imposait, était la corvée: de plus, ils devaient loger les religieux. Le maire, maior, officier sous la direction duquel les terres du chapitre étaient cultivées, avait aussi sa part des droits imposés aux colongiers. Ceux-ci, en revanche, avaient l’usage dans les bois morts, et l’affouage, c’est-à-dire la faculté de couper du bois pour construire ou réparer leurs habitations, toutefois après avoir obtenu la permission du maire. Quiconque abattait, à cette fin, un chêne, payait un pain au messier, forestarius 3 . /188/
Le village d’Apples, dans la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier, comptait au XIVe siècle douze colongiers. Suivant le plaid général de 1327, confirmé en 1355 1 , acte qui n’est autre que la loi de la terre ou de la cour (Hofrecht), formée de l’ensemble des obligations et des droits des colons et des autres villageois, ces douze colongiers devaient, une ou deux fois l’an, s’aider à charrier et battre les blés du prieur. Ils avaient l’usage dans les forêts banales pour reconstruire leurs cabanes, mais seulement dans le cas où elles avaient été détruites soit par nécessité, soit par le temps, soit par le feu. Ils jouissaient de l’affouage dans les bois morts, pour leurs enclos seulement; les autres hommes de la terre payaient pour ce droit deux deniers de cens annuel. Les colongiers avaient, de plus, le droit de charronage, et la paisson des porcs qui leur appartenaient en propre. Ils avaient encore, au temps de la moisson, la faculté de couper dans leurs champs quatre à cinq gerbes, pas davantage, et nul ne pouvait couper ses blés sans la permission du prieur, sous peine de trois sols.
A la mort du colongier, son fonds de terre passait à ses héritiers: ceux-ci payaient à leur seigneur quinze deniers pour la reprise de cette espèce de fief.
Les colons d’une église ou d’un monastère étaient ordinairement représentés en justice par l’avoué, advocatus, avoerius, coutume qui avait été instituée dans des vues de protection et dans l’intérêt du clergé 2 . Cette protection — qui dégénéra bientôt en oppression — n’était point gratuite; /189/ elle coûtait aux colongiers d’Apples quatre livres par an, qu’ils payaient aux religieux. La répartition de cette somme devait se faire équitablement par deux hommes élus à cet effet par le village et accompagnés d’un officier dit nonce du prieur. Aucun n’était dispensé de cette contribution, à moins qu’il n’en eût été affranchi anciennement 1 .
Si on compare aux devoirs des colons, tels que M. Guérard les a fait connaître 2 , les obligations imposées aux colongiers, on se persuade aisément que l’état de ces derniers ne différait pas de la condition des premiers. On ne peut plus douter de la permanence du colonat, au moins sur les terres ecclésiastiques. Le colongier du moyen-âge n’est que le descendant du colon que la loi des Allemands appelle homme libre de l’Eglise. Si l’état des anciens colons est un état mixte, composé moitié de liberté, moitié de servitude, la condition des colongiers révèle l’existence d’une classe intermédiaire entre les hommes libres et les autres hommes qui, bien que jouissant de quelque liberté, n’en sont pas moins placés sous le joug du servage et soumis à des charges onéreuses 3 .
La coutume s’opposait à l’émancipation du colongier. Dans la terre de Romainmotier, le mariage avec une femme libre du prieur lui était interdit: en cas de formariage, la succession de la femme retournait au seigneur de la terre. /190/
Il était encore expressément défendu au colongier, sous peine d’exil et de confiscation, de jurer la commune avec les sujets d’un autre seigneur, ou, comme s’exprime la loi de la terre, de faire bourgeoisie, serment ou garde à quelque cité, bourg, village ou château, sans la permission du prieur, ou d’invoquer secours, patronage ou protection d’autrui contre le droit de l’Eglise 1 . Vivre et mourir sur le sol où il était né, c’était là son destin, comme celui de l’ancien colon.
Il y a entre les colongiers et les colons une ressemblance si frappante, qu’on les prend aussitôt pour des membres de la même famille. Les colongiers se sont cachés sous un nom trompeur, mais ils n’ont point disparu de la société. On les reconnaît malgré leur déguisement, et leur nom même les trahit, car dans sa forme altérée, il a conservé l’empreinte de son origine.
L’identité du colongier et du colon étant constatée, j’applique sans hésiter au premier ce que M. Guérard a si bien dit du second. « De même que le colon jouissait de la liberté, mais d’une liberté imparfaite, de même il avait la jouissance du droit de propriété, mais d’un droit restreint et conditionnel; néanmoins, il était capable de posséder et d’acquérir à titre perpétuel et héréditaire. Sa tenure était devenue comme une espèce de bénéfice ou de fief infime, grevé de redevances onéreuses et de charges avilissantes, et soumis, en général, à la loi des fiefs; il se trouva lui-même placé sur l’échelle féodale, à la vérité sur le plus bas échelon » 2 .
III.
Affranchissement.
L’affranchissement du moyen-âge a cela de commun avec la manumission romaine, que l’un et l’autre consistaient dans le droit que le maître accordait au serf d’aller où il voulait, sans empêchement et sans pouvoir être réclamé 1 . L’affranchissement, dont le mode variait suivant les coutumes locales et les usages des peuples, n’était pas soumis aux mêmes formalités que la manumission des Anciens. Il n’est question, dans les affranchissements du moyen-âge, ni de la baguette, vindicta, ni du bonnet, pileus 2 .
L’expression usitée dans nos chartes latines pour désigner l’affranchissement est un mot barbare, dont le nôtre s’est formé, savoir le mot affranchesatio, dérivé de francus, qui, dans son acception primitive, indiquait un homme appartenant à la race franke, au peuple conquérant des Gaules, et qui, dans la suite, fut appliqué à tout individu qui, né libre, ou mis en liberté, était égal au Frank 3 . Affranchir /192/ (manumittere) un esclave, c’était, dans l’antiquité, l’élever de l’état de chose à celui de personne; dans le moyen-âge, affranchir (affranchesiare) un serf agricole, un homme de corps, c’était le détacher de la glèbe ou de la personne à laquelle il était lié, et l’assimiler, en quelque sorte, au Frank, à l’homme libre de race; c’était, si je puis m’exprimer ainsi, le tirer de l’état de la population agricole et sujette pour l’élever à la condition personnelle de la population guerrière et souveraine.
Il est vrai que le sens du mot frank s’altéra depuis que les possesseurs de bénéfices s’emparèrent de ceux-ci, et que, s’érigeant en seigneurs indépendants et en maîtres du sol, ils asservirent les cultivateurs, qui formaient la majeure partie de la population. Alors le faible, opprimé par le fort, perdit jusqu’au nom de franc, et le nombre des non libres se grossit de tous les hommes libres qui furent attachés à la glèbe et faits hommes de corps. Ils ne furent affranchis de la servitude que par l’établissement des communes, que Louis le Gros reconnut et sanctionna, et surtout par la célèbre ordonnance de Louis le Hutin, qui, considérant que son royaume s’appelait le royaume des Franks (non des esclaves), voulut que la chose répondit au nom — que le mot frank reprit son ancienne signification, — et que les servitudes fussent ramenées à franchises.
La dénomination de franc avait passé dans la langue d’autres peuples avec la signification d’affranchi ou d’homme élevé de la servitude à l’état de liberté personnelle. Il y avait dans les terres de la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier /193/ quinze Francs 1 , dont sept maires, villici, un sautier, salterius, espèce d’huissier; un maréchal, marescallus 2 , ou gendarme, deux messiers, forestarii, un sommier, sommerius 3 , un marguillier, matercularius 4 , un portier, porterius ou janitor, et le cuisinier du couvent, cocus. Or, tous ces offices, accessibles aux serfs mêmes, étaient alors inféodés par le prieur à des hommes affranchis du joug de la servitude, qui cependant conservaient des restes de la condition servile, d’où eux ou leurs prédécesseurs avaient été tirés 5 .
Enfin, nous ferons observer que plusieurs chartes se servent de l’expression franc et libre pour désigner un homme qui jouit de la pleine liberté 6 .
L’affranchi, de quelque nom qu’on l’appelât, jouissait de la liberté naturelle, qui consiste dans la faculté d’aller et de venir librement, de quitter une terre pour s’établir sur une autre. Cette faculté était souvent exprimée dans les actes /194/ d’affranchissement. Elle ne conférait pas les droits politiques dont jouissait l’homme né libre. L’affranchi tenait le milieu entre l’homme libre de race et le serf. Incapable de posséder du bien en propre, il n’était pas habile à siéger aus assises des hommes libres.
Le serf qui possédait un fonds de terre, le conservait après être sorti de la servitude. Son maître, en lui donnant gratuitement la liberté personnelle, pouvait lui imposer la condition de demeurer sur la terre qu’il cultivait 1 . Ordinairement en le déclarant libre, le seigneur l’obligeait à l’hommage libre ou lige envers lui, et, dans les terres ecclésiastiques, à la fidélité envers le monastère ou envers l’Eglise.
Privé de la protection qu’accordait à l’homme libre le droit public, qui d’ailleurs ne protégeait que la pleine propriété; ne jouissant que d’une liberté imparfaite et précaire, l’affranchi recherchait la protection d’un tiers, à qui il payait une redevance annuelle pour le droit de patronage. La classe intermédiaire dont il faisait partie avait, en général, beaucoup à souffrir de la part des forts et des puissants; les affranchis étaient souvent opprimés et replongés en servitude. — Au patronage dont nous parlons étaient attachés des redevances, des devoirs, des services 2 .
Ordinairement les serfs qui étaient pauvres recevaient, avec la liberté, une terre à cultiver. Les nouveaux membres /195/ de la commune n’étaient pas abandonnés à leur sort; on les attachait à un bien fonds, qui, dans la règle, ne leur appartenait pas en propre, mais les mettait dans un autre rapport de dépendance envers leurs anciens maîtres 1 . Ils cultivaient la terre qui leur était assignée et vivaient sous la protection ou mainbourg d’un patron.
Le serf pouvait obtenir la liberté parfaite, ou devenir vraiment libre, bene ingenuus, fulfreal, par une déclaration formelle de son maître dans l’assemblée des hommes libres qui l’agrégeait: alors cet affranchi pouvait ceindre l’épée et porter la lance; il avait le port d’armes de l’homme libre 2 .
Lorsque l’affranchi recevait la liberté parfaite, il n’était pas soumis aux devoirs de l’affranchi ordinaire: néanmoins, souvent on lui assignait un patron pour le défendre, ou bien on lui laissait la faculté de le choisir à son gré: dans ce cas, il était astreint envers son patron à quelque redevance ou à quelque obligation.
« Le serf pouvait sortir de la servitude par la volonté ou sans la volonté de son maître. Dans le premier cas, l’affranchissement était un don fait par le maître, ou une convention passée entre le maître et le serf. »
« Le maître donnait la liberté au serf, soit à titre de récompense, soit par humanité, soit par esprit de religion /196/ et pour le salut de son âme, soit à l’occasion et en mémoire de quelque événement remarquable » 1 .
Paul Diacre nous apprend que les Lombards élevaient beaucoup de serfs à l’état de liberté afin d’augmenter le nombre de leurs guerriers 2 . — Un motif semblable fut une des principales causes de l’affranchissement des serfs, de la reconnaissance des communes par la couronne de France et, par contre-coup, du déclin de la féodalité.
« L’affranchissement par convention avait lieu lorsque le maître donnait la liberté au serf, et que celui-ci donnait, en retour, à son maître, de l’argent, des terres ou des meubles » 3 .
Le serf devenait libre, sans le consentement de son maître, de plusieurs manières, savoir: par la fuite, lorsqu’il n’était pas repris; par la prescription, lorsque pendant une génération, au moins, le maître avait négligé ses droits envers le serf; par le crime du maître qui abusait de ses droits; — le juge public ne pouvait refuser justice et liberté au plaignant qui avait souffert en son corps de la part d’un maître barbare; — par l’ordination, lorsqu’il entrait dans le clergé sans que son maître le réclamât dans l’année de son ordination 4 .
L’Eglise, en admettant des serfs dans les rangs du clergé, diminuait sensiblement la classe des non libres. Les villes, /197/ de leur côté, favorisaient l’affranchissement en recueillant de nouveaux hôtes dans leurs murs et dans les faubourgs 1 . C’était, dans mainte contrée, un axiome reçu, que le serf qui, s’étant établi parmi les hommes libres d’une ville, n’avait pas été réclamé par son maître « jusqu’à ce que an et jour fust passé », acquérait par ce seul fait la liberté.
« Après avoir conquis l’hérédité de leurs tenures et le droit de propriété, les serfs se servirent de ce qu’ils avaient déjà pour conquérir la liberté qui leur manquait encore. Quelquefois, avons-nous dit, ils l’obtenaient gratuitement, plus souvent ils rachetaient, soit à prix d’argent, soit au prix de leurs offices et de leurs propriétés héréditaires, ou même du bien qui leur appartenait en propre 2 . »
Mais les marchés de ce genre devinrent de plus en plus rares au XIIIe siècle. Depuis les concordats dont nous avons parlé, depuis qu’un droit nouveau eut remplacé le droit ancien, les droits que les maîtres avaient conservés sur leurs serfs ne pouvaient plus guère valoir un pareil prix.
La liberté ne pouvait pas tarder à suivre la propriété, dont elle était une conséquence nécessaire. A son tour, elle devait servir au serf à conquérir le droit naturel d’être libre.
L’esclavage antique avait cédé la place à la servitude: celle-ci fut convertie en servage, forme adoucie de la condition servile. Le servage, à son tour, attaqué sur tous les points par la commune, fut promptement transformé en roture.
C’est peut-être dans le XIIIe siècle que les lettres d’affranchissement /198/ sont le plus nombreuses. Sur la fin de ce siècle, du moins au commencement du XIVe, le nombre des affranchis était fort considérable dans le pays de Gruyère, où on les distinguait en simples affranchis et affranchis jurés, affranchesiati jurati. Ceux-ci, pensons-nous, se rapprochaient plus que les autres des hommes libres. C’étaient apparemment des hommes qui pouvaient non-seulement ester en jugement, mais encore assister aux assemblées de commune, siéger en justice, et procéder à l’exécution de la sentence.
IV.
Des Colliberts.
Ce nom ne signifie pas franc du col ou du collier, comme D. Mulay l’a pensé 1 . De même que con-servus indiquait un compagnon de servitude, de même con-libertus 2 ou collibertus servait, chez les Romains, à désigner le camarade d’un affranchi, d’un libertus 3 , et, au pluriel, les affranchis d’un même patron, comme il est dit dans Ducange. Ce mot conserva longtemps sa véritable signification 4 ; dans la suite, elle s’altéra. La définition que D. Mulay en a donnée peut s’appliquer aux colliberts du moyen-âge. Alors, en effet, « on appelait de ce nom ceux qui n’étaient ni serfs ni affranchis, dont la condition était entre l’homme libre et l’esclave » 5 , ou plus exactement, entre l’affranchi proprement dit et le serf. /200/
La différence entre la condition des colliberts et celle des affranchis n’a point échappé à l’esprit attentif et pénétrant de M. Guérard; et cependant, — ce qui prouve combien il est difficile d’établir une distinction claire et précise entre ces deux conditions —, ce savant semble hésiter sur la place qu’il convient d’assigner aux colliberts: tantôt il les distingue des serfs proprement dits et les tient pour une espèce de serfs libres, ou bien il les assimile aux colons, « qu’ils paraissent même avoir remplacés »; tantôt il les envisage comme des serfs et les comprend avec ceux-ci dans une seule classe de personne. « Les colliberts, dit M. Guérard, peuvent se placer à peu près indifféremment ou au dernier rang des hommes libres, ou à la tête des hommes engagés dans les liens de la servitude 1 . » De quelque manière qu’on interprète leur nom, « il est certain que les colliberts étaient privés en partie de la liberté ».
« Il y avait parmi les libres des personnes soumises à des obligations serviles; mais il y a cette différence entre les hôtes, hospites, par exemple, et les colliberts, que les premiers avaient une condition accidentelle, conventionnelle et muable, tandis que celle des derniers était originelle, permanente et fixe. Le fils d’un hôte, s’il perdait l’hospice de son père, n’était plus un hôte; au contraire, le fils d’un collibert restait collibert quel que fût le changement apporté à la personne, à la tenure, à la position de ses parents. Les colliberts étaient d’ailleurs vendus, /201/ donnés, échangés comme les serfs. C’est par ces considérations réunies », dit M. Guérard, « que nous nous sommes décidé à les comprendre avec ceux-ci dans la même classe 1 .»
La distinction entre les colliberts et les serfs était pourtant réelle. Dans le Cartulaire de St.-Père, p. 180, est une charte de l’an 1061, par laquelle certain Hugue donne aux moines de St.-Père un collibert, sur lequel il a un droit de propriété 2 , avec sa femme, son frère et leurs enfants présents ou futurs, à condition qu’ils resteront libres, liberi, au service du monastère 3 . Il s’agit donc ici, comme M. Guérard l’a fait observer 4 , d’un serf que son maître affranchit en le faisant collibert de St.-Père 5 .
Un caractère distinctif de la condition du serf élevé au rang de collibert, c’est qu’il cessait d’être homme de corps, homo alieni iuris, un homme sur lequel on avait droit de propriété. Il était homme de pôté, c’est-à-dire en la puissance ou dans la dépendance d’autrui, comme le serf agricole et le colon. Comme l’affranchi, il pouvait être remis en servitude pour quelque délit. Les enfants qu’il avait alors restaient colliberts, ainsi le voulait l’équité; mais ceux qui venaient à naître depuis la dégradation de leurs parents /202/ naissaient serfs, ils subissaient la loi de leur origine 1 .
Les colliberts du moyen-âge étaient des affranchis de la moindre espèce: ils avaient un pied dans la servitude. Loin de jouir de la liberté parfaite, ils n’avaient qu’une liberté restreinte, conditionelle, surbordonnée à certaines obligations. En vertu, sans doute, d’une convention personnelle entre les serfs et leur maître, ou d’un droit réservé par celui-ci dans l’acte qui les sortait de la servitude proprement dite, les colliberts étaient tenus envers leur ancien maître, qui devenait leur patron, à certains devoirs que les chartes expriment par le mot d’obsequium ou de servitium. Dans un document précieux de l’an 1264, qui constate l’existence de la classe des colliberts dans le comté de Gruyère, on lit que le comte Rodolphe dit le Jeune, remettant à l’avoué et au Conseil de Fribourg, et à la commune de ce lieu, ses droits sur un homme de Morlon (village près de Bulle), ses deux fils et leur postérité, hommes et femmes, les affranchit de tous les devoirs qui les obligent envers lui et ses héritiers, devoirs connus sous le nom d’obsequium colliberti ou de servitium colliberti, toutefois sous la condition expresse que du moment que le dit homme ou l’un des siens renoncera à la bourgeoisie de Fribourg, il sera tenu de s’acquitter envers le dit comte et ses héritiers ou successeurs de toutes les obligations qui lui étaient imposées à titre de service de collibert, colliberti servitium 2 .
Cette dernière expression indique assez clairement que /203/ la condition des colliberts se rapprochait beaucoup de celle des serfs, ou qu’elle en différait peu.
Suivant M. Guérard, « l’obsequium imposé aux affranchis après des manumissions imparfaites consistait dans une somme d’argent, ou dans quelques autres redevances, accompagnées ordinairement de certains services ou devoirs, le tout au profit des patrons. »
« Dans les nombreux affranchissements faits par l’église de Paris au XIIIe siècle, il est presque toujours stipulé que les affranchis resteront soumis à la taille annuelle ad placitum ou à merci, aux dîmes, aux cens, aux redevances, aux corvées. L’obsequium comprenait aussi plusieurs restrictions au droit commun; mais, d’un autre côté, il créait, en faveur de l’affranchi, un patronage à l’abri duquel était placée, avec ses biens, sa liberté naissante 1 ».
Il paraît que la famille du village de Morlon, voulant améliorer sa condition et s’élever à l’état de liberté, alla s’établir à Fribourg, de l’aveu du comte de Gruyère, son patron, et se placer sous la protection de la mainferme (Handveste) ou constitution de cette ville 2 , calquée sur celle de Fribourg en Brisgau, qui déclarait libre tout serf qui venait en ville. Le comte de Gruyère renonça à l’obsequium en cessant d’être le patron de la famille du collibert qui s’était établie à Fribourg, et il se réserva ce droit pour le cas où cette famille ou l’un de ses membres rentrerait sous son patronage. /204/
Les colliberts se montrent rarement dans les chartes, soit qu’ils n’aient pas eu une longue existence, soit qu’ils aient été compris dans la classe des affranchis, ou qu’ils se soient bientôt confondus dans celle des villains et des mainmortables, ou dans la population libre des villes et des cités.
V.
Considérations générales sur la condition des serfs et leurs progrès dans la liberté.
Les défenseurs de la justice et de l’équité, les hommes généreux, les vrais amis de l’humanité ont flétri l’esclavage de tous les temps, sous quelque forme et chez quelque peuple qu’il se soit élabli et maintenu. « L’esclavage, dit un historien, fut le crime de la société païenne, et la Providence voulut que comme toute société qui le maintient, elle y trouvât son châtiment. Tant que le travail et l’agriculture furent en honneur à Rome, que l’esclave, véritable membre de la famille, travailla sous les yeux du père de famille et avec lui, son sort fut comparativement tolérable; de ces rapports continuels de l’esclave et du maître, naissait une autorité plus douce, et le travail s’en ressentait; cette vie en commun était à la fois utile à l’esclave, au maître, à l’Etat. Mais, quand le travail dédaigné eut été abandonné aux races serviles, que les progrès du luxe eurent multiplié le nombre des esclaves, et qu’il se trouva des citoyens qui en possédèrent jusqu’à quatre mille, ces troupeaux de misérables devinrent étrangers à leurs maîtres; le travail languit, l’agriculture fut négligée, et l’Italie, obligée de tirer sa nourriture des contrées lointaines, fut facilement affamée dès qu’on parvint à l’isoler du reste du monde, ce qui arriva dans la guerre des pirates, et plus tard lors des invasions. L’esclavage tua l’industrie comme l’agriculture, en écrasant par une concurrence inégale les travailleurs libres, les pauvres /206/ plébéiens, qu’il réduisit à la mendicité; il la tua également en la concentrant dans les mains de misérables qui l’exerçaient sans zèle, parce qu’ils l’exerçaient sans profit 1 ».
« La servitude, dit un autre écrivain, la servitude est une lèpre sociale, dont une nombreuse classe d’hommes a souffert chez les peuples tant anciens que modernes, et qui s’est propagée sous les gouvernements les plus libres aussi bien que sous les plus despotiques 2 ».
Les Anciens, en particulier les Romains, dont les mœurs avaient quelque chose de féroce, voyaient dans l’esclave un être qui n’avait rien gardé d’humain que la faculté de prévoir ses souffrances. Contre une si abominable dégradation, contre ce funeste abus de la force et du préjugé, point de réclamation, pour ainsi dire, avant la prédication de l’Evangile. Chez les hommes politiques, une froide et tranquille exploitation de l’homme par l’homme; chez la plupart des philosophes, ignorance du droit naturel, ou dédain pour l’infortuné qui avait été réduit à l’état de chose et mis sous l’entière dépendance d’un maître; chez l’esclave, une stupide résignation à son état d’avilissement, et une abjection tellement profonde qu’il ne la sentait plus 3 ; partout, enfin, l’esclavage considéré comme une question jugée, comme un fait hors de contestation.
Cependant, si les lois romaines méconnaissaient à l’égard /207/ de l’esclave tous les droits de l’humanité, si elles le dépouillaient de la dignité humaine, et l’abaissaient au rang de l’animal et de la chose, quelques philanthropes, un Cicéron, un Atticus, bravant le préjugé vulgaire avec l’énergie et la conviction que donnent une conscience éclairée et l’amour du bien, traitaient leurs esclaves avec douceur et bonté, et l’on pourrait dire que le sort de ceux-ci n’était pas très-malheureux, si le plus grand malheur pour des hommes n’était pas la perte de la liberté, la privation de toute espèce de droit. Mais, quoique la douceur et la clémence de ces deux célèbres Romains envers leurs esclaves ne fût, à vrai dire, qu’un heureux accident, qu’une exception, cependant un pareil exemple dut faire une impression profonde sur quelques-uns de leurs concitoyens. Il y a plus, Cicéron, dans son Traité des Lois 1 , a parlé de la dignité de l’homme, des rapports de l’homme avec Dieu, de l’excellence de ses facultés intellectuelles avec tant de raison, de force et de sentiment que, frappés de ses observations, des hommes éclairés et sensibles, à qui l’expérience avait d’ailleurs appris que sous le vil manteau de l’esclave pouvait battre un cœur généreux, ont reconnu l’énormité du crime que la société avait commis envers l’esclave, et pensé à la réhabilitation de cet être dégradé.
C’est dans les écrits de l’illustre disciple de Platon que plusieurs pères de l’Eglise, Lactance, St.-Ambroise et d’autres, ont puisé, en partie du moins, ces idées de justice et de droit qui, propagées dans les pays chrétiens, ont puissamment contribué à l’émancipation de la race servile.
D’un autre côté, Juvénal a plaidé avec éloquence la cause /208/ des esclaves, et revendiqué pour eux une juste part des droits de l’humanité. Sénèque, dans son Traité de la Clémence (I, 18), a prononcé ces paroles remarquables: « Bien que (selon la loi) tout soit permis envers l’esclave, le droit commun de tous les êtres animés ne souffre pas que tout soit permis envers l’homme ». Dans une épître que ce philosophe écrit à son ami Lucile (Ep. 47), il le loue de sa douceur envers ses esclaves; il les recommande avec chaleur à sa bienveillance, à sa bonté. Afin de le fortifier contre un faux préjugé, il lui rappelle que les anciens Romains avaient coutume de considérer leurs esclaves comme des membres de la famille, familiares. « Ce sont des serfs »? ajoute-t-il, « mais ce sont des hommes. » — « Un tel est un esclave? Mais qui sait si dans sa poitrine ne bat point le cœur d’un homme libre » 1 .
Les idées philosophiques de l’antiquité ont assurément exercé une salutaire influence sur les destinées des esclaves; mais c’est au christianisme bien plus qu’à la sagesse des Anciens qu’on doit attribuer l’adoucissement de la servitude et les progrès de l’émancipation; aux idées chrétiennes, qui avaient déjà fait leur chemin dans l’esprit de ceux-là même qui persécutaient les disciples de Jésus-Christ. L’esclave qui se convertissait à la foi chrétienne était reçu et traité comme un frère par les apôtres du Sauveur; le principe chrétien d’égalité devant Dieu se réalisa; la fraternité humaine se répandit de proche en proche. Cependant, il faut le dire, la doctrine de Celui dont « le royaume n’est pas de ce monde », dont le code de salut n’a point le caractère d’une institution civile, la doctrine chrétienne, disons-nous, appelait plutôt /209/ l’affranchissement de l’esclavage spirituel que celui de l’esclavage du corps, selon cette parole: « La vérité vous rendra libres. » L’Evangile réclamait la douceur et la clémence du maître envers l’esclave, et enseignait à celui-ci la résignation dans les épreuves, la soumission et l’obéissance en toute chose excepté en ce qui est contraire à la volonté de Dieu 1 . Il répugne à l’esprit du christianisme qu’un fidèle soit traité à l’égal d’une chose. Dans le code sacré de l’Evangile, un homme ne peut être la propriété d’un homme. Mais le Nouveau-Testament n’intervenait point dans les attributions des Césars, il n’abordait point la question du droit qu’a l’homme d’être libre. Alors même que le christianisme, au bout de trois siècles, eut fait alliance avec l’autorité civile, le législateur ne reconnut pas au serf le droit d’être libre. Au sixième siècle, Justinien, qui avait reçu le baptême, définit le serf un homme sans état, c’est-à-dire, sans droits, un homme au pouvoir d’autrui, sur lequel on a un droit de propriété 2 .
L’influence que le christianisme exerça sur les destinées de l’esclave fut morale bien plus que politique. Mais grâce à la doctrine de charité, on vit s’améliorer par degrés les mœurs, les usages, toute l’ancienne organisation de la société et de la famille, et se préparer à la longue une sage émancipation, qui fut un progrès lent, à la vérité, mais sûr, inévitable. Des traces sensibles de l’influence chrétienne se trouvent dans les nouvelles facilités accordées pour les affranchissements par les empereurs. /210/
L’établissement des Barbares dans la Gaule ne changea pas plus la condition des serfs qu’elle n’améliora celle des colons. Les serfs continuèrent d’être considérés comme une chose 1 . Toutefois, peu à peu l’esclavage fit place à un état moins rigoureux. On dut en partie cet adoucissement aux mœurs des Germains, chez qui la condition de l’esclave était beaucoup moins dure que chez les Romains. « Chez les Romains, on le sait, le travail et les profits des esclaves, à l’exception d’un pécule assez modique, appartenaient aux maîtres 2 , tandis que dans la Germanie, les maîtres n’exigeaient, en général, de leurs esclaves que des redevances et des services limités et réglés par des conventions et par des coutumes 3 . Le servage qui se forma dans la Gaule, sous la domination des Franks, du mélange de la servitude romaine et de la servitude germanique, prit à la fois le caractère de l’une et de l’autre, avec les tempéraments apportés par la doctrine évangélique 4 ».
Pénétrant peu à peu dans tous les rangs de la société, le christianisme prépara une nouvelle économie, où l’homme ne serait plus la propriété de l’homme. C’était surtout par l’Eglise que les droits de l’humanité étaient reconnus et le plus respectés dans la personne des serfs; elle vint à la défense de ces malheureux contre la brutalité de leurs maîtres, en prononçant l’excommunication et une pénitence de deux années contre toute personne qui tuerait son propre serf /211/ sans le concours du juge 1 . L’Eglise ouvrit aux serfs des asiles sacrés; elles les admettait dans les rangs du clergé, où, dès le Ve siècle, ils pouvaient être élevés aux hautes dignité du sacerdoce; mais les serfs du roi pouvaient, aussi bien que ceux de l’Eglise, parvenir aux premiers honneurs 2 . Si, d’un côté, l’Eglise favorisa les affranchissements, de l’autre, elle contribua elle-même au maintien de la servitude: alliant les intérêts matériels aux intérêts spirituels, elle entretenait des serfs nombreux pour cultiver ses vastes domaines et faire divers services, exécuter les travaux manuels, exercer des métiers. Il est vrai que ses propres serfs jouissaient d’un sort qu’enviaient les serfs des seigneurs laïques; mais ce n’étaient pas moins des hommes privés de la liberté personnelle. On pourrait même dire que l’Eglise, ou, si l’on aime mieux, le clergé augmenta, en quelque sorte, la race servile, car les enfants illégitimes des clercs furent déclarés par les conciles serfs des églises desservies par leurs pères 3 . L’Eglise, à la vérité, adoucit la servitude, mais elle ne travailla pas avec assez d’ardeur à son abolition, parce qu’elle ne fut pas assez pénétrée de l’esprit de l’Evangile. L’Eglise prêchait que les serfs étaient, devant Dieu, les égaux des puissants et des riches, par la nature, mais elle n’enseignait pas l’égalité des hommes devant la loi. Qui eût alors songé à proclamer ce grand principe qui, /212/ consacré par l’antiquité profane, périt sous les ruines de la république romaine, et ne fut rappelé à la vie qu’au bout de plusieurs siècles? — On ne saurait méconnaître dans l’amélioration graduelle du sort des serfs l’action de la religion et de l’Eglise; mais l’Eglise, ou plutôt le clergé, qu’il ne faut point confondre avec la religion, ne fit rien pour réintégrer le serf dans le plus saint de tous les droits; elle ne s’employa pas à rétablir en faveur de l’homme ce droit que la violence lui avait ravi, le droit d’être libre. Aussi longtemps que ce droit ne fut pas reconnu et sanctionné, l’homme sorti de la servitude ne jouit que d’une liberté précaire.
D’abord les serfs s’efforcèrent d’affranchir leurs personnes et leurs possessions. Pendant que les vassaux, agissant contre leurs suzerains, s’érigèrent en seigneurs presque indépendants, les serfs agricoles, encouragés par cet exemple, réagirent contre les vassaux, leurs maîtres; pendant que les grands s’emparèrent de leurs bénéfices et des emplois royaux pour les convertir en propriétés héréditaires, les petits, à leur tour, travaillèrent à retirer leur corps et leurs champs des mains de leurs seigneurs, et à s’approprier leurs tenures 1 . Cette double révolution, dans le haut et dans le bas de la société, cette double appropriation fut une des principales causes de la fréquence des guerres. Aux associations des seigneurs, les serfs opposèrent les communes jurées et l’insurrection: ils rappelèrent la vieille ghilde germanique, qui, transplantée de la Germanie sur le sol de la Gaule et dans les autres contrées occupées par les Barbares d’outre-Rhin, /213/ se propagea avec une inconcevable rapidité. Les serfs, s’unissant par l’association sous le serment, résistèrent à la tyrannie de leurs maîtres. « Leurs tentatives d’affranchissement se multiplièrent de siècle en siècle, et devinrent plus difficiles à réprimer. Dès le règne de Charlemagne, on trouve, dans la législation des Franks, des dispositions à prévenir les conjurations des serfs 1 ». Ces unions sous la foi du serment, quelquefois tolérées, furent l’objet de diverses prohibitions durant tout le moyen-âge 2 .
On sait que le droit du vainqueur fut une des principales sources de l’esclavage, que les prisonniers de guerre étaient emmenés en captivité et fort maltraités. Une grande partie de la population saxonne avait été plongée en servitude. Elle attendait le moment de la vengeance.
Déjà pendant la guerre civile entre les fils de Louis le Débonnaire, dans le court intervalle qui s’écoula entre la sanglante bataille de Fontenay et le partage de Verdun, l’empereur Lothaire, afin de pouvoir opposer plus de résistance à ses deux frères, fit un appel aux Saxons. Ils se soulevèrent en masse contre les seigneurs franks, leurs maîtres, « domini », qui avaient obtenu des bénéfices et des offices royaux dans leur pays, et rallumèrent la guerre d’indépendance qui avait si longtemps occupé Charlemagne. Ce ne fut qu’avec /214/ beaucoup de peine que Louis le Germanique parvint à soumettre les insurgés. Le récit des chroniqueurs nous révèle un fait important, savoir que Louis étouffa la rébellion en exerçant envers les vaincus les droits que les seigneurs s’étaient arrogés sur les serfs. En effet, cent quarante furent décapités, quatorze furent pendus aux fourches patibulaires, outre un grand nombre qui furent mutilés 1 . C’est dans cette guerre, la première des paysans allemands contre les seigneurs, que se manifestent les premiers symptômes de résistance populaire contre les usurpations et la tyrannie des nobles, que se montre la résolution de peuples opprimés de se soutenir par des secours et une protection mutuelle, et de se soustraire au joug que leur imposaient les seigneurs. Il est difficile de ne pas le croire, si on rapproche des dispositions législatives et des prohibitions qui frappèrent les associations des serfs, d’une part le soulèvement des Saxons en 842, la grande conjuration des paysans de Normandie contre leurs seigneurs et les chevaliers, sur la fin du Xe siècle 2 , la révolte des paysans d’Alençon, au XIe 3 , l’insurrection /215/ des serfs du Vermandois, au commencement du XIIe 1 , et d’autres émeutes populaires. Ces divers soulèvements ont le même caractère, et sont produits par les mêmes causes.
De quoi se plaignaient les serfs? quels étaient les griefs des paysans? Deux peuples, qui au Xe siècle se connaissaient à peine, deux peuples séparés par la barrière infranchissable que la différence des langues avait élevée entre eux, les Gaulois et les Germains faisaient entendre les mêmes plaintes. Voici ce qu’entendaient dire, en France et en Allemagne, aux paysans du Xe, du XIe et du XIIe siècle, les poètes nationaux, fidèles échos de la société contemporaine. « Les seigneurs ne nous font que du mal, nous ne pouvons avoir d’eux raison ni justice; ils ont tout, prennent tout, mangent tout, et nous font vivre en pauvreté et douleur. Chaque jour est, pour nous, jour de peine; nous n’avons pas une heure de paix, tant il y a de services et de redevances, de tailles et de corvées, de prévôts et de baillis 2 ».« Nous ne pouvons couper des arbres, ni prendre le gibier dans les forêts, ni le poisson dans les rivières. Les seigneurs disposent des prés, des pierres, de l’eau, du bois; ils nous empêcheraient, s’ils le pouvaient, de respirer l’air dont tout le monde a le droit de jouir; ils nous déroberaient volontiers la lumière du soleil, /216/ la pluie et le vent, ou nous les feraient payer à prix d’or 1 ».
En Angleterre, en Italie, le peuple n’était pas plus heureux qu’en France et en Allemagne. C’est à s’affranchir du joug de la servitude, qui pesait lourdement sur eux, que les paysans et les gens de métier travaillèrent constamment. Animés de l’esprit de la vieille ghilde, qui se répandait de toutes parts, ils se liguèrent pour obtenir par la force ce qu’ils ne pouvaient obtenir autrement. Les associations qui s’étaient jadis formées aux sommités de la société, trouvèrent leur contrepoids dans celles qui se formèrent à sa base. Dans les villes et dans les campagnes, les hommes livrés au commerce, à l’industrie, à l’agriculture, s’unirent soit pour résister à l’oppression des seigneurs, aux vexations des chevaliers, soit pour se soustraire aux obligations trop onéreuses de leur propre condition 2 . Ces association fréquentes n’étaient autre chose que des communes jurées. Les villes, comme les paroisses rurales, se formaient en communes. Celles-ci vinrent à paraître presque aussitôt que les seigneuries furent constituées; elles s’organisèrent pour repousser la violence des seigneurs. /217/
Formées ensuite de ce mouvement populaire qui éclata vers le milieu du IXe siècle et se propagea dans les siècles suivants, les communes s’opposèrent à cette multitude de petits souverains locaux, pour conquérir non des droits civils, mais des droits purement matériels, pour obtenir le droit de vivre à l’abri des extorsions et des mauvais traitements. Le côté politique et moral ne se fait apercevoir que plus tard dans l’histoire des communes. Former une commune, s’organiser en commune 1 , devint le mot d’ordre des cultivateurs, des artisans, des marchands, c’est-à-dire des serfs émancipés, mais soumis à des obligations entachées d’une origine et d’un caractère serviles. Bientôt nombreuses et assez fortes pour se protéger elles-mêmes, les communes n’eurent pas de peine à se faire adopter, reconnaître et confirmer par la couronne. Les rois, d’ailleurs, commençaient à s’appuyer sur le peuple pour recouvrer leur autorité, que les grands feudataires avaient minée. Jusque-là les communes pouvaient être considérées comme des réunions extra-légales, n’existant que de fait et d’une manière précaire, c’est-à-dire à condition d’avoir constamment la force de leur côté. Elles avaient besoin de la sanction royale. Celle-ci ne se fit pas attendre longtemps. Dans le même siècle, Louis le Gros, roi de France (1108-1137), les empereurs Henri IV (1056-1106) et Henri V (1106-1125), et Henri Ier, roi d’Angleterre, (1100-1135), confirmèrent les communes, moyennant une forte somme d’argent, qu’ils considérèrent comme le prix légitime et la juste indemnité de leur protection.
La sanction royale donna aux communes un caractère de /218/ légalité et de stabilité; elle les élevait au rang d’institution; en reconnaissant ou confirmant leurs chartes, leurs statuts, ou en leur accordant des libertés et des franchises, l’autorité suprême leur concédait des droits que personne ne pouvait leur contester. La nouvelle société passait du fief dans l’Etat; ses membres devenaient hommes du souverain. Ce n’était pas là simplement changer de maître, mais plutôt passer de la domination d’un seigneur sous la protection du chef de l’Etat. Les communes durent le service militaire au souverain immédiatement 1 .
Mais quelque importante que fût la confirmation des communes, elle ne reconnaissait ni formellement ni implicitement à l’homme le droit d’être libre. Ce droit naturel, gravé dans le code de l’éternelle justice, ce droit imprescriptible, inaliénable, dont la violence et l’abus de la force avaient dépouillé l’homme, ne lui fut rendu qu’après que les princes séculiers eurent uni leurs efforts pour se soustraire au joug du sacerdoce romain et se rendre indépendants de l’Eglise 2 . Ici encore, l’exemple des grands fut suivi par les petits, et la révolution se fit dans le bas aussi bien que dans le haut de la société. L’Eglise avait usurpé des droits que l’Evangile ne lui conférait pas, des droits qui sont même étrangers à l’esprit du christianisme. Les princes et les grands vassaux, au contraire, revendiquaient un droit qui est antérieur à l’établissement du christianisme, qui est /219/ par conséquent au-dessus des lois de l’Eglise et indépendant de ces lois, un droit qui a sa racine dans la nature et sa raison dans la conscience du genre humain. La conquête que firent les princes, en secouant, après une lutte opiniâtre, le joug du sacerdoce romain, facilita l’émancipation des hommes non libres, et leur affranchissement de la servitude signala partout en Europe un progrès dans la liberté civile.
A peine l’autorité séculière se fut-elle dégagée des liens dans lesquels l’enserrait le pouvoir de Rome, que des idées plus libérales avaient déjà pénétré dans les esprits. Au commencement du XIIIe siècle, un gentilhomme saxon, nommé Eik de Repgow, rédacteur du recueil de coutumes connu sous le nom de Miroir des Saxons, s’exprimait en ces termes: « Lorsqu’on établit le droit, il n’y avait pas de serfs, et tous les hommes étaient libres quand nos ancêtres vinrent dans ce pays. Je ne conçois pas comment, en vérité, un homme peut être la propriété d’un homme. Un fait incontestable, c’est que la servitude a sa source dans la violence exercée envers des hommes faits prisonniers à la guerre, dans le droit du plus fort, dont on a fait jadis une coutume inique, et qu’on prétend aujourd’hui être un droit acquis 1 ».
Le XIIIe siècle est surtout mémorable en ce qu’il marqua /220/ la transition de l’ancien droit servile au droit nouveau. C’est apparemment dans ce siècle, avons-nous déjà dit, que les lettres d’affranchissement sont le plus nombreuses. L’Allemagne, où peut-être, au Xe siècle, la moitié au moins de la population ne jouissait pas de la liberté 1 , avait fait au XIIIe de grands progrès dans la voie des affranchissements. Après avoir été longtemps dépassée par la France, elle semblait vouloir la devancer à son tour.
Au commencement du XIVe siècle se fit, en France, une révolution sociale semblable à celle qui venait d’avoir lieu dans les pays d’outre-Rhin. Quelques années après le fameux démêlé de Philippe le Bel avec Boniface VIII, et la résistance énergique de la royauté aux prétentions du pape, qui portaient atteinte aux libertés de la France, le 3 juillet 1315, Louis le Hutin, dans une ordonnance célèbre, déclara la liberté de droit naturel pour tous les Français 2 .
Ce n’était pas dans des vues désintéressées que le roi proclamait un tel principe, puisqu’il vendit ce droit naturel d’être libre « à bonnes et convenables conditions … par lesquelles, dit-il, soffisant recompensation nous soit faite des émoluments qui desdittes servitudes pooient venir à nous et à nos successeurs … » Les seigneurs qui avaient des hommes de corps, mirent en vente, à son exemple, la liberté de leurs serfs. Il en fut de même dans les autres contrées de l’Europe. Les vassaux des seigneurs de la Gruyère ne furent pas plus que ceux d’autres seigneurs gratifiés de la liberté; ils l’acquirent à prix d’argent. Quoi /221/ qu’on pense de ces marchés 1 , ils prouvent que les serfs avaient fait des progrès dans la propriété, qu’ils avaient du bien, puisqu’ils étaient capables de payer chèrement la franchise qu’on leur vendait. « C’était là, à coup sûr, entre le XIe et le XIVe siècle, une immense différence et un immense progrès 2 ».
Toutefois cette œuvre d’émancipation n’était pas entièrement accomplie; la réforme commencée par la proclamation du grand principe que l’autorité royale venait de consacrer, et que les grands vassaux s’empressèrent de reconnaître, ne fut pas générale: diverses causes en ralentirent le progrès. Nous n’en indiquerons qu’une seule. Les serfs qui avaient un pécule convenable purent s’affranchir, tandis que les autres demeurèrent en état de servage. A la vérité, le droit naturel d’être libre, reconnu par lettres patentes, sanctionné par les lois du royaume, ne fut plus contesté, les seigneurs n’eurent plus sur le paysan ou le villain le droit de propriété, ni celui de le replonger en servitude; mais il n’en est pas moins constant que, dans mainte contrée, la plus grande partie de la population agricole continua de gémir dans la misère et l’oppression. Aussi les insurrections se renouvelèrent de siècle en siècle et devinrent toujours plus sérieuses et plus menaçantes.
Cependant, sous le régime paternel des comtes de Gruyère, leur petit empire ne fut le théâtre d’aucune scène qui eût le caractère de la jacquerie (en 1358), ou de la révolte des campagnards anglais, sous Richard II, (en 1381), /222/ ou de la fameuse insurrection des paysans d’Allemagne, pendant le XVIe siècle, (en 1525). Toutes ces masses attachées à la culture des terres demandaient à grands cris l’abolition de la servitude et des charges pesantes qui les accablaient.
Dans le petit Etat monarchique traversé par la Sarine, les pâtres et les cultivateurs qui composaient la presque totalité de la population gruérienne, après avoir retiré leur corps des mains de leurs seigneurs, et obtenu successivement, et sous diverses conditions, le droit de propriété, l’hérédité perpétuelle de leurs tenures, l’abolition du droit de suite, et d’autres franchises, formaient, au XIVe siècle, une classe nombreuse de paysans libres, membres de communes, et investis des droits civils. Ces paysans n’avaient pas, à la vérité, les priviléges des bourgeois des villes et des bourgs, mais ils n’en étaient pas moins hommes libres et citoyens actifs. Des charges nombreuses et variées pesaient encore sur eux, mais redoublant de zèle et d’énergie, ils réussirent par leur travail et leur économie à en diminuer le nombre et le poids; ils parvinrent à dégrever leurs propriétés, à se libérer peu à peu de la mainmorte, des lods et ventes, enfin à affranchir leurs communes, en acquérant, au moyen d’une somme considérable, le droit de sceau, prérogative essentielle des communes. Cet affranchissement multiple, qui fut lent, à la vérité, mais progressif, continuel, s’opéra dans la Gruyère sans troubles et sans violente secousse.
C’est ainsi que les hommes non libres de ce pays, de même que ceux d’autres contrées voisines ou éloignées, s’élevèrent graduellement jusqu’à la pleine liberté. Chacun de leurs pas affermissant leur marche dans la carrière, on les voit conquérir avec la propriété, et par elle, une vie politique. Partout ils forment des communes de citoyens libres /223/ investis des droits civils, et exerçant ces droits dans les assemblées publiques.
Il est vrai que le mouvement d’amélioration et d’affranchissement de la population agricole fut arrêté ou du moins ralenti, en France, par la royauté qui absorba le tiers-état, en Suisse, par l’aristocratie des villes; mais se fortifiant d’époque en époque, le simple homme libre se vit au bout de quelques siècles en possession du pouvoir. « Telle est la destinée du peuple dans la société moderne: il commence par la servitude et finit par la souveraineté 1 ».
VI.
Des hommes libres en général.
« L’homme libre du moyen-âge est en quelque sorte défini par la formule ordinaire des actes d’affranchissement; c’est l’homme qui jouit du droit d’aller où il veut sans pouvoir être réclamé légalement par aucun maître 1 ».
Nous distinguons avec M. Guérard trois ordres d’hommes libres, suivant qu’ils ont: 1° liberté, propriété et juridiction; 2° liberté et propriété sans juridiction; 3° liberté sans propriété ni juridiction.
Le premier ordre formait l’aristocratie territoriale ou la noblesse féodale, dont nous parlerons plus tard; le deuxième comprenait les hommes libres qui ne jouissaient d’aucune immunité ni juridiction, soit parce qu’ils n’habitaient pas sur leurs propriétés, soit parce qu’ils étaient soumis à la juridiction ou du propriétaire sur les terres duquel ils habitaient, ou du seigneur qu’ils s’étaient choisi. Les hommes libres du troisième ordre ne possédaient ni terre ni juridiction; c’étaient en général des hommes soumis à des tributs ou cens. Lorsqu’un homme libre, harcelé par un plus fort, était incapable de protéger son patrimoine ou sa liberté, il se rangeait volontiers sous le patronage de quelque seigneur puissant, et lui remettait sa propriété sous la condition d’en conserver la jouissance perpétuelle et héréditaire, moyennant un cens annuel et déterminé. /225/
Les hommes libres de cette classe étaient fort nombreux durant le régime de la féodalité. Ils n’étaient pas attachés à la glèbe, mais loin de jouir d’une liberté sans entrave, ils occupaient la place intermédiaire entre le noble et le serf, et acquittaient des droits et des services aux seigneurs dont ils avaient invoqué le patronage ou sur la terre duquel ils étaient établis 1 .
Il ne faut pas confondre l’ingenuus, c’est-à-dire l’homme libre de race, avec l’homme libre par affranchissement; les avantages de ce dernier étaient moins considérables que ceux de l’ingénu.
Des rôles du commencement du XIVe siècle 2 , appelés Extentes, soit reconnaissances des personnes, des terres et des revenus d’une partie du comté de Gruyère, à savoir des mandements du Vanel et de Château-d’Œx, indiquent un nombre considérable d’hommes libres, distingués en homines liberi (en moindre quantité), homines liberi domini, et homines liberi domini iurati, ou iurati homines liberi domini, et encore iurati homines domini liberi.
Les hommes libres du seigneur n’étaient autres que les hommes d’autrui, dont nous traiterons ci-après. Quant à ceux qui sont, de plus, appelés jurés, ou jurats, jurati, et que nous n’avons rencontrés sous cette dénomination que dans nos Extentes, nous inclinions d’abord à penser qu’ils /226/ différaient des autres hommes libres du troisième ordre en ce que n’ayant d’autres terres que celles qu’ils prenaient à bail, moyennant un cens et des services déterminés, ils étaient cependant conjureurs, conjuratores, c’est-à-dire que leur témoignage était reçu en justice dans toutes les questions, excepté dans celles de propriété. Dans cette hypothèse, il en eût été de même des affranchis jurés, affranchesiati iurati, et des taillables jurés, talliabiles iurati, de nos Extentes 1 . On sait que, dans certains cas, les serfs même pouvaient témoigner en justice avec les hommes libres, et ester en jugement; on sait aussi que déjà anciennement, sous les Romains et sous les Franks, les témoins étaient appelés jurés, parce qu’ils devaient faire leurs dépositions et leurs témoignages sous la foi du serment, « ut ea quæ noverint iurati dicant 2 ». Mais on ne pourrait pas voir dans les nombreux jurés de nos Extentes des experts en fait de coutume, ni les comparer aux jurés, « personæ iuratæ », de la Terre de Romainmotier, espèce de commissaires du Prieur, dont il y avait tant par commune, chargés d’interpréter les plaids ou la loi de la seigneurie. 3
Tout bien considéré, nous croyons que les hommes libres dits jurés n’étaient autres que ceux qui avaient prêté serment à la commune, et juré d’observer la loi du pays, tout comme les nouveaux bourgeois des villes reconnaissaient sous la foi du serment la commune et la constitution de la ville.
Les hommes libres établis sur le même territoire, et vivant sous la même loi, formaient entre eux une espèce de /227/ société civile, et jouissaient en commun de certains droits et usages, suivant la nature des lieux. Ceux dont il s’agit formaient apparemment une de ces corporations: on les qualifiait jurés ou jurats, parce qu’ils avaient juré la loi publique et l’association, c’est-à-dire la communauté ou la commune.
On verra ci-après que l’expression de jurati ou de « jurats », soit de conjurés, servait à désigner les membres de la commune.
Les affranchis, assimilés par leur sortie du servage aux hommes francs 1 ou libres, avaient, comme ceux-ci, la faculté de se réunir en assemblées. Les affranchis jurés, affranchesiati iurati, composaient, à notre avis, une espèce de société civile concurremment avec les hommes dont nous venons de parler.
Quant aux taillables de nos Extentes, ils étaient d’une condition inférieure à celle des hommes libres du seigneur 2 . Ils étaient hommes propres du seigneur, et ils payaient la taille réelle, ou le cens personnel, selon qu’ils avaient ou n’avaient pas de tenure 3 . Je présume que les taillables /228/ jurés de la Villa d’Œx, par exemple, concouraient avec les quelques hommes libres de ce lieu à la formation de la commune, dont ils avaient juré d’observer les statuts.
Les hommes libres, homines liberi, des rôles que nous venons de citer, étaient apparemment des hommes qui, possédant quelque bien en propre, cultivaient avec ce fonds des terres étrangères, et qui étaient, par conséquent, soumis à la juridiction ou du propriétaire sur le fonds duquel ils habitaient ou du seigneur qu’ils s’étaient donné. Il est dit de l’un ou de l’autre de ces hommes « libere tenet », ce qui prouve seulement qu’il n’avait pas un manse servile. Tous les hommes libres de cette espèce possédaient (tenebant) quelque bien que le seigneur ou le comte leur avait concédé. Ils lui payaient une redevance ou un cens annuel. On peut ranger parmi les charges qu’il leur avait imposées l’obligation de le suivre à la guerre.
Observations générales sur les hommes libres.
Dans le moyen-âge les hommes libres étaient mandés à cri public, soit pour délibérer sur les intérêts communs, soit pour concourir à l’exercice de la justice et poursuivre un criminel, soit encore pour entreprendre une expédition de guerre. Lorsque le seigneur ou son lieutenant les convoquait aux assemblées publiques, aux assises, il plantait soit un chapeau, soit une bannière, une lance ou une flèche, signes militaires et symboles de l’autorité féodale. L’organisation militaire servait de base à l’organisation civile.
L’homme libre avait le port d’armes, la lance et l’épée. Il transmettait ce droit à ses fils. Lui arrivait-il de forfaire à l’honneur, l’épée lui était interdite, le couteau, arme offensive /229/ du serf, la remplaçait. Cette peine était une dégradation.
L’homme libre, ingenuus, liber, possédait ou ne possédait pas des terres, mais il jouissait du droit de propriété. Il pouvait acheter, vendre, hériter, donner, transmettre, léguer. Il pouvait ester en jugement: son serment valait celui de l’homme non libre assisté de onze conjureurs. Habile à exercer des droits civils et politiques, il assistait aux assemblées générales et y paraissait armé; il délibérait avec ses pairs sur les intérêts de la commune dont il était membre. Il siégeait en justice, et, dans certains cas, procédait à l’exécution des jugements. Il jouissait du droit public (Landrecht). Il était vrai citoyen de la terre, ou, suivant les expressions de nos chartes, il était patriota, paysan, Landsasse, fils du pays.
Dès l’origine, l’homme libre était exempt de diverses charges, mais en aucun temps il ne fut dispensé du cens annuel, ni de l’obligation d’aller à la guerre et de faire le guet. De plus, il offrait chaque année au seigneur suzerain des dons ou des présents, annualia dona, munera. C’était, du moins dans la Gruyère, un usage dont le temps avait fait en quelque sorte une obligation pour l’homme libre de la campagne: Celui-ci logeait le comte et sa suite, ou subvenait à ses dépenses de voyage ou de tournée dans le pays. Il contribuait aux frais de toute expédition militaire qui avait pour but la défense de la patrie. Les hommes libres, en général, consentaient certaines contributions ou aides, dont chacun payait sa part en raison de ses moyens. Des hommes choisis par la commune faisaient la répartition de ces subsides volontaires.
De même que le serf pouvait obtenir la liberté, de même /230/ l’homme libre pouvait perdre la sienne et devenir incapable de la transmettre à ses enfants. L’homme ou la femme libre qui épousait quelqu’un de moindre condition tombait en servitude, suivant les principes du droit romain qui furent observés par les Barbares 1 . C’était une maxime commune en matière de droit féodal qu’en formariage le pire emporte le bon 2 . Cependant il arrivait que la femme libre qui était tombée en servitude par le fait de son mariage avec un serf, obtint, après la mort de son mari, de revenir à son premier état de liberté 3 .
Plusieurs lois, entre autres celles des Bourgondes 4 , voulant empêcher les mariages mixtes, dans l’intérêt de la liberté, ajoutaient à la dégradation une peine encore plus rigoureuse 5 .
Toute personne libre de l’Eglise de Romainmotier qui épousait une personne non libre, était exilée de la Terre et son héritage dévolu à la dite Eglise 6 .
On sait que les enfants nés du mariage d’un serf avec une femme libre furent agrégés à la classe des serfs, jusqu’à ce qu’une législation plus douce permit aux enfants de suivre en pareil cas la condition de leur mère plutôt que celle de leur père.
« La condition d’un enfant était fixée par celle de ses /231/ parents au moment de sa naissance, et n’était nullement altérée par les changements ultérieurs que ceux-ci pouvaient éprouver. Ainsi l’enfant était libre s’il naissait de parents libres, et demeurait tel lorsque ces derniers tombaient dans la servitude. De même les enfants nés lorsque leurs père et mère étaient affranchis ou colliberts, ne pouvaient être eux-mêmes qu’affranchis ou colliberts. Il eût été injuste que le crime du père ou de la mère fût aussi vengé sur les enfants; mais ceux que les époux engendraient après leur dégradation dans la servitude, naissant serfs, ne pouvaient être d’une autre condition que les serfs. Les uns et les autres subissaient la loi de leur origine 1 ».
L’homme libre perdait encore sa liberté soit en s’établissant parmi des serfs, soit en passant volontairement de la condition d’homme libre à l’état de servage. Le besoin de protection, une disette, la misère, d’autres calamités engagèrent maint homme libre à renoncer à une liberté qui, ne lui offrant ni sécurité ni bien être, n’avait pour lui plus de prix. Forcé de courber la tête sous le joug de la servitude, il aliénait sa liberté à des conditions stipulées entre lui et son maître futur. Trop faible ou trop pauvre pour conserver le bien qui donne le plus de charme à la vie, il ne renonçait pas toutefois à l’espoir de rentrer de droit dans la liberté s’il parvenait à payer ses dettes, ou s’il satisfaisait la personne qu’il avait lésée 2 . Il ne voulait pas se plonger en esclavage, il engageait sa liberté bien plus qu’il ne la vendait; mais souvent il était opprimé par l’homme puissant dont il avait recherché la protection. Les annales de la Suisse, /232/ du XIe siècle, en fournissent un exemple qu’on a souvent cité, parce qu’il est propre à faire voir combien la liberté sans la force était de difficile garde pendant le moyen-âge 1 . Alors, les hommes libres qui n’avaient ni fortune ni crédit étaient vexés, opprimés, dépouillés par les autres, aussi bien par les évêques, les abbés et leurs avoués que par les seigneurs laïques. Au contraire les hommes libres qui se sentaient forts bravaient l’autorité des grands et méprisaient leurs ordres 2 .
Cependant on aurait tort d’attribuer la diminution des hommes libres uniquement à l’oppression et aux vexations des seigneurs. Elle est due en partie à l’adoucissement du servage et à d’autres circonstances qui rapprochèrent les deux conditions des libres et des non libres, comme nous allons le démontrer.
Souvent les hommes libres qui ne possédaient rien, qui ne pouvaient ou ne savaient plus être libres, se mettaient au service d’autrui, et cultivaient des terres étrangères. Il y eut un temps où les colons et les serfs agricoles furent les seuls cultivateurs des champs d’un propriétaire foncier. Peu à peu le nombre des laboureurs se grossit d’une multitude d’hommes libres pressés par le besoin, dominés par la misère. Le seigneur de la terre leur concéda quelque bien fonds, d’abord à vie seulement, puis avec faculté de le transmettre à leurs enfants. Dès le IXe et le Xe siècle, les immeubles concédés passèrent aux neveux de ceux qui les avaient obtenus, souvent même à leurs /233/ collatéraux 1 . En recevant un fonds de terre dont les tenanciers étaient soumis aux charges de la servitude ou du servage, l’homme libre s’obligeait à tous les devoirs qui résultaient de cette tenure. Il devait en être ainsi, attendu que, sans cette obligation, le seigneur du sol occupé par les hommes libres dont il s’agit, eût été privé des droits et des redevances que lui assurait le domaine direct. Ainsi, quoique l’homme libre ne fût pas inséparablement lié à la glèbe, cependant, devenu possesseur d’un héritage censuel, il acquittait les mêmes redevances et faisait les mêmes services que le serf ou le colon, à moins que le seigneur de la terre ne l’affranchit des obligations qui lui étaient imposées.
Nous avons déjà dit qu’en principe la condition de la terre était indépendante de la personne qui l’occupait, et réciproquement. Ainsi, le manse servile occupé par un libre ne changeait pas de nature, et le libre établi sur une terre servile ne devenait pas serf pour cela. Mais comme tout droit territorial produisait un rapport de dépendance réelle et personnelle, l’homme libre, devenu possesseur d’un immeuble mainmortable qui, n’étant ni la pleine propriété ni le simple fermage, passait, selon la coutume, à ses descendants, se trouvait par ce fait placé au rang du serf agricole, et, comme celui-ci, sujet au droit de mainmorte. Il y a plus: le droit public (Landrecht, Volksrecht) ne couvrant, en principe, que la pleine propriété, l’homme libre qui avait une tenure, et qui par conséquent avait besoin de protection et mainbourg, réclamait naturellement le patronage du /234/ seigneur qui lui avait concédé le fonds, et se mettait sous la loi de la Terre ou de la Cour (Hofrecht).
Les relations de dépendance entre le possesseur et le seigneur, relations fondées sur des actes écrits, comme tout ce qui déroge au droit commun, et parfois mal définies, plus souvent encore mal interprétées, pouvaient donner lieu à diverses contestations. Les différents nés de ces rapports étaient soumis au droit sous lequel les dits possesseurs vivaient, c’est-à-dire au droit appelé lex ou jus curiæ, Hofrecht, la loi de la cour. Or ce droit, ou cette loi, d’abord applicable aux serfs et aux colons seulement, dut l’être aussi aux hommes libres devenus possesseurs d’un fonds étranger mouvant d’un fief, et placé sous le patronage du seigneur de ce fonds. Le rapport de dépendance entre eux et le seigneur foncier, les assimilant en quelque sorte aux cultivateurs non libres, et élevant ceux-ci presque au niveau des premiers, rapprochait sensiblement les deux conditions. Déjà, en effet, le serf n’était plus distingué du censitaire de condition libre que par certaines prestations féodales, souvenirs du servage, et par le droit qu’avaient les hommes libres de paraître aux assises du comte ou haut justicier, de prendre part à l’instruction des procès criminels et à la confirmation de la sentence. Grâce au rapprochement que nous venons de signaler, et à la relation de dépendance personnelle et réelle qui en était la source, il fut possible d’introduire dans la loi de la terre ou de la cour la plupart des dispositions du droit national ou public (Volksrecht), et de réunir les deux classes de laboureurs sous une espèce de droit commun. Dès lors, la ligne de démarcation qui séparait le serf de l’homme libre tendit à s’effacer de plus en plus, et les deux classes, se fondant en une /235/ seule, concoururent à former la commune, communitas, universitas 1 .
Ce rapprochement des deux classes de cultivateurs fut singulièrement facilité, par exemple dans la Gruyère et dans les terres du chapitre de Lausanne, au XIIIe siècle, par l’abolition du droit de suite. Cet événement mémorable, que nous avons déjà signalé, contribua plus que toute autre circonstance à élever les serfs agricoles au niveau des laboureurs de condition libre, et à fondre les deux conditions en une seule classe de cultivateurs, soit de campagnards ou de paysans, qui formèrent les paroisses ou communes rurales, et qui sont désignés, dans la Suisse romane, sous la dénomination particulière de prudhommes.
Des considérations qui précédent il résulte que le nombre des hommes libres, avant l’institution des communes, alla toujours en augmentant ou en diminuant, suivant l’idée qu’on attache à ce mot. Si on entend par liberté l’état des personnes qui, n’ayant aucune tenure, aucun office, ne devaient ni droits ni services à quelque seigneur, et s’établissaient où ils voulaient, les hommes libres devinrent toujours moins nombreux et finirent par disparaître 2 . A l’époque où commence l’histoire politique de la Gruyère, tout ce qui habitait cette contrée était, comme on était en d’autres pays, l’homme de quelqu’un, bien qu’à des conditions différentes. Mais si on entend généralement par libre tout ce qui servait à composer l’ordre intermédiaire entre la noblesse territoriale et les serfs, la classe des hommes libres se /236/ grossit continuellement 1 . A la vérité, ce progrès ne continua pas, au delà du XIVe siècle, avec autant de rapidité et d’étendue qu’on pourrait le présumer. Le mouvement d’amélioration et d’affranchissement de la population agricole fut ralenti par diverses causes 2 . Un fait que nous tenons à enregistrer, c’est qu’au XIVe siècle il n’y avait plus de serfs proprement dits dans le petit empire de Gruyère 3 .
VII.
Des Prudhommes.
I.
La question des Prudhommes, intéressante en elle-même, acquiert une nouvelle importance par les débats qu’elle a fait naître. Elle mérite d’être discutée de nouveau et traitée à fond. J’essaierai de la résoudre: pour cet effet, je devrai entrer dans plusieurs détails.
Le mot prudhomme, qui nous est venu de probus homo 1 , est synonyme de bonus homo et de bonus vir, comme on le verra dans le cours de cette discussion.
Tel érudit a cru voir dans les boni ou probi homines, c’est-à-dire dans les prudhommes du moyen-âge, des traces soit des rachinburgi ou rachimburgi de la Loi salique, soit des scabini, ou scavini, c’est-à-dire des juges, iudices, institués par Charlemagne; tel autre en a fait des magistrats municipaux.
Les écrivains qui prennent les bons hommes pour des magistrats des anciens municipes, sont forcés de dire ou de supposer que l’expression boni homines correspond à celle de senatores et s’applique aux sénateurs gallo-romains. Il convient donc de déterminer le sens du mot bonus et de ses équivalents honestus et probus, qui, conservés sous la /238/ domination franke, ont passé avec leur signification primitive dans le régime féodal, et servi à désigner une même classe de personnes, une même condition sociale.
Les Romains donnaient la qualification de boni et d’honesti aux hommes nés libres, et plus particulièrement aux affranchis, pour les distinguer: 1° des esclaves qui, n’ayant pas la puissance d’eux-mêmes, n’avaient pas de droits; 2° des ingénus, ingenui, liberi, soit des hommes libres de race ou d’origine, dont ils différaient principalement en ce qu’ils demeuraient dans un rapport de dépendance envers leur patron, qui était leur ancien maître 1 .
La qualification de boni et d’honesti assignait aux affranchis, /239/ dans la société, la place que revendiquait pour eux leur nouvelle condition, état intermédiaire entre l’esclavage et la liberté complète. La manumission ne conférait à l’affranchi ni le titre de citoyen, civis, qui seul était appelé liber, ni les prérogatives attachées à ce nom 1 .
A Rome, les secrétaires privés, par exemple, les scribæ privati, étaient presque tous des esclaves, et on les traitait, en général, comme les autres personnes de leur condition 2 , tandis que les secrétaires de l’Etat ou des magistrats, les scribæ publici, étaient des affranchis, des hommes estimés de quiconque savait apprécier leur mérite, et considérés en raison de l’importance de leur office, qui exigeait beaucoup de connaissances, une fidélité à toute épreuve, la discrétion et d’autres qualités rares. C’est pourquoi Cicéron donne à la classe des greffiers publics le titre d’ordo honestus, et à ceux qui la composaient les qualification de boni et d’honesti, malgré le préjugé qui s’attachait à leur naissance 3 .
Les boni dont parle Salluste, dans le Jugurtha, ch. 85, étaient ce qu’on est convenu d’appeler des gens comme il /240/ faut, les honnêtes gens, la classe qui jouit d’une certaine considération, et dont les mœurs n’ont rien de servile.
J’ajouterai que, chez les Romains, les mots bonus et honestus étaient en quelque sorte synonymes de liberalis 1 , mot qui servait à désigner tout ce qui annonçait une personne libre et bien élevée, qui avait reçu ce qu’on appelle une éducation libérale 2 .
Si des Romains nous passons aux Franks, qui leur succédèrent dans la Gaule, nous verrons que le mot bonus conserva dans son intégrité la signification qu’il avait chez les Romains. En adoptant la langue des vaincus, les conquérants germains n’altérèrent pas, en général, le sens des mots. — Il est souvent question des boni homines dans /241/ l’histoire des temps mérovingiens. On appelait alors de ce nom une classe d’hommes, laquelle, sans être assimilée en tout point à la race dominante, jouissait au moins de la liberté personnelle et des droits de propriété et de liberté. Ces bons hommes, ces honnêtes hommes, c’étaient des Romains, des indigènes, des hommes libres, des citoyens actifs. Ils paraissaient comme témoins dans les actes civils, quelquefois comme intermédiaires; ils siégeaient dans les plaids ou assemblées publiques, en qualité de juges, je dirais volontiers de jugeurs (Urtheiler, Urtheilfäller), plutôt que de juges (Richter). Les rachimburgi franks avaient les mêmes priviléges 1 , et leur nom, qui désigne spécialement les hommes libres exerçant les droits de citoyens actifs dans les assemblées publiques, présidées par le justicier, c’est-à-dire par le comte ou le vicomte, est souvent traduit par celui de boni homines. On peut dire que, pris dans un sens politique, le mot de boni homines avait, dans la bouche des Gallo-romains, la même signification que celui de rachimburgi dans l’idiome maternel des Franks.
Aux rachimburgi des Franks répondent les arimanni des Lombards. Dans une acception particulière, ce nom désignait les guerriers: pris dans ce sens, il est traduit par l’expression de homines exercitales, plus souvent par celle de liberi. /242/
« Il est certain que les rachimburgi des Franks, les arimanni des Lombards et les boni homines des Gallo-romains ne désignaient point des magistrats, des hommes investis de fonctions spéciales, judiciaires ou autres, et distincts, à ce titre, du reste des citoyens ou des hommes libres. Dans une foule de documents, les arimanni sont mentionnés comme témoins, comme simples guerriers; le même nom est donné aux bourgeois libres des villes; les rachimburgi franks paraissent de même en des occasions où il ne s’agit d’aucune fonction publique à remplir: on peut en dire autant des boni homines. Tout démontre que ces noms s’appliquaient aux hommes libres, aux citoyens en général, et non à quelque magistrature spéciale, à quelque pouvoir public 1 ».
Les uns et les autres avaient le droit d’association, la faculté de se réunir en nombre indéterminé.
Ce qui sert encore à prouver que les bons hommes n’étaient pas nécessairement des magistrats ou des officiers publics, ce sont les formules d’anciennes chartes, où il est dit que telle ou telle donation a été faite à l’Eglise par les hommes bons et craignant Dieu 2 .
Les expressions de boni et de probi homines ne désignent en général que les simples bons hommes, les honnêtes hommes, composant une classe mitoyenne entre l’affranchi qui ne jouit que d’une liberté imparfaite, et le Frank ou le Lombard, qui jouit d’une liberté complète et du droit que la race dominante et guerrière exerce sur la race agricole /243/ et sujette. Quelquefois leur nom est remplacé par celui de pagenses 1 , auquel répond le mot patriotæ des temps féodaux, mot qui désigne les paysans, c’est-à-dire les hommes du même pays, les vassaux ou sujets du même suzerain, du même supérieur féodal.
Les dénominations de rachimbourgs et de bons hommes ont existé simultanément, au moins jusqu’au Xe siècle. La première devint de plus en plus rare, à mesure que l’idiome des Franks disparut devant la langue des Gallo-romains. Elle finit par céder la place à celle de boni homines 2 .
Nous ne dirons rien des scabini soit scavini 3 ou juges d’office institués par Charlemagne, et bien différents des arimans, des rachimbourgs et des bons hommes 4 . Ces derniers /244/ continuent pendant et après les Capitulaires à paraître comme citoyens actifs aux assemblées de justice. Ils se montrent durant tout le moyen-âge, comme simples hommes libres. Leur nom désigne des hommes libres, en possession des droits attachés à la liberté. D’ordinaire, les mots de boni homines, boni viri et probi homines sont employés dans le sens général d’hommes libres, d’hommes non engagés dans la servitude: ce n’est qu’à ce titre qu’ils exercent des droits civils 1 .
« Les chartes d’affranchissement des habitants de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et Crône, et des habitants de Thiais, Choisy et Grignon, les maintiennent dans l’obligation d’aider et défendre l’abbé de Saint-Germain, comme des hommes loyaux, boni homines, doivent le faire à l’égard de leur seigneur 2 ». « Au sujet de l’expression boni homines », dit M. Guérard, à qui nous empruntons ce détail 3 , « je /245/ rappellerai que M. Raynouard en a singulièrement abusé pour démontrer l’existence du régime municipal durant le moyen-âge. Après lui avoir ôté la signification générale qu’elle a presque toujours dans les passages dont il s’est servi, il lui en a supposé une toute particulière et fort restreinte, boni homines signifiant, selon lui, des magistrats municipaux. Mais c’est une erreur; ces mots signifient simplement, comme en latin, les honnêtes gens, ou comme le dit Montesquieu (XXX, 18), les notables. Cela n’empêche pas que les magistrats municipaux, quand il y en avait, n’aient été des boni homines; seulement ceux-ci n’étaient pas nécessairement des magistrats municipaux, au moins dans les textes des deux premières races et dans ceux des premiers siècles de la troisième. »
M. Guizot, ordinairement si profond et si vrai, a partagé l’erreur de M. Raynouard. Après avoir admis l’existence d’une noblesse sénatoriale à Bourges, au VIIe siècle, cet historien essaie de démontrer, à l’aide de quelques textes, qu’il y avait de temps immémorial, dans la ville de Bourges, un corps municipal, dont les membres, nommés d’abord senatores, auraient été désignés, dans la suite, sous les diverses dénominations de primores, boni homines, probi homines, barones, lesquels correspondaient, selon lui, aux senatores de la cité. « Le mot a changé avec la langue », dit M. Guizot, « mais c’est évidemment des mêmes personnes, de la même condition sociale qu’il s’agit 1 ».
Les primores ou barones formaient un ordre bien distinct /246/ de celui des boni ou probi homines, comme on le verra plus tard. Nous ferons observer ici que sous les Franks, on entendait par la cité, la contrée, ou le lieu, où l’évêque exerçait la juridiction ecclésiastique, et le comte la juridiction civile; que les bons hommes, par le fait même de leur condition civile, n’étaient point appelés aux fonctions des magistrats municipaux, pris dans l’ordre sénatorial. L’institution des plaids, où paraissaient les bons hommes, est d’origine germaine. Cette institution était essentiellement démocratique, tandis que l’esprit aristocratique dominait dans le régime municipal romain, comme M. Guizot l’a clairement démontré. Aux assemblées publiques assistaient, soit comme témoins, soit en qualité de juges, sous la présidence du comte ou du vicomte, de simples hommes libres, citoyens actifs, auxquels les Gallo-romains donnaient la qualification honorable de boni homines, et les Franks celle de rachimburgi. Ces deux mots, ainsi qu’il a été dit, avaient la même signification et désignaient des hommes, soit Franks, Romains, Gaulois ou autres, de la même condition sociale, exerçant les mêmes droits civils, mais qui n’avaient rien de commun avec les magistrats municipaux.
Les probi homines soit les prudhommes qui, en 1107, rendirent un jugement à Bourges, étaient, non des magistrats municipaux, mais simplement des hommes libres, des citoyens actifs, qui siégèrent au plaid en qualité de juges, sous la présidence du comte ou de son lieutenant, c’est-à-dire du justicier. C’étaient les mêmes personnes qu’on appelait bons hommes. Les anciens senatores, s’il y en avait à Bourges, n’avaient pas été remplacés par les boni ou les probi homines. Ces mots avaient conservé leur signification propre, /247/ et ils continuèrent à désigner les mêmes personnes, la même condition sociale dont nous avons parlé 1 .
La qualification de bons hommes ou de prudhommes se présente moins souvent à mesure que les simples hommes libres de race deviennent plus rares, mais elle se multiplie bientôt en raison de l’accroissement de la classe des affranchis et des hommes libres d’autrui. Cette classe se grossit continuellement sous l’influence de la religion chrétienne et sous la protection de l’opinion publique, qui reconnut enfin à tout homme le droit naturel d’être libre. A mesure que les affranchissements deviennent plus nombreux, le nom de prudhommes devient plus commun. C’est, en effet, depuis le XIIIe, et surtout depuis le XIVe siècle, qu’il se montre le plus souvent dans les chartes de l’Helvétie romane. L’abolition du droit de suite et la transition du droit ancien au droit nouveau, le passage de la servitude à la liberté, et l’établissement des communes, la proclamation du grand principe qui reconnaissait à l’homme le droit naturel d’être libre, ces faits considérables signalèrent une grande révolution dans l’ordre social, un progrès général du sort et de l’importance de la population agricole.
Dès le XIVe siècle, les documents du pays de Gruyère ne présentent que des gens soumis à la taillabilité réelle ou des choses, des affranchis et des libres. Plus de serfs proprement dits dans ce petit empire, à peine aperçoit-on ci et là quelques traces de l’ancien droit servile. Les dénominations de servi et de mancipia ont fait place, dans tout le pays roman et au delà de ses limites, aux qualifications de probi homines ou de prudhommes, de patriotæ, de Landleute, qui désignent partout des paysans libres et propriétaires.
II.
On a vu que, dans le Polyptique d’Irminon et dans d’autres textes, le nom de boni homines est donné a des affranchis, à de simples hommes libres, et que bonus homo est synonyme de probus homo. Ce nom, que la langue française a rendu par prudhomme, c’est-à-dire honnête homme, semble contenir l’idée d’une condition moins humble que celle du serf, et plus modeste que celle de l’ingénu ou du noble et du chevalier (miles, baro), l’idée d’un état intermédiaire, conséquence de l’affranchissement de quelque servitude. L’acception générale de cette expression, au moyen-âge, rend très-probable l’opinion que je viens d’énoncer. En effet, le pieux auteur du Mireour du monde 1 appelle preudommes les gens « quiex Dieu a par sa grace affranchi du servage au déable ». Il compare la transition graduelle du mal au bien, à celle du servage à la liberté. Dans plusieurs passages du Mireour 2 , les mots prudhomme et prude-femme signifient honnête et chaste, c’est-à-dire non esclave du péché. Ailleurs encore 3 , prudhomme signifie courageux, brave, loyal 4 , plein d’honneur et de probité, qualités qu’on /249/ n’attribuait qu’à l’homme libre, à l’homme dégagé des liens du servage, ou non entaché de servitude, vu que le serf, en principe, était privé du droit de port-d’armes, exclu de toute expédition militaire. On ne pouvait dire que de l’homme libre qu’il avait l’âme élevée et le cœur vaillant.
Le mot preux vient de probus 1 , et prouesse, jadis synonyme de bravoure, vient de probitas: prudhomme est la traduction de probus homo, et prudhommie, qui se trouve aussi dans nos chartes, signifiait à la fois sagesse et probité 2 . /250/
Les dénominations de honesti homines, boni homines ou boni viri 1 , et de probi homines ou de prudhommes, si fréquentes dans les chartes du moyen-âge, servaient indubitablement à désigner les personnes affranchies de l’ancien droit servile, ou de simples hommes libres, qui, en cette qualité, siégeaient aux plaids ou assemblées publiques, et y /251/ prenaient une part active, sous la présidence du justicier. Ils accomplissaient un devoir en même temps qu’ils exerçaient un droit. Leur présence aux assemblées publiques était non facultative, mais obligatoire. Toutefois, il ne faut pas conclure de l’affranchissement dont nous parlons à l’exception soit des corvées, soit de la mainmorte, soit d’autres charges féodales. Les habitants de Charmey, de Gessenay, de Rougemont, de Château-d’Œx, et d’autres lieux du comté de Gruyère, sont appelés prudhommes dans des actes bien antérieurs aux chartes qui les dispensent de diverses obligations onéreuses et les libèrent de la mainmorte.
Quelle était donc cette franchise qui valut aux gens du comté de Gruyère, ainsi qu’aux habitants de la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier, et à ceux d’autres terres, la qualification de prudhommes? C’était l’affranchissement de la servitude personnelle. La taillabilité réelle, attachée aux propriétés, non aux personnes, n’était pas le servage de la glèbe. La condition mainmortable des terres n’excluait de la liberté civile ni le tenancier ni l’emphytéote: elle était même compatible avec la noblesse héréditaire 1 . La condition de la terre, nous l’avons déjà dit, était indépendante de la condition de la personne qui l’occupait, et réciproquement. La servitude de la terre et la servitude personnelle étaient deux choses différentes. Toute personne franche de la servitude personnelle avait la jouissance de la liberté civile. Or, tous ceux qui jouissaient de cette liberté dans le comté de Gruyère, de même que dans la seigneurie de Romainmotier, et dans d’autres terres de l’Helvétie romane, tous les simples hommes libres de la campagne, tous les /252/ paysans ou villageois en possession de la liberté civile, étaient qualifiés prudhommes.
Les personnes de cette classe sont bien souvent désignées, dans le comté de Gruyère, par les noms de patriotæ, de Landleute, ou de paysans, qui signifient les gens du pays (patria, Land). Il est telle charte qui les appelle simplement les hommes, homines; mais comme cette expression s’employait aussi quelquefois des personnes de condition servile, et, dans une acception générale, de tous les hommes libres de la campagne et des villes, on la faisait le plus souvent précéder d’un adjectif qui servait à désigner les hommes affranchis de la servitude personnelle; on les nommait les honnêtes hommes, les bons hommes 1 , presque toujours, et dans la règle, les prudhommes, probi homines. A cette qualification répondent, dans les chartes en langue allemande, les mots erbre (ehrbare, honorables), biderbe, (biedere, preux, loyaux), et d’autres 2 . /253/
Les hommes libres de cette classe composaient les paroisses et les communes rurales 1 . /254/
Les prudhommes, c’est-à-dire les membres de la paroisse ou commune rurale, prenaient naturellement une part active aux affaires de leur commune. Il y a plus, les femmes même prenaient part aux actes publics ou privés. En voici deux exemples entre plusieurs.
Premier exemple. Il y eut au XIIIe siècle, un différend entre le prieur de la chartreuse d’Oujon et les habitants de Begnins, au sujet d’un droit de pâturage dont ceux-ci prétendaient jouir dans certains bois compris dans les limites du territoire du couvent, droit que le Chapitre leur contestait. Après de longs débats, les deux parties firent un accord, qui fut consenti et approuvé non-seulement par les hommes de Begnins, mais encore par des femmes: celles-ci figurent dans le contrat aussi bien que les hommes 1 .
Second exemple. Gui de Prangins, évêque de Lausanne, au XIVe siècle, ayant acquis un chesal et un four à Chexbres, loua l’un et l’autre à la commune de ce lieu. Le contrat fut approuvé par quarante-un hommes et une femme, qui le confirmèrent en leur propre nom et au nom des autres prudhommes de la dite commune 2 . /255/
L’auteur des Recherches sur Romainmotier, feu M. Fréd. de Charrière, a inféré de quelques chartes, en particulier du plaid général d’Apples, de l’an 1327, où paraissent quarante-trois hommes et femmes, qualifiés probi homines, que les femmes n’étaient pas exclues des plaids généraux 1 .
Ce fait remarquable a pu lui paraître étrange; cependant il n’est point isolé, point extraordinaire.
Il est certain que parmi les « preudes gents », les femmes pouvaient, aussi bien que les hommes, paraître comme témoins dans les actes civils: pour cet effet, il fallait nécessairement qu’elles pussent siéger dans les plaids ou assemblées publiques.
On lit dans les statuts accordés en 1398 à la ville et à la châtellenie de Cossonay: « … Tous les bans qui viennent d’être mentionnés doivent être prouvés et attestés par le serment, prêté sur les saints Evangiles, de plusieurs prudhommes ou femmes, « proborum virorum vel mulierum », non intéressés au débat, et cela au lieu où il est d’usage de tenir les plaids devant les prudhommes de la dite ville 2 . »
Dans le Cartulaire de Romainmotier et dans les deux /256/ chartes de 1266 et de 1384 que nous avons citées, on ne voit intervenir que peu de femmes. La question qui se présente est donc celle-ci: Les femmes ne paraissaient-elles aux plaids qu’en nombre déterminé? en d’autres termes: leur présence aux assemblées publiques, leur participation aux actes civils, était-elle subordonnée à quelque condition?
La réponse à cette question peut se trouver dans un passage intéressant du Cartulaire de Romainmotier, qui ne permet pas de douter que la coutume ou la loi de la Terre n’ait assimilé aux prudhommes les femmes qui remplaçaient les maîtres ou chefs de maison décédés, et qui avaient hérité des obligations des défunts aussi bien que de leurs droits 1 . La même loi était observée dans d’autres terres, et apparemment dans toute l’Helvétie romane. Or, le chef de famille, soit le chef de ménage ou maître de maison 2 , devait assister au plaid général 3 . /257/
De tout ce qui précéde, il suit que les prudhommes du moyen-âge, notamment dans la Suisse romane, étaient les paysans libres, propriétaires, chefs de famille, qui composaient la commune rurale, et que leur nom ne désigne nullement des magistrats spéciaux, des officiers revêtus de quelque pouvoir public. Cela n’empêche pas que les membres d’un conseil municipal ou communal n’aient été des prudhommes 1 , seulement ceux-ci n’étaient pas nécessairement des fonctionnaires publics 2 .
D’ordinaire les membres d’un conseil communal sont qualifiés probi homines, honesti viri, d’où on a conclu par erreur que cette qualification était propre aux magistrats, aux officiers publics, ou bien encore, qu’elle servait à désigner des coutumiers spéciaux, soit des experts en fait de /258/ coutume, des interprètes de la coutume ou de la loi du pays. Ces opinions ne sont appuyées d’aucune preuve. De même que les magistrats, les coutumiers ou les jurés étaient des prudhommes, mais ceux-ci n’étaient pas nécessairement des fonctionnaires chargés d’expliquer la coutume.
Dans maint document on voit se réunir tous les probi homines, c’est-à-dire tous les citoyens actifs d’une commune, soit pour établir ou constater certains faits, soit pour expliquer la loi de la terre, soit encore pour recueillir en un code les us et coutumes (qui constituent la loi non écrite) du pays 1 .
On donnait aussi les noms de bons hommes, de prudhommes et d’honnêtes hommes à une assemblée de patriotes commis par leurs concitoyens pour discuter et régler une affaire, ou à ceux qui, dans telle ou telle circonstance, avaient été choisis pour représenter les autres prudhommes, les autres citoyens actifs de la commune 2 . /259/
Enfin, dans un sens particulier et restreint, le nom de prudhommes servit à désigner les hommes qui composaient un conseil, une cour de justice. « A Orbe et à toutes les autres justices du pays (de Vaud), » dit un chroniqueur du XVIe siècle, « y sont commis douze que l’on appelle prodommes ou jurez de la justice … 1 »
Le prudhomme du moyen-âge, celui de nos chartes, c’est l’homme qui a retiré son corps et son bien de la main de son seigneur; qui n’est plus homme de suite; c’est le cultivateur ou le pâtre, chef de famille ou maître de maison, qui ne paye plus de fermage, mais seulement des droits seigneuriaux; qui, bien que soumis à des obligations féodales très-onéreuses, jouit à la fois du droit de propriété et de liberté; qui exerce les droits de citoyen actif dans les assemblées publiques; qui est délivré de tout joug de servitude, à l’exception des corvées, de la taille réelle, des cens et redevances auxquels il est soumis à cause de sa propriété et de divers services qui l’attachent au seigneur de la terre et le maintiennent dans un état de dépendance. Dans la hiérarchie sociale, le prudhomme du moyen-âge appartient à l’ordre inférieur des hommes libres investis des droits civils 2 , à une classe plus nombreuse et moins privilégiée que celle des bourgeois./260/
Les hommes de cette condition sociale étaient tous hommes libres du seigneur, hommes de pôté, en la puissance ou dépendance d’autrui, soumis à des obligations plus ou moins serviles 1 . Tous étaient soumis, dans un temps, à la mainmorte des propriétés. Les hommes des villages de la châtellenie de Gruyère ne furent affranchis de cette servitude, « manus mortue serve conditionis », qu’en 1388; ceux du Gessenay n’obtinrent l’abolition du droit d’héritage et de succession (« Erbschaft und Todfall »), soit de la mainmorte, qu’en se rachetant de celle-ci en 1397; ceux de Rougemont n’en furent libérés qu’en 1456; ceux de la terre de Romainmotier seulement en 1591 2 . Cependant tous ces hommes, tous ces paysans libres et propriétaires, étaient désignés par le nom de prudhommes. Ils avaient dès longtemps cessé d’être hommes de corps.
VIII.
Nobles, Chevaliers, Barons, Bourgeois, Habitants, etc. 1 .
Le service militaire, la naissance, l’illustration, la richesse, les charges considérables élevaient certains hommes au-dessus des autres hommes: ils étaient qualifiés nobles. Mais la noblesse considérée comme un ordre, la noblesse féodale ou l’aristocratie territoriale dut son origine à l’institution des fiefs, en sorte que ce fut la possession des terres qui fit les nobles, parce qu’elle leur donna des droits, des priviléges, et une espèce de sujets nommés vassaux, qui s’en donnèrent à leur tour par des sous-inféodations 2 .
Cependant on ne doit point comprendre dans la classe des nobles tous les fieffés ou possesseurs de fiefs, parmi lesquels on trouve des personnes exerçant des offices qui n’avaient rien de noble. Aussi, en disant que la noblesse commença à l’époque où les fiefs devinrent héréditaires, nous n’entendons point par là que tous les fiefs donnèrent la noblesse, et nous faisons une réserve pour les temps où toute chose susceptible de possession et les serfs même pouvaient être tenus en fief 3 ./262/
Au XIe siècle, la noblesse était complétement constituée, c’est-à-dire privilégiée et héréditaire. Elle peut être divisée en haute, moyenne et basse.
La haute noblesse était formée des grands vassaux, autrement des feudataires relevant immédiatement de la couronne, tels que le comte de Savoie, le comte de Gruyère, l’évêque de Lausanne, en sa qualité de prince temporel, et tous les autres dont le roi des Romains était le seigneur direct ou le suzerain. En principe, le bénéfice ou le fief accompagnait toujours le titre: ainsi le duc possédait un duché, le comte un comté, etc. 1 .
Sous les grands feudataires étaient les seigneurs composant la moyenne noblesse. Ils ne relevaient de l’Empire qu’indirectement, mais ils avaient des droits de seigneurie, c’est-à-dire de justice 2 . Ils exerçaient la haute, moyenne et basse juridiction dans leurs domaines, ou dans leurs seigneuries. Tels étaient, par exemple, les seigneurs de l’Helvétie romane qui dépendaient immédiatement, les uns du comte de Gruyère, les autres, en bien plus grand nombre, du comte de Savoie.
Ces divers nobles, établis sur leurs propres terres, dont ils avaient l’administration et la justice, formaient ce qu’on peut appeler le premier ordre des hommes libres. Ils jouissaient de plusieurs priviléges considérables. Outre les droits de propriété, de juridiction, d’immunité, et celui de seigneurie qui leur permettait d’avoir des prisons appelées cippi, dans lesquelles ils enfermaient leurs hommes ou leurs justiciables accusés ou convaincus de quelque crime, et /263/ mettaient aux détenus les ceps aux pieds et aux mains, ils eurent pendant longtemps, le droit de port d’armes et de guerre privée 1 , c’est-à-dire le droit de poursuivre et de venger, les armes à la main, leurs propres injures et celles de leurs parents 2 .
Nous rangeons, avec M. Guérard 3 , dans la basse noblesse les vassaux ou vavasseurs, qui n’avaient pas de juridiction territoriale, et les officiers attachés au service de la personne ou des terres du seigneur. Dans cette classe étaient un grand nombre de milites, c’est-à-dire de chevaliers et officiers, à la fois nobles et serfs, en ce qu’ils devaient des offices plutôt que des services, et qu’ils étaient placés dans la dépendance personnelle d’un seigneur, de laquelle ils ne pouvaient sortir que par l’affranchissement. Tels étaient, entr’autres, les milites cédés avec leurs fiefs au chapitre de Lausanne, dont ils étaient les hommes, et auquel ils faisaient foi et hommage, hominium et fidelitas 4 .
A ces nobles nous ajoutons les milites de la charte de 1177, et les autres vassaux de même condition, qui sont désignés quelquefois sous le nom de cavallarii ou caballarii, c’est-à-dire de cavaliers de guerre, de chevaucheurs ou d’hommes devant le service avec un cheval.
Sous les Franks mérovingiens, le mot miles désigne simplement l’homme d’armes d’un comte, le fidèle d’un supérieur. Il conserve longtemps son caractère presque exclusivement guerrier, et, devenu synonyme de vassus et vassalus /264/ (Gesell), il indique qu’un homme tient d’un autre un bénéfice et lui est attaché à ce titre. Du IXe au XIIe siècle, le mot miles désignait, non le chevalier tel qu’on le conçoit ordinairement, mais simplement le compagnon, le vassal d’un suzerain 1 .
Mais depuis que la chevalerie féodale eut atteint son complet développement, depuis le XIIe ou le XIIIe siècle, au plus tard, le mot de miles eut une signification toute particulière et fort restreinte, ce nom ne servant plus, en général, qu’à désigner les seigneurs ou officiers, c’est-à-dire les possesseurs de fiefs ou d’offices qui avaient été faits chevaliers, tandis que l’expression de nobilis, conservant la signification générale qu’elle a dans toutes les chartes, s’appliqua à tous les hommes libres de race 2 , à tous les gentilshommes sans distinction, et spécialement aux fils ou aux descendants de chevaliers, qui, par le fait de leur origine, étaient nobles, mais non chevaliers, milites, parce qu’ils n’avaient pas encore été admis au rang et aux honneurs de la chevalerie 3 . /265/
Alors on avait soin de distinguer le chevalier (miles) du simple noble (nobilis). Cette distinction est bien établie dans les documents, par exemple, dans une charte du 16 oct. 1256, où il est dit que Hartman, le jeune comte de Kibourg, accorda certaine autorisation non-seulement à ses chevaliers (qui sont communément appelés ses hommes liges), mais encore à d’autres hommes qui ont le nom et le caractère de la noblesse (c’est-à-dire qui sont hommes libres de race) et qui, bien qu’ils ne soient pas décorés des insignes de la chevalerie, sont toutefois les descendants légitimes d’une famille, dont quelque membre avait été fait chevalier 1 .
Les nobles de race ou d’origine qui aspiraient à ce titre, objet de leurs vœux et de leur ambition, les fils ou descendants de chevaliers, qui avaient le droit de le devenir, bref ceux qui n’avaient pas encore reçu l’accolade se distinguaient en deux classes, les domicelli et les armigeri.
Quoique le nom de domicellus, soit damoisel ou donzel, dans le vieux langage, se donnât aux fils des possesseurs de terres immédiates de l’Empire, et aux grands vassaux eux-mêmes, qui le portaient jusqu’à ce qu’ils eussent été faits /266/ chevaliers, cependant il ne signifiait pas nécessairement le fils d’un seigneur féodal (dominus), en possession d’un comté ou d’un autre domaine avec droit de seigneurie ou de justice, mais il désignait le plus souvent le possesseur de fief, le gentilhomme ou le noble qui, non chevalier lui-même, était fils ou descendant de chevalier 1 , et pouvait prétendre au même caractère. Dans ce sens, le possesseur de fief pouvait être à la fois dominus et domicellus 2 . Il ne déposait ce dernier titre qu’au moment où il était admis à la dignité de chevalier 3 .
Le nom de domicellus indique le plus souvent que celui qui le porte n’a pas encore été fait chevalier 4 . /267/
L’expression de dominus avait deux significations, l’une subjective, l’autre objective. Dans le premier sens, dominus 1 était un titre d’honneur que portaient tous les ecclésiastiques d’un ordre élevé, sans égard à leur origine. Parmi les laïques, il n’y eut d’abord que les empereurs, les rois et les ducs qui le portèrent; dans la suite on le donna également aux comtes, aux seigneurs possesseurs de fiefs immédiats et chevaliers, enfin, il fut appliqué à tous les chevaliers indistinctement. Nul ne pouvait se parer de ce titre à moins qu’il n’eût été armé chevalier.
Pris dans le sens objectif, le mot dominus indiquait le possesseur d’un fief auquel était attachée la haute, moyenne et basse justice. Quiconque avait une juridiction territoriale, par conséquent une seigneurie et des vassaux, portait de plein droit le titre de dominus 2 .
Le fils d’un possesseur de fief ou d’office médiat, qui, placé dans la dépendance d’autrui, ne pouvait prétendre ni à la qualité de dominus, ni à celle de domicellus, s’appelait armiger, c’est-à-dire écuyer. Il n’échangeait ce nom contre celui de dominus que lorsqu’il était reçu chevalier 3 . /268/
Les écuyers (armigeri) dont nous parlons appartiennent moins à la noblesse du second ordre qu’à celle du troisième ordre.
On mettra dans la même classe les ministeriales ou serviteurs des grands feudataires laïques et ecclésiastiques, notamment ceux qui avaient été faits chevaliers. La chevalerie formait un ordre ou une corporation qui rapprochait les diverses conditions: séparées par le rang, la naissance et la fortune, elles étaient immédiatement unies à un centre commun par le lien étroit de la fraternité. Aux joûtes et aux tournois, le ministériel qui avait reçu l’accolade n’était pas un adversaire indigne du roi ou de l’empereur; agrégé au même ordre, élevé à la même dignité féodale, il était, à ce titre, le frère et l’égal du prince dans les combats de la chevalerie, tandis que le noble de race, quel que fût son rang dans la société, était exclu de la lice, s’il ne pouvait justifier du titre de chevalier. Aussi, quoique les ministériels ne fussent pas nobles, pas même hommes libres, cependant la dignité de chevalier leur faisait donner le titre de dominus, et le caractère de leur office, les distinguant des serfs, et même de ces fieffés (feodati) parmi lesquels on trouve des cuisiniers, des marguilliers, des portiers, voulait qu’on les désignât par les dénominations de honestiores servitores, honorabiles ministri, nobiles servientes 1 . En général, ce qui distinguait les ministériels des autres hommes non libres, c’était le droit qu’ils avaient de porter les armes et /269/ la faculté d’être faits chevaliers. Ils n’en étaient pas moins les hommes propres d’autrui 1 .
D’autres officiers privés de la liberté personnelle, le métral, mistralis, le maire, maior, villicus, parvinrent à s’approprier leurs offices, à les rendre héréditaires dans leurs familles, même pour les femmes, et à s’élever par ce moyen au rang de la noblesse du troisième ordre.
Enfin, nous pouvons ranger dans la basse noblesse les casati du prieuré de Romainmotier 2 , qui devaient résider dans les terres de l’église dont ils tenaient un casement ou chasement, casamentum, c’est-à-dire « une tenure faisant partie d’un fief, occupé soit par un libre, soit par un non libre; ce que l’on a nommé un arrière-fief 3 . »
On a vu que dans l’opinion de M. Guizot les primores, les boni homines, les probi homines, les barones correspondaient aux sénateurs de la cité romaine, et qu’ils formaient une espèce de noblesse. Nous avons fait connaître les boni ou probi homines, il nous reste à définir les primores et les barones, en passant de la noblesse à la bourgeoisie.
Sous la domination des Franks, les hommes appelés primores, seniores, meliores, maiores, etc., par opposition aux juniores, aux minores, aux simples boni homines, qui étaient à l’égard des premiers dans un certain rapport de dépendance, en un mot, les principaux étaient distingués des /270/ bons hommes ou des prudhommes par le rang ou par la condition plus élevée qu’ils devaient soit à leurs propriétés et à leurs richesses, soit aux fonctions qu’ils exerçaient et qui les plaçaient, dans la hiérarchie sociale, au-dessous du comte et des grands officiers, illustres viri, et au-dessus des simples hommes libres. Ils n’étaient pas pour cela magistrats municipaux. On les appelait aussi les puissants, potentes, les magnifiques hommes, magnifici viri, (expressions qui servirent plus tard à désigner les seigneurs féodaux qui avaient une juridiction territoriale, les hommes du pouvoir, les hauts magistrats des républiques de Berne, de Fribourg, etc.) Les fonctions de juges et le respect qui s’attachait à cette dignité, faisaient donner à ces mêmes hommes le titre de vénérables (venerabiles), qualification qui, dans la suite, fut particulièrement appliquée aux membres du clergé, tandis que celle d’honorables (honorabiles, honorati) fut donnée indifféremment aux laïques et aux ecclésiastiques 1 .
Quant au mot baro ou varo, mot barbare, que Cicéron emploie plus d’une fois dans le sens de niais ou de stupide 2 , le scholiaste de Perse 3 l’a pris pour un mot gaulois, dans la signification de valet d’armée 4 , et Isidore l’a rendu par mercenarius. Je ne conçois pas comment, dans l’idiome des Romains, ce mot eût jamais pu devenir synonyme de senator. Dans son acception la plus générale, le mot baro, qui est apparemment d’origne celtique, signifie l’homme, par /271/ opposition au serf, donc un homme libre, homo ingenuus. Telle est sa signification dans la loi salique 1 .
L’expression de baro remplaça quelquefois celle de senior. Ainsi, par exemple, les hommes qui dans une charte de 1145, relative à Bourges 2 , sont appelés les barons de la cité, étaient désignés dans telle autre ville par les noms de seniores civium, de seniores urbis, ou de maiores, synonyme de primores.
Baron est un titre qu’ont porté au moyen-âge non-seulement les principaux bourgeois de plusieurs villes d’Angleterre et de France, mais encore ceux des villes ou des cités de la Suisse.
Ce sont évidemment les principaux bourgeois de Fribourg qui sont désignés dans ce passage d’une charte de 1182: « rogatu baronum de Friburch 3 . » Il ne s’agit là ni de magistrats municipaux, tels qu’ils existaient chez les Romains, ni de barons tels qu’on les conçoit ordinairement, et que J. de Muller se les est représentés 4 .
Cela n’empêche pas que le nom de baron n’ait servi, déjà au XIIIe siècle, à désigner un seigneur féodal, c’est-à-dire un homme libre de race, possesseur de châteaux et de fiefs. Il fut un temps où les bourgeois des villes, jaloux de /272/ leurs libertés, s’engagèrent à n’admettre au droit de bourgeoisie aucun baron féodal 1 .
Le mot de baro conserva longtemps la signification d’homme libre de race ou d’état. Les barons, tout comme les chevaliers (milites) et les simples nobles, compris ensemble dans l’expression collective de gentilshommes, composaient une classe privilégiée ou une corporation distincte d’une autre classe, qui était celle des bourgeois.
Dans le moyen-âge, la population de chaque bourg ou ville forte (castrum 2 , oppidum) de l’Empire était composée de deux éléments ou de deux ordres, dont l’un comprenait les nobles, l’autre les non nobles (nobiles et ignobiles). Les premiers étaient souvent désignés par les noms de barons et de chevaliers (barones, milites), les seconds, par les noms de bourgeois et de citoyens (burgenses, cives ). Les uns étaient les maiores (-civium ou burgensium), les autres, les minores.
Un fait important, dont les chartes relatives aux villes de Zurich, de Lucerne, de Fribourg, de Lausanne, de Berne, de Gruyère, etc., offrent de nombreux exemples, c’est que les deux classes que nous venons de désigner, celles des nobles et des bourgeois, composaient ensemble la commune /273/ urbaine, qu’elles formaient les deux éléments fondamentaux de la cité 1 .
Cependant il y eut des villes où les habitants de la cité et ceux du bourg composaient deux sociétés, qui se faisaient de temps en temps la guerre. A Lausanne, les barons et les bourgeois, « barones et burgenses », dont il est fait mention dès le XIIIe siècle, au plus tard 2 , formèrent jusque vers la fin du XVe, non-seulement deux ordres différents, mais deux communes distinctes. En 1481, la cité et la ville inférieure se réunirent pour ne former qu’une seule commune, qui prit le nom de la Cité comme étant le quartier le plus important, et s’intitula Communauté de la Cité de Lausanne 3 . /274/
Pris dans une acception générale, le mot de bourgeois (« borjois, borges, borgeiz » ), burgenses, servait au moyen-âge à désigner les personnes ou les corporations qui avaient des statuts et des franchises constituant le droit de bourgeoisie (« ius burgensiæ ») d’une ville (villa), d’une cité (civitas), ou de quelque autre lieu fort (burgum, oppidum, castrum), investi du droit de bourgeoisie 1 , ou tous les citoyens, cives, soit les membres de la commune urbaine ou de la cité, ayant leur administration particulière. — Le mot civis s’employait pour burgensis, et celui de concivis ou de concitoyen avait la signification de combourgeois 2 .
Nous avons vu qu’on distinguait ces personnes en principaux bourgeois et en simples bourgeois, soit en bourgeois du premier et du second ordre.
Dans un sens plus restreint, on entend par burgenses les /275/ hommes soumis à l’obligation de garder la maison forte ou le château, et de défendre la ville ou le village muré, en un mot le bourg, burgum: de là leur nom. Ils composaient la garnison du lieu dans l’enceinte duquel ils résidaient, et ils n’étaient tenus envers le suzerain à aucun service qui ne leur eût pas permis de rentrer avant la fin d’un jour et d’une nuit.
Pour être burgensis, il fallait nécessairement appartenir à un burgum, parce que lors de la création d’une ville nouvelle, ou de la transformation d’un village en ville ou lieu fort, ou de l’institution d’une commune urbaine, la concession des statuts et franchises constituant le ius burgensiæ accordé à ses habitants, était particulièrement attachée à l’obligation de défendre la ville murée ou le bourg 1 .
De plus, il fallait non-seulement jouir du droit de bourgeoisie, mais avoir son domicile dans la ville, soit dans le lieu muni de fortifications, ou tout au moins posséder quelque bien-fonds dans son ressort.
Les burgenses ou bourgeois formaient une classe privilégiée et distincte de celle des villani ou villageois, c’est-à-dire de la population de la campagne, des paysans libres et propriétaires, désignés, dans la Suisse romane, sous la dénomination particulière de prudhommes.
On disait, par exemple, les bourgeois de Gruyère, de Bulle, de Palésieux, de Corbières, d’Arconciel, de Cossonay; mais en parlant des bourgeois de ces endroits et d’autres lieux analogues on ne substituait pas le nom de civis à celui de burgensis, parce que ces petites villes ou ces bourgs ne formaient pas une cité, civitas, et on n’employait jamais l’un /276/ ou l’autre de ces deux qualificatifs pour la population de la campagne, c’est-à-dire, pour les paysans libres et propriétaires, soit pour les membres des paroisses et des communes rurales, soit encore pour les habitants des lieux ouverts qui n’avaient ni le caractère ni les droits ou priviléges des oppida, des castra, des villes ou des cités, bien qu’ils fussent en communes, et qu’ils formassent des associations libres, jouissant d’une vie politique et exerçant les droits civils 1 . Ces paysans libres, simples sujets de l’Etat ou du suzerain, n’avaient pas le ius burgensiæ; ils n’appartenaient à aucune bourgeoisie 2 .
De même que les corporations des villes de Zurich, de Berne, de Fribourg, de Lausanne, et d’autres cités, celles des villes et des bourgs que nous avons nommés ci-dessus, étaient composées de deux éléments distincts, savoir des nobles ou gentilshommes et des bourgeois 3 . Tout comme à /277/ Fribourg et à Soleure, par exemple, ces deux ordres y sont parfois fondus dans le nom collectif de burgenses 1 .
Après les nobles et les bourgeois se présentent dans les chartes les habitants et les incoles. Quelquefois on pourrait être tenté de confondre les incoles avec les habitants ou les citoyens du pays, mais le plus souvent, et dans la règle, ils en sont distingués.
En effet, les incolæ — ce mot rappelle les inquilini —, étaient, à ce qu’il paraît, des locataires, incolentes aliena, in terra aliena habitantes, des habitants d’une maison ou d’une terre appartenante à autrui, de laquelle ils payaient une redevance annuelle. Leur nom semble indiquer qu’ils se livraient particulièrement à la culture des terres.
Le nom d’habitants (habitantes, habitatores) servait souvent à désigner la population de la campagne, des localités où il n’y avait pas de bourg ni de ville forte ayant le droit de bourgeoisie, où il n’y avait par conséquent pas de bourgeois 2 . /278/
Dans un sens particulier et restreint, le mot habitants désignait les cultivateurs, les gens de métier, ou d’autres personnes, qui, pour se soustraire au joug des seigneurs féodaux, et acquérir une liberté qu’ils convoitaient depuis longtemps, s’étaient réfugiés sous la protection des villes fortes et des cités. Les villes, on le sait, prirent d’abord intérêt à l’affranchissement des gens de la campagne, des artisans, des industriels, etc. Elles y trouvaient l’occasion de croître en population et en richesse, de maintenir leurs priviléges et leurs franchises, d’avancer le développement de leur commune, et de hâter l’affaiblissement des petits souverains locaux. La bourgeoisie libre ne pouvait s’élever qu’aux dépens de la noblesse féodale.
C’était au moyen-âge un principe assez généralement reconnu, que le lieu fait libre et que la loi urbaine casse la loi champêtre. Les paysans et les gens de métiers soumis aux seigneurs, qui se réfugiaient dans la ville voisine, y trouvaient un asile ouvert. Une multitude d’étrangers ou de gens du dehors, qui cherchaient leur sûreté auprès de cette espèce de sanctuaire, s’établissaient au pied des murs d’un bourg ou d’une cité, ou se plaçaient sous sa protection dans /279/ les faubourgs, entre les remparts de la ville et les palissades qui bornaient son territoire ou sa banlieue.
Admis aux priviléges de la bourgeoisie, quoique résidant hors de l’enceinte de la ville ou du bourg, ces hommes prétendaient en conséquence être exempts de tout devoir et de toute redevance envers leurs anciens maîtres. De là naissaient des querelles et des guerres entre les villes, qui favorisaient l’émancipation des serfs, et les seigneurs, qui revendiquaient leurs droits. Les bourgeois étaient tenus de protéger de tous leurs moyens, même à main armée, chacun des anciens ou des nouveaux membres de la communauté, et de les défendre contre toute attaque.
Cependant ces affranchissements étaient soumis à certaines conditions. A Gruyère, comme dans telle autre ville, tout étranger qui, après s’y être établi, n’avait pas été réclamé par son seigneur avant qu’un an et jour fût passé, ne pouvait plus être repris: il était libre et admis au droit de bourgeoisie.
Voici comme s’exprime à cet égard la coutume ou la Loi de Gruyère, calquée en 1359 sur celle de Moudon, et conservée dans une vieille traduction 1 :
« Si aulcung vien à Gruyère et a faict à la ville serement, et là aye fait demourance an et jour (le) sachant son seigneur, et que dedans an et jour ne soit esté requis, demourera bourgeois. Et sy dedans an et jour est requis, au seigneur qui le requiert doibt fayre raison. Et sy ne soy peult envers le seigneur qui le requiert excuser, et (que) le seigneur le preuve par deux de ses parents qui jurent avec le seigneur, qu’il est taillable 2 , la ville ne le /280/ doibt poynt tenir pour bourgeois 1 . Ilz peult neantmoyns en la ville et dans les termes de la ville 2 demourer. Et si s’en veult aller de la ville, luy et ses choses (la ville) doibt conduyre vnz jour et vne nuyt 3 . »
Voyez dans les Additions la note relative à cette disposition.
Pour être admis à la bourgeoisie, l’habitant devait, en présence de la communauté, prêter serment et reconnaître la loi de la ville ou de la cité. « Jusqu’à ce qu’il eût acquis dans la ville une maison en propre, il était privé de quelques-uns des avantages et des priviléges attachés au droit de bourgeoisie » 1 . Par une ordonnance de la commune de Fribourg, de l’an 1289, concernant la réception de nouveaux membres, les Fribourgeois s’engagèrent, pour le terme de cinq ans, à n’admettre pendant ce temps au droit de bourgeoisie aucun habitant qui ne demeurerait pas dans la ville: ils décidèrent, de plus, que tout nouveau bourgeois serait tenu de faire, selon ses moyens, l’acquisition d’une maison dans la ville, et d’y résider avec sa femme et sa famille, au défaut de quoi, il serait déchu du droit de bourgeoisie, et la maison qu’il aurait acquise deviendrait la propriété de la ville 2 .
Or, ces hommes qui demeuraient hors de la ville, de foris a villa, suivant l’expression de la charte de 1289, que je viens de citer, n’étaient autres que les personnes qui figurent dans un si grand nombre de chartes sous le nom d’habitants. C’étaient non pas de vrais bourgeois investis de /282/ tous les droits attachés à la bourgeoisie, mais des bourgeois externes ou du dehors, « de foris a villa », des Ausburger 1 , ou Pfahlburger, comme on les appelait en Alamannie, ceux qu’on désignait encore sous la dénomination de faubourgeois, laquelle nous est venue de Pfahlburger 2 . Ce nom signifiait littéralement les bourgeois des palissades ou des pals, c’est-à-dire les hommes qui, bien que jouissant de la plupart des avantages qui résultaient du droit de bourgeoisie, ne demeuraient pas dans la ville même ou dans la cité, mais dans l’enceinte des palissades ou des poteaux qui marquaient la limite du territoire, soit du ressort de la ville ou de sa banlieue.
A l’exception des paysans des cantons forestiers Uri, Schwyz, Unterwalden, et de la vallée de Hasli, les habitants des paroisses rurales du moyen-âge ne formaient pas des corporations semblables aux bourgeoisies des communes urbaines. Même dans les cantons libres que nous venons de nommer, les membres des communautés n’étaient pas désignés sous le nom de burgenses. On les appelait, et ils s’appelaient eux-mêmes hommes du pays ou paysans, Landleute, /283/ dénomination dont ils se sont glorifiés jusqu’à nos jours.
Cependant les hommes libres de ces vallées, au moins ceux de Schwyz, sont quelquefois appelés cives dans les anciens documents. On disait aussi, dans le même sens, « habitatores villæ Suites », et « ii qui in villa Suites habitant. »
La qualification de cives donnée aux hommes de Schwyz a une certaine importance. Elle les assimilait en quelque sorte aux bourgeois des villes, aux citoyens des cités. Ceux-ci jouissaient de la liberté politique, ils avaient des priviléges, des franchises, ils administraient eux-mêmes leurs affaires; ils choisissaient leurs propres magistrats. Ils se partageaient en compagnies de milices ayant chacune son banneret; ils formaient des corps réguliers, et apprenaient le métier des armes sous des chefs élus par eux; ils étaient les maîtres des fortifications de leurs villes, en composaient la garnison, et se gardaient eux-mêmes. C’est pourquoi ils n’étaient obligés envers leur suzerain à aucun service qui ne leur eût pas permis de rentrer avant le coucher du soleil, ou du moins dans les vingt-quatre heures. Il fallait que le bourg ou la cité fût à l’abri d’un coup de main. — Ils conféraient le droit de bourgeoisie à ceux qui venaient s’établir chez eux; ils n’avaient pas besoin du consentement du suzerain pour admettre de nouveaux membres dans la commune. Ils obligeaient tout nouveau bourgeois, soit noble, soit roturier, à faire l’acquisition d’une maison dans leur ville. Ils recevaient le serment que chaque nouveau bourgeois prêtait à la commune et à la loi de la ville. Un de leurs magistrats gardait le sceau dont la commune scellait ses actes.
Les nobles et les bourgeois d’une ville ou d’une cité formaient /284/ une corporation (universitas) de citoyens on de bourgeois, soit une communauté, civitas, communitas, appelée aussi commune jurée, conjuratio, conspiratio, Eidgenossenschaft. Les membres de ces associations sous la foi du serment portaient dans les actes officiels les noms de combourgeois, de conjurés ou de jurats 1 , et de confédérés 2 , c’est-à-dire d’hommes liés par serment 3 , conspirati, conjurati, et iurati. Ces expressions, employées dès le VIIIe siècle pour désigner les membres de la ghilde ou de la confrérie, se présentent en Suisse dès le XIIIe, et désignent particulièrement les Confédérés des Waldstetten. Les bourgeois de Lucerne sont déjà nommés les conjurati des hommes de Stans et de Buchs dans une charte du milieu du XIIIe siècle 4 , et les bourgeois de Berne sont appelés coniurati ou combourgeois de ceux de Fribourg dans le traité d’alliance et de combourgeoisie passé le 13 mai 1249 entre Fribourg et Payerne 5 .
Les villes de Berne et de Fribourg, renouvelant, le 16 /285/ avril 1271, le traité de combourgeoisie qu’elles avaient fait en 1243, s’engagèrent à ne recevoir, sans consentement réciproque, aucun baron féodal au nombre de leurs combourgeois ou conjurés; elles déclarèrent que nul seigneur ayant ville, fort ou château n’entrerait dans leur commune 1 .
L’expression d’Eitgnoze (Eidgenosse), employée dans le sens d’allié, de membre de la commune jurée, est ancienne: elle se montre déjà dans une charte du 15 mai 1251, relative à Berne 2 . Dans le pacte du 1er août 1291, les hommes d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden se nomment eux-mêmes conspirati et conjurati (confédérés), mots que le texte allemand rend par ceux de mitgeschworne, zusammengelübte, qui ont la même signification que ceux de conjurés et de confédérés. Le pacte de 1291 n’est ni une conspiration ni une conjuration, dans l’acception ordinaire de ces mots, mais le renouvellement d’une ancienne alliance ou confédération 3 . Les trois pays ou Waldstetten se liguaient entre eux, tout comme les villes de Fribourg, de Berne, de Lucerne, par des traités de combourgeoisie.
Un autre fait assimilait aux corporations ou bourgeoisies /286/ des villes les associations ou communes jurées des Waldstetten, savoir l’usage du sceau. Les unes et les autres scellaient leurs actes 1 . Le droit de sceau était le principal privilége, la plus belle prérogative des communes. Ce qui distinguait essentiellement les communes rurales des communes urbaines et des communautés des Waldstetten, c’est qu’elles /287/ ne pouvaient sceller aucun de leurs actes: elles devaient y faire appliquer le sceau du suzerain, dont elles payaient un droit considérable. Ce ne fut qu’en 1448 que la commune de Gessenay obtint du comte de Gruyère le droit de sceau, moyennant une forte somme.
Il existait une autre différence notable entre la condition politique des villes et celle des paroisses de la campagne. Tandis qu’au moyen-âge, les villes, jalouses de leurs libertés, se liguaient entre elles, que les hommes des Waldstetten se confédéraient entre eux ou avec des villes, et réciproquement, que les communes des cités s’engageaient à n’admettre au droit de leur bourgeoisie aucun seigneur féodal, il était expressément défendu aux campagnards, tant de la Suisse allemande que de la Suisse romane, de se liguer entre eux ou avec leurs voisins. Ainsi, par exemple, il fut interdit, sous des peines sévères, aux villageois de Kussenach, d’Haltikon et d’Immensee de se liguer avec des seigneurs, ou avec des villes et des pays contre l’avoué ou contre le maire de Kussenach 1 . — La coutume ou la Loi de la Terre de Romainmotier défendait aux gens de cette seigneurie de faire quelque serment ou alliance entre eux, ou de jurer bourgeoisie en quelque bourg, ville forte ou cité, ou de rechercher la protection de quelque homme puissant, contre le droit de l’Eglise (de Romainmotier), sous peine de bannissement et de la perte de leurs biens, à moins de venir à résipiscence dans un terme à fixer par le prieur 2 . /288/
Tandis que dans les villes la vie politique se développait rapidement, dans les campagnes l’esprit de liberté était sans cesse comprimé. Les villes croissaient en population, en richesse, en puissance. Assez fortes pour résister aux petits souverains locaux, les communes des villes, vassales du suzerain, se formèrent en petits Etats séparés, gouvernés par un petit nombre de bourgeois, qui cherchaient à étendre leur autorité sur les autres, et à s’assujettir les gens de la campagne. Ceux-ci, on le sait, n’appartenaient à aucune bourgeoisie. Obligés de défendre la cité, de travailler au maintien de ses fortifications, et de suivre les bourgeois à la guerre, ils souffraient impatiemment le joug qui leur était imposé, et ne manquaient aucune occasion de le secouer. Telle était en général la condition des villageois sujets de la cité. Le sort des paysans de la Gruyère était plus doux. La petite ville de Gruyère n’obtint qu’au milieu du XVe siècle le droit d’élire son conseil. Inféodée au comte, elle n’eut jamais dans ses murs une bourgeoisie assez nombreuse et assez puissante pour opprimer les pâtres et les agriculteurs du pays. Ceux-ci étaient dans la dépendance du chef de l’Etat, et sous le gouvernement des princes de ce petit empire pastoral, ses habitants acquirent des franchises qui améliorèrent leur condition en diminuant les charges qui pesaient sur eux.
IX.
De l’homme d’autrui. Homo.
L’homme d’autrui n’appartient pas à une caste particulière; il se montre dans les diverses classes de la société féodale.
Les mots de homo et de bonus homo indiquaient tantôt un être d’une condition inférieure à celle de l’homme libre 1 , tantôt un homme d’un état supérieur à celui du serf 2 . Lorsqu’il s’agit de la condition des personnes dans la seigneurie, le nom de homo sert à désigner, non comme celui de libre, de colon, de collibert ou de serf, un état originel et permanent, mais une condition accidentelle et variable, qui se rapporte à la dépendance actuelle de la personne 3 . Par exemple, quelqu’un est-il appelé homme du comte de Gruyère, homme du chapitre de Lausanne, ou du prieur de Romainmotier, cela ne veut pas dire qu’il soit de condition libre ou servile, mais cela signifie seulement que le comte de Gruyère, le chapitre ou plutôt le prévôt du chapitre de Lausanne, le prieur de Romainmotier, est ou son maître ou son seigneur. /290/
Dans la hiérarchie sociale du moyen-âge, du simple colon jusqu’au possesseur d’un grand fief, du petit tenancier jusqu’au puissant comte de Gruyère, qui devint un jour vassal du comte de Savoie, feudataire de l’Empire, chacun avait au-dessus de soi quelqu’un dont il était l’homme.
Il n’était point rare qu’un possesseur de fief fût à la fois le seigneur d’un vassal et l’homme de quelqu’un. Ainsi, par exemple, Coenet, seigneur de Genollier, au XIIIe siècle, avait pour homme lige noble Pierre de Bursinel, chevalier, et pour supérieur féodal, Henri, seigneur de Mont 1 .
Si le vassal d’un seigneur était qualifié son homme, cette qualification se donnait aussi à ses colons ou serfs. Noble Pierre de Bursinel, chevalier, et Ulric le Bègue (balbus), simple cultivateur ou serf agricole, sont qualifiés l’un et l’autre hommes du sire de Genollier, qui, à son tour, était l’homme ou le vassal du seigneur de Mont 2 .
La liberté n’empêchait pas la dépendance. Le libre, le noble, le chevalier pouvait aussi bien que le serf être l’homme de quelqu’un. Seulement, il y avait entre le libre et le serf cette différence notable, que le premier était homme libre du seigneur, « homo liber domini »; le second, au contraire, homme taillable, talliabilis, proprius domini; que le premier tenait de son seigneur un fonds de terre, un bénéfice, un fief, et lui était attaché à ce titre, tandis que le serf, lié à la terre ou engagé au service personnel d’un seigneur, était /291/ homme de corps, homme propre de son maître, qui avait sur lui un droit de propriété. Mais l’un et l’autre, le libre aussi bien que le serf, étaient dans la dépendance d’un maître, in dominio, « de dominio », et ils ne pouvaient s’en détacher que de son consentement.
« L’homo devait à son seigneur ou à son maître obéissance, fidélité, secours et service. C’était sa condition personnelle et la condition de la terre dont il avait la jouissance, qui déterminaient la nature de son service, appelé hominium, c’est-à-dire servitium hominis; il faisait service de vassal ou chevalier, de colon, de serf, selon ce qu’il était lui-même, et selon qu’il possédait un fief, ou une terre colonaire ou servile. Le maître ou seigneur devait, de son côté, à son homme justice et protection 1 ».
De même que le mot hominium indiquait un état de dépendance envers un seigneur ou un maître, de même homo, employé absolument, signifiait, dans son acception générale, l’homme d’autrui. Il n’était pas nécessaire de l’accompagner de l’adjectif ligius pour en déterminer le sens.
Dans une charte du 26 juin 1254, le comte de Gruyère emploie plus d’une fois l’expression de nostri homines, en parlant de deux villageois, l’un d’En-ey, l’autre de Villars-sous-Mont, qui, de son aveu, tenaient à charge de cens annuel, du chapitre de Lausanne, un pâturage du Moléson, et, dans un autre charte, postérieure de quelques jours à la précédente, ces mêmes hommes, dont la condition personnelle n’avait subi aucune modification, sont qualifiés par le même comte ses hommes liges, « homines nostri ligii, » et plus bas, dans le même acte, ses hommes, « homines nostri.» /292/
Le mot ligius s’employait aussi absolument pour l’homme d’autrui 1 .
Cependant les mots homo et homo ligius n’étaient pas des expressions synonymes. De même, il y avait une différence réelle entre l’hominium, sans autre désignation, et l’hominium ligium ou l’hommage lige, celui-ci étant, dans certain cas, l’affranchissement du premier, c’est-à-dire l’hommage par lequel d’homme en la puissance de quelqu’un ou devenait son homme libre, son vassal.
Un exemple fera mieux comprendre la distinction que je veux établir.
En 1226, certain Amédée, fils de Nanthelme, de Saint-Prex, sollicita le chapitre de Lausanne de le recevoir son homme lige, « in hominem ligium. » Le prévôt, ayant ouï les religieux, répondit à Amédée, que lui et ses prédécesseurs étaient hommes du chapitre, — ce qu’Amédée avoua —, et que par conséquent il n’était point nécessaire qu’il fit hommage dans les mains du prévôt 2 . Toutefois, cédant aux instances d’Amédée et de ses amis, le prévôt le reçut son homme lige, en faveur du chapitre, mais en déclarant que l’inféodation et l’hommage manuel auxquels il venait de consentir, ne pourraient jamais être interprétés dans le sens que lui, Amédée, et ses héritiers étaient exemptés, pour l’avenir, de l’hominium et affranchis de la condition qui les attachait au chapitre comme tous les serfs de l’église 3 . Alors Amédée remit au chapitre l’alleu ou le bien qu’il possédait en propre à St.-Prex, à savoir la terre de Mayz, et le chapitre /293/ lui donna en fief le dit alleu avec d’autres terres que le père d’Amédée avait tenues du chapitre. Amédée en payait annuellement au chapitre 5 sols, et 30 ferrats ou 15 deniers 1 .
On voit par cette charte que le prévôt du chapitre de Lausanne ne renonçait pas au bénéfice de la loi par laquelle les affranchis pouvaient être replongés dans la condition de leur origine.
On pouvait être homme lige de plus d’une manière, selon qu’on était dans la dépendance personnelle d’un seigneur ou d’un maître, auquel cas on lui payait chaque année la taille personnelle ou la capitation; ou qu’on tenait de lui un fonds de terre, dont on lui payait cens et rente, en nature et en argent; ou qu’on était pourvu d’un office, d’un fief; ou qu’on avait cédé à un seigneur soit ecclésiastique, soit laïque, un alleu pour le tenir en fief.
La charte de 1226, que nous venons de citer, offre un exemple du dernier cas; voici des exemples des trois premiers:
1° Dans les villages de Thierrens et de St.-Cierge, domaines du comte de Gruyère, étaient, au XIIIe siècle, plusieurs hommes qui n’avaient aucun fonds de lui. Placés dans la dépendance de ce seigneur, ils étaient ses hommes liges et soumis à la taille à volonté 2 . — Les hommes liges de cette espèce ne différaient pas, à notre avis, des hommes qu’on appelait servi capitales, censuales de capite ou « sers de /294/ la teste. » C’étaient des censitaires dont le cens reposait sur leur tête.
2° Dans le même temps, il y avait à Ogens des cultivateurs qui tenaient du comte de Gruyère, leur seigneur, quelques fonds de terre, un pré, une oche, un chesal; ils étaient pour cela ses hommes liges 1 , et lui payaient une redevance annuelle de 12 sols. Ils étaient liges, par le fait de leur tenure; le cens annuel reposait sur la terre et sur les chaumières qu’ils occupaient.
3° Dans les reconnaissances générales des droits des évêques de Lausanne, de l’an 1144 à 1231, il est dit que l’avoué, advocatus, tient de la main de l’évêque l’avouerie hors des murs de la cité et dans d’autres cours, pour laquelle avouerie, c’est-à-dire pour lequel office ou fief, il doit être homme lige de l’évêque 2 .
De même, les quinze Francs de la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier étaient les hommes liges du prieur, à raison des offices qu’il leur avait inféodés 3 .
L’homme libre du seigneur, homo liber domini, c’est-à-dire qui n’était pas homme de corps, mais néanmoins dans la dépendance d’autrui, payait à son seigneur ou à son maître cens et rente, outre les services auxquels il était obligé envers lui. — Il pouvait acheter, par conséquent acquérir des biens en propre 4 ./295/
Un noble ou un possesseur de fief était, aussi bien que le simple homme libre qui tenait un bien fonds ou un office, homo liber domini, mais à des conditions différentes. Aymon de Mont-la-Ville fit hommage à « Amé, sire de Nufchastel », parce qu’il était son homme libre 1 .
Une charte de 1340 nous apprend, d’une part, que les charges imposées à l’homme libre du seigneur étaient variées et nombreuses, de l’autre, qu’il pouvait être exempté de certaines obligations, sans cesser pour cela d’être dans la dépendance du seigneur ou du maître dont il avait obtenu des franchises. « Le comte de Gruyère, est-il dit dans cette charte, considérant les services qu’ils a reçus d’un certain Johannod Roz 2 , de Château-d’Œx, son homme libre, « nostrum hominem liberum, » l’exempte à perpétuité, lui et ses héritiers, moyennant six livres lausannoises, de toute espèce de charges, usages, tailles, servitudes, impôts, levées et aides pécuniaires, corvées, journées, etc., se réservant toutefois le cens ou tribut ordinaire, les bans (amendes), les clames (ou clains, c’est-à-dire poursuites) et le service militaire. » — Le dit Roz, libéré de divers services et devoirs, n’en demeura pas moins homme lige du seigneur-comte.
L’homme libre ou le noble pouvait s’attacher à un seigneur particulier et s’engager dans le vasselage sans perdre pour cela sa liberté 3 . Quand il était entré dans l’hommage d’un seigneur, il n’avait pas la faculté de se faire homme lige d’un autre. En 1225, Guillaume de St.-Prex, donzel /296/ (domicellus), eut avec le chapitre de Lausanne un démêlé au sujet de la troisième part d’une dîme, que le chapitre prétendait lui appartenir. Après de longs débats, les deux parties s’accordèrent comme il suit: Guillaume reçut en fief du chapitre le tiers qu’il réclamait, et fit hommage 1 au prévôt. Celui-ci affirma devant Guillaume que ses pères avaient été hommes du chapitre, que lui, Guillaume, l’était pareillement, et qu’il ne pouvait faire hommage lige 2 à nul autre qu’au chapitre. Guillaume n’eut rien à objecter 3 .
L’année suivante (1226), le prévôt du chapitre de Lausanne se plaignit à Guillaume de St.-Prex de ce que, lui et ses ancêtres étant hommes du chapitre, de l’aveu même de son propre père, il eût fait hommage lige à Guerric d’Aubonne, au préjudice de la bienheureuse Vierge Marie (patrone de la cathédrale de Lausanne) et du chapitre. Guillaume s’excusa en disant que pour le fait d’un héritage qui lui revenait de sa mère, il avait dû agir comme il l’avait fait, mais qu’il se détacherait volontiers de Gruerric s’il le pouvait avec le secours du chapitre, et continuerait d’être l’homme de celui-ci, comme il y était tenu 4 .
On a vu que l’homme libre du seigneur pouvait être exempté de divers services et devoirs, moyennant une somme d’argent. Il en était de même du simple homo. Celui-ci, par le fait de l’affranchissement de certaines obligations serviles, améliorait sa condition, en acquérant une liberté dont il avait été privé jusqu’alors. /297/
Les habitants de Vallorbe, dans la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier, hommes du prieur, taillables pour leurs héritages et leurs possessions, furent affranchis, en 1403, de tout joug et servitude taillable 1 , moyennant la somme de 40 francs d’or d’entrée et 20 livres de redevance annuelle, outre les corvées et autres services dus selon l’usage. Il fut accordé à chacun desdits hommes du prieur 2 , pour eux et leur postérité, faculté entière de jouir de tous les droits que possédait l’homme lige qui avait un état, « homo sui iuris effectus, » sous la condition expresse que les dits hommes de Vallorbe, leurs héritiers et leurs successeurs, habitant au dit lieu, seraient et demeureraient à jamais hommes liges du prieuré, sujets à la condition mainmortable 3 , suivant la coutume ou la loi de Romainmotier 4 .
L’affranchissement dont parle cette charte est un fait qui, à la vérité, marque le passage de l’hommage taillable à l’hommage lige, et l’acquisition d’une liberté civile plus entière, comme on l’a dit 5 ; mais cette explication nous paraît incomplète.
On a remarqué ci-dessus 6 que les habitants d’Ogens, taillables à merci, étaient, par ce fait même, hommes liges, c’est-à-dire obligés envers leur seigneur ou leur maître, le comte de Gruyère, à la capitation à bon plaisir; que ceux de Thierrens et de St.-Cierge étaient taillables pour leurs tenures. Ceux de Vallorbe, également taillables pour leurs /298/ possessions et leurs héritages, étaient, à raison de ce fait, hommes liges du prieur; mais en devenant homines ligii sui iuris, de simples homines domini, c’est-à-dire, alieni iuris, qu’ils étaient auparavant, ils retirèrent leurs corps et leurs biens de la main du seigneur, qui cessa d’avoir sur eux un droit de propriété; ils acquirent la puissance d’eux-mêmes, sui iuris; ils s’élevèrent à la condition de mainmortables, comme étaient les autres homines liberi domini. Leur élévation fut un progrès dans la liberté civile. Ils n’en durent pas moins au prieuré le cens accoutumé, ainsi que les corvées, charrois, usages et services divers auxquels étaient tenus les hommes liges de condition libre, soit les hommes libres du troisième ordre, tels que, par exemple, Johannod Roz de Château-d’Œx 1 .
Le prieur de Romainmotier fit en 1403 ce qu’avait fait un autre prélat bien longtemps auparavant. « Dans plusieurs chartes de la première moitié du XIIIe siècle, l’abbé de St.-Père de Chartres, affranchissant quelques serfs, retint d’eux, selon l’usage, le libre hommage, liberum hominium, pour lui et ses successeurs, et la fidélité envers l’abbaye 2 ». /299/
« L’affranchissement, dit M. Guérard, n’était pas toujours l’indice d’une servitude antérieure: nous avons même des preuves qu’au XIIIe siècle on affranchissait quelquefois des nobles 1 . » Il n’y a là rien d’étonnant, ce nous semble. Depuis que l’hérédité de la propriété foncière, des fiefs et des tenures se fut introduite et établie, la relation du serf agricole, du colon, du vassal au seigneur dont il était l’homme, dut être héréditaire, et non personnelle: elle engagea les enfants aussi bien que le père, l’avenir comme le présent. A la mort d’un homme lige ou d’un vassal, quelle que fût sa condition dans la société, son fils devait renouveler l’hommage du père, et il n’était véritablement possesseur qu’après s’être acquitté de ce devoir 2 . La conséquence nécessaire de ce principe, c’est que l’homme lige, qu’il fût noble ou roturier, ne pourrait se détacher légalement du seigneur ou du maître auquel il avait fait hommage, que par l’affranchissement 3 .
CHAPITRE VII.
Des droits seigneuriaux.
Les institutions seigneuriales renfermaient deux éléments distincts, le fief et la justice, plus profondément séparés à mesure qu’on remonte à leur origine. Cette distinction s’exprimait par la maxime célèbre: « Fief et justice n’ont rien de commun. » Le seigneur justicier n’était pas du tout le seigneur féodal; l’une et l’autre qualité s’unissaient parfois sur la même tête, mais demeuraient distinctes dans le droit. C’est au seigneur justicier que sont dus les services personnels et les tributs, c’est-à-dire les droits de justice: ces droits sont tous productifs, presque tous vexatoires; au contraire l’hommage, le service militaire, l’investiture, la directe et les lods et ventes caractérisaient les droits des fiefs 1 .
A l’époque où le régime féodal s’établit, les justiciers, s’emparant de leur office, le convertirent en seigneurie héréditaire avec le territoire où ils exerçaient leur autorité. Ils avaient pour siéges des châteaux forts, à fossés et ponts-levis; à ces châteaux furent attachés les droits de justice /301/ et la mouvance de la seigneurie. De là cette maxime du droit féodal: « Concesso vel vendito castro, censetur concessa vel vendita jurisdictio 1 . »
Le comte de Gruyère était seigneur haut justicier en même temps que seigneur féodal. De cette double qualité résultaient les droits nombreux et variés que nous allons passer en revue, et qui sont rappelés pour la plupart dans la « Rénovation faite en 1664 des droits et revenus de LL. EE. de Berne rière la châtellenie d’Œx, à cause de leur château et bailliage de Rougemont. » Aux souverains seigneurs de la ville de Berne, successeurs des comtes de Gruyère dans la dite contrée, appartenaient: 1° Toute la juridiction, haute, moyenne et basse, avec les droits qui en dépendaient, tels que les droits de gîte, les corvées, les tributs, les bannalités, les tailles, la confiscation et tous les droits régaliens, issus de la souveraineté; 2° La directe seigneurie, les lods et ventes, etc.
Sans prétendre à une classification rigoureuse des droits mentionnés dans les chartes qui se rapportent au comté de Gruyère, nous avons cherché, dans la revue rapide que nous en devions faire, à distinguer les droits de justice des droits de fief, et, dans le doute, nous avons eu égard à l’affinité, à l’analogie qu’ils offrent entr’eux, en rapprochant les uns des autres ceux qui nous ont paru se ressembler sous quelque rapport. Nous comprenons ces droits divers sous la dénomination de droits seigneuriaux. /302/
1. Le Ban.
Le ban, bannum, est pris ici dans la signification de l’amende, emenda, imposée à ceux qui contrevenaient aux prescriptions ou défenses faites au nom de l’autorité, ou qui se rendaient coupables de quelque délit. Les amendes payées d’abord au roi, se payèrent ensuite aux seigneurs, lorsque ceux-ci se furent mis en possession des droits régaliens.
Les bans étaient une source féconde de revenus. Dans le comté de Gruyère, il y avait amende pour insulte et outrage; amende pour n’avoir pu vérifier un droit de reprise (clama); amende pour avoir négligé le payement d’une rente; amende pour avoir jeté des pierres à quelqu’un, ou pour l’avoir frappé avec une corde, pour lui avoir cassé un bras, pour avoir dégainé l’épée, pour avoir répandu le sang, pour avoir fait à sa femme une blessure où le sang avait coulé; amende imposée à la femme pour s’être portée partie plaignante contre son mari 1 ; amende pour avoir vendu un gage plus qu’il ne valait et au delà de ce que devait le débiteur; amende pour avoir employé de faux poids et de fausses mesures; pour avoir laissé paître le bétail sans gardien sur champ et pré d’autrui, pour avoir cueilli le fruit sur l’arbre de son prochain, vendu le pain à un taux trop élevé, ou débité du pain de mauvaise qualité; pour avoir maltraité un étranger dans la taverne, etc., etc. D’autres articles complétaient le règlement de police féodale.
Les amendes étaient comprises dans les émoluments ou revenus casuels du seigneur justicier. Cependant elles ne tournaient pas exclusivement à son profit. Il y avait telles /303/ amendes dont une partie était appliquée à l’officier du seigneur, et le reste aux besoins de la commune.
2. La Clame.
La clame, clama, ou le clain, était un droit de poursuite, ou de saisie et de séquestre, exercé en certains cas par le seigneur sur les meubles et sur l’héritage de ses vassaux.
3. Les Treuves.
Les treuves, dans le langage roman, sont les épaves, par où il faut entendre non-seulement les bêtes égarées ou perdues, les animaux errants sans maîtres ni gardiens, les essaims d’abeilles non poursuivis (épaves d’abeilles, abeillage), mais encore d’autres objets trouvés sur le bord des rivières (épaves de rivières), dans les limites d’une juridiction; des meubles et immeubles dont on ne connaissait pas le propriétaire, et qui n’étaient pas réclamés au temps fixé; des héritages abandonnés (épaves foncières et immobilières). Ces treuves ou épaves appartenaient de droit au seigneur dans la circonscription de sa justice.
4. L’Aubenage.
L’aubenage se disait d’un droit qui était dû pour l’inhumation d’un aubain, advena, c’est-à-dire d’un forain ou étranger, décédé dans la juridiction du seigneur.
On appelait aubainage ou droit d’aubaine, le droit qu’avait le seigneur de recueillir la succession de cet étranger.
Le droit d’aubaine étant compris dans le droit d’épave, ne pouvait être inconnu dans le comté de Gruyère. On a des preuves qu’il existait dans l’évêché de Lausanne. /304/
5. La Confiscation.
La confiscation, appelée barre (?) dans nos chartes, était un droit d’échute « per homicidium et latrocinium. » Le droit de connaître de l’homicide et du vol ou des larcins, latrocinia, était une des attributions essentielles du seigneur haut justicier. Ce droit devait son origine à des coutumes germaniques, mais les principes de la législation romaine le développèrent et lui donnèrent plus d’extension. Chez les Germains, tout individu qui était déclaré traître, ou celui à qui le roi retirait sa protection, et qui, par conséquent, était exclu de la commune, perdait tout son bien. Dans la suite, le droit de confiscation s’étendit à divers crimes, tels que ceux de vol, de meurtre, d’homicide, etc. Le seigneur haut justicier acquérait les biens du malfaiteur contumace ou condamné 1 .
La confiscation criminelle, dont il est ici question, comprenait tout ce que le délinquant avait eu en son pouvoir avant sa condamnation. Elle n’atteignait que la fortune du coupable, et ne s’étendait pas jusqu’à la fortune particulière de celui des époux qui était innocent. Il eût été souverainement injuste de punir le crime des parents sur leurs enfants.
C’était dans quelques pays une axiome de droit féodal que « Qui confisque le corps confisque les biens 2 ». Dans le pays de Gessenay, dans certains cas, le criminel, homme ou femme, échéait corps et biens au seigneur haut /305/ justicier 1 ; mais celui-ci n’avait aucun droit sur le corps de l’homicide: il échéait à la famille du mort 2 .
D’après les franchises de la Roche, de l’an 1438, l’homicide devait perdre la tête, et son bien appartenait au fisc, toutefois sans préjudice de sa femme et de ses enfants. Dans aucun cas le crime du père ou de la mère ne pouvait priver les enfants de leurs biens, le seigneur ne pouvant confisquer que la part du criminel 3 .
Conformément au principe qui attachait à la souveraineté « les charrières (ou voies) publiques, les cours des grandes eaux et rivières, » le seigneur haut justicier avait la propriété des routes, des cours d’eaux et des forêts, d’où dérivaient plusieurs droits, tels que ceux de péage, d’abénévis, d’affouage, etc.
6. Le péage.
Le péage, pedagium, était un droit de passage qui se percevait dans certains lieux déterminés sur les routes et au bord des rivières.
7. L’Abènévis.
On donnait ce nom 4 à un droit que le seigneur prélevait /306/ sur chaque maison habitée, pour la concession des eaux nécessaires aux irrigations, aux usines, etc., soit à l’agriculture et à l’industrie.
8. L’Affouage.
On appelait affouage et marronnage, un droit pour les usagers de prendre dans les forêts le bois de chauffage et le bois de construction qui leur étaient nécessaires. On lit dans une charte du XIIIe siècle 1 , que Rodolphe le Jeune, comte de Gruyère, donna à l’abbaye d’Hauterive l’usage, usementum, dans toutes ses forêts d’Ogo, dès le château de Pont jusqu’à la Tine, pour y prendre du bois de chauffage et du bois de charpente toutes les fois que ce monastère en aurait besoin 2 . /307/
9. Le droit de pêche et de chasse.
Le seigneur haut justicier ayant la propriété des eaux et des forêts, avait par conséquent le monopole de la pêche et de la chasse (Wildbann). Il avait seul le droit de prendre le gibier dans les bois et le poisson dans les rivières, on dans les étangs et les lacs 1 . Il louait ce droit ou le cédait à titre de cens et de rente. Avant que de vendre le produit de la pêche ou de la chasse, le vassal devait le présenter au seigneur, qui s’était naturellement réservé la préférence 2 .
Au milieu du XVIe siècle, les habitants de Château-d’Œx, animés de l’esprit d’indépendance qui caractérisait les paysans du Gessenay, opposèrent de la résistance au comte Michel, dont « le chastellain avait faict crier à l’éclise 3 que tous ceulx prennant sauluagynes (sauvagines) deans la chastellenie de Oyes ny les debuoyent vendre sans premièrement les présenter à sa seigneurie »; ce qui était contraire, disaient-ils, à leurs franchises, libertés et coutumes 4 .
La protestation des paysans de la haute Gruyère n’empêche pas que les comtes n’aient exercé dans un temps le droit dont nous venons de parler. /308/
10. Les Vendes ou Ventes.
Le seigneur haut justicier avait, de plus, le droit des vendes, vendæ, ou des ventes, lequel comprenait:
a) Le forage ou l’afforage, autrement dit ohmgeld 1 , et receverie 2 . C’était un droit que le seigneur percevait particulièrement sur le vin, mais aussi sur toute autre marchandise et sur les animaux 3 .
b) Le tribut des oboles, appelé vulgairement des melies, melles ou mailles, droit sur la vente du vin, qu’on prélevait avec le forage sur ceux qui vendaient du vin en détail, à la pinte, à raison d’une obole par pot.
c) Les ventes proprement dites, droit sur les denrées et autres objets ou marchandises qui se vendaient dans un lieu public. Suivant la nature des objets exposés au marché les ventes avaient une dénomination particulière; ainsi, par exemple, la « savaterie », qui consistait dans le droit qu’avait l’exacteur des ventes, qu’on nommait ly vendeir 4 dans l’idiome roman, de percevoir pour l’évêque de /309/ Lausanne trois fois l’an, à Noël, à Pâques et à Pentecôte, une paire de souliers, qu’il choisissait en les touchant de sa baguette, après que le cordonnier avait mis à part une paire de son choix.
« Le cordanier, » dit la coutume de Gruyères, « doibt au seigneur en la feste sainct Andrey vng part (une paire) de soulliers des meilleurs qui trouvera riere les cordaniers excepte deux pers 1 . »
A l’occasion des vendes, nous devons signaler une ancienne pratique reçue dans le Pays de Vaud, notamment à Palézieux, et dans la ville de Gruyère, qui, de même que Palézieux et tout le Pays de Vaud, suivait la coutume de Moudon, calquée sur la constitution de Fribourg en Brisgau. L’usage dont il s’agit avait sa source dans les institutions germaniques.
Tout marchand ou vendeur qui avait quitté la foire ou le marché sans avoir payé les vendes, devait rebrousser chemin et s’acquitter de ce devoir, ou faire remettre les vendes /310/ par un messager, avant de rentrer chez lui. S’il ne pouvait revenir sur ses pas, ni faire remettre les vendes à l’exacteur, il devait les déposer sur la route sous une pierre, et mettre pierre de çà, pierre de là, en témoignage du fait. On ne pouvait poursuivre ni condamner à l’amende le marchand qui avait observé cette formalité, attendu qu’il était censé avoir payé le droit de ventes. Le mercredi suivant, jour de marché, le même marchand devait prendre avec lui deux hommes loyaux, probi homines, retirer les vendes du lieu où il les avait déposées huit jours auparavant, et les remettre au seigneur ou à l’officier chargé de les percevoir. Moyennant cette précaution, le marchand était libéré de ce qu’il devait, et il n’encourait aucune amende 1 .
11. La Journée de faux.
Dans certaines localités du comté de Gruyère, chaque feu ou ménage devait au seigneur justicier une journée de faux ou de faneur, jornata, jornena ou dieta falcis, qu’on appelait aussi la fauchée, expression qui, comme celle de faucheur (sector), s’est employée dans certaines contrées pour une mesure de surface, répondant à ce qu’un ouvrier pouvait couper de foin en un jour. — La journée de faux était rachetable et variable. On l’évaluait ici à douze deniers, ailleurs à quatorze deniers de Lausanne. Chaque focager de Lessoc devait tous les trois ans seulement une journée de faux, ou six deniers de Lausanne. Cette redevance était fixée au même taux dans le mandement de Château-d’Œx, mais /311/ elle y était annuelle. Dans la commune de Charmey et des Arses, elle était estimée douze deniers.
12. La Corvée.
La corvée, corvata, l’un des droits les plus onéreux que la féodalité ait fait peser sur les hommes, était de plusieurs espèces, et variait selon les temps et les lieux. Pris dans un sens général, le mot de corvée désigne tout service de corps et tout ouvrage effectué par le moyen de bêtes de somme ou de trait, une ou plusieurs fois par année, au jour fixé par le seigneur. Ces travaux gratuits et forcés étaient dus non-seulement par les hommes, mais encore par les animaux, tant pour la culture des terres du seigneur que pour les charrois, les constructions, les réparations, etc.
Tous les habitants des paroisses rurales étaient soumis à la corvée ou en payaient le prix en argent.
Les paysans de la châtellenie de Gruyère devaient annuellement deux corvées de charrue, soit de labour fait par la charrue, corvatas aratri, et, comme eux, les paysans du mandement de Château-d’Œx devaient pour chaque corvée entière, au printemps, trois sols lausannois.
On appelait corvée entière celle qui devait être faite tout entière par un seul tenancier. Elle était partielle lorsque plusieurs paysans, deux ou quatre, par exemple, se réunissaient pour la faire 1 . /312/
13. L’Angarie.
On donnait le nom d’angaries 1 et de parangaries à des services de corps de toute espèce, qu’on a plus tard désignés sous le nom général de corvées 2 . Dans un sens particulier, on entendait par angaries, des corvées de charrois, qui consistaient dans l’obligation imposée aux vassaux d’angarier, comme on disait dans le vieux langage, c’est-à-dire de voiturer par terre et par eau, pour le seigneur, soit du bois et d’autres matériaux pour la réparation des manoirs, des /313/ maisons fortes et des ponts, soit le blé, le vin et les autres denrées de la récolte seigneuriale, qu’il fallait transporter au château ou à quelque autre endroit.
14. Le Guet et la Garde.
L’origine du droit de guet et de garde, ou de la garde du guet, remonte aux temps carolingiens. « Pour suppléer à l’insuffisance de la protection publique, il fallait avoir recours à l’emploi de la force privée, et chacun avait toujours à défendre directement soi-même sa personne et ses biens. Aussi devait-on faire la garde non-seulement pour les villes et les frontières, contre les ennemis de l’empire, mais encore pour les propriétés contre les malfaiteurs du dedans. »
« En général, les hommes libres étaient chargés du premier service, et les serfs du second. L’une et l’autre garde s’appelait wacta, de l’allemand wacht, en français guêt 1 . » — De là se sont formés les mots de waite, waiti, gayta, gayte et guète, qui se montrent plusieurs fois dans nos chartes 2 .
Lorsque la féodalité s’établit, que le sol fut hérissé de forts et de bretèches, que la guerre fut partout, les justiciers, les seigneurs de châteaux, les évêques et les abbés, appliquant à leur situation un droit établi, imposèrent à leurs vassaux l’obligation de faire, en certaines occasions et pendant un certain temps, le guet dans leur château ou dans leur monastère, de se tenir à poste fixe, dans une tour /314/ ou dans un clocher, eu guise de sentinelle, d’observer ce qui se passait au loin, et d’annoncer l’approche de l’ennemi, ou l’incursion des corps qui venaient faire le gast, c’est-à-dire qui se jetaient à l’improviste dans un lieu pour le dévaster et pour y faire un riche butin 1 .
Le service dont nous parlons se répartissait par feux, c’est-à-dire par chefs de ménages et non par individus. Il était rachetable. Dans le comté de Gruyère, le droit de guet et de garde fut converti en une redevance en argent fixée à 12 deniers de Lausanne.
15. La Chevauchée.
La chevauchée, calvacata, s’appelait aussi, dans le vieux langage, rese, de l’allemand reise, qui signifiait une expédition militaire. Dans l’origine, la chevauchée se disait d’un service militaire que le vassal était tenu de faire à cheval, soit envers le roi, soit envers le seigneur. Dans l’acception commune de ce mot, la chevauchée est un droit d’arrière-ban 2 , droit qu’avait le seigneur justicier de faire marcher à la guerre les ressortissants de sa juridiction; une obligation imposée aux vassaux de marcher pour défendre leur seigneur féodal lorsqu’il était attaqué, ou de le servir lorsqu’il était en guerre.
La chevauchée n’était obligatoire que pour un certain /315/ temps et dans de certaines limites 1 . Suivant l’antique usage, les hommes d’une bannière ou d’un mandement du comté de Gruyère, notamment ceux du Gessenay, étaient tenus de suivre leur seigneur dans les guerres entreprises pour la défense du territoire et dans la circonscription de sa justice 2 . Lorsque, dans une circonstance critique, le comte les priait de prendre les armes et de franchir les limites du pays, ils pouvaient le suivre, du consentement de la commune, et, dans ce cas, le comte devait leur délivrer une charte portant que le service qu’ils avaient fait pour lui, dans une urgente nécessité, était un acte de « grâce spéciale », sans conséquence pour l’avenir 3 .
16. Les Meneides ou Manaides.
Le Gîte.
Dans les documents qui concernent la Gruyère, et dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne, il est plusieurs fois question d’un droit qui, dans l’idiome roman, est appelé meneides, meneydes, ou manaides, menaides et menaydes.
Suivant le Complément du Dictionnaire de l’Académie, manaide, dans le vieux langage, signifiait puissance, protection. Les textes de nos chartes où paraît ce mot, ne nous autorisent pas à croire qu’il faille entendre par là une redevance par laquelle les vassaux ou sujets achetaient la protection de leur seigneur. Dans un vieux texte cité par Ducange, au mot manada, ce vocable paraît signifier maine ou mainée, c’est-à-dire plein la main, ce que la main peut contenir. Cette signification ne convient pas plus que la précédente aux meneides ou manaides de nos documents. Malheureusement ceux-ci sont avares de renseignements au sujet d’un droit qui était commun autrefois. Il résulte cependant de diverses chartes, que les meneides ou les manaides, qu’on distinguait en grandes et petites, selon leur quantité, étaient une redevance annuelle, consistant particulièrement en vivres (pains et viande), qu’elle reposait sur des tènements et d’autres fonds de terre, et qu’elle pouvait se payer en argent 1 . /317/
Je suppose que l’expression de meneides ou de manaides signifiait, comme celle de manseis, un droit qui se prélevait sur les manses ou mas, soit sur les tènements ou les abergements; une redevance que l’on payait pour le droit de gîte. Le mot meneide, ou plutôt manaide, venait sans doute d’un mot qui signifie loger, ou maindre, selon l’expression usitée dans le vieux langage, laquelle vient du latin manere. Les mots maine, mainement et manoir, qui ont la même origine, signifiaient habitation, demeure, gîte. Le dernier (manoir) se disait même quelquefois d’un manse servile. Dans notre hypothèse, le ius meneidarum ou manaidarum n’était pas autre chose que le droit bien connu sous le nom de droit de gîte ou de giste, en latin gestum 1 , droit qu’avait le seigneur en voyage de loger seul ou avec ses gens chez son vassal. Il pouvait en exiger du pain, du vin, de la viande en quantité suffisante et de bonne qualité. Le droit que le seigneur /318/ avait de prendre un repas chez son vassal, se nommait procuration.
Le droit d’hospitalité dont il s’agit était aussi désigné sous les noms de alberga, albergue, alberge (d’où notre auberge), herbergagium, albergeage, herbergamentum (en allem. herberg), albergement.
On donnait encore le même nom à la somme que le seigneur percevait sur ses vassaux pour l’exemption de l’hébergement, et pour s’indemniser des frais de voyage, de passage ou de séjour 1 .
Quoi qu’il en soit de l’étymologie du mot menaide, que nous avons proposée, le droit de gîte ne fut pas inconnu dans le comté de Gruyère, bien qu’il ne se présente peut-être pas dans nos chartes sous cette dénomination. Dans ce pays l’obligation pour les vassaux d’héberger leur seigneur dut être, comme une foule d’autres charges, soumise à la condition du rachat et convertie en une redevance en nature, ou en une rente annuelle en argent.
Il ne faut pas confondre le droit de gîte avec la gite ou gette, dont il sera bientôt question.
17. Le Focage ou Fouage.
Le focage, de focus, ou foage et fouage, de feu, était un droit né de la capitation carolingienne, soit du chevage 2 , cens personnel qui se percevait sur les personnes, et non-seulement sur les gens de condition servile, mais aussi fréquemment sur les libres. D’après le Polyptique de l’abbé /319/ Irminon, la capitation se payait souvent par feu et non par tête 1 . Cet impôt accablant pour les familles dut être allégé dans la suite. Ce qui n’est pas douteux, c’est que le fouage des temps postérieurs, ou le focage, comme il est appelé dans nos chartes, se prélevait non par feu, comme on l’a cru par erreur, mais sur chaque maison 2 ou freste 3 , c’est-à-dire par toiture à deux pentes 4 .
On peut supposer que le focage étant une taxe encore fort onéreuse, il arriva dans le pays de Gruyère, ce qui eut lieu à cet égard dans la Terre de Romainmotier, c’est-à-dire que bientôt plusieurs ménages se logèrent à l’ombre d’une seule toiture, prolongée sur plusieurs maisons 5 , de telle sorte que chaque ménage ne dût qu’une petite fraction de l’impôt. — Il appert d’un compte-rendu des revenus du comte Michel dans la châtellenie de Gruyère, que le nombre des feux ne constituait pas la totalité des ménages de tel ou tel endroit.
18. Les Bannalités.
Le régime des bannalités n’était pas inconnu dans le /320/ comté de Gruyère. Plusieurs documents prouvent que, dans ce pays, le seigneur assujettissait les habitants, ses vassaux, à se servir de son moulin à foulon pour y faire teindre ou préparer leurs étoffes, de ses battoirs (batiours, battitoria), ou machines à battre le grain, de ses moulins pour le moudre, de ses fours pour cuire le pain. Chaque endroit avait un four banal. Les habitants soumis à cette obligation, ou les banniers, comme on les appelait aussi, devaient en faire usage, et payer une redevance annuelle qui variait de 2 sols à 2 sols 6 deniers et 3 sols. Les grandes scies ou les scieries, raisses, ou reysses, étaient placées sous le même régime.
Les boucheries banales appartenaient aussi au seigneur de haute, moyenne et basse juridiction. On ne pouvait vendre des viandes de gros bétail que dans les boucheries banales. Celles-ci s’affermaient chaque année au boucher qui offrait les meilleures conditions.
19. La Gite ou Gette.
Nous avons mentionné le droit de gîte, dont le nom a été confondu avec celui d’un impôt nommé gite, giet, giète, ou gette, ject, iect, mots qui viennent de jacio, jeci, jactum, ou de jactire, adjectire, employés dans le moyen-âge pour jacere, qui signifie jeter. Les mots ject ou iect, (de iactus) et jecter ou iecter (de jactire) se disaient, dans le vieux langage, de la manière de compter avec des jetons 1 . Dans les administrations, la chambre des comptes, par exemple, chaque /321/ conseiller ou auditeur, muni d’une bourse de jetons (jetoirs, jettouers), suivait attentivement la lecture qui était faite et exprimait les chiffres en jetant devant lui, dans un ordre convenu, ces pièces que contenait une bourse spéciale. Ensuite il faisait l’addition, c’est-à-dire qu’il « déjetait. »
De là vient que les noms de gite et de gette 1 ont été donnés à certaines impositions de deniers, et que les verbes giter, getter 2 , ont signifié asseoir, répartir une taille, un impôt. Les gettoers étaient le principal moyen employé à cette répartition 3 .
Dans un document du XVe siècle, relatif à la Gruyère, ce subside est appelé taille et jectaye.
Il faut ranger parmi les gites, les contributions extraordinaires que les sujets payaient à tant par feu, à l’occasion de la joyeuse entrée ou du joyeux avénement, « pro iucundo adventu », de quelque prince ou princesse, qui venait visiter ses Etats, et à qui on voulait offrir un don gratuit, selon l’usage 4 .
30. La Taille.
La taille, tallia, quant à la variété de ses formes, non quant à son principe, date de l’époque où la noblesse était constituée et où la chevalerie féodale atteignit son complet développement. On distingue la taille ordinaire ou périodique, et la taille extraordinaire. La taille ordinaire était personnelle ou réelle, selon qu’elle reposait sur la tête d’un homme, ou qu’elle était due par le fonds ou à cause du fonds. Nous appelons taille personnelle, par exemple, la taille que le comte de Gruyère percevait chaque année sur ses hommes liges établis à Thierrens et à Saint-Cierge, qui n’avaient de lui aucune tenure. Cette taille périodique et personnelle n’était pas régulière et fixe, mais laissée à la discrétion du maître 1 . De là vient qu’on l’appelait taille à volonté, ou à merci et à miséricorde, « tallia ad voluntatem, ad placitum, ad libitum, ad misericordiam. »
La taille extraordinaire, obligatoire en tant que consentie et stipulée dans un contrat 2 , n’était pas périodique comme la taille ordinaire, c’est pourquoi on l’appelait aide, auxilium, subsidium, iuvamen 3 . Les aides étaient une exaction féodale 4 , un surcroit d’impôt, comme l’indique leur nom. Le /323/ seigneur, usant d’un droit de supériorité qu’il s’était réservé, pouvait indire aide, c’est-à-dire imposer ses vassaux, dans certains cas déterminés à l’avance dans un acte authentique. C’est ce qu’on appelait encore l’aide-chevel, ou l’indire (subsidii indictio) à un ou à plusieurs cas.
Le Cartulaire de St.-Père de Chartres contient une charte de l’an 1111, où la taille extraordinaire est réduite au seul cas de rançon 1 .
Le Plaid ou la coutume de la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier, de l’an 1266, imposait aux sujets du monastère quatre sortes d’aides: 1° pour payer les dépenses que pourrait occasionner un procès sur sa juridiction; 2° pour l’entretien des religieux en cas de grand dommage des récoltes du prieuré, pourvu que les hommes de la Terre n’en eussent pas été atteints; 3° pour faire l’acquisition de certains fonds et revenus; 4° pour le rachat de quelque partie du domaine de l’Eglise, que le prieur avait engagée du consentement commun 2 .
En 1319, Pierre de Gruyère, seigneur du Vanel et coseigneur de Corbières, et Marguerite de Corbières, sa femme, affranchissant de la taillabilité personnelle leurs hommes de Charmey et des Arses, se réservèrent, pour eux et leurs héritiers, les aides dans trois cas: 1° lorsqu’ils marieraient leur fille ou leurs filles; 2° lorsqu’ils feraient /324/ l’acquisition de quelques objets de la valeur de deux cents livres; 3° lorsque le dit seigneur Pierre ou ses fils, issus de son mariage avec Marguerite de Corbières, iraient à la guerre, ou seraient dans le cas de faire des dépenses pour le logement des soldats.
Dans ces trois cas, les taillables, c’est-à-dire les hommes de corps, que le coseigneur et la Dame de Corbières venaient d’élever au rang d’hommes libres du seigneur, moyennant la somme de 80 livres, devaient payer les aides chacun selon ses moyens.
Dans la règle, les sujets invités à payer les aides ou subsides, en faisaient la répartition entr’eux: chacun était taxé d’après le produit de ses fonds, ou selon sa faculté; c’est-à-dire que chaque ménage contribuait pour sa part à former la somme exigée par le seigneur, ou plutôt la somme qui lui était due d’après une convention, ou que les sujets avaient consentie 1 . Il était cependant tel cas où les contribuables payaient tous une part égale 2 .
On cite communément quatre sortes d’aides principales: /325/ L’aide de chevalerie, celle qui se payait au seigneur quand on armait chevalier son fils aîné; l’aide de mariage, quand il mariait sa fille 1 ; l’aide de rançon, lorsqu’il était fait prisonnier de guerre; et l’aide de voyage d’outre-mer, lorsqu’il prenait la croix pour aller combattre en Terre-Sainte.
Telles étaient les aides qu’au XVe siècle un paysan des Mosses reconnaissait devoir à Antoine, comte de Gruyère et coseigneur des Ormonts 2 .
Il existait une grande variété à l’égard des aides, et d’autres seigneurs avaient encore prévu bien des cas dans lesquels ils pouvaient exiger des secours pécuniaires 3 .
La fin des croisades et le déclin de la féodalité, l’établissement de la paix publique et la cessation des guerres privées, bref la situation nouvelle de l’Europe, dans ses rapports politiques, et le changement opéré dans les mœurs, rendirent inutiles les cas de voyage d’outre-mer et de rançon, mais le principe subsista. Quant à la chevalerie féodale, qui avait dépéri comme la féodalité elle-même, le droit de /326/ taille qu’elle donnait au seigneur, fut transporté au cas où il serait agrégé à l’un des Ordres de cour enfantés par la chevalerie.
21. Le droit de mainmorte 1 .
Nous avons déjà eu l’occasion de parler de ce droit qu’avaient les seigneurs de succéder, dans certaines circonstances, à leurs mainmortables 2 . Nous avons indiqué les principales modifications qu’il subit 3 . Le droit de mainmorte, alors même qu’il eut été modifié, était un droit d’un revenu considérable pour le seigneur, et dont la population, à mesure qu’elle grandissait et prospérait, cherchait constamment à s’affranchir.
Les mainmortables pouvaient aliéner leurs biens de mainmorte /327/ à des gens de leur condition, sans charge de lods et de ventes 1 . Cependant, ces biens n’étant pas transmissibles à des étrangers, ni par conséquent livrés au commerce et à la concurrence, perdaient beaucoup de leur valeur. Les propriétaires souffraient de cet état de choses. Aussi préféraient-ils libérer à prix d’argent leurs immeubles de la condition mainmortable, et payer les lods et ventes à chaque changement de main. Ainsi firent, par exemple, les paysans du Gessenay, qui, en 1397, furent libérés du droit de mainmorte des propriétés pour la somme de 5,200 florins 2 .
22. Les Lods et Ventes.
Un des droits les plus considérables des sires de la maison de Gruyère était celui de lods 3 et ventes. C’était un droit qui dérivait de la seigneurie directe, et qui se payait au seigneur pour l’aliénation d’une terre dépendante de la seigneurie; un droit que le seigneur percevait toutes les fois qu’il y avait transmission de la propriété d’un immeuble dans la mouvance de son fief, soit par vente, soit par échange, donation, testament ou par héritage. Il correspondait à ce qu’on nomme aujourd’hui le droit de mutation. C’était le prix de l’approbation ou du consentement (laudis) que donnait le seigneur direct au changement de main. /328/
Dans le pays de Gessenay, les lods se payaient au denier vingt, soit un sol pour livre 1 . Ils étaient de sept deniers pour livre dans le mandement de Château-d’Œx 2 .
Les lods étaient encore un droit de perception sur les abergements, soit sur les concessions de fonds que le seigneur faisait à ses emphytéotes.
Dans un sens plus étendu, les lods étaient un droit de chancellerie sur tous les actes, contrats et marchés, qui, pour être valides, devaient être munis soit du grand sceau, soit du petit sceau ou contre-scel du comte 3 . Sous ce rapport les lods étaient un droit qui découlait de la justice souveraine.
Le droit de sceau était si important, le privilége qui s’y rattachait, si considérable, que, en 1448, la commune de Gessenay l’acheta, avec d’autres droits d’un moindre revenu, au prix énorme de 24,733 livres laus., petit poids. /329/
23. La Saisine.
Celui qui voulait aliéner une propriété, une terre inféodée, un fonds ou un revenu, était obligé de se dessaisir ou dévêtir entre les mains du seigneur de qui ce bien relevait. Celui-ci percevait les lods du nouvel acquéreur, qui, pour se faire ensaisiner ou vêtir (investir) 1 , c’est-à-dire mettre en possession du fonds qu’il avait acheté, devait payer un droit qu’on appelait proprement droit de saisine.
Par cette formule ou cet acte d’investiture, « le cédant déguerpissait, ou abandonnait la propriété, et le preneur en était saisi définitivement. L’acte était par conséquent double; d’une part se faisait le devest, et de l’autre le vest 2 », comme on le voit dans plusieurs de nos chartes. Mais le droit de vest et de devest, soit le droit de saisine et de dessaisine en aliénation d’un héritage censuel, n’était pas pour cela un droit double que le seigneur eût exigé de l’acheteur et du vendeur.
24. Le Cens.
Le cens réel ou des choses, census, était une redevance annuelle d’un bien mouvant d’un fief, et dû au seigneur direct, c’est-à-dire au seigneur de qui relevait le fief, de la main duquel un héritage était tenu en cens ou censive. Cette rente seigneuriale était foncière et perpétuelle, et se payait, soit en /330/ argent soit en nature, suivant les termes de la convention. Elle se percevait pour les tènements, les abergements, etc. Elle n’était pas rachetable, et ne pouvait être due qu’au seigneur du fief dans la mouvance duquel se trouvait l’héritage ainsi grevé.
Le cens en argent se payait à jour fixe et, dans la règle, avant le coucher du soleil. Celui qui négligeait de l’acquitter était puni. Dans telle localité, il devait payer un cens double, c’est-à-dire une fois plus considérable que le cens ordinaire.
Rodolphe, comte de Gruyère, fit à l’église de N.-D. de Lausanne le don de cinq sols de cens annuel, qui lui étaient dus par des tenanciers de Rossinière, et payables à la fête de St-André. Ce cens devait être doublé le lendemain, si les débiteurs ne le payaient pas au jour fixé 1 .
Deux pâtres de Villars-sous-Mont avaient pris à cens une alpe (un pâturage) du Moléson, dont ils devaient donner cinq moutons ou dix sols, monnaie de Lausanne, payables à Albeuve, à la fête de Ste-Marie-Madelaine. S’ils n’acquittaient pas au jour fixé le cens dû, celui-ci devait être doublé le lendemain, aux termes du contrat 2 .
25. La Dîme.
La dîme, decima (- pars), est une part des fruits, ordinairement le dixième, prélevé sur tous les produits. La dîme était primitivement une redevance ecclésiastique, une institution que le clergé avait trouvée dans la Bible et empruntée à la loi mosaïque 1 . Ce droit, purement ecclésiastique dans son origine, et prélevé exclusivement par le clergé, fut aussi exercé dans la suite par les seigneurs laïques, qui l’avaient ou acquis, ou usurpé, ou reçu en fief 2 . On distingua dès lors les dîmes ecclésiastiques, dîmes possédées sans aucune charge féodale 3 , et les dîmes inféodées, soit seigneuriales ou laïques, dîmes possédées par les laïques à titre d’inféodation.
Je ne m’arrêterai pas à toutes les formes et à toutes les variétés de la dîme. Les terres, les pêcheries, les pâturages, les bestiaux, les fruits, les héritages, le travail et l’industrie des hommes, tout était sujet à ce droit.
La dîme inféodée ou des fiefs laïques était connue dans la Gruyère au XIe siècle. Le comte Guillaume, fondateur du /332/ prieuré de Rougemont, donna à ce monastère les dîmes qu’il possédait dans plusieurs localités. Son cousin Ulric et d’autres personnages en firent de même.
Le gouvernement de Berne, héritier des droits des comtes de Gruyère, percevait dans des châtellenies qui avaient appartenu à ces derniers, la onzième part de tous les grains et de tous les fonds sans exception, en orge, blé, avoine, légumes, chanvre, lin, etc. 1 .
On connaissait donc dans le comté de Gruyère, aussi bien qu’en d’autres pays, les grosses dîmes, grosse decime, qui se prélevaient principalement sur le produit le plus clair d’une paroisse, comme le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, le vin et l’huile, et les menues dîmes, minutæ decimæ, ou decimulæ 2 , dîmes levées sur les peaux d’animaux, sur la volaille, la laine 3 , les fruits, les légumes 4 .
Le seigneur avait, de plus, « la dîme de tous les nascents » 5 , c’est-à-dire un droit qui se prélevait sur les animaux de toute espèce qui naissaient à ses ressortissants. Cette dîme était proprement un droit ecclésiastique 6 , que les seigneurs laïques s’arrogèrent à leur tour. /333/
26. Redevances en nature.
Les redevances en nature variaient suivant la fertilité du sol, le genre des produits et la quantité des volatiles. — Chaque focager du mandement de Château-d’Œx payait annuellement trois bichets d’avoine pour l’avenage, pro aveneria; une coupe d’orge pour l’usage, et une de fèves; de plus, deux chapons pour la chaponnerie, pro caponeria, une tête de beurre, caput butiri, et une redevance en fromage.
Les paysans de Charmey et des Arses payaient annuellement un chapon et une coupe d’avoine à leur seigneur.
Les villains n’étaient pas tous soumis aux mêmes redevances. Le seigneur foncier avait égard à la fortune de ses gens et à la nature du quartier où ils étaient établis. Ainsi, par exemple, les focagers de la vallée sauvage de l’Etivaz ne devaient fournir qu’une tête de beurre, « belle et recevable ». Du reste, ils étaient, comme d’autres sujets, tenus au guet, dont ils s’acquittaient en payant 12 deniers de Lausanne, et de plus, à la chevauchée accoutumée.
On n’exigeait des chefs de ménages établis au delà du ruisseau de Gérignoz, que le guêt, une coupe d’avoine et un chapon.
27. L’Onciége.
Nos chartes mentionnent plusieurs fois un droit seigneurial /334/ qu’on appelait onciége ou ociège 1 dans la Gruyère et aux Ormonts, et qui était désigné dans le Gessenay sous le nom de Erbetten. Nous pourrions lui donner le nom de vacherie, qui se disait d’un droit sur les troupeaux de vaches qu’on menait paître à la montagne ou dans la plaine. L’onciége était un droit d’alpage 2 , une redevance en nature, que payaient les usagers, c’est-à-dire ceux qui jouissaient du droit de faire paître leurs bestiaux dans les usages ou terrains vagues appartenant à une commune, mais relevant du seigneur, soit dans les pâturages communs, qu’on ne fauchait pas. Cette redevance consistait dans le fruit, c’est-à-dire dans le produit du lait qu’on avait tiré des vaches pendant un ou plusieurs jours, appelés pour cette raison dies fructiferi 3 . Dans le pays de Gessenay, lorsque deux ou /335/ trois paysans faisaient paître ensemble leurs vaches dans les pâturages communs, sans en couper l’herbe, ils donnaient au seigneur le produit du lait qu’ils en avaient tiré en deux ou trois jours 1 . Chaque usager de la montagne de Sador, dans la châtellenie de Montsalvens, devait au seigneur un fromage pour l’onciége 2 . Les sujets du prieuré de Rougemont payaient annuellement au prieur l’onciége de six jours et demi des vaches qu’ils avaient mises sur les montagnes de Rubli (« Rebloz ») et de Rougemont, et celui de trois jours et un quart des vaches qui paissaient dans les plaines ou dans les pâturages communs 3 . Les sujets du prieur devaient chaque année charger 4 la montagne, c’est-à-dire y mettre le nombre de vaches et de bêtes à lait qu’elle pouvait nourrir. Le prieur, de son côté, devait fournir tout ce qui était nécessaire à l’alpage, domestiques, /336/ chalets, bardeaux, aissantes, tamis et formes à fromages, etc.; de plus, il devait envoyer annuellement une coupe de fèves pour servir à la nourriture des domestiques et des pâtres.
28. La pelucherie ou pillicherie.
Ce mot, qui se montre fréquemment dans les chartes relatives au Pays-d’Enhaut et à la Basse-Gruyère, ainsi que dans le Cartulaire de la chartreuse d’Oujon, s’employait pour certains droits seigneuriaux, qui sont parfois compris dans l’expression vague d’usages (Gewohnheiten), sans autre désignation.
Le mot de pelucherie, ou de pillucherie, pelucheria, pillucheria 1 , servit d’abord, selon nous, à désigner une redevance en peaux de divers animaux, en général une fourrure (pellis, Pelz), que, dans mainte contrée, le serf devait donner à son seigneur. De même que pour pelisse ou pellisse, on disait pelice ou pellice dans le vieux langage, qui avait pris ce mot du latin pellicea ou pellicia (-vestis), de même on disait pellicier 2 , de pelliciarius, pour peaussier, pelletier, et pellicerie ou pellicherie, pour pelleterie. — La destruction de plusieurs forêts, le défrichement des terres, la diminution des bêtes fauves, les travaux de l’industrie, le changement opéré dans les mœurs, firent tomber en désuétude les fournitures en peaux d’animaux sauvages, mais le principe resta. La redevance en fourrures, comme tant d’autres /337/ charges, fut convertie en argent; dans certaines contrées elle fit place à une rente qu’on appela Denier de pelice. Dans le comté de Gruyère, et dans tel autre quartier de la Suisse romane, le nom de pellicherie, qui se conserva, fut appliqué à divers droits, qui se payèrent en argent, en denrées et en services.
Nous possédons quelques pièces qui, réunies, contiennent tous les droits qui étaient désignés ou compris sous le nom de pilucherie. Voici l’énumération de ces droits ou de ces redevances annuelles: le focage, le droit d’abénévis, la corvée de charrue, la journée de faux, le guet, la chevauchée, les vendes, une coupe d’orge, un bichet (plus souvent trois bichets) d’avoine, un chapon 1 . /338/
Nous avons déjà fait connaître ces divers droits, et indiqué le prix de ceux que l’on pouvait acquitter en argent. La plupart étaient rachetables. Ils n’étaient pas tous imposés aux mêmes personnes.
CHAPITRE VIII.
De la succession féodale et de quelques autres coutumes. Note
Il nous a paru convenable de traiter, dans notre Introduction, de l’hérédité et de quelques autres institutions qui se rattachent plus ou moins à ce sujet, dont l’explication facilitera l’intelligence de nos chartes et jettera du jour sur certaines coutumes de la Suisse romane, qui n’ont pas été suffisamment étudiées.
Les Germains de Tacite ne connaissaient, en fait de succession, que le droit naturel, fondé sur la parenté. Chez eux, les testaments étaient inconnus. Les enfants étaient les héritiers naturels de leurs pères. Au défaut des enfants, les ayant-droit à la succession du défunt étaient d’abord ses frères, puis ses oncles paternel et maternel. Les neveux n’étaient pas exclus de l’hérédité. Les neveux maternels étaient aussi chers à leur oncle qu’à leur père. Il y avait des Germains qui regardaient même ce lien de parenté comme le plus intime et le plus sacré 1 .
Les lois des peuples germains ne faisaient aucune différence entre les mâles, et ne stipulaient aucun avantage en faveur de l’aîné./340/
Le droit d’aînesse ne fut point usité non plus sous la première race ni sous les premiers rois de la seconde. Les Mérovingiens et les premiers Carolingiens partagèrent leurs états par égale portion entre leurs enfants. L’histoire des princes de l’empire germanique offre plusieurs exemples de ces funestes partages, qui sacrifiaient le bien commun à un amour de justice mal entendu. Peu à peu le droit d’aînesse s’établit dans plusieurs états. Cependant les droits des puînés ne furent pas abolis. On leur donna une portion plus ou moins considérable de la succession. Quand le droit de primogéniture fut établi pour la succession à la couronne, il passa de même à l’hérédité des fiefs, et jusqu’à celle des tenures de villains. Et tout comme les princes cadets recevaient des apanages, de même les fils puînés d’un seigneur possesseur de fief, recevaient une portion de la succession paternelle.
On remarque chez les tribus germaines postérieures à celles de Tacite, que les mâles sont préférés aux femmes. Souvent celles-ci étaient exclues de l’hérédité. Cet usage était fondé sur l’importance que la commune des hommes libres attachait à la propriété. Il était naturel que l’homme et non la femme, représentât dans l’assemblée de la tribu, le fonds propre ou l’alleu, sur lequel reposaient des droits, qui étaient en même temps des devoirs. C’était la propriété avec ses droits, non le service militaire, qui constituait l’élément fondamental de la commune et des assemblées publiques 1 . Ce principe continua de subsister au moyen-âge. On en a souvent cherché l’origine dans la loi salique./341/
Quoique l’ancien code des Francs, composé des lois et des capitulaires, n’ait plus guère été en vigueur après la chute du gouvernement central à la fin du IXe siècle, ou au commencement du Xe, la plupart des anciennes coutumes n’en subsistèrent pas moins, et même on continua d’invoquer les textes hors d’usage qui les consacraient. Il est fait mention de la loi salique à des époques assez récentes, et non-seulement en France, mais encore hors de France 1 . Guichenon a publié deux chartes qui prouvent que certaines dispositions de la loi des Saliens s’étaient conservées en Bourgondie. Dans l’un de ces documents, de l’an 1185, Jean, seigneur du Balmey, affranchit de l’usage de la loi salique un de ses hommes et les enfants légitimes de celui-ci, de telle sorte que ses filles ou leurs filles pourront hériter avec leurs frères 2 .
Dans l’autre charte, du 10 décembre 1296, Girard, seigneur de Charmey, qui avait légué ses biens à la Chartreuse de la Val-Sainte, pour cause de manque d’enfants, ayant eu, depuis, une fille, demanda au prieur et aux religieux de ce monastère, et obtint d’eux, sous la condition de la loi salique 3 , observée dans ce pays, une partie (le /342/ tiers) des biens qu’il leur avait cédés par donation entre vifs, de telle sorte que si elle ou ses héritiers mouraient sans laisser d’enfants mâles et légitimes, cette donation reviendrait de plein droit au couvent.
La charte de Girard, seigneur de Charmey, ne prouve point que la loi salique ait été en usage dans le comté de Gruyère. Qu’établissait certaine disposition de cette loi? Les uns ont cru qu’elle excluait les femmes de la possession des terres allodiales et les privait du droit de la couronne, d’autres prétendent qu’elle excluait indirectement les femmes de l’hérédité pour les terres saliques.
Arrêtons-nous un moment sur ce mot pour en préciser le sens.
La terre salique, terra salica, appelée ainsi du mot tudesque sala, qui signifie maison, était non la terre des Saliens, comme on le croyait par erreur avant que l’érudition de M. Guérard n’eût éclairé l’opinion commune, mais la terre de la maison, la terre attachée au principal manoir, ou, en d’autres termes, le domaine lui-même; de sorte que la terre salique des chartes, la sala, sela, sele, le « Sellant, » et la terre domaniale ou seigneuriale, la terra indominicata 1 étaient une seule et même chose. C’était, pour nous servir d’une autre expression, le bien patrimonial 2 . /343/
On n’a pas de preuve que chez les Saliens, ou chez d’autres tribus germaines, les femmes aient été exclues de l’hérédité pour la terre dépendante de la maison ou du manoir, ni, par conséquent, que la disposition qui aurait exclu les femmes de l’hérédité pour les terres dépendantes du manse domanial ait passé de la loi salique dans les coutumes féodales. Terre salique et tribu ou loi des Saliens n’ont rien de commun. Il faut remarquer, de plus, que l’expression de « terra salica » ne se trouve point dans le texte le plus ancien de la loi salique. On y lit ces mots: « De terra vero nulla in muliere hereditas est, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota terra perteneat 1 », c’est-à-dire que la terre ne sera point recueillie par les femmes, et que l’hérédité tout entière sera dévolue aux mâles.
Or, cette terra, qui paraît avoir été appelée improprement terre salique, ou à laquelle on a du moins donné un sens impropre, était ce que le texte de la loi des Ripuaires, qui correspond à celui de la loi salique, nomme hereditas aviatica 2 , succession que cette loi, comme celle des Saliens, réserve aux hommes, à l’exclusion des femmes.
On l’appelait encore alodis, une terre allodiale, attendu que, dans la loi salique, la disposition qui la concerne est placée sous le titre de l’alleu, de alode. Elle est aussi appelée avia terra, dans un texte de la même loi; elle est désignée ailleurs sous les noms de hereditas paterna, terra paterna, alodis parentum, dont la signification évidente, a dit M. Guérard, répond à celle de patrimoine 3 . /344/
Ce bien patrimonial, qui était aussi désigné dans la Gruyère sous le nom d’hereditas 1 , c’était la terre transmise par les parents à leurs fils, à l’exclusion des filles; c’était le fonds héréditaire qui venait des aïeux (avia terra) 2 et qui avait passé par succession au possesseur actuel; c’était le principal fonds, auquel étaient attachés l’honneur et les droits de la famille.
La loi des Ripuaires, au titre de alodibus, qui règle l’ordre de succession dans la famille, contient la prescription suivante: « Cum virilis sexus extiterit, femina in hereditatem aviaticam non succedat, » c’est-à-dire que les filles étaient exclues de tout partage avec les mâles dans la succession de la terre patrimoniale.
Cette disposition, semblable à celle de la loi salique, mais plus claire et plus précise, nous porte à croire qu’au défaut d’enfants mâles, les filles pouvaient hériter du patrimoine ou de l’alleu, conformément à ce qui était établi dans la loi des Allemands 3 . /345/
L’empire des idées romaines, l’influence de la religion chrétienne, la faculté accordée aux laïques d’aliéner des biens en faveur de l’Eglise, ont de bonne heure tempéré la rigueur des anciennes lois germaines, qui excluaient les filles de tout partage avec les mâles dans la succession du patrimoine. Il fut permis au père de déroger à cette disposition, et d’appeler, par acte spécial, sa fille et les enfants de sa fille à partager avec ses fils 1
La loi de Gondebaud voulut que, dans la Bourgondie, au défaut de mâle, la fille pût recueillir l’héritage du père et de la mère 2 , et qu’au défaut de fils et de fille, il passât aux plus proches parents du défunt 3 .
Bien que les Bourgondes eussent cessé vers la fin du IXe siècle, ou un peu plus tard, d’être gouvernés suivant le code de Gondebaud, cependant il en fut de cette loi comme de la loi salique, plusieurs de ses dispositions se transformèrent en coutumes qui subsistèrent durant le moyen-âge, et furent en vigueur sous le régime féodal. On /346/ ne découvre aucune trace de l’usage de la loi salique dans le comté de Gruyère. Il serait plus naturel de supposer que, dans ce petit empire qui, on le sait, a fait partie de la Bourgondie, l’hérédité fut établie d’après les principes de la loi de Gondebaud, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.
Quelle que soit l’origine du droit qui réglait la succession dans la Gruyère, le principe qui a prévalu dans cette contrée est nettement exposé dans l’ouvrage d’Oton de Freisingen, savant historien du XIIe siècle, où nous lisons ce qui suit: « Dans la Bourgondie, comme dans presque toutes les provinces de la Gaule, c’est la coutume que l’autorité attachée au patrimoine passe toujours à l’aîné et à ses enfants, mâles ou femmes, et que les autres membres de la famille le considèrent comme leur seigneur 1 ».
Tel est l’usage qui a été constamment suivi dans le comté de Gruyère.
Dans toute la Bourgondie, l’aîné d’une maison souveraine était le Chef de la famille et de toute la Seigneurie. La dignité de comte de Gruyère, comme celle de comte de Neuchâtel, ne reposait que sur une seule tête 2 . Dans le testament du comte Antoine, il est dit expressément que François, l’aîné de ses deux fils, sera et devra être comte et seigneur de Gruyère, et que le cadet, son cohéritier, ne /347/ sera que seigneur 1 . Cela n’empêche pas que, dans certains cas, le père n’ait partagé l’autorité souveraine avec son fils, celui-ci avec le puîné, le neveu avec l’oncle, et l’oncle avec le neveu. L’association d’un cadet au pouvoir ne portait aucune atteinte au droit de primogéniture.
Et non-seulement les femmes avaient droit, avec les mâles, à la succession des biens autres que le fief principal, qui était la terre privilégiée de l’aîné, mais leur aptitude à succéder au comte, soit au chef de la famille, au défaut d’héritier mâle et légitime, était reconnue en droit: elle fut même reconnue en fait.
C’est en vertu de ce droit que, par exemple, Marguerite, femme de Pierre de Gruyère, seigneur du Vanel, exerça les droits de la seigneurie de Corbières, conjointement avec son mari, partageant avec lui des droits qu’elle ne pouvait pas lui transmettre, qu’elle ne pouvait pas aliéner. C’est en vertu du même principe que les femmes pouvaient et devaient assister au plaid général, à l’assemblée de commune, où elles remplaçaient les maîtres de maisons, les chefs de famille défunts, et représentaient la propriété et les droits qui en découlaient 2 . On le voit, les assemblées publiques avaient moins pour objet principal le service militaire que la propriété et les droits civils.
Tout comme au XIIIe siècle, Richenza, veuve de Rodolphe, comte de Neuchâtel, administra pendant plusieurs années la seigneurie de Nidau, et scella des actes 3 , que, /348/ dans le même siècle, Sibille, veuve d’un autre Rodolphe, comte de Neuchâtel, exerça tous les droits de haute seigneurie 1 , de même on vit, dans la Gruyère, des femmes investies de l’autorité. Willermette de Grandson, veuve du comte Pierre III, a régné, sinon seule, du moins conjointement avec son beau-père, le vieux comte Pierre II, ensuite, avec son second fils (Pierre), l’aîné étant mort avant son père. Dans une charte de 1283, elle approuve et ratifie avec Pierre II, la cession d’une vigne, et se contente du sceau du vieux comte 2 . En 1307, elle fonde, avec son fils Pierre, le monastère de la Part-Dieu; en 1308, elle scelle avec lui un acte de donation. Voilà des preuves qu’elle a exercé ou du moins partagé les droits de seigneurie.
Dans son testament, le comte Antoine avait prévu le cas où sa sœur cadette, Jeanne de Gruyère, dame de Bressieu, pourrait être appelée à lui succéder. Claudie de Seyssel, veuve du comte Louis, a été tutrice testamentaire de ses enfants et comtesse-régente de Gruyère. Elle a signé, en cette qualité, plusieurs actes importants, assistée du seigneur d’Oron, oncle et gouverneur du jeune comte François. Hélène, sœur de ce dernier, était désignée par son père, le comte Louis, pour lui succéder, au défaut d’héritiers mâles, en ligne directe. On le sait, pour que le comté ne tombât point en quenouille, Hélène dut céder la couronne à son parent, Jean de Gruyère, seigneur de Montsalvens; mais ce qui est moins connu, c’est qu’Hélène, avant d’être forcée à l’abdication, avait été investie, du /349/ comté de Gruyère par le roi des Romains 1 , qu’elle avait porté le titre de comtesse et son mari celui de comte de Gruyère. Ces faits prouvent, à coup sûr, que dans le comté de Gruyère, la femme était habile à hériter du fief patrimonial et de l’autorité qui en dépendait.
Parmi les dispositions testamentaires qui font partie de notre chartrier, nous citerons, en substance, celles des comtes Antoine et Louis. Elles feront connaître exactement l’usage suivi dans la Gruyère en matière de succession.
En 1433, le comte Antoine institue pour ses héritiers ses deux fils, François et Jean. Le premier, par droit d’aînesse, sera comte et seigneur de Gruyère, le cadet sera seigneur, dominus, et il recevra la part de la succession qui, suivant l’usage des ancêtres, revient au puîné. Si François décède avant son frère sans laisser un ou plusieurs enfants mâles de légitime mariage, son frère Jean héritera de tous ses droits. Si François a laissé des filles, elles seront convenablement dotées par leur oncle Jean, et établies comme il sied à leur rang. Si Jean meurt le premier, laissant des filles, elles recevront une dot convenable de leur oncle François. Si les deux frères meurent et que l’un d’eux ou les deux laissent des filles, celles-ci seront les héritières du comte Antoine. Pour le cas où ils décéderont l’un et l’autre avant l’âge de vingt-cinq ans, sans laisser d’enfants, mâles ou femmes, en sorte qu’ils meurent sans lignée légitime, Antoine leur substitue, d’une part, son neveu Jean de Vergy, fils de Pierre /350/ de Vergy 1 , seigneur de Champvent, et de Catherine de Gruyère, sœur du dit comte Antoine, et, de l’autre, sa sœur Jeanne de Gruyère, dame de Bressieu, chacun pour la moitié de la succession. Le dit Jean de Vergy et ses héritiers mâles seront comtes et seigneurs de Gruyère et du pays de Gessenay, Jeanne sera dame d’Aubonne, de Palésieux et d’autres terres. Pour le cas où Jean de Vergy mourrait sans enfants, Antoine lui substitue sa propre sœur Jeanne et ses enfants mâles. Ses filles auront une dot appropriée à leur rang, et réciproquement. Si l’un et l’autre, Jean de Vergy et Jeanne de Gruyère, décèdent sans laisser d’enfants légitimes, mâles ou femmes, pour ce cas le comte Antoine leur substitue pour héritier de ses biens et du fief patrimonial, hereditas, le duc de Savoie, son redouté seigneur.
En 1492, le comte Louis institue pour son légataire universel son fils François, qui aura pour héritiers ses fils. Le comte donne à sa fille Hélène la somme de 8000 florins. — Si François meurt sans laisser d’enfants mâles, issus de légitime mariage, il aura pour successeur son oncle François de Gruyère, seigneur d’Oron, frère du comte Louis. A François d’Oron, le comte substitue sa fille Hélène, pour elle et ses enfants mâles, sous la condition expresse que ceux-ci et leur père, mari d’Hélène, porteront les armes du comte Louis et de la maison de Gruyère, purement, simplement, sans aucune addition quelconque. Si les fils d’Hélène ou leur père négligeaient ou refusaient de porter les armes de Gruyère, franches de tout autre /351/ emblême ou symbole, ou bien si Hélène venait à décéder sans laisser d’enfants mâles, pour l’un et l’autre cas, le testateur substitue aux héritiers susdits le fils aîné de Jean de Gruyère, seigneur de Montsalvens, son cousin germain (fratris nostri germani), pour lui et ses enfants et héritiers mâles, issus de légitime mariage, et, à leur défaut, le plus proche parent, descendant par mâle de la souche masculine des comtes de Gruyère.
Il résulte des dispositions testamentaires du comte Antoine et du comte Louis, ainsi que des détails qui les précédent, que conformément à la coutume de Bourgogne, citée par Oton de Freisingen, les femmes, au défaut de mâles, héritaient du domaine patrimonial et de l’autorité qui en dérivait; que, les mâles étant constamment préférés aux femmes, le testateur substituait à sa fille, à sa sœur, bref à sa plus proche héritière en ligne directe, les fils de celle-ci par ordre de primogéniture, et que si elle n’avait pas de fils, ou avant qu’elle en eût, elle partageait l’autorité avec son mari, lequel prenait ou devait prendre et les armes et le nom de comte de Gruyère, comme fit Claude de Vergy, mari d’Hélène de Gruyère 1 .
La coutume ou la loi, en réglant la succession des fiefs sur les principes de la couronne, et en consacrant le droit de primogéniture, ne voulut pas que l’aîné possédât l’intégralité du fief. Elle lui accorda le domaine patrimonial, hereditas, soit le fief principal, auquel était attaché le droit de haute seigneurie. Elle voulut qu’il fût le chef de la /352/ famille, qu’il fût investi de l’autorité suprême, qu’il eût par conséquent une certaine prééminence sur ses frères.
L’Etat (nous pouvons employer cette expression en parlant du comté de Gruyère) était considéré comme une succession indivise, dans ce sens que les mandements et seigneuries qui formaient le comté de Gruyère proprement dit, ne devaient pas être aliénés, mais continuer de composer ensemble le comté de Gruyère. Bien que possédées par plusieurs membres de la famille, les seigneuries de Gruyère et de la Tour, de Montsalvens, de Rougemont, du Vanel et de Château-d’Œx, devaient constituer le comté de Gruyère, et, en cas d’extinction de la famille de ce nom, être dévolues au comte ou duc de Savoie, c’est-à-dire au suzerain du comté de Gruyère.
Quant aux seigneuries d’Oron, de Palésieux, d’Aubonne, etc., qui ne faisaient point partie intégrante du comté, soit de l’Etat, elles pouvaient échoir aux cadets, aux filles, leur servir d’apanages et d’établissements, ou passer en d’autres mains, avec faculté de rachat en faveur du comte de Gruyère 1 .
Le chef de famille, souverain du comté de Gruyère, partageait sa succession soit par égale portion, soit autrement, entre ses héritiers, réservant à l’aîné le château et la seigneurie de Gruyère, résidence du souverain.
Il pouvait déshériter. En 1365, le comte Jean Ier, après /353/ avoir institué pour ses héritiers ses neveux Rodolphe et Jean, par égale portion, « pro equali portione, » déclara que, pour le cas où l’aîné disputerait au cadet la part qui était destinée à celui-ci, il serait lui-même privé de la sienne, ou déshérité 1 .
Les damoiselles (domicellæ) de la maison de Gruyère avaient aussi droit à la succession de leurs père et mère; mais, pour empêcher que les fiefs ne passassent en mains étrangères, le testateur leur donnait, au lieu de terres appartenantes aux seigneuries qui formaient le comté, une somme équivalente à la portion qui leur revenait de l’héritage, et qui devait être prélevée sur les revenus du comté. Elles étaient apanagées, c’est-à-dire convenablement dotées ou établies. Parfois elles recevaient, à titre d’établissement, des terres qui ne faisaient point partie intégrante du comté. Moyennant une dot appropriée à leur rang, elles renonçaient formellement aux biens patrimoniaux et aux droits qui en dépendaient, sauf le cas où, au défaut de mâles, la plus proche héritière serait appelée à succéder au dernier comte 2 .
Les seigneurs de la maison de Gruyère devaient rendre hommage au chef de famille pour les portions de l’héritage soit du fief qui leur étaient échues. Henri, fils de Sibille, comtesse de Neuchâtel au XIIIe siècle, fit hommage à son /354/ frère aîné Amédée, pour la part qu’il avait obtenue 1 . La même coutume existait sans doute dans le comté de Gruyère, qui, comme celui de Neuchâtel, faisait partie de la Bourgogne. On le sait, la transmission de la propriété n’était entièrement accomplie qu’après la cérémonie de l’investiture, et celle-ci devait être précédée de l’hommage, quoique le principe de l’hérédité des fiefs fût complétement élabli. Ou bien, au lieu de prêter hommage à l’aîné, les cadets devaient-ils plutôt le rendre au comte de Savoie, suzerain de la Gruyère, et lui engager leur foi?
Dans notre recueil de chartes, qui est considérable, se trouvent plusieurs actes de reconnaissance et de prestation d’hommage par le comte de Gruyère au comte de Savoie et à l’évêque de Lausanne, à raison des fiefs qu’il tenait d’eux, mais nous n’avons pas une seule charte qui prouve que les cadets de la maison de Gruyère, possesseurs de fiefs, aient rendu hommage au suzerain du comté. On peut inférer de là, que l’aîné de la famille de Gruyère rendait seul foi et hommage au suzerain, et qu’il recevait l’hommage des puînés /355/ pour la portion de l’héritage qu’il leur avait assignée.
En prêtant hommage à l’aîné, le cadet reconnaissait la mouvance du fief, et devenait ainsi à l’égard du suzerain un arrière-vassal.
Cette espèce de sous-inféodation, celle tenance féodale était connue sous le nom de parage 1 , qui servait à désigner l’égalité de droit et de possession d’une terre par indivis. C’était une manière de tenir un fief entre parents. Quelques coutumes lui donnent le nom de frérage.
Dans le comté de Gruyère cette tenure féodale était connue sous le nom de fraréche 2 . Frarager, et frarécher, termes de droit coutumier, signifiaient partager un fief, de telle sorte que les frères puînés et les sœurs tenaient leur part en foi et hommage de l’aîné, qui, nous l’avons dit, rendait seul foi et hommage au suzerain.
Dans le comté de Gruyère, où, selon la coutume, la femme pouvait acquérir et succéder en choses féodales, où elle était apte à hériter de la haute seigneurie au défaut de mâle, elle était naturellement admise au frérage, c’est-à-dire qu’elle avait droit à une portion de l’héritage ou du fief. Mais, selon l’usage dont nous avons déjà parlé, l’aîné lui assignait, à titre de dot et d’établissement, une somme moyennant laquelle elle renonçait au frérage, et à tout droit quelconque, toutefois sans préjudice de ses droits à la haute seigneurie, pour le cas où celle-ci lui serait dévolue 3 . /356/
D’après le droit commun, les enfants légitimes pouvaient seuls venir en possession d’un héritage paternel; les enfants naturels, nés hors d’un mariage légal, ou qui venaient de bas 1 , et demeuraient hors de la puissance paternelle, n’étaient habiles à hériter que le bien de leur mère. Ce bien leur revenait de droit, parce que nul n’est enfant illégitime ou bâtard de celle qui lui a donné le jour.
Si le père d’un enfant naturel était connu, il devait pourvoir à son entretien et à son établissement, ou lui assigner une somme, payable, si c’était une fille, à l’époque de ses noces, ou quand elle serait en âge de se marier, et si c’était un garçon, quand il aurait dix-huit ans accomplis. De là vient que le bâtard entretenu par son père est appelé dans les chartes filius nutritus, ou alumnus; filia nutrita, ou alumna.
Le préjugé aristocratique établissait une différence notable entre le bâtard noble et le bâtard de basse extraction, c’est-à-dire dont le père n’appartenait pas à l’ordre des grands ou de la noblesse. Cependant le premier ne pouvait hériter ni du fief principal, ni par conséquent de l’autorité souveraine, à moins qu’il n’eût été légitimé par l’empereur, comme le furent, en 1433, François et Jean, fils naturels d’Antoine, comte de Gruyère. Son troisième fils, Antoine, n’est pas même nommé dans le testament de son père. Cependant il fut seigneur d’Aigremont, qu’il avait probablement reçu de son père. Il eut de son frère Jean les vidomnats de Vuadens et de Vauruz 2 ./357/
L’hommage des cadets les subordonnait à l’aîné, dont ils devenaient les hommes. Cela n’empêchait pas que la partie du fief qui était passée au cadet ne transportât au possesseur les droits et les prérogatives de l’aîné comme seigneur. Ainsi, par exemple, Jean de Gruyère, seigneur de Montsalvens, chevalier, du consentement de son oncle Pierre, comte de Gruyère, et de son frère Pierre, seigneur du Vanel, chevalier, affranchit de diverses charges ses sujets ou vassaux (« homines et fideles meos »), habitants des communes de sa seigneurie (« dominium »), en tant qu’elle s’étendait de Château-d’Œx jusqu’à Rougemont, où commençait la seigneurie de son frère 1 .
On vient de voir que le seigneur de Montsalvens et de Château-d’Œx n’accorda des franchises à ses sujets que du consentement de son oncle et de son frère. Ainsi le voulait la coutume. Pendant le moyen-âge, l’aliénation de la propriété, ou la vente des droits qui y étaient attachés, rencontrait maint obstacle et donnait lieu à beaucoup de procès. Tout bien patrimonial étant considéré comme appartenant à la famille, c’est-à-dire non-seulement au chef de famille ou à l’individu qui le possédait actuellement, mais encore à tous ceux auxquels il pouvait échoir un jour par /358/ héritage, on avait soin, dans les donations et dans toutes les aliénations en général, de les faire approuver par tous les parents 1 . Cette formalité était de rigueur non-seulement pour tout acte de donation, d’affranchissement, d’émancipation, de vente, d’hypothèque, mais aussi pour toute espèce de pacte, tels que traités de paix, contrats de mariage, etc. De là tant de personnes dont les noms sont écrits dans les actes pour marque de leur consentement, ainsi qu’on le voit dans un grand nombre de nos chartes.
A la question qui fait l’objet principal de ce chapitre se rattache celle de l’âge où l’enfant pouvait jouir de ses droits, posséder, acquérir, contracter d’une manière valable. Le Franc salien était reconnu majeur à douze ans. C’est du moins dès cet âge qu’il était jugé coupable s’il commettait un crime ou s’il troublait la paix 2 . Cependant le jeune homme devenu majeur (c’est-à-dire pubère), n’exerçait aucun droit dans la commune, parce qu’il ne pouvait pas y représenter la propriété, n’ayant aucun bien particulier du vivant de son père 3 .
Selon les règlements promulgués en 1095, tout mâle âgé de douze ans, et plus, devait jurer la trève de Dieu, et s’engager formellement à l’observer. La constitution de Fribourg en Brisgau, de l’an 1120, porte que tout homme qui n’a pas atteint l’âge de douze ans ne peut ni rendre témoignage ni exercer aucun droit civil. Cet âge était le /359/ premier degré de la majorité. La loi des Lombards fixait la majorité à l’âge de dix-huit ans 1 .
Chez la plupart des Germains, la majorité était fixée à l’âge où on pouvait porter les armes et brandir la lance, c’est-à-dire à quinze ans 2 .
A la majorité de quinze ans correspondait l’âge parfait ou plein de vingt-un ans, d’après la loi des Visigoths 3 .
On lit dans les Etablissements de St.-Louis: « Gentilhons (gentilhomme) n’a aage de soi combattre devant que il ait vingt un an. Home coustumier si est bien aagé, quand il a passé quinze ans, d’avoir sa terre … mes il n’est pas en aage de soi combattre devant que il ait vingt un an 4 ». C’est-à-dire que le coutumier, soit le roturier, pouvait entrer en possession d’une terre (aussi bien qu’un fils de famille), mais que ni le noble ni le roturier ne pouvaient défendre leur cause en justice avant d’avoir atteint l’âge parfait, qui, en France, était fixé à vingt-un ans 5 .
La loi Gombette condamnait à la servitude les femmes et les fils âgés de plus de quatorze ans, qui ne dénonçaient /360/ pas sur-le-champ leurs maris ou leurs pères, coupables d’un vol de bœufs ou de chevaux 1 . L’enfant qui avait atteint cet âge était censé avoir connaissance du vol et conscience de la criminalité de l’action 2 . Suivant la même loi, à l’âge de quinze ans on était maître de ses actions; avant cet âge, on ne pouvait ni affranchir, ni vendre, ni donner 3 .
La majorité fixée par la loi de Gondebaud à quinze ans, c’est-à-dire à quatorze ans accomplis, coïncide avec l’âge fixé par d’autres lois germaines et avec la législation des Romains 4 .
Dans les chartes du comté de Gruyère, nous rencontrons deux âges différents, l’âge de puberté, fixé pour les enfants des deux sexes à quatorze ans, et l’âge de majorité, c’est-à-dire l’âge parfait ou plein, perfecta ætas, plena ætas, fixé, pour les fils et pour tout homme tenant fief, à vingt-cinq ans.
« Dans son sens primitif, le mot de puberté désigne l’état de développement corporel qui rend apte au mariage, mais dans les idées romaines il s’employait aussi pour marquer la limite d’âge en deçà de laquelle on ne présumait pas chez l’homme un degré suffisant d’intelligence pour lui attribuer juridiquement la capacité d’action. — Cette limite une fois franchie, l’homme était capable de tous les actes de la vie civile et pouvait disposer de sa fortune, soit entre vifs soit pour cause de mort 5 . » /361/
Chez les Romains, l’âge de puberté était fixé, pour les femmes, à douze ans, et pour les jeunes gens, à quatorze ans 1 . Ces deux termes furent législativement sanctionnés par Justinien.
Dans le comté de Gruyère, l’âge de quatorze ans accomplis déterminait l’époque de la puberté pour les femmes comme pour les hommes 2 .
Dans le droit romain apparaît une époque intermédiaire entre la naissance et la puberté: c’est l’infantia, dont la limite fut fixée à sept ans. Le fils ou la fille de la première jeunesse était appelé infans, qui ne sait pas parler. L’enfant qui savait bégayer son langage et se faire comprendre, était appelé jusqu’à l’âge de sept ans, infantiæ proximus, — impuber qui fari potest, quamvis actum rei non intelligat. — Fari, dans ce sens, indiquait l’intelligence des paroles prononcées, ce qui ne veut pas encore dire la connaissance de l’acte lui-même et de ses conséquences juridiques. Depuis l’âge de sept ans jusqu’à celui de quatorze ans accomplis, le jeune homme était pubertati proximus. Dans cette époque intermédiaire entre l’enfance et la puberté, on lui reconnaissait ce que certaines chartes nomment /362/ l’âge de discrétion, anni discretionis, anni intelligibiles, (expressions qui parfois s’entendent aussi de l’âge de puberté). Alors il était reconnu capable de prendre part à l’acte, en prononçant quelques paroles solennelles, sans avoir toutefois la capacité d’action 1 . — Aussi voyons-nous, d’après ce principe, le jeune comte Antoine, âgé de neuf ans, en présence et par le conseil de son gouverneur Jean de Blonay, chevalier, administrateur du comté de Gruyère, nommé par le comte de Savoie, ainsi que d’Antoine d’Aubonne et de Jean de Mont, assister à la lecture que Jean Balay, commissaire du comte de Savoie, fait en langue romane 2 , d’un acte de reconnaissance du dernier comte de Gruyère, aïeul paternel du jeune Antoine, et celui-ci se reconnaître, de même, homme lige et vassal du comte de Savoie, à raison des fiefs qu’il tient de ce prince, suzerain du comté de Gruyère. Cet acte de foi et d’hommage fut ratifié par le conseil du jeune comte, en présence de plusieurs témoins 3 .
Avant l’âge de quatorze ans accomplis le jeune seigneur était impubère et mineur, incapable de contracter valablement, et placé sous tutelle, s’il était orphelin. S’il avait encore sa mère, celle-ci pouvait lui servir de tutrice, et administrer le comté, conjointement avec un conseiller tutélaire et, sans doute, de l’aveu du suzerain 4 . Dès l’âge de /363/ puberté, il avait la capacité d’action, c’est-à-dire qu’il était capable de tous les actes de la loi civile. Il pouvait concéder telle faveur, s’engager envers des tiers, stipuler, sans avoir toutefois la faculté de disposer du patrimoine 1 , soit des biens confiés à l’administration de la personne ou des personnes sous la garde et la direction desquelles il était placé. Il avait un gouverneur, lieutenant du suzerain, et un conseil, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, qui était l’âge de majorité, ou, comme on l’a dit, l’âge parfait ou plein 2 . /364/
Cette disposition, qui ne se trouve pas dans la loi des Germains, est un emprunt positif à la législation romaine.
Au moment de la puberté, le jeune Romain avait la capacité d’action. En prenant à cette époque la toge virile, il devenait citoyen, et commençait la vie politique. Mais ce nouveau costume ne revêtait point l’adolescent d’expérience et de maturité d’esprit. Sa volonté, apte à l’engager envers des tiers, n’était pas encore assez éclairée pour le préserver de séductions ou de tromperies. Pour obvier aux inconvénients que présentait cette capacité prématurée, on prit une mesure qui, maintenant le principe, eut exclusivement pour but d’éloigner les piéges dans lesquels tombait trop souvent le jeune homme durant les premières années de la puberté. On fit une loi qui, créant une nouvelle période de la vie, soumettait la jeunesse à une protection spéciale, dès l’âge de la puberté jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans 1 . Cette loi nommée Lex Plætoria, du nom de son auteur, a été désignée sous celui de Loi des vingt-cinq ans, par Plaute 2 , qui la cite plus d’une fois.
« Je suis mort! s’écrie Callidore, dans le Trompeur: la loi des vingt-cinq ans me tue. Tout le monde a peur de prêter. » — « Cette loi, répond Ballion, me retient aussi: je crains de faire crédit 3 . » /365/
« Donne-moi, » dit un personnage de la pièce intitulée le Cable, « donne-moi un homme qui vienne avec moi devant le juge. Tu verras si je ne prouverai pas que tu as extorqué de moi cette promesse par surprise, et que je suis encore mineur et n’ai pas vingt-cinq ans 1 . »
Ces passages nous révèlent l’esprit de la Lex Plætoria. Le but essentiel de cette loi, comme l’indique son titre « de circumscriptione adolescentium, » était de garantir les jeunes gens de contrats dans lesquels un tiers s’enrichissait avec dol à leur préjudice. La loi Plætoria annulait tous les engagements des jeunes gens qui n’avaient pas vingt-cinq ans, et poursuivait criminellement tous ceux qui avaient abusé de leur inexpérience 2 .
« La Lex Plætoria posa pour la protection des minores XXV annis, des principes que d’autres institutions ne tardèrent pas à développer. Bientôt, en effet, le Préteur, en promettant la restitutio in integrum, à l’égard de tous les actes ou de toute omission, de nature à léser le mineur, lui assurait un secours très-puissant 3 . Tout préjudice commis à l’égard des mineurs devait être réparé 4 . »
Les principes de la loi Plætoria, développés par d’autres institutions, passèrent à l’état de coutume au moyen-âge. On en voit des traces dans telles formules de nos chartes, /366/ qui ne permettent pas de douter que les dispositions relatives aux minores XXV annis, soit aux pubères qui n’avaient pas atteint l’âge de vingt-cinq ans, n’aient été, comme nous l’avons dit, un emprunt positif à la législation romaine 1 .
Les minores XXV annis, qui avaient leur père, demeuraient sous la puissance paternelle jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âge parfait. Mais ils pouvaient en être affranchis par l’émancipation ou par le mariage. A vrai dire, l’émancipation suffisait sans qu’on fût marié, et quand on était marié, on était émancipé. La fille, affranchie de l’autorité paternelle par le mariage, passait sous celle de son mari. C’est à lui qu’était remise la dot de sa femme; mais cette /367/ dot était assurée sur hypothèque. Le fils mineur, en cas de mariage, était libre et indépendant.
L’émancipation, acte différent, au moyen-âge, de la triple vente fictive usitée chez les Romains, consistait dans certaines formalités que Boyve nous fait connaître. « Parmi nous, dit-il, l’usage est que le père et le fils se transportent chez le juge, ou le juge au logis du père, quand celui-ci est empêché. Là, et en présence du juge, le fils à genoux et les mains jointes, supplie son père de l’émanciper; le père dit qu’il l’émancipe, lui déjoint les mains et le relève. Le juge déclare le fils émancipé, dresse un procès-verbal du fait, et en garde minute dans son greffe 1 »
L’émancipation affranchissait pour toujours l’enfant de la puissance de son père. — Nous lisons dans le contrat de mariage entre Humbert de Grolée et Jeanne de Gruyère, passé en présence du comte de Savoie et de plusieurs témoins, que noble Humbert de Grolée, fils aîné de noble et puissant seigneur Guillaume de Grolée, étant émancipé et dégagé de tous liens de la puissance paternelle 2 , reçut de son père, à titre d’établissement 3 , les châteaux de Neyriac et de Juys, avec tous leurs droits et dépendances, sous certaines réserves. La mère et les frères d’Humbert donnèrent, selon l’usage, leur consentement à l’émancipation d’Humbert, et à la donation que lui fit son père 4 .
CHAPITRE IX.
De quelques offices.
Nous nous proposons de traiter, dans ce chapitre, des offices dont les possesseurs, à la nomination du comte de Gruyère, rendaient la justice en son nom, ou exerçaient des fonctions qui formaient une dépendance de l’administration de la justice. Les anciennes chartes du moyen-âge nous fournissent peu de détails sur cette matière. La plupart des renseignements que nous avons recueillis proviennent de documents des XVe et XVIe siècles. Quelques-uns pourront servir à compléter ce que plusieurs auteurs ont écrit sur les offices de châtelain, de banneret, de mestral et d’autres fonctionnaires subalternes.
Avant de nous occuper de ces offices, nous ferons connaître en peu de mots les attributions du chef du petit empire pastoral qui fut fondé sur les bords de la Sarine.
Le comte de Gruyère, comme supérieur féodal, était, selon les expressions d’une charte, « le naturel et droyturier et hault seigneur en avant sus les nobles, bourgeois et autres 1 . »
Comme seigneur haut-justicier, il possédait « la totale seigneurie et juridiction, 2 » c’est-à-dire toute justice, haute, moyenne et basse. Suivant une formule empruntée, du moins en partie, à une institution romaine, et très-usitée /369/ dans nos chartes, il avait le « merum mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem. »
Le merum imperium, ou le droit de glaive, émanait du souverain, c’est-à-dire du peuple, sous le gouvernement consulaire, et de l’empereur depuis la chute de la république. Ce pouvoir était conféré à certains magistrats, qui l’exerçaient dans les provinces, mais non en vertu de leur magistrature, ni comme une conséquence de leur juridiction.
Le mixtum imperium comprenait le droit de glaive mêlé à la juridiction, et considéré comme une conséquence de celle-ci 1 .
L’union des deux pouvoirs, ou « le mère et mixte impère » constituait le droit seigneurial le plus élevé, qui emportait la haute justice criminelle et la supériorité territoriale.
C’est pourquoi dans les chartes en langue allemande, ce droit est désigné sous le nom de « kaiserlicht Recht » 2 , qui signifie droit impérial ou royal, droit émanant du chef de l’empire. /370/
Le seigneur haut justicier, investi du double pouvoir qu’on vient de nommer, avait donc le droit de glaive, c’est-à-dire le droit de connaître des crimes qui méritent la peine de mort, ou une autre peine afflictive, et par conséquent le droit d’échelle, c’est-à-dire le droit d’avoir dans sa juridiction une échelle ou une potence 1 , soit des fourches patibulaires, pour montrer qu’il possédait la haute justice, en vertu de laquelle il pouvait torturer les malfaiteurs, les juger, les pendre et confisquer leurs biens 2 .
La haute justice était une des attributions essentielles du comte de Gruyère. Les causes qui appartenaient à cette justice étaient l’homicide, le meurtre, le vol, bref les causes criminelles entraînant la peine de mort et les autres peines afflictives ou infamantes 3 . Nous avons exposé au chapitre VII les droits attachés à ces causes et ceux qui dérivaient de la justice inférieure.
Une autre attribution importante du comte de Gruyère consistait dans la fonction d’avoué 4 , c’est-à-dire de protecteur et de défenseur civil des églises ou des monastères de son territoire.
Dans l’origine, le comte, le viguier (vicarius) ou le vicomte /371/ ne jugeait pas. Il présidait à l’assemblée des juges de son territoire. Il pourvoyait à l’exécution de la sentence qu’ils avaient prononcée. Son office avait le caractère d’un pouvoir exécutif. Avec le temps, il arriva que le justicier jugea lui-même. Mais lorsqu’il se fut approprié la justice, qu’il eut converti son office en fief héréditaire, et qu’il se fut érigé en souverain local de simple officier du roi qu’il était auparavant, il ne put plus exercer ou rendre la justice en personne, il dut nommer à cet effet des fonctionnaires spéciaux, des juges auxquels il confia ce qui avait été de son office, savoir l’exercice de la justice.
Le comte de Gruyère, seigneur haut justicier, et, de plus, souverain, ne jugeait pas en personne, et ne présidait pas à l’assemblée des juges. Il se faisait représenter par les officiers qu’il établissait dans les divers mandements du comté. Ces officiers rendaient la justice en son nom, ou exerçaient des fonctions qui dépendaient soit de l’administration de la justice, soit du droit de guerre, ou qui se rapportaient aux attributions du comte.
Ces officiers étaient le châtelain et son lieutenant ou le vice-châtelain, le banneret, les mestraux, et les messagers ou envoyés. D’autres fonctionnaires d’un ordre inférieur étaient le maréchal et le forestier ou messier.
1. Le Châtelain.
Nous avons déjà fait observer qu’aux châteaux étaient attachés des droits de justice et la mouvance de la seigneurie. La garde du château et l’exercice de la justice dans l’étendue de sa juridiction étaient confiés à un officier qui /372/ en prit le nom de châtelain 1 . Autant de châteaux féodaux dans le comté de Gruyère, autant de châtellenies et de châtelains, soit de ressorts ou de juridictions, et de lieutenants du seigneur haut justicier.
Il paraît que, dans un temps, la coutume autorisait le comte de Gruyère à préposer à une paroisse ou communauté, soit à un mandement, un juge étranger; mais les nombreux inconvénients qui pouvaient résulter ou qui résultaient en effet d’un pareil privilége excitèrent le mécontentement des populations de la Haute-Gruyère, qui demandèrent instamment une réforme.
Tout comme à la fin du XIIIe et au commencement du XIVe siècle, les hommes des Waldstetten s’étaient engagés sous la foi du serment à n’admettre ou recevoir dans leur pays aucun juge qui ne serait pas leur compatriote et n’habiterait point parmi eux, de même, au XVIe, les habitants de la Haute-Gruyère, jaloux des libertés qu’ils avaient acquises à grands frais de travail et d’argent, s’opposèrent à la nomination d’un juge étranger. A son avénement, le comte Jean II, confirmant aux habitants de Gessenay leurs libertés et franchises, déclara qu’à l’avenir le châtelain de ce lieu serait élu parmi les gens de langue allemande et « ayant feu et lumière » (c’est-à-dire leur domicile) dans le pays de Gessenay, afin que la paroisse eût un juge connaissant l’idiome, les usages et les besoins du pays 2 . Sous Jean III, les paysans de Château-d’Œx, mécontens des juges étrangers, /373/ parce que, disaient-ils dans leur langage naïf, « les forains pourroient amodier le dit office (de châtelain), par quoi n’administreroient par briève justice, comme de raison, et aussi pourroient charger les pouvres gens de plusieurs griefs et exactions 1 , » refusèrent le châtelain étranger que le comte voulait leur donner. Il fut décidé, par jugement arbitral de l’avoyé et conseil de la ville de Berne, que le comte de Gruyère ne pourrait plus établir à volonté un châtelain de Château-d’Œx, mais qu’à l’avenir il serait tenu de nommer à cet office un homme du pays, et que le lieutenant du châtelain devait être pareillement un bourgeois de la commune de Château-d’Œx 2 .
La châtellenie était un office que le comte de Gruyère confiait de préférence à quelque gentilhomme vassal ou seigneur de sa cour. On rencontre parmi ses châtelains des hommes appartenant aux plus nobles familles de son petit empire, les d’Ursins, les Wisternens, les Cléry, les St.-Germain, les Corbières, les d’Aigremont, les Gruyère. Depuis que le châtelain de Gessenay et celui de Château-d’Œx durent être choisis parmi les habitants du pays, l’un ou l’autre ne pouvait être qu’un paysan de bonne renommée, un notable de la paroisse, honoré de la confiance de ses pairs. Nous remarquons à Château-d’Œx les Favrod, qui d’anciens taillables, puis d’hommes libres du seigneur, se virent élevés par leur office au rang de la noblesse inférieure; à Gessenay, les Baumer, les Bander, les Hauswirt, et d’autres.
L’office de châtelain n’était ni viager ni héréditaire. /374/ D’abord la durée de cette charge fut laissée à la discrétion du seigneur haut justicier. Dans la suite celui-ci, c’est-à-dire le comte Gruyère, dut promettre aux gens des seigneuries de Château-d’Œx et de Gessenay, non-seulement de ne leur donner aucun châtelain étranger, mais encore de n’en point élire pour plus de trois ans, et de leur en donner un autre au bout de ce temps. Le comte se réserva prudemment la faculté de révoquer son châtelain et de lui en substituer un autre, si ce fonctionnaire se permettait quelque acte ou quelque parole qui pût porter atteinte à l’honneur et aux intérêts du seigneur-comte ou de sa famille 1 .
L’office de châtelain était rétribué. Le châtelain d’Œx recevait un salaire annuel de 14 L. lausannoises, soit de 20 florins, valant chacun 14 sols. Ce salaire fut porté dans la suite à 25 florins. Le même officier avait, de plus, des émoluments ou revenus casuels, tels que les bans ou amendes de 10 sols et au-dessous, et les clames ou plaintes de 3 sols, etc. 2 .
Le châtelain n’était pas tenu de résider au chef-lieu de sa juridiction. Il fut du moins décidé en 1528 que celui de Château-d’Œx pourrait faire sa demeure en cet endroit, ou ailleurs, où il lui plairait, pourvu qu’il se fit représenter /375/ par un lieutenant qui fût de Château-d’Œx et y demeurant 1 .
Le jour de l’installation du châtelain, le seigneur justicier lui remettait le bâton de justice 2 . En recevant l’insigne de sa dignité, la marque du pouvoir dont il venait d’être investi, le nouveau châtelain jurait, la main levée, de veiller à ce que son seigneur ne reçût aucun dommage ni en son honneur, ni en ses prééminences, d’exercer loyalement son office, d’observer les droits de son maître et ceux de ses ressortissants, de rendre bonne et brève justice, de ne point abuser du pouvoir qui lui était conféré, de n’opprimer personne, d’être impartial et intègre 3 .
Le châtelain présidait la cour de justice, ou les assises 4 . Au défaut du châtelain, l’assemblée était présidée par son lieutenant 5 , ou par le banneret 6 .
Présider aux jugements, prononcer la sentence trouvée par les jurés, la faire exécuter, percevoir les amendes, tel était le droit de justice exercé par le châtelain au nom de son seigneur.
Non-seulement le châtelain avait la moyenne justice, c’est-à-dire qu’il avait la connaissance de toutes les causes /376/ civiles sans distinction et des criminelles lorsque l’amende n’excédait pas 60 sols, mais encore les attributions de sa charge se rapportaient au droit de haute justice. Le châtelain du comte pouvait saisir, emprisonner et mettre à la question tout homme coupable d’un délit méritant peine corporelle ou supplice. Dans ce cas, il devait en aviser aussitôt le conseil ou la cour de justice, faire conduire le prévenu au lieu où siégeait la cour, y instruire son procès, et faire exécuter la sentence prononcée à la pluralité des voix, toutefois sans préjudice de la cour du seigneur haut justicier, à laquelle le condamné pouvait avoir recours; car il y avait appel d’un cas décidé par la cour du châtelain au tribunal du comte. Celui-ci, haut justicier dans ses états, avait les dernières appellations, c’est-à-dire qu’il connaissait de l’appel des sentences des justiciers inférieurs, et jugeait en dernier ressort par un commissaire ou juge par lui député à cet effet, et assisté de douze jurés 1 .
Nous transcrivons ici le sommaire d’une ordonnance rendue, dans la première moitié du XVIe siècle 2 , par le comte /377/ de Gruyère, au sujet d’un conflit entre les juridictions de Gessenay et de Rougemont. Cet acte contient quelques détails instructifs concernant la compétence du châtelain et la participation du banneret à l’administration de la justice.
« Le châtelain tiendra sa cour de justice au lieu accoutumé et au temps ordinaire, et sera sa dite cour composée de douze jurés à la nomination du comte, lesquels connoîtront et jugeront d’après la coutume du pays toute affaire civile portée devant le dit châtelain: ès causes criminelles le châtelain aura le pouvoir de saisir et emprisonner (dans les limites de sa juridiction) les délinquants, de les examiner et faire torturer au dit lieu de Rougemont. Si le crime emporte mutilation de membres, le châtelain appellera le banderet de Gessenay pour assister au jugement; le dit banderet en connaîtra le premier, après lui connoîtront (voteront) les jurés à main levée, et le châtelain de Rougemont fera le rapport de la sentence (prononcera) d’après la pluralité des voix. Si le crime entraîne adjudication de corps (soit sentence de mort), la cour de justice se tiendra devant la grange du Vanel, le banderet de Gessenay connaîtra le premier, après lui les jurés: le châtelain de Rougemont fera le rapport, comme ci-dessus. L’exécution se fera en la justice du Vanel, et le châtelain et les sujets de Gessenay seront tenus d’accompagner la justice. »
Si le châtelain arrêtait dans le ressort de sa juridiction un malfaiteur étranger, il ne pouvait ni lui faire subir la torture, ni instruire son procès, mais il devait le remettre, corps et biens, à son juge naturel, avec le procès qu’on pouvait avoir contre lui.
Nulle personne ne pouvait être arrêtée sur un territoire /378/ étranger. Le seigneur de Gruyère ou son châtelain ne pouvait ni saisir un individu dans quelque autre seigneurie du comté, ni par conséquent le faire transporter arbitrairement à Gruyère. Il n’appartenait (du moins au XVe et au XVIe siècle) qu’au châtelain du fief, nous voulons dire du mandement où se trouvait le prévenu, de le faire arrêter et emprisonner, soit spontanément, soit à la réquisition du comte. Celui-ci devait y envoyer un « procureur », chargé de réclamer le délinquant au jour fixé pour l’audience par le châtelain local ou par son lieutenant. Cet officier ne pouvait livrer la personne dont le comte ou le châtelain de Gruyère demandait l’extradition, qu’après avis de la cour, ou de la communauté, qui, ayant mûrement examiné le cas, accordait ou refusait l’extradition 1 .
Personne ne devait être soustrait à son juge naturel. La coutume ou la loi du pays offrait des garanties contre les arrestations et les jugements arbitraires.
En temps de guerre, lorsque le comte faisait faire le bandiment, soit la proclamation ou la semonce, c’est-à-dire l’appel au service des armes, le châtelain était chef militaire.
Outre les fonctions de juge et de capitaine, dérivant du /379/ droit de justice et du droit de guerre, le châtelain exerçait encore l’office de receveur, ou de percepteur des droits et des redevances qui appartenaient à sa justice, dans l’étendue de sa juridiction 1 .
Cependant, il y a lieu de croire qu’il y avait aussi des receveurs spéciaux dans le comté de Gruyère 2 .
A l’expiration du terme pour lequel le châtelain avait été nommé, il remettait à son seigneur le bâton de la justice, et rendait compte de son administration, jurant sur les saints Evangiles qu’il avait exercé ses fonctions avec fidélité. Il présentait, devant le seigneur, son compte-rendu /380/ aux auditeurs des comptes, et ceux-ci, après l’avoir examiné et approuvé, le signaient 1 .
2. Le Banneret.
Le second officier était le banderet ou banneret 2 . Il avait le droit de bannière à la guerre, et, au moins dans certains cas, celui de prendre part à la justice 3 . Il avait le droit d’arrêter ou de faire arrêter et emprisonner les malfaiteurs 4 .
Le banneret, comme les autres officiers, était élu et établi par le comte dans les seigneuries où celui-ci avait la justice souveraine. En recevant de la main de son seigneur la bannière qui devait rassembler les hommes d’armes de la châtellenie et les conduire à la guerre, le banneret jurait de garder fidèlement ce signe militaire, de ne point le porter hors du pays, sinon par ordre et de l’aveu de son souverain et des hommes du pays; d’être fidèle à son seigneur et à la patrie, de défendre et maintenir les droits de ses concitoyens et ceux de son seigneur 5 .
Tout comme le châtelain était chef militaire et justicier dans le ressort de sa châtellenie, de même le banneret était officier militaire et juge. Il occupait le second rang. D’après l’ancien droit germanique, l’officier qui avait le droit de /381/ bannière, plantait ce symbole en signe de convocation des hommes d’armes; il exigeait l’hériban. Mais cet acte solennel servait aussi à mander les hommes libres aux plaids, où ils paraissaient armés. Ce qui prouve que les fonctions du banneret se rapportaient non-seulement à la guerre, mais encore aux affaires civiles et judiciaires, c’est qu’au défaut du châtelain ou de son lieutenant, il présidait le conseil ou l’assemblée publique 1 , et que, du moins dans un temps, lorsque le châtelain de Rougemont tenait sa cour de justice à l’occasion d’un crime capital, le banneret de Gessenay, mandé par le dit châtelain, assistait au jugement et votait le premier 2 .
Le banneret ne payait aucun droit des biens dont il faisait l’acquisition pendant la durée de son office, parce que celui-ci était gratuit 3 .
3. Le Mestral.
Outre le châtelain et le banneret, le seigneur-comte nommait pour chaque châtellenie, ou pour chaque chef-lieu de juridiction, deux mestraux. Ceux-ci, en recevant le bâton de justice, juraient à leur seigneur de lui être soumis et fidèles 4 , suivant l’antique usage.
Le haut justicier pouvait établir un mestral dans les autres /382/ localités ou villages de la châtellenie, conformément à l’ancienne coutume. De là vient que nous rencontrons un mestral à Lessoc et à Grandvillars, dans la châtellenie de Montsalvens; à Villars-sous-mont, dans celle de Gruyère; à Rossinière, dans celle de Château-d’Œx; un mestral du val et pays de Charmey, dans la châtellenie de Corbières.
L’office de mestral était une dépendance des droits du seigneur haut justicier.
Le nom de mestral ou de mistral, mistralis, abréviation de celui de ministralis, employé dans certains documents 1 , et qui vient de ministerialis, montre que l’officier qu’on appelait de ce nom appartenait dans l’origine à la classe des ministériels, mot qui, dans le moyen-âge, s’entend d’un officier, comme celui de ministerium, d’où il s’est formé, s’entend d’un office en général. « Parmi les ministeriales ou ministériels, les uns étaient des hommes libres, ayant des emplois publics ou domestiques, soit dans l’Etat ou dans le palais du roi, soit dans les églises ou dans les monastères; les autres, des hommes de condition servile, remplissant diverses fonctions dans les maisons ou dans les terres des seigneurs 2 . » — Il faut ranger parmi les ministériels de cette classe les mistrales ou mestraux, dont il est souvent fait mention dans les chartes du moyen-âge. C’étaient des officiers subalternes des comtes et des seigneurs, chargés de l’office de juges de première instance, et d’autres fonctions qui dépendaient de l’administration de la justice. Ils avaient le soin des causæ minores, c’est-à-dire de prononcer dans les procès sur des objets d’une certaine valeur ou sur les délits qui appartenaient à la justice inférieure. Ils avaient /383/ l’obligation de prélever les redevances du seigneur et de veiller à ses intérêts 1 . Le mestral devait ouïr les causes de sa compétence devant sa maison, et prononcer sur toutes clâmes ou plaintes, nonobstant le châtelain, ou même sur les demandes en poursuite faites par le châtelain d’une autre juridiction 2 . Il va sans dire que dans le ressort du châtelain dont le mestral était le subalterne, il y avait appel de la sentence de celui-ci à la cour de celui-là.
Le mestral devait régler et marquer les poids et les mesures 3 , selon la loi 4 , et exercer une stricte surveillance sur les vendeurs. Ceux qui contrevenaient à la loi étaient sévèrement /384/ punis. « Qui tient deux mesures, l’une petite et l’autre grande, et achète en la grande et vend à la petite, est à la miséricorde du seigneur, » dit la Coutume de Gruyère.
Le mestral percevait une part des amendes. Il avait divers autres émoluments ou revenus casuels, qui rendaient son emploi lucratif.
Le mestral a été souvent confondu avec le maire.
L’officier qu’on appelait maior ou maire n’apparaît nulle part dans le comté de Gruyère 1 . Dans les terres ecclésiastiques, on rencontre non-seulement le maire, mais aussi le mestral. Ainsi, par exemple, au milieu du XVe siècle, le prieur de Rougemont avait (suivant la coutume) un mestral, qui exerçait son office dans la commune et paroisse de Rougemont. Cet officier était à la nomination du prieur, qui pouvait le révoquer 2 . Il y avait à la Vallée du lac de Joux des mestraux de l’Abbaye, tout comme il y en avait dans la terre du prieuré de Romainmotier 3 .
Il n’y avait pas de maires dans les fiefs laïques, parce /385/ que les fonctions attribuées à cet officier y étaient exercées par les mestraux. Dans les domaines ecclésiastiques, au contraire, nous apercevons constamment des maires et, de plus, des mestraux 1 . J’essaierai d’expliquer ce fait, auquel on n’a pas donné jusqu’ici, je crois, l’attention qu’il méritait.
Le maire, en fait d’attributions, n’avait guère que celles d’un fonctionnaire d’une abbaye, d’un monastère, chargé de percevoir exactement les revenus de l’église ou du couvent, d’exercer le droit de police, de régler et marquer les poids et les mesures de longueur et de capacité, comme faisait le mestral dans les fiefs laïques, de prendre les vendeurs à faux poids et à fausses mesures, de les conduire à la maison des religieux et de les transmettre à leur messager (nuncius), soit à leur huissier, enfin, d’ouïr les causes devant sa maison, et de prononcer dans les procès sur des objets de minime valeur ou les délits de peu d’importance. Le mestral, dans les seigneuries laïques, avait non-seulement les attributions du maire, mais encore une compétence plus étendue. Dans les seigneuries ecclésiastiques, il exerçait des fonctions qui n’étaient point dans les attributions du maire. Ce qui distinguait essentiellement la mistralie de l’office du maire, c’est que le mestral prenait part à l’administration de la justice criminelle. Les délinquants /386/ condamnés à mort lui étaient remis, sur l’ordre du châtelain, et il présidait à leur exécution, qui s’accomplissait par des officiers subalternes. Jamais (si je ne me trompe) on ne voit le maire investi du droit de justice en matière criminelle, ni chargé du soin de faire exécuter la sentence de mort.
Le prieur de Romainmotier, par exemple, qui jouissait de l’immunité complète, avait le droit de haute justice, le droit de glaive; mais comme l’Eglise ne devait pas faire verser le sang ou exécuter un criminel, charge qui était dévolue à un dignitaire laïque, représentant de l’autorité impériale ou royale, le Prieur, en vertu de l’immunité parfaite, exerçait le droit de glaive par son avoué, qui était l’avoué du château des Clées 1 , soit par son châtelain, qui administrait en son nom la justice en cour séculière, et faisait exécuter la sentence de mort par le mestral, et non par le maire, qui n’avait point cette attribution, non plus que le maire de Glaris, officier de l’abbesse de Seckingen 2 , ou celui de quelque autre terre ecclésiastique.
Il n’est donc pas exact de dire que l’office de maire et celui de mestral étaient identiques, ou à peu près. Ils étaient analogues à plusieurs égards 3 , mais sous d’autres rapports il existait entre eux la différence notable que nous venons de signaler.
Le Maire, maior 4 ou villicus, fut sous les Franks ce qu’il avait été sous les Romains, un officier rural, de condition /387/ servile 1 , qui surveillait et dirigeait les travaux de la campagne 2 . Ses fonctions se renfermaient davantage dans ce qui concerne l’agriculture et l’économie rurale, la perception des cens et d’autres redevances. Sous les Franks le maire était placé sous l’autorité du judex. Lorsque la féodalité se fut établie, les maires ne tardèrent pas à acquérir de l’importance. Ils devinrent juges de basse justice, en même temps que percepteurs des droits seigneuriaux. Le caractère de leur office les distinguant, comme les ministériels en général, des autres serfs, leur donna de la considération et un appui 3 . Les maires, comme les mestraux, tendirent à s’élever, et imitant les possesseurs de fiefs, ils s’approprièrent, autant qu’ils purent, les biens dont ils n’avaient que l’administration, et rendirent leur office héréditaire dans leur famille, même pour les femmes. L’hérédité des mairies et des mistralies passa d’abord en usage, puis en droit. Quelquefois ces deux offices étaient tenus par des femmes, qui portaient alors le titre de maiorissa 4 (mairesse) ou de mistralissa 5 . /388/
Il y avait des particuliers qui possédaient le droit de mistralie, quoiqu’ils n’eussent aucune seigneurie. La mistralie héréditaire pouvait se vendre et se donner en gage.
Quoique d’une condition plus ou moins engagée dans la servitude, les maires et les mestraux, prenant pour nom de famille celui de leur office 1 , parvinrent à s’élever au rang de la noblesse inférieure, sans s’arrêter toutefois au même degré de l’échelle sociale.
Il semblerait d’après quelques textes que les mestraux aient aussi été appelés nuncii, envoyés ou messagers 2 . Nous ne croyons pas nous tromper en disant que l’office de mestral et celui de nonce ou d’envoyé étaient distincts. Notre opinion est fondée sur un passage d’une charte que nous avons déjà citée, où il est dit que certains droits dont le comte de Gruyère venait d’accorder l’exemption à la commune de Gessenay, ne devaient plus être payés ni à ses châtelains, ni à ses mestraux, ni à ses nonces ou officiers 3 .
Les nuncii, aussi appelés officiarii et commissarii, en allemand Boten, étaient des officiers subalternes, apparemment des sergents, établis par le comte pour surveiller l’administration /389/ de ses revenus 1 et autres redevances, porter des citations juridiques, transmettre divers ordres, et assister le châtelain ou le mestral dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.
Le Forestier était le garde des bois, en allemand bannwart, d’où nous sont venus, par corruption, les mots de banvard et de bannard, (qui, dans le vieux langage, signifient littéralement garde du territoire banal) et celui de brevard 2 , qui, conservé dans le langage vulgaire du Jura bernois, s’applique de préférence au garde champêtre. Au mot bannwart répond le mot français bannier, particulièrement en usage dans la Bresse et le Dauphiné, où ce terme servait à désigner le garde des vignes, qui dénonçait les maraudeurs au châtelain, et leur faisait payer le ban ou l’amende 3 . Dans certaines localités du comté de Bourgogne, le forestier était appelé messier. Ce terme, qu’on retrouve dans la Suisse romane, notamment dans la Gruyère, sous la forme de messelier ou de missilier 4 , et qui vient de messis, qui signifie moisson, servit d’abord à désigner un homme qui a la garde des champs à l’époque de la moisson. On donna en France le nom de sergent messier ou messelier, à celui qui était commis à la garde des moissons et des vignes 5 .
Le missilier de Rougemont remplissait des fonctions analogues à celles qu’exerçait le brevard, dans le Jura bernois. /390/
Choisi parmi les pâtres, et élabli pour la garde des monts Rubli et Rougemont, cet officier inférieur devait saisir et mettre à l’amende le bétail étranger qu’il trouvait dans ces montagnes et le conduire au prieuré. Il percevait un droit de 6 deniers, et le prieur un ban de 3 sols, monnaie de Lausanne 1 .
Le forestier, chargé primitivement de la garde des bois, fut aussi préposé dans la suite à la garde des biens ou des fruits 2 , dans le territoire du seigneur foncier, qui établissait ce fonctionnaire et lui faisait faire la garde; d’où vient que ses sujets lui payaient un droit nommé messellerie, missiliaria 3 .
Le nom de Maréchal, soit de marescal ou de mariscal, formé du mot mariscalus, qui est parfois remplacé par les mots de stabularius et de equorum custos, désignait primitivement un serf auquel étaient commis la garde et le soin de douze chevaux 4 . De là vient le mot maréchaucie, qui, dans le vieux langage, signifiait une écurie. Dans un temps le maréchal était un officier ayant sous ses ordres un certain nombre d’hommes. Au moyen-âge, marescalier ou maréchal, désignait un garde des frontières, un gendarme, ou la maréchaussée.
J’ai trouvé mentionnée quelque part « la maréchallerie d’ene (d’En-ey?) en la communauté de Montbovon. » L’officier /391/ appelé maréchal n’était donc pas inconnu dans le comté de Gruyère. S’il avait les mêmes attributions que le maréchal de la terre de Romainmotier, il devait amener les malfaiteurs au châtelain et assister cet officier supérieur, ou le mestral, dans l’exercice de la justice. La mareschacie ou maréchallerie ne tarda pas à devenir un emploi considérable et même héréditaire, comme d’autres offices 1 .
CHAPITRE X.
Des Plaids.
Le mot plaid ou plait n’est qu’une forme altérée du mot plaict 1 : celui-ci vient de placite, soit de placitum, qui s’est dit: 1° de la sentence prononcée par les juges; 2° de l’assemblée dans laquelle se jugeaient les procès. Les Germains employaient dans ce sens mâl, qui signifie réunion. De là les noms de mallum ou mallus, de malstatt et de Gerichtsmal, qui se trouvent dans les chartes du moyen-âge, et qui signifient cour de justice, lieu où se réunit le tribunal 2 . Le texte des lois des Germains prouve que les mâls ou plaids ont continué depuis l’invasion. Nous verrons que cette institution s’est perpétuée à travers le moyen-âge, qu’elle s’est établie et maintenue dans le comté de Gruyère.
On donnait les noms de mallus publicus ou legitimus, et de placitum legitimum aux assemblées générales et régulières dans lesquelles se jugeaient les causes. Selon les lois, ou selon les circonstances, ces assemblées étaient convoquées /393/ de sept en sept nuits, ou de quatorze en quatorze nuits, ou à toutes les kalendes, c’est-à-dire que les plaids se tenaient tous les huit jours, ou tous les quinze jours, ou tous les mois.
Les mâls étaient composés de tous les hommes libres établis dans la circonscription d’un territoire; tous avaient non-seulement le droit, mais l’obligation de s’y rendre.
On y traitait de toutes choses, de tous les intérêts communs des hommes qui s’y rassemblaient; mais leur principale affaire était de rendre la justice, ce qui donnait aux mâls le caractère de plaids judiciaires. Toutes les causes, toutes les contestations se portaient là pour être soumises à la décision des hommes libres, des bons hommes chargés de dire ou de déclarer la loi, et de trouver le jugement 1 .
Les anciens plaids étaient de deux sortes: les plaids locaux, réunions des hommes libres de chaque circonscription territoriale, et les plaids généraux, placita generalia, assemblées de la nation entière.
Les plaids nationaux furent promptement frappés de décadence sous les Mérovingiens. Avec les premiers rois de la seconde race, ils reprennent quelque vigueur, mais bientôt ils dégénèrent de plus en plus, et tombent en ruine. De leurs débris se recomposent plus tard les plaids, ou les assemblées de tous les hommes libres d’un territoire, traitant de leurs affaires communes, exerçant les droits de citoyens actifs, conformément à la loi de la terre, c’est-à-dire à l’ensemble des usages et coutumes, à la constitution d’un territoire, qui était désignée elle-même sous le nom de placitum generale ou de plaid général./394/
Sous les Franks, les plaids locaux partagèrent le sort des plaids généraux. Ils tombèrent en désuétude.
Primitivement, lorsque la centène, soit le canton du centenier (officier royal subordonné au comte) comprenait cent manses plus ou moins rapprochés, les hommes libres pouvaient se réunir assez facilement. Mais lorsque l’organisation politique et féodale eut subi des modifications importantes, le droit des rachimbourgs ou des bons hommes se convertit en une charge onéreuse; les plaids locaux devinrent toujours moins actifs et moins fréquents; ils tombèrent dans une telle désuétude que vers la fin de la race mérovingienne, les juges locaux, les viguiers et les centeniers ne les convoquaient plus pour rendre la justice, mais pour satisfaire leur cupidité en mettant à l’amende les hommes libres qui ne s’y rendaient pas.
Charlemagne, pour remédier à ces abus, réduisit à trois par an le nombre des plaids ordinaires, et il établit des scabini ou juges d’office, chargés de rendre la justice, au défaut des simples hommes libres qui n’en voulaient plus prendre la peine.
Le nombre des plaids ordinaires, qu’un décret de Charlemagne avait fixé à trois par an, fut maintenu par une ordonnance de Louis le Débonnaire, de l’an 819 1 .
Cependant l’institution des scabins ne fit pas abolir les assemblées où les simples bons hommes avaient coutume de rendre la justice. Elles cessèrent d’être aussi fréquentes, aussi actives qu’elles l’avaient été autrefois, mais elles n’en subsistèrent pas moins. Sous les formes des plaids usités /395/ au moyen-âge on reconnaît les vieilles coutumes, et on en conclut légitimement la continuation prolongée de l’ancienne institution germanique 1 . Il se peut que l’ancienne organisation ait été modifiée; mais on ne saurait douter, à la vue de certaines chartes, que le système judiciaire des Germains établis dans la Gaule, n’ait été conservé en principe dans toute la Bourgondie, par conséquent dans la Gruyère, et en particulier dans la partie alamannique de ce petit empire 2 .
Sans prétendre à une classification rigoureuse des plaids du moyen-âge, nous croyons distinguer, dans les chartes, trois ou quatre sortes d’assemblées publiques:
1° Les assemblées générales, telles que la réunion des diverses bannières, ou celle des hommes d’une bannière, par exemple, à l’avénement du comte, espèce de joyeuse entrée, où le nouveau souverain jurait à ses sujets de maintenir leurs droits, leurs franchises et libertés, et recevait d’eux, à son tour, le serment de fidélité; ceux qui /396/ avaient lieu, par exemple, à l’occasion d’un homicide, dans le pays de Gessenay 1 ; les plaids généraux, placita generalia, qui eurent lieu en 1266, 1327, 1355 et 1499, dans la seigneurie ecclésiastique de Romainmotier 2 ; les plaids que tint le comte de Buchegg, landgrave de Bourgogne 3 , et d’autres.
2° Les assemblées de paroisse ou de commune, convoquées et tenues par des magistrats locaux, chargés du soin des intérêts communaux, de l’administration des revenus, etc. Ces assemblées se tenaient à des époques différentes, suivant les circonstances. On y traitait des affaires communes qui n’avaient pas rapport à l’administration de la justice. On y passait des actes d’achat, de vente, de fermage, bref des contrats de toute espèce, qui étaient consentis, approuvés, validés par tous les membres de la commune, c’est-à-dire par tous les prudhommes, ou du moins par un bon nombre d’entre eux, qui agissaient et témoignaient en leur propre nom et au nom de leurs pairs. Dans ces réunions, où il s’agissait d’affaires communes, où se consommaient les actes civils, on voyait paraître même des femmes, remplaçant des chefs de maison décédés, et représentant la propriété, les intérêts de famille. /397/
Telles furent, par exemple, l’assemblée de la commune de Begnins, en 1266, celle de Chexbres, en 1384 1 , celle des banneret, mestral et prudhommes de Château-d’Œx, qui se tint en 1438, au sujet des franchises de l’église de ce lieu 2 .
Peut-être convient-il de mentionner ici une assemblée, un plaid, qui mérite notre attention. Au milieu du XVe siècle, le prieur de Rougemont et les gens de cette paroisse eurent ensemble une contestation au sujet de certains usages dont les paroissiens réclamaient la franchise, et que le prieur voulait maintenir. Après de longs débats, où les deux parties avaient défendu leurs droits sans pouvoir terminer le différend, elles s’en remirent à la décision du comte de Gruyère, qui donna son jugement arbitral, après s’être exactement informé des droits de chaque partie, qui furent discutés par ses conseillers et par plusieurs autres experts et des coutumiers 3 . La sentence fut approuvée et confirmée tant par le consentement du prieur, que par celui de soixante prudhommes, probi homines, présents à l’audience, et qui ratifièrent le jugement arbitral du comte, en leur propre nom et au nom de tous les autres prudhommes et habitants de la paroisse de Rougemont 4 . — Les paysans, ces simples hommes libres, avaient délibéré sur /398/ des affaires communes, traité d’intérêts communs, dans une assemblée publique et locale.
3° Les plaids de justice, convoqués et présidés par un officier du comte, et auxquels assistaient les hommes libres d’une paroisse ou d’un mandement.
Un précieux document de la première moitié du XVe siècle nous offre le spectacle d’un plaid judiciaire dans une seigneurie qui forma plus tard le cinquième mandement du comté de Gruyère. C’est apparemment un mestral qui présidé à la cour de justice 1 .
« Nous Ulric dit Rossier 2 de Villarvolar et François Suneveis, donzel, savoir faisons à tous présents et futurs, que Jean Chalvini, châtelain de Gruyère, m’ayant transmis, à moi le dit Ulric, une demande en poursuite contre Jaques 3 Tuller de Gessenay, ici demeurant, accusé d’avoir tué sa femme et de l’avoir occise dans le ressort de la châtellenie de Gessenay, me requérant de m’assurer de sa personne et de ses biens, pour tirer raison de lui comme d’un homicide, j’ai, en vertu de cette demande en poursuite, arrêté et emprisonné le dit Jaques, afin de le livrer au châtelain de Gruyère et de faire ce qu’ordonnerait la coutume du lieu. J’ai fait connaître au dit Jean Chalvini, châtelain de Gruyère, et au dit Jaques, qu’ils eussent à comparaître devant moi ou devant François Suneveis, donzel, mon commissaire député à cette /399/ cause, le vendredi après la fête de St. Denis, soit le 11 octobre de l’année indiquée ci-dessous, à une heure, à Villarvolar, devant ma maison où j’ai coutume de tenir mes plaids 1 , et d’informer selon l’usage du lieu et du pays, afin que le dit Jean, châtelain de Gruyère, fît personnellement sa poursuite en justice, qu’on pût informer de cette affaire, et procéder ultérieurement, selon l’ordre établi par la coutume. Or, le vendredi, jour que je leur avais fixé pour comparaître devant moi, le dit Ulric, et devant François Suneveis, mon commissaire député à cette cause, j’amenai le dit Jaques Tuller dehors, devant ma maison, en la cour 2 , et je le présentai à mon commissaire pour qu’il en informât, selon la coutume du lieu, en présence des nobles, bourgeois et prudhommes, ci-dessous nommés, siégeant et jugeant avec nous en la cour 3 . Le prévenu ayant été ainsi conduit dehors et présenté en la cour, au tribunal 4 , à l’heure désignée, devant moi, le dit François Suneveis, donzel, je lus en la cour aux hommes ci-dessous nommés, la demande en poursuite faite par Jean Chalvini, châtelain de Gruyère, en vertu de laquelle le dit Jaques avait été arrêté et emprisonné, je fis proclamer par trois fois le dit Jean Chalvini, châtelain de Gruyère, afin d’apprendre s’il était présent et s’il voulait poursuivre sa demande contre le dit Jaques Tuller. Jean Chalvini, châtelain, ainsi proclamé, ne comparaissant point sur la citation, le dit Jaques, que j’avais pourvu d’un conseil, proposa et dit par son avocat et conseil 5 , qu’à l’heure fixée /400/ pour être ouï, le dit Jean Chalvini, châtelain de Gruyère, n’ayant pas comparu, et nulle autre personne ne faisant la demande en poursuite; que, vu le droit, l’usage, la coutume et la liberté du lieu, usités de toute ancienneté et maintenus entre les seigneurs-comtes de Gruyère et les sujets et habitants de la seigneurie, terre et comté de Gruyère, d’une part, et les seigneurs, nobles, et habitants de toute la terre et seigneurie de Corbières, d’autre part, à savoir que, si quelque personne, ayant commis fortuitement un homicide sur le territoire ou dans la juridiction de l’un des deux seigneurs prédits de Gruyère ou de Corbières, a pu s’évader, s’enfuir de la terre où il a commis l’homicide, et se réfugier sur le territoire et dans la juridiction de l’autre seigneur, où il n’a pas commis l’homicide, il ne peut être poursuivi ni arrêté avec son avoir par l’un des deux seigneurs susdits, mais doit être libre quant à son corps et à ses biens; que le dit Jaques, ayant été arrêté et emprisonné dans la seigneurie et juridiction de Corbières, où les droit, usage, coutume et liberté susdits sont en vigueur, et n’y ayant commis aucun délit ni fait aucun mal, devait en conséquence être renvoyé des fins de la plainte, le défenseur du prévenu conclut à sa mise en liberté, en présence des nobles, bourgeois et prudhommes avec moi siégeant, connaissant et jugeant en la cour. Ayant fait emmener le prévenu, afin que la cour pût délibérer, et ayant posé la question à la connaissance des nobles, bourgeois et prudhommes siégeant, connaissant et jugeant avec moi en la cour (suivent vingt-quatre noms), ces jurés connurent et jugèrent à l’unanimité que, vu, ouï et considéré les us, coutume, droit et liberté de tout temps usités dans le pays, et les allégations ci-dessus rapportées, moi susnommé François je devais, selon le droit /401/ et la coutume, renvoyer le dit Jaques Tuller des fins de la plainte, demande et poursuite de Jean Chalvini, châtelain de Gruyère, et le remettre en liberté avec ses biens. Ce jugement ayant été ainsi donné d’un commun accord, moi, ledit commissaire, je fis reparaître devant le tribunal, soit en la cour, le dit Jaques, et je lui rapportai le jugement des nobles, bourgeois et prudhommes, tel qu’ils me l’avaient donné d’un commun accord. Il le trouva bon. Je déclarai que, vu le jugement unanime de la cour, le dit Jaques devait être et serait par moi renvoyé des fins de la plainte, demande et poursuite de Jean Chalvini susdit, et je lui rendis la liberté, en lui mettant à la main un rameau 1 , selon l’usage reçu en pareil cas, etc. — Le procès-verbal de ce plaid fut dressé, séance tenante, en la forme accoutumée, et la vérité de son contenu attestée par les nobles, bourgeois et prudhommes qui avaient donné le jugement, le vendredi après la fête de St. Denis, l’an de N. S. mil quatre cent vingt. »
Cet acte important nous invite à dire un mot de la composition des plaids judiciaires. On sait qu’ils se tenaient en plein air, tantôt sur une colline, tantôt sous un arbre, de préférence sous un chêne ou sous un tilleul, tantôt sur un cimetière, dans une prairie, ou dans quelque autre lieu ouvert 2 , quelquefois sous un toit. On les distingue en /402/ plaids ordinaires et plaids extraordinaires. Dans les circonscriptions territoriales où il n’y avait que des paysans, dans les paroisses rurales, les plaids ordinaires étaient composés du châtelain ou de son lieutenant, du banneret, ou du mestral et des membres de la commune, c’est-à-dire des paysans libres et propriétaires, désignés, dans la partie alamannique du comté de Gruyère, sous les dénominations de Leute ou de Landleute, et, dans la partie romane, sous celle de prudhommes, dont nous avons donné la vraie signification.
Dans les territoires où il y avait un lieu fort, un burgum, partant des burgenses, et, de plus, des nobles, comme à Corbières, à Gruyère 1 , les plaids judiciaires, du moins ceux où devaient se juger des causes criminelles, étaient composés de nobles, de bourgeois et de prudhommes ou de paysans notables, comme celui du 11 octobre 1420.
Tout comme dans les anciens mâls ou placites, le seigneur justicier, le comte, le viguier ou le vicomte, le centenier ne jugeait pas, mais présidait à l’assemblée des juges, des bons hommes, de même, dans les plaids du comté de Gruyère, le comte ou son commissaire, député pour présider à la cour de justice, le châtelain, le mestral, ne jugeait pas lui-même. Il ordonnait l’audience, faisait connaître le cas, entendait les parties, posait à la connaissance des jurés la question à décider, et, ceux-ci ayant dit la loi ou déclaré la coutume, il prononçait le jugement qu’ils avaient donné, et le faisait exécuter. Le juge n’était que l’organe des arrêts prononcés par la cour, et l’exécuteur de la loi ou de la coutume. /403/
4° Outre les plaids ordinaires de justice, il y avait des plaids extraordinaires, que le juge ou son officier proclamait quand les circonstances lui en faisaient un devoir, et auxquels n’assistaient, avec lui, que les plaideurs et les jurés ou les témoins. Ces plaids avaient lieu d’après un usage établi au commencement du IXe siècle, et qui se maintint dans les siècles suivants. On lit dans un capitulaire de Charlemagne:
« Que personne ne soit convoqué au plaid (extraordinaire), si ce n’est celui qui poursuit sa cause, et celui contre qui il la poursuit; sauf sept scabins qui doivent assister à tous les plaids 1 . »
On retrouve ce nombre dans la composition des plaids du moyen-âge 2 .
Mais pour qu’une cour de justice fût complète et solennelle, il fallait nécessairement la présence de douze jurés. Au défaut d’un nombre suffisant de scabins, le comte devait y suppléer par le choix de bons hommes ou de notables de son territoire 3 .
Le nombre 12 se présente plus souvent que le nombre 7 dans les coutumes du moyen-âge. Celui-ci ne se montre dans aucune de nos chartes.
Déjà dans la loi salique il est question, à propos des /404/ plaids judiciaires, de 12 jurés, juratores 1 . Ils donnaient le jugement, ou disaient la loi sous la foi du serment, jurati.
On pourrait croire que le nombre 12, adopté par toutes les tribus germaines, fut de toute ancienneté le nombre normal 2 . Cette opinion me semble trouver un appui dans le capitulaire de l’an 819, qui ordonne au juge de compléter, au moyen de bons hommes, le nombre des scabins, pour former une cour plénière.
Nous avons dit 3 que Charlemagne ayant établi des scabini ou juges d’office, alors que les hommes libres se dispensaient d’assister aux plaids, l’ancien droit n’en subsista pas moins à côté de l’institution nouvelle, que les simples bons hommes continuèrent à prendre part à l’administration de la justice et à rendre des jugements. Nous devons ajouter ici que l’institution des juges d’office, loin de tomber en désuétude, se maintint à côté de l’institution ancienne, à travers le moyen-âge. — Que les juges, ou plutôt les jugeurs, aient continué ou non de porter le titre de scabini 4 , il n’en est pas moins certain que les cours de justice /405/ composées de 7 ou de 12 membres se présentent fréquemment, du moins les dernières, aussi bien dans la Suisse romane que dans la Suisse germanique. C’est dire que nous les trouvons chez les deux races qui composent la population du comté de Gruyère.
Ce qui nous porte à penser que l’institution dont il s’agit était une coutume générale, au moins dans la Suisse romane, c’est le passage suivant d’une chronique vaudoise du XVIe siècle, que nous avons déjà citée 1 . « A Orbe et à toutes les autres justices du pays (de Vaud), y sont commis douze que l’on appelle prodommes ou jurez de la justice. »
Les causes criminelles appartenant à la haute justice étaient portées devant un tribunal (judicium, curia) composé non de tous les hommes libres d’une juridiction, mais d’un nombre déterminé de jurés, à la nomination du seigneur haut justicier. Douze était le nombre normal. Ces douze jurés, que certains documents en langue allemande désignent sous le nom de Rechtsprecher 2 , nom qui exprime bien la fonction d’hommes notables, élus pour dire la coutume ou la loi, pour donner le jugement (Rechtsspruch), étaient choisis soit parmi les villageois seulement, c’est-à-dire parmi les paysans libres et propriétaires, autrement dits Landleute et prudhommes, soit parmi les nobles, bourgeois /406/ et paysans, selon qu’il y avait des nobles et des bourgeois dans une circonscription territoriale, ou qu’il n’y avait que des villageois, des coutumiers. Ils étaient pris dans diverses localités d’une juridiction.
On a vu que, pour affaires criminelles, la cour du châtelain de Rougemont devait être composée de douze jurés, à la nomination du comte 1 . On lit dans un document du 6 juin 1538, concernant les dernières appellations de cas décidés par le châtelain de Corbières, ou par son lieutenant, « qu’elles devaient demeurer à Corbières, par devant le comte de Gruyère, à son commissaire par lui à ce député, ayant douze jurés pour l’audience et connaissance des dites appellations, et que ces douze jurés devaient être pris à savoir six dès le sentier au-dessus de Charmey, et six de Corbières et Vuadens. »
Dans un autre acte, du 19 août 1555, qui contient la nomination des officiers du nouveau seigneur d’Oron, il est dit que « pour jurés ont été ordonnés, constitués et élus douze, savoir: d’Oron-le-Châtel, 2 jurés, de Chesalles 3, de Bussigny 3, de Rogive 1, du Currat 1, de Progin 1, et et de Porsel (ou de Mossel?) 1. »
Enfin on lit dans un acte du 26 juin 1549, que, « en cas de différend entre le comte de Gruyère et ses sujets, pour offense (ou rébellion), le comte doit élire, dans ses cinq bannières, douze hommes de bien, qui, avec l’officier et châtelain du comte en la ville de Gruyère, connaîtront des plaintes, lesquelles seront terminées au jugement du plus (de la majorité) de ces douze hommes 2 . » /407/
Mainte autre assemblée d’hommes exerçant des droits civils, était composée de douze membres. Ainsi, par exemple, anciennement, les villes, les communes ou paroisses nommaient douze hommes probes et loyaux chargés de répartir équitablement sur chaque feu, selon ses facultés, les tailles ou subsides que le peuple avait concédés au souverain 1 .
Celui qui poursuivait sa cause et celui contre qui il la poursuivait ayant droit à un nombre égal de jurés, il arrivait que la cour était composée de 2 fois 12, soit de 24 jurés. Nous citerons comme exemple le plaid du 11 octobre 1420, qui fut composé de 24 hommes connaissant et jugeant, dont 12 nobles, bourgeois et prudhommes de la châtellenie de Gruyère, et autant de la châtellenie de Corbières.
Le nombre 12 a de même servi de base à la formation /408/ des conseils soit des communes rurales 1 , soit des communes des villes, vassales du suzerain. Il fut un temps où les conseils des communes urbaines formaient autant de cours de justice, présidées par un juge, dont l’élection par la commune des bourgeois était soumise à la confirmation du suzerain, qui était seul le haut justicier. Aussi tenait-il, selon l’ancienne coutume, trois fois par an le plaid général, où il jugeait selon les décisions et les droits des bourgeois 2 . Berne eut longtemps son conseil ordinaire des XII, qui officiait comme cour de justice, sous la présidence d’un avoué 3 ; Fribourg eut son conseil des XXIV, nommés jurés 4 , magistrats institués à l’exemple des vingt-quatre consuls ou conseillers et juges de la ville de Fribourg en Brisgau 5 , et présidés par un avoué, dit aussi justicier 6 . L’avoué et les jurés /409/ résidant en ville, devaient siéger un jour de chaque semaine pour rendre la justice 1 .
Lorsque la ville de Gruyère eut obtenu, au milieu du XVe siècle, la faculté d’élire son conseil, elle le composa de 12 membres. Ce conseil, présidé par un gouverneur, fut chargé uniquement de l’administration municipale 2 . Je ne sache pas que ces XII aient été nommés jurés, ni qu’ils aient pris part à l’administration de la justice; s’ils l’ont fait, ç’a dû être sous la présidence du châtelain ou de son lieutenant.
Le conseil de Gessenay (de même celui de Château-d’Œx, etc.) convoqué pour l’administration de la justice, était nécessairement présidé par le châtelain, ou par son lieutenant, bref par un officier du seigneur haut justicier 3 . Mais lorsqu’il était réuni pour s’occuper des intérêts /410/ de la paroisse, de l’administration des affaires communes, pour délibérer sur des points de coutume et de droit, il avait sans doute pour chef un homme élu par les membres de la paroisse. Cela me semble résulter de la réponse que les gens de Gessenay firent au comte Antoine, qui leur reprochait d’empiéter sur ses droits: « Quelques statuts ou règlements que nous ayons établis, lui dirent-ils, nous avons toujours invité à nos réunions le châtelain ou l’officier qui alors était châtelain de Gessenay de la part de Monseigneur le comte de Gruyère, et nous avons discuté et consommé toutes choses d’après son avis 1 . »
Les jurés nommés par le seigneur haut justicier, par le comte de Gruyère, prêtaient serment en audience solennelle. La main levée 2 , ils juraient à leur seigneur, ou à son commissaire, d’exercer loyalement leur office, de s’acquitter /411/ de leurs devoirs avec impartialité, de connaître suivant leur entendement, et selon Dieu et la raison 1 .
Une ordonnance du XVIe siècle, concernant les dernières appellations, que le comte se réservait en sa cour de Corbières, contient quelques détails que nous croyons devoir publier.
« Si parmi les douze jurés nommés pour connaître des dernières appellations de cas décidés par la cour du châtelain ou d’un juge inférieur, il s’en trouvait qui eussent déjà été appelés à prononcer en moyenne ou basse justice sur le fait en question, ils ne pouvaient en connaître en dernière instance que du consentement des deux parties.
« Chacun des jurés connaissant en dernière instance, devait recevoir, pour le procès à juger, un salaire de six gros, bonne monnaie, ayant cours dans le comté de Gruyère, payable, ainsi que les frais du comte ou de son commissaire, par celui qui perdait sa cause. Les jurés qui n’avaient pas besoin de se déplacer, ne recevaient que quatre gros, pour frais et salaire 2 .
« Avant l’ouverture de la séance, les parties litigantes devaient « fiancer », c’est-à-dire répondre des dépens faits ou à faire à l’occasion de l’appel en la cour suprême d’une sentence rendue par un juge inférieur.
« Si les parties litigantes s’accordaient depuis /412/ l’intimation, elles devaient payer les dépens faits et le salaire des jurés, chacune la moitié.
« Toutes les causes devaient se décider à la pluralité des voix; la majorité devait gagner la dite appellation 1 . »
Le dernier point était une coutume ancienne et généralement observée 2 .
Nous terminons ce chapitre par l’examen d’une coutume qui a un cachet primitif, et qui mérite d’autant plus notre attention qu’elle offre une nouvelle preuve de la permanence des plaids généraux dans le comté de Gruyère. La coutume dont nous parlons, contestée par le comte Antoine, défendue par les paysans du Gessenay, fut reconnue par les seigneurs de Berne et de Fribourg, pour un usage que le temps avait consacré dans ce pays, et elle fut maintenue par leur sentence arbitrale.
« Lorsqu’un homicide avait été commis dans le pays de Gessenay, c’était la coutume de convoquer jusqu’à trois fois le plaid général 3 , de proclamer à la première, à la seconde et à la troisième assemblée le bannissement de l’homicide, qui dès lors était proscrit de tout le pays de Gessenay et de tout le territoire du comté. Ses biens étaient confisqués au profit /413/ du seigneur, et son corps échu aux plus proches amis, c’est-à-dire aux plus proches parents du mort, qui pouvaient, jusqu’au troisième degré de parenté, poursuivre et venger le meurtre. Quelque mal qu’ils fissent au corps de l’homicide, dans les limites du pays de Gessenay ou dans celles du comté de Gruyère, ils n’en étaient responsables ni à sa seigneurie ni à quelque autre personne. Le seigneur justicier ne pouvait faire grâce au coupable ni lui permettre de résider dans le pays, à moins que la famille du défunt n’eût consenti à un accommodement 1 . »
C’était là, disaient les gens de Gessenay, une coutume que leurs ancêtres leur avaient transmise, et qu’ils espéraient maintenir, d’autant plus qu’elle existait non-seulement chez eux, mais aussi dans d’autres contrées.
L’assertion des paysans de la Gruyère alamannique était fondée. En effet, la coutume que nous venons de signaler était antique, et, de plus, elle était connue et suivie dans certaines contrées de la Suisse.
Nous en citerons deux exemples pris dans l’histoire d’un canton voisin. Ils caractérisent les mœurs fribourgeoises au XVIe siècle. « Pierre Jetzeler avait tué Hans Penchilli du Gouggisberg (1504). Par sentence arbitrale, que ratifièrent les seigneurs de Fribourg, il fut réconcilié avec la famille de la victime, aux conditions suivantes: 1° Il évitera toute rencontre avec les membres de cette famille, jusqu’au troisième degré de parenté; il ne se trouvera jamais avec eux ou l’un d’eux, ni sur les chemins, ni à l’église, ni dans un cabaret, ni au marché. Dans toute rencontre de ce genre, il se retirera sans délai; si c’est à l’auberge, il s’éloignera /414/ dès qu’il aura mangé ce qu’on lui aura servi. 2° Il fondera, pour 25 livres, une lampe perpétuelle dans l’église de Gouggisberg, pour le repos de l’âme du défunt. 3° Il payera, en trois termes, une indemnité de 105 livres à la famille du défunt. 4° Il quittera, pour n’y plus rentrer, la justice ou le territoire du Gouggisberg. »
« Une sentence semblable fut rendue vingt-cinq ans plus tard. Jean Dogis, bourgeois de Fribourg, ayant tué d’un coup d’arquebuse noble Guillaume Forney, ancien banneret de Vevey, la parenté du défunt conclut avec le meurtrier l’arrangement suivant: 1° Il évitera, sur toutes les places publiques, la rencontre des parents du mort; 2° Il ne viendra jamais à Vevey; 3° Il payera aux héritiers une indemnité de 1300 livres, en trois termes, et il fournira une caution jusqu’à ce qu’il ait payé la somme 1 . »
Après avoir trouvé dans l’histoire d’un canton voisin de la Gruyère deux traits qui ont une analogie frappante avec le droit de vengeance personnelle, héréditaire, que le peuple de Gessenay défendait comme un de ses plus beaux priviléges, nous n’aurons pas de peine à découvrir l’origine de cette coutume.
Nous lisons dans Tacite: « Il est du devoir des Germains d’embrasser les inimitiés comme les amitiés d’un père ou d’un parent 2 . »
Ce trait se retrouve chez tous les peuples, dans l’enfance de la civilisation 3 . Mais ce qui surprend, c’est que, malgré /415/ la propagation de l’Evangile, la coutume des Germains de Tacite se soit transmise et maintenue jusqu’en plein XVIe siècle, et peut-être au delà. — Les Germains ont apporté avec eux et implanté le droit de vengeance personnelle dans toutes les contrées où ils se sont établis et où leurs usages ont prévalu. Ce droit est sanctionné par la vieille ghilde. La ghilde chrétienne, c’est-à-dire l’ancienne ghilde tempérée par le christianisme, ne fit que modifier la forme de l’institution originelle. Parmi les statuts de la fraternité du Banquet, il en est deux sur lesquels je me permettrai d’insister: ce sont ceux qui concernent le meurtre d’un convive par l’un de ses frères, et le meurtre d’un convive par un homme étranger à l’association. Ces deux statuts consacrent la vengeance, et la remettent aux parents ou héritiers du mort, et à la confrérie, aux plus proches amis du défunt, suivant l’expression de la coutume de Gessenay. Le meurtrier devait quitter le pays pour se soustraire à la vengeance. Il pouvait toutefois y rentrer, en payant une forte amende. S’il ne la payait pas, il n’avait plus ni trève ni repos, la vengeance le poursuivait partout.
Ainsi la loi du Banquet admettait une composition, c’est-à-dire une compensation pécuniaire à payer par le meurtrier à la famille ou aux parents de celui qu’il avait tué.
La coutume de Gessenay et celle de Fribourg consacraient le même principe, comme on a pu le voir. Or ce principe n’était point une innovation du moyen-âge, enfantée par le Code de salut, qui déclare que la vengeance n’est point permise au chrétien. Il n’est pas autre chose qu’un emprunt à la coutume des anciens Germains. Dans le même chapitre où Tacite parle de l’état de haine et d’hostilité où vivaient des familles germaines à la suite d’un meurtre, il nous dit: /416/ « Du reste, ces inimitiés ne sont pas implacables. On rachète même l’homicide par une certaine quantité de gros et de menu bétail, et toute la famille du mort est réconciliée. »
Il est évident que la coutume de Gessenay a sa source dans celle des anciens Germains.
Cette obstination dans la vengeance personnelle, héréditaire, fut une des licences que le christianisme eut le plus de peine à détruire.
APPENDICE.
Nous rassemblons, dans un supplément, quelques détails qui n’auraient pas facilement trouvé leur place dans le cours de cet ouvrage.
I.
Des noms propres.
A propos des noms propres, dont il a été dit un mot ci-dessus, pages 107 et 151, nous remarquons ce qui suit:
1. Des noms de personnes.
La plupart des noms de personnes que nous avons rencontrés non seulement dans notre Cartulaire du comté de Gruyère, mais encore dans un grand nombre de documents relatifs à d’autres contrées de la Suisse romane, appartiennent aux langues du nord. Cette observation paraît surtout applicable aux noms d’hommes. Tels sont les suivants: Aimo ou Aymo et Haimo, Albertus, Amalricus, Anselmus, Bernardus, Bertholdus, Boamundus, Cono, Cuno et Cœnetus, qui sont formés de Conradus; Ebal ou Hebal, Franciscus, Georgius, Girardus, Godefridus, Gualcherus ou Valcherus et Walcherus, Gualterus ou Walterus, Guarnerius ou Warnerius, Guerricus, Guibertus ou Wibertus, Guido ou Guigo et Wido, Guillelmus et Willelmus ou Guillermus et Willermus, Henricus, Hubertus, Hugo et Ugo, Humbertus et Umbertus, Joceranus, Jocelinus, Jordanus, /418/ Lambertus, Landricus, Lodovicus, Mermetus, Nanthelmus, Nicodus ou Nicolaus, Rabodus, Rainaldus ou Reinaldus, Robertus, Radulfus ou Rodulfus, dont les Romans, rejetant le d, ont fait Raoul, Roul, Rou et Ruil 1 ; Richardus, Rogerius, Thurimbertus, Torincus ou Turincus, Udalricus, soit Uldricus ou Ulricus.
Quelques-uns sont des noms ecclésiastiques, tels que Jacobus, d’où on a fait Jaquetus et Jaqueta; Johannes, d’où viennent Johanna et Johanneta, et Petrus, d’où se sont formés le nom masculin Perrodus et les noms féminins Petronilla, Perroneta, Pernette.
Parmi les noms de femmes qui appartiennent aux langues du nord, nous remarquons les suivants: Adela, Adelais, Adelina, Agnes, Alix, Beatrix, Bertha, Catharina, Ermengardis ou Irmengardis, Gertruda, Guillermeta ou Willermeta, Henrietta, Isabel, Isabelle ou Isabeau, Jordana, Luqueta (de Ludowica?), Mermeta, Odelina, etc.
D’autres noms de femmes sont d’origine grecque ou latine, tels que Agatha, Ambrosia, Anastasia, Bastiana 2 , Bonna, Cæcilia, Claudia, Clementia, Columba, Constantia, Contesseta 3 , Helena, Juliana, etc. /419/
2. Des nom de familles.
Pendant longtemps le campagnard, l’artisan, le simple homme libre n’eurent d’autre nom que celui que le prêtre leur avait donné. L’homme du peuple ne connaissait son égal ou son pair que sous le nom que celui-ci avait reçu à l’église. On disait: Pierre fils de Pierre ou de Rodolphe. Mais le plus souvent, pour distinguer un individu d’un autre qui avait même nom que lui, on le désignait par un surnom. Les surnoms, déjà communs à l’époque où s’établit la féodalité, étaient ordinairement placés après le nom de baptême. Les chartes de nos contrées nous en fournissent un bon nombre.
Les uns sont empruntés des qualités physiques des personnes: Petrus albus, P. blancus (Blanc, Leblanc), Nicoletus niger (Noir, Lenoir), Willelmus rufus (Rufi, Rouge, Rousseau, Roux, Leroux); Aimus pilosus, etc.
Tel surnom rappelle un vice de la parole: Uldricus balbus (Bègue, Bégoz); tel autre annonce une qualité morale: Uldricus sapiens (Lesage).
Il en est qui sont tirés des produits de la terre, p. ex. Petrus panis et vinum.
D’autres sont empruntés à des animaux: Petrus lupus (Loup), Boso piscis (Poisson), etc.
Plusieurs se rapportent aux habitudes personnelles: Paganus manducans lardum (mâchelard); Petrus morandus (Morand).
Les uns marquent des pays, ou l’origine: Petrus de Germania, Petrus dictus thotonicus, Peronet li alamant.
D’autres se rapportent à quelque localité, à quelque propriété, etc. Jaquetus deis cullayes (Descoulayes), P. de bosco /420/ ou del bosco (Dubochet, Dubois), W. de subtus viam (Soulavie), R. dou villar, et dou willere (Duvillars), P. de esserto (Delessert, Desessarts), W. de prato (Dupraz, Dupré), P. de puteo (Dupuis), etc.
Un grand nombre de surnoms se rapportent à la profession: Willelmus fabri (Fabri, Fabre, Favre), Johannes sutor, P. carpentarius (Charpentier), Rodulfus li pelliciers, P. molenarius (Meunier, Monnier), P. monachus (Lemoine).
D’autres indiquent un office: Johannes mistralis (Mestral), R. maior ou Mayor, P. cellerarius (Cellérier), R. marescallus (Maréchal). Remarquons encore les noms de Chastellain ou de Châtelain et de Tschachtlan.
Une foule de surnoms ont des origines diverses: Willelmus campus avene (Champd’avoine), P. panis avene (Paindavoine), Petrus cognominatus miles (Chevalier, Lechevalier), Stephanus dictus ou cognomine appellatus comes (Comte, Lecomte), P. nomine rex (Roi, Leroi), Guillelmus dictus imperator (L’empereur). — Ces hommes sont des taillables, de simples tenanciers du XIIIe siècle.
Avec l’affranchissement des serfs, l’augmentation des prudhommes ou des paysans libres et propriétaires, et la formation des communes coïncide l’hérédité des surnoms, qui constituent par conséquent de vrais noms de familles. Ainsi, p. ex., le fils d’Uldricus balbus, au XIIIe siècle, s’appelait Perretus balbus, preuve que le surnom, passant de père en fils, était devenu un véritable nom de famille héréditaire. Il en était de même des surnoms rufus, niger, faber, paganus (Payen) 1 , etc. /421/
Enfin, nous ferons observer que des noms de baptême sont devenus des noms de famille: p. ex. Guarinus ou Warinus, Gualterus ou Walterus, Guarnerius ou Warnerius, Germundus, Henricus et d’autres.
II.
Du droit de justice.
(Voyez ci-dessus, p. 300-301.)
Avant que le comté de Gruyère se fût accru de la seigneurie et châtellenie de Corbières, il comprenait quatre mandements militaires ou bannières, qui s’appelaient Gruyère, Montsalvens, Château-d’Œx et le Vanel. Chacun de ces noms était le nom d’un château fort, manoir ou siége de quelque seigneur de la maison de Gruyère, qui, en raison des droits attachés à ce château, était le justicier du territoire ou de la juridiction qui en dépendait.
Y avait-il dans la Suisse romane, notamment dans la Gruyère, des cas où la justice fût tenue indépendamment du château, comme provenant d’une inféodation différente? ou plutôt n’y avait-il que des justices inséparablement attachées au château, qui fissent corps de fief avec lui, et où la justice dût suivre la concession du château comme une annexe ou une dépendance?
Le second cas nous paraît seul admissible 1 .
Cependant les quatre anciens mandements du comté de Gruyère formaient ensemble six châtellenies, attendu que ceux de Gruyère et du Vanel comprenaient chacun deux châtellenies, à savoir: le premier, les châtellenies de Gruyère /422/ et de la Tour; le second, celles de Gessenay et de Rougemont.
Remarquons d’abord que la Tour-de-Trème n’était pas un château ayant droit de justice, qu’elle n’a point servi de résidence à un seigneur justicier de la maison de Gruyère; ensuite, que Rougemont n’avait pas de château féodal, que celui qui existe est une construction de la fin du XVIe siècle 1 .
Néanmoins, des documents de 1549 et de 1555 font mention d’un lieutenant de la châtellenie de Rougemont; un autre, du 13 décembre 1539, donne à ce village paroissial et à son territoire le nom de mandement. De même, il est plusieurs fois question du châtelain de Gessenay ou de son lieutenant, ainsi que du mandement de ce nom 2 .
Il y a plus. On lit dans une charte du 10 mars 1397 que les habitants de Gessenay appartenaient à la justice et châtellenie de Rougemont, tandis qu’une autre charte, du 5 septembre 1531, enseigne que ceux de Rougemont devaient marcher à la guerre avec ceux de Gessenay, parce qu’ils étaient du ressort ou de la juridiction de ce lieu.
La contradiction entre ces deux chartes est plus apparente que réelle. La châtellenie, et même, dans un sens, le mandement n’était parfois qu’une division de la Bannière. Les deux châtellenies, ou les deux mandements de Rougemont et de Gessenay étaient deux divisions de la bannière du Vanel, tout comme la châtellenie de Gruyère et celle de la Tour étaient deux divisions de la bannière de /423/ Gruyère. Or, chaque bannière formant une juridiction dont la haute justice était attachée au principal manoir, il est évident que les causes civiles concernant la châtellenie de Rougemont devaient être portées devant le châtelain de cet endroit ou devant son lieutenant, et celles qui appartenaient à la châtellenie de Gessenay, devant le châtelain de ce lieu, tandis que l’appel en la cour suprême d’une sentence rendue par l’un de ces officiers et les causes criminelles entraînant le supplice ou quelque autre peine afflictive, devaient être portés à la cour du seigneur haut justicier, et l’exécution se faire au lieu de la justice, c’est-à-dire au Vanel. Le château de ce nom n’était plus qu’une ruine, mais de cette ruine même dépendait la haute justice. C’était là que, pour affaires criminelles, devait se tenir la cour de haute justice; c’était, comme on l’a dit, en la justice du Vanel que l’exécution devait se faire. Voyez ci-dessus, p. 377, l’acte qui, ce me semble, devait terminer un conflit entre les châtelains de Gessenay et de Rougemont.
III.
De l’otage.
On appelait ostage ou ostaige 1 une peine conventionnelle, très-commune au moyen-âge, peine que subissaient les débiteurs et les cautions des débiteurs infidèles à la promesse qu’ils avaient faite de rembourser ou de payer au terme fixé dans le contrat, la somme qu’on leur avait prêtée ou la dette qu’ils avaient contractée. Tout homme qui /424/ faisait une dette sous la condition de l’ostage, et qui ne la payait pas à l’échéance, devait se rendre en quelque lieu et y demeurer à ses frais, soit pendant plusieurs semaines, soit jusqu’au payement de la dette, suivant les termes de la convention.
On lit dans la grande charte de Fribourg (en Suisse), du 28 juin 1249:
« Si un bourgeois est tenu de faire otage à un autre bourgeois, et qu’il refuse de le faire, celui dont il est le débiteur peut le saisir ouvertement, sans préjudice. Si le débiteur qui doit se constituer otage est assez fort pour résister à son créancier qui veut l’arrêter, l’avoyé et la ville prêteront leur aide à ce dernier, afin qu’il puisse obliger son débiteur à remplir ses engagements 1 . »
Les chevaliers, les seigneurs, soumis à l’ostage, devaient se rendre avec une suite d’hommes et de chevaux, dans une auberge désignée par le créancier, et y demeurer à leurs frais. Comme la plupart des chevaliers et des seigneurs ne manquaient pas, en pareil cas, de faire bonne chère et de régaler les amis qui venaient les visiter 2 , l’ostage avait souvent pour résultat la diminution de leur fortune, sinon la ruine de leur famille, car l’ostage, c’est-à-dire la dépense à l’auberge, était à la charge des débiteurs. Ceux-ci étaient naturellement intéressés à s’acquitter au terme de payement et à éviter l’ostage, condition très-onéreuse, établie en faveur du créancier, qui y trouvait un moyen de les contraindre de payer. /425/
Suivant Grimm, le créancier devait pourvoir à l’entretien des ostagers 1 , ainsi que de leurs chevaux, et réparer le dommage qu’ils pouvaient éprouver au lieu qui leur servait de logement 2 . Cela ne nous paraît point probable: nous n’avons du moins trouvé rien de pareil dans nos chartes 3 .
Quelques exemples feront mieux connaître la coutume dont il s’agit.
Par acte de l’an 1210, Guy de Mont céde à la chartreuse d’Oujou ses droits sur diverses propriétés, telles que prés, /426/ pâturages, cours d’eau, terres cultivées, etc., dans les limites de la dite chartreuse, et reçoit, en retour, du prieur et des religieux, cinq cents sols, monnaie de Genève. Il garantit la cession qu’il a faite, s’engage à la faire respecter, et promet d’être le défenseur de la maison d’Oujon. De plus, il lui fournit des cautions, fideiussores, et des otages, ostagios, à savoir: Pierre de Bursinel, chevalier, Jean Fabre 1 , les trois frères de celui-ci, nommés Anselme, Nicod et Arduin, et vingt-huit autres personnes, en tout trente-trois cautions. Si Guy ou son héritier fait quelque tort au monastère d’Oujon, dit Bernard, évêque de Genève (dans le diocèse duquel était la dite chartreuse), tous ces fidéjusseurs seront tenus de faire ostage (facere ostagium) en tel lieu qui sera désigné par nous ou par notre successeur, pourvu qu’ils soient en sûreté, et jusqu’à ce que la maison d’Oujon soit entièrement satisfaite. Guy et les cautions ont juré cela; bien entendu, toutefois, que si quelque fidéjusseur vient à mourir en ostage, on ne pourra lui refuser la sépulture chrétienne; mais son héritier sera fidéjusseur à sa place et fera l’ostage. De même, si l’un des fidéjusseurs susdits veut aller en pèlerinage, ou entrer en religion, le prieur et les religieux d’Oujon ne pourront pas l’en empêcher 2 .
Dans un acte de donation de l’an 1244, passé par Béatrix, dame d’Aubonne, en faveur de la chartreuse d’Oujon, il est dit que, pour le cas où on fera quelque tort à Boson, qui doit payer quatre sols de cens annuel cédés par Béatrix à la prédite chartreuse, elle a établi fidéjusseur perpétuel, pour réparer le dommage, Guerric, seigneur d’Aubonne, et /427/ ses héritiers. Huit jours après qu’il en aura été requis par les religieux d’Oujon, Guerric devra réparer le dommage fait à Boson et à son héritier, au défaut de quoi le même Guerric ou son héritier tiendra l’ostage au château d’Aubonne, jusqu’à ce que le monastère d’Oujon ou le dit Boson aient obtenu complète réparation 1 .
En 1272, Jean de Mont, donzel, engage au monastère de Romainmotier l’avouerie de Morlens pour la somme de 15 L. lausannoises, et pour garants de l’hypothèque, il fournit au couvent deux fidéjusseurs, savoir Humbert de Trelay, chevalier, et Jaques, co-seigneur d’Aubonne, donzel. Ceux-ci s’engagent, sous la foi du serment, à se constituer otages (tenere ostagia) à leurs propres frais, à St-Prex, à la réquisition du prieur, si le dit Jean de Mont, ou quelque autre, de son aveu, portait préjudice au couvent 2 .
Une charte de l’an 1398, relative aux seigneurs de Gruyère, mérite d’être citée ici.
Rodolphe, comte de Gruyère, et son fils, Rodolphe de Gruyère, seigneur de Montsalvens et de Vaulgrenant, chevaliers, devaient la somme de 2000 fl. d’or d’Allemagne à Jaquet Barguin, marchand et bourgeois de Fribourg, où il avait son domicile. Noble Nicolas de Blonay, chevalier, leur servait de caution avec plusieurs autres personnes. Ce seigneur s’était constitué fidéjusseur, débiteur, vrai et légitime otage (obsidem), ayant, sur les saints Evangiles, juré, pour lui et ses héritiers, et sous obligation de tous ses biens présents et futurs, que pour le cas où la somme due à Jaquet /428/ Barguin ne serait pas remboursée au jour fixé à cet effet, dès lors, et dans les huit jours qui suivraient la première réquisition, soit verbale soit écrite, du dit créancier ou de ses héritiers, ou de l’un d’eux, lui, le dit Nicolas de Blonay, tiendrait l’ostage dans la ville de Fribourg, et l’observerait loyalement, dans la maison d’un hôte public, à ses propres frais et dépens, soit en personne, avec un écuyer (scutifero), un domestique (famulo) et trois chevaux, soit par un autre noble offrant les garanties désirables, et qui prendrait avec lui deux domestiques et trois chevaux. Le fidéjusseur ne devait point quitter l’auberge de Fribourg mais tenir fidèlement l’ostage jusqu’à ce que la somme due à Jaquet Barguin fût intégralement payée, avec intérêts, frais et dépens. Il fut convenu entre les parties contractantes que si au bout d’un mois d’ostage le créancier n’était pas payé, celui-ci ou ses ayant-droit, pourraient saisir la totalité des biens et des droits du fidéjusseur et en disposer à volonté, selon la coutume, jusqu’à extinction de la dette.
A leur tour, le comte de Gruyère et son fils passèrent un acte d’indemnité en faveur de Nicolas de Blonay, c’est-à-dire un recours auquel celui-ci avait droit, envers le comte de Gruyère et le seigneur de Montsalvens, pour la dette à laquelle il s’était obligé. De l’aveu du créancier, ils s’engagèrent solennellement, sur les saints Evangiles, à se constituer en personne otages à Fribourg, à la réquisition verbale ou écrite de Nicolas de Blonay, et aux conditions susdites, chacun d’eux avec un écuyer, un domestique et trois bons chevaux, ou à se faire remplacer convenablement. Ils promirent aussi de dédommager le seigneur de Blonay de tous /429/ frais et dépens, engageant à cet effet les biens de leur famille et du comté de Gruyère 1 .
Parfois le débiteur ou sa caution obtenait un délai. Ainsi, par exemple, en 1399, le comte de Gruyère et deux seigneurs de Langin, qui avaient cautionné le comte de Savoie pour une somme qu’il devait à la ville de Fribourg, ayant été requis de se constituer otages, demandèrent un sursis. Il leur fut accordé.
IV.
Le doyen d’Ogo.
On voit figurer dans un grand nombre de chartes relatives au comté de Gruyère, un fonctionnaire qui porte le titre de Decanus de Ogo. Ce décan était un doyen rural, dignitaire ecclésiastique, qui avait le droit d’inspecter les cures de campagne et le doyenné d’Ogo, une des divisions du diocèse de Lausanne. Le plus ancien que nous connaissions est Gérold, sacristain du chapitre de Lausanne, nommé doyen d’Ogo, dans une charte du 10 déc. ( IV Id. Dec.) 1250.
Cette date est importante. C’est au XIIIe siècle que furent institués les officiaux ecclésiastiques et les notaires impériaux ou royaux, chargés de recevoir les actes civils et de leur imprimer un caractère d’authenticité. Le doyen d’Ogo ne paraît dans nos chartes que pour assurer aux transactions plus de validité, pour donner aux contrats et à d’autres actes la publicité et l’authenticité que les notaires et /430/ les officiers publics sont aujourd’hui chargés de leur donner. Nous en trouvons la preuve dans la formule ordinaire des chartes confirmées par le doyen d’Ogo, et nous en citons de préférence une du XVIe siècle: Nos … decanus de Ogo … sigillum curie nostri decanatus his presentibus litteris duximus apponendum. Dat. 18 oct. 1533.
Dans la suite, le décanat d’Ogo ne fut plus qu’un office purement ecclésiastique, comme celui de la Val-Sainte.
« Ce dernier », écrivit en 1779 un notable de Charmey, « est le neuvième des 15 doyennés actuels du diocèse de Lausanne. Il comprend, outre le pays de Charmey, les paroisses de Serville (Scherwyl) ou de la Roche, de Pont-la-Ville, de Haute-ville-de-Corbières, de Villarvolar et de Bellegarde. Ordinairement le plus ancien curé est le doyen. C’est à lui que tous les ordres de la cour épiscopale sont adressés. Tous les ecclésiastiques du doyenné sont soumis à sa vigilance: ils doivent le regarder comme leur père spirituel, et lui faire part de tout ce qui concerne le for ecclésiastique intérieur et extérieur. C’est aussi chez lui que se tiennent les conférences établies pour que ceux qui ont le soin et la charge des âmes trouvent, parmi leurs confrères, des consolations et des avis sur toutes les matières qui concernent leur ministère et la direction des consciences. »
F.-C.-N. Blanc, Notices historiques sur le pays de Charmey. MS.
FIN DE L’INTRODUCTION.
ADDITIONS
Note (Addition relative à la page 280): La disposition dont il s’agit en cet endroit est consignée dans une charte beaucoup plus ancienne que le plaid de Romainmotier, qui en dérive, à savoir dans la charte de Fribourg en Brisgau, de l'an 1120, où on lit ce passage:
« Quicunque Friburc burgensis fuerit, volens inde recedere, rerum et corporis usque in medium Renum et per totum sui comitatus ambitum securum debet habere ducatum (saufconduit) domino conducere. » [retour]
Note (Addition relative au chap. VIII): Ce qui a été dit, au chap. VIII, de la transmission des fiefs dans les pays de la Bourgondie et des règles suivant lesquelles se partageaient les successions des hauts seigneurs, trouve un solide appui dans le savant mémoire de M. E. Mallet sur le pouvoir que la maison de Savoie a exercé dans Genève. Voy. Mém. et Doc. publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, I. VII, p. 197. Cp. p. 226. [retour]