ESSAI SUR L’ORIGINE ET LE DÉVELOPPEMENT DES LIBERTÉS DES WALDSTETTEN URI, SCHWYZ, UNTERWALDEN, JUSQU’A LEUR PREMIER ACTE DE SOUVERAINETÉ ET A L’ADMISSION DE LUCERNE DANS LEUR CONFÉDÉRATION, EN 1332.
PAR
J. J. HISELY
Docteur en Philosophie et Belles-Lettres, Professeur honoraire à l’Académie de Lausanne, Instituteur de Philologie latine au Gymnase cantonal, Membre correspondant de l’Institut Royal des Pays-Bas, etc.
”Quæ priores, nondum comperta, eloquentia percoluere, rerum fide tradentur. „
C. C. Tacitus.
ESSAI SUR L’ORIGINE ET LE DÉVELOPPEMENT DES LIBERTÉS DES WALDSTETTEN.
Nos chroniqueurs et nos annalistes ont raconté bien des choses que les écrivains postérieurs ont admises sans examen. A les entendre, les habitants des Waldstetten ou communes alpestres, c’est-à-dire, des vallées d’Uri, de Schwyz, d’Unterwalden et du pays de Hasli jouissaient de temps immémorial des droits de commune et de la liberté de se gouverner eux-mêmes ou d’élire leurs magistrats. Ainsi que les habitants des Waldstetten, disent-ils 1 , ceux du Hasli étaient gouvernés par un magistrat de leur choix, nommé Landamman, et recevaient de l’Empire un Régent chargé d’exercer le droit de glaive ou de haute juridiction, /2/ pour lequel ils payaient annuellement à l’Empire cinquante livres d’argent 2 . Ce qui au 13e siècle était vrai du Hasli, que l’Empire se réserva, ne l’était pas des Waldstetten.
Plusieurs chroniques font remonter à une époque très-reculée cette prétendue liberté des Waldstetten: quelques-unes en placent même l’origine au temps de l’Empereur Théodose I, ou de Théodose II; mais la plupart à l’an 829 de notre ère. Elles rapportent que vers ce temps, sous le règne de Louis-le-Pieux ou le Débonnaire, les Sarrasins ayant fait d’horribles dégâts en Italie et porté leurs armes dévastatrices jusqu’à Rome, les habitants d’Uri, de Schwyz, d’Unterwalden et du Hasli, appelés par le Pape Grégoire IV, volèrent à son secours et que, conduits par Guidon Pusterla, noble milanais, que Charlemagne avait créé Marquis 3 de Lombardie, titre inconnu jusqu’alors en Italie, ils sauvèrent Rome, défirent les Barbares dans une bataille et en purgèrent l’Italie 4 . Elles ajoutent que l’Empereur Louis, à la /3/ sollicitation du pape qui voulait récompenser les habitants des Waldstetten de leur généreux secours, leur accorda entre autres avantages, l’autonomie, c’est-à-dire le droit de se donner des lois, de régler la forme de leur /4/ gouvernement, de choisir leurs magistrats et de suivre leurs mœurs et coutumes; enfin, que Grégoire leur conféra le beau titre de Défenseurs de l’Eglise, titre qui fut confirmé, eu 1512, par Jules II 5 .
Ce soi-disant droit d’indépendance et de souveraineté, que des écrivains guidés par des préjugés, ont admis en principe et sans examen, que d’autres soutiennent obstinément, parce qu’il flatte l’orgueil national, et qu’il est plus commode d’admettre comme vrai ce que l’on a toujours dit que d’entreprendre et de poursuivre des recherches pénibles dans le dédale du moyen âge, ne repose cependant sur aucun fait avéré. Une foule de documents récemment découverts prouvent que cette prétendue liberté antique est une chimère. Avancer que l’origine de l’indépendance des Waldstetten se perd dans la nuit des temps, ou que de temps immémorial l’ensemble des vallées qui composent les cantons primitifs de la Suisse, était indépendant, choisissait ses magistrats, se donnait des lois, ne reconnaissait d’autre chef que l’Empereur, c’est méconnaître l’histoire primitive de notre patrie et ne tenir aucun compte des changements qu’amena la suite des siècles, ou les ignorer complètement. C’est une supposition purement gratuite, en faveur de /5/ laquelle ne milite aucun document, qui n’a pour elle aucune probabilité historique, et dont une connaissance quelque peu exacte du régime ou du système féodal démontre la fausseté. On ne peut supposer raisonnablement que les Waldstetten, qui faisaient partie de l’Empire germanique, aient échappé seules au régime féodal, qu’elles seules, parmi tant de contrées de l’Europe, n’en aient pas subi les conséquences.
Avant la chûte de l’Empire romain d’Occident, la partie septentrionale, c’est-à-dire la plus grande, de l’Helvétie, habitée par les Alemans, était soumise aux Francs; dans la partie du Jura demeuraient et gouvernaient les Bourguignons; l’Helvétie rhétique était dominée par les Goths. Au 6me siècle toute l’Helvétie reconnaissait la domination des Francs. Lors du partage de la monarchie franke sous les Mérovingiens, l’Helvétie échut à deux princes, dont l’un gouverna la partie alemannique, l’autre la partie bourguignone, appelée Petite-Bourgogne. Pepin les réunit, et Charlemagne ouvrit dans l’Helvétie des sources de prospérité. Après la chûte de la race carlovingienne (sous les faibles successeurs de Charlemagne), il se forma le royaume d’Arles (879) entre le Jura et le Rhône, et le royaume de Bourgogne entre la Reuss et le Jura. Trente ans plus tard les deux royaumes de Bourgogne n’en firent plus qu’un. Après la mort du dernier roi de Bourgogne, en 1032, l’Empereur Conrad II, le Salique, réunit l’Helvétie bourguignons à l’Helvétie alemannique, qui était déjà incorporée à l’Empire germanique. L’Empereur Henri IV, petit-fils de Conrad II, persécuté par le Pape Grégoire VII, voulant s’assurer de puissants partisans, donna l’Helvétie alemannique au duc de Zæringen, gouverneur impérial. En 1125, le Duc Conrad y ajouta l’Helvétie bourguignone, et les Ducs de Zæringen portèrent depuis le titre de Ducs de Zæringen et de /6/ Recteurs de la Bourgogne. A la mort du dernier, Berthold V, en 1218, l’Helvétie, après avoir été pendant cent vingt ans gouvernée par les Ducs de Zæringen, fut de nouveau incorporée à l’Empire germanique.
On connaît l’origine des fiefs de l’Europe et les causes de leur hérédité. « En Germanie, plusieurs circonstances ralentirent la marche et retardèrent les progrès du régime féodal. Aussi ne fut-ce que vers l’an 1024 que Conrad le Salique accorda à ses fidèles la transmission des fiefs des enfants du vassal à ses petits-enfants et que celui dont le frère serait mort sans enfants pût succéder à leur père commun 6 . »
L’hérédité des fiefs était déjà presque généralement établie sous le règne de l’Empereur Henri IV (1056-1106). L’Empereur dut reconnaître la perpétuité des grands fiefs pour assurer dans sa maison celle de sa couronne. L’hérédité des seigneuries s’établit aussi plus tard au profit des femmes. Les héritiers de plusieurs familles portèrent leur patrimoine dans des maisons étrangères. Ces fortunes accumulées formèrent de grandes masses qui devinrent dangereuses pour l’autorité royale. L’inégalité fut au comble lorsque par crainte ou par faveur les grands propriétaires joignirent à leur patrimoine de riches abbayes, des domaines du fisc, et même la puissance publique. Ces graces d’abord amovibles, devinrent bientôt perpétuelles, et élevèrent des maisons qui insensiblement devinrent les rivales du trône 7 . C’est ainsi que dans l’Helvétie, qui fut partagée en fiefs considérables qui devinrent héréditaires, il s’éleva de puissantes maisons, dont l’une occupa, en effet, le siége impérial.
Les grands feudataires, vassaux immédiats de l’Empire, /7/ représentant les propriétaires indépendants, avaient le droit de prononcer l’amende du ban royal, et la peine de mort, qui constituait le droit de haute justice. Ce droit, nécessairement émané du chef de l’Empire, devint héréditaire 8 . Il était exercé dans l’Argau, qui comprenait les Waldstetten, par un Comte, Landgraf, Comes provincialis 9 ou Landgravius, qui exerçait, dans toute l’étendue de la province confiée à son administration, le Landrecht 10 , droit de haute justice et de haute ou de grande police, ou de haute juridiction, dont la principale attribution était la peine de mort; et il exigeait l’hériban, — Heerbann, ban et arrière-ban, — c’est-à-dire qu’il convoquait les vassaux et les arrière-vassaux à la guerre. Il pouvait se faire remplacer ou représenter par un lieutenant, Locum Landgravii tenens, Substitut ou Officier de justice, ou vice-Landgrave, vice Landgravius, vicem Landgravii gerens, Landrichter 11 . /8/
Le Landgrave ou son Lieutenant appelait à ses plaids généraux, c’est-à-dire aux audiences ou assises provinciales, — publicus mallus 12 , Landgericht, — auxquels les hommes libres étaient tenus de se rendre où qu’il établît son siège dans le Comté, ou Landgrafschaft 13 .
Le Comte ou son Lieutenant, c’est-à-dire le Juge supérieur, allait aussi tenir des plaids solennels et extraordinaires dans les justices subalternes 14 . Il est dit d’une manière explicite qu’il exerçait les droits de Landgrave, ou le Landrecht, le pouvoir judiciaire, sur les hommes libres, super homines liberos 15 , c’est-à-dire sur ceux qui étaient liberæ conditionis et non pas servilis conditionis 16 . Ces derniers dépendaient de leurs Seigneurs, ou des Chevaliers qui, vu que le vasselage n’était pas une servitude, avaient le droit d’assister aux plaids généraux et d’y voter au moins par acclamation. Du reste, les chevaliers portaient leurs causes devant le Landgrave; ils devaient obtenir son consentement pour certains actes et les faire approuver ou sanctionner par lui 17 .
Le Landgrave était aussi Avoué suprême, supremus Advocatus, oberster Vogt, d’une grande église ou d’un /9/ monastère, dont l’abbé, ou celui à qui l’abbé vendait ou cédait ses droits, était le seigneur, Dominus, ou propriétaire foncier des domaines, des fermes et censes qui dépendaient de l’abbaye. Un diplome de 1210 contient ces mots: « Bertholdus dux Zaringiæ Dei et Imperatorum ac Regum dono Judex Constitutus et Advocatus quod vulgo Castvogte dicitur, id est, in omne Thurigum imperialem Jurisdictionem tenens 18 , » passage remarquable, qui prouve que le Landgrave (Judex) pouvait être en même temps Avoué (Advocatus), et que ces deux titres comprenaient tout le pouvoir commis par l’Empereur.
Il ne faut pas confondre deux dignités ou deux prérogatives bien distinctes, l’Avouerie impériale, Reichsvogtei, et l’Avouerie épiscopale ou ecclésiastique, Kastvogtei. L’avoué impérial était Vicaire de l’Empereur, et exerçait un grand pouvoir; l’avoué épiscopal ou ecclésiastique était l’avoué du prélat. Le premier de ces titres était supérieur au second. Il pouvait arriver que les deux dignités fussent réunies en la même personne, qui, en sa double qualité, jouissait d’un pouvoir fort étendu 19 . D’autres avoués étaient en sous-ordre.
Ainsi on distingue les Avoués, Advocati, Vœgte 20 , en avoués ecclésiastiques et avoués laïcs ou séculiers. Les premiers, nommés Advocati, Vœgte, Defensores, Schirmvœgte, très-souvent Castaldi, Kast- ou Kastenvœgte, et quelquefois Kirchenvœgte, étaient Avoués, Défenseurs ou Protecteurs des grandes églises et des abbayes21 , ils /10/ percevaient les revenus, surveillaient les droits, les franchises ou libertés, toute l’administration des chapitres, et exerçaient la juridiction civile sur les sujets de l’Eglise ou de l’Abbaye.
L’abbaye n’était pas bornée à n’avoir qu’un avoué. Si elle avait des biens considérables ou que plusieurs propriétés fussent mouvantes de cette abbaye, elle avait la faculté de les confier, à titre de fiefs, à plus d’un avoué. C’est ainsi que Rodolphe comte de Raprechtswile, ou Rapertswile, tenait, selon sa propre déclaration 22 , en fief de l’abbaye d’Einsiedeln ou de Notre-Dame-des-Ermites, toutes les avoueries (advocatias, Vogteien) des possessions de ce monastère situées au-delà du mont Etzel. Les maisons de Habsbourg et de Homberg, ou Hohenberg, héritières de celle de Raprechtswile, firent la même déclaration 23 .
La juridiction qu’exerçaient les avoués, tant laïcs qu’ecclésiastiques, ne pouvait être émanée que du Souverain 24 , /11/ qui était Chef de l’Empire et Advocatus Ecclesiæ, Avoué, protecteur et défenseur de l’Eglise. D’abord ce furent les empereurs, les rois, qui nommèrent les avoués, mais bientôt, à ce qu’il paraît, abandonnant ce droit aux abbayes, ils se contentèrent de les prendre sous leur protection immédiate; ce qui était d’autant plus nécessaire que les grands feudataires, après avoir assuré l’hérédité de leurs offices, étaient disposés à regarder les abbayes comme dépendant de leurs domaines. Quoiqu’il en soit, des fondateurs de couvents, ou leurs descendants, s’arrogèrent ce droit d’élection, et non-seulement eux, mais encore plusieurs avoués rendirent l’avouerie ou la Kastvogtie héréditaire dans leur famille. Ainsi firent Werner, évêque de Strasbourg, fondateur de Habsbourg, à l’égard de l’avouerie de Muri 25 ; Ulric, comte de Raprechtswile, avoué d’Einsiedeln, qui mourut en 1129, dont le fils Rodolphe occupa la même charge 26 ; Henri comte de Raprechtswile, qui la transmit à son frère le comte Rodolphe 27 ; Ulric comte de Lenzbourg qui, ne laissant pas d’enfant, fit passer l’avouerie de Beromunster à l’aîné de ses neveux 28 . Le droit héréditaire des avoués ecclésiastiques, de même que celui des /12/ autres feudataires, fut bientôt reconnu droit légitime 29 .
L’Avoué laïc ou séculier, Advocatus, Vogt, exerçait une autorité plus ou moins étendue, selon le territoire et la juridiction qui lui étaient confiés. Nous ne parlons pas du Reichsvogt ou Landvogt, qui remplaça le Landgraf, et auquel le Landrichter fut subordonné 30 , mais du Vogt (préfet ou bailli), subordonné au Landgrave et établi par lui, et que l’on distingue en Stadtvogt, Burgvogt, etc. Cet Avoué, Vogt, était non-seulement gouverneur, gardien, administrateur, agent chargé de percevoir les droits d’un seigneur, ou d’administrer les domaines des grands vassaux, mais encore il avait le Twing und Bann, c’est-à-dire, qu’institué par son suzerain le Landgrave, dont il tenait l’avouerie, Vogtei, en fief 31 , il en exerçait aussi les droits, nous voulons dire la haute juridiction 32 . Il avait chaque /13/ année trois plaids, Vogtgedinge, en Mai, à la St.-Martin et à la St.-Hilaire 33 .
Toutefois ce n’était pas le cas dans certaines contrées ou communes que l’Empire s’était réservées (reservata Imperii), qui, comme la commune pastorale du Hasli, ne reconnaissaient d’autre suzeraineté que celle de la Couronne.
Dans l’origine, l’Avoué laïc proprement dit était, comme nous l’avons fait observer, subordonné au Comte. Dans un diplome de l’an 888 paraît le Comte Eberhard, et avec lui Adalbert comme son avoué à Zurich 34 . Dans un autre diplome de l’an 1037 paraît un Eberhard, comte du Zurichgau, avec l’avoué Ulric 35 .
Les avoueries devinrent fiefs héréditaires, même au profit des femmes. Ainsi les chevaliers de Kussenach possédèrent jusqu’à l’extinction de leur maison l’avouerie de ce nom, qui, échue à un seigneur de Tottikon, passa par sa fille à son époux Henri de Hunwile 36 .
Dans l’acte de 1261, cité plus haut, Rodolphe comte de Raprechtswile déclare non-seulement qu’il possède, comme ses ancêtres, à titre de fiefs, de l’abbaye d’Einsiedeln, les avoueries des biens à elle appartenant au-delà du mont Etzel, mais encore qu’il les transmet, par les mains de l’abbé, à sa fille Elizabeth, afin qu’à sa mort elles lui soient dévolues à titre de fiefs 37 . /14/ Ces mêmes avoueries passèrent légitimement aux maisons de Habsbourg et de Homberg, héritières de celle de Raprechtswile, et échurent enfin toutes à la maison de Habsbourg lorsque celle de Homberg s’éteignit, vers l’an 1330. 38 Les avoués pouvaient même transmettre à leur tour, à titre de fiefs, ou plutôt à titre d’arrière-fiefs, d’arrière-avoueries, celles qu’on leur avait accordées 39 . /15/
Parmi les avoués dont nous avons parlé, il y avait celui que l’on nommait communément Schirmvogt, tout à la fois protecteur, défenseur, gouverneur d’un district, y exerçant la haute juridiction au nom du Comte provincial. Outre les droits qu’il exerçait sur le territoire qui lui était confié, il avait l’obligation de le défendre, de le protéger de son épée. Le Schirmvogt était en même temps seigneur terrier, propriétaire de droit ou de fait. L’hérédité de son office s’établit dans le même temps que celle des autres feudes et des autres fonctions.
Longtemps avant que la maison de Zæringen fût appelée à gouverner l’Helvétie, les comtes de Lenzbourg, qui avaient des propriétés dans les Waldstetten, étaient les Schirmvœgte, avoués, défenseurs de ces vallées. Au milieu du XIe siècle, Arnold comte de Lenzbourg, neveu et héritier du comte Ulric qui mourut en 1045, devint avoué, Kastvogt, de N. D. de Zurich, dont une partie d’Uri était mouvante, et de l’abbaye de Seckingen, dont dépendait le pays de Glarus 40 .
Comme toutes les avoueries devinrent héréditaires, que le premier Schirmvogt des Waldstetten dont il soit fait mention fut un comte de Lenzbourg, et que pendant l’existence de cette maison on ne rencontre pas un seul Schirmvogt des Vallées d’une autre famille, il faut nécessairement conclure de là que l’avouerie dite Schirmvogtei était héréditaire dans la maison de Lenzbourg. Nous verrons plus bas comment elle passa à la maison de Habsbourg. /16/
Les Avoués, tant ceux des abbayes que ceux des domaines séculiers, devaient se rendre aux plaids généraux du Comte provincial ou Landgrave, pour répondre aux plaintes que l’on pouvait porter contre eux, et que cet Officier était en droit d’instruire. Rarement ils restaient dans les bornes de leur pouvoir; tantôt ils voulaient plus de services qu’on ne leur en devait, tantôt ils exigeaient plus d’impôts qu’ils n’avaient le droit d’exiger, ou prononçaient une trop forte amende: toute leur étude était de se rendre puissants et de s’enrichir. Dans tout le moyen-âge on voit réclamer contre les exactions, les extorsions, les vexations des avoués et des sous-avoués 41 .
D’autres fonctions ou charges moins considérables que celle d’Avoué étaient confiées à des officiers ou employés subalternes, tels que le Meier, le Keller, le Pfleger, etc. Le Meier, ou maier, maior, maieur, maire, villicus (de /17/ villa) dans les chartes latines, dont l’office était un fief de l’abbaye, était établi sur une terre, ferme et cense, curtis, Hof, d’un seigneur direct ecclésiastique, ou d’une abbaye, en qualité de juge des droits seigneuriaux, pour exercer la basse juridiction au nom de son seigneur 42 . Les maires devinrent des feudataires assez importants pour former une classe de la noblesse 43 . Nous citerons pour exemples le chevalier Arnold maire de Silennon, Landamman d’Uri 44 , et Hartman, maire de Stans, chevalier, Landamman d’Unterwalden 45 .
Le Keller, ou Kelner 46 , cellerarius, cellérier, adjoint au maire, était proprement l’économe d’un monastère. Dans certains endroits il était plus que celà; car, outre qu’il administrait le domaine, il exerçait la basse juridiction au nom du seigneur qui l’avait établi. Ceci demande explication. Si les domaines d’une abbaye étaient assez considérables pour occuper et entretenir plusieurs employés, le seigneur y établissait un maire pour administrer les droits domaniaux, ou la justice, et un cellérier pour percevoir les rentes; le /18/ premier était sous-juge ou bas-justicier; le second, économe. C’est ainsi qu’il y avait à Kussenach, outre l’avoué (Vogt) un maire et un cellérier 47 . Si, au contraire, le domaine du monastère était trop peu considérable, le seigneur y établissait simplement un maire, comme à Silenen et à Stans 48 , ou un cellérier, comme à Sarnen, à Boswile 49 , ou un procureur, Pfleger, comme à Buchs. Dans ce cas, l’officier préposé à la régie des biens seigneuriaux exerçait les doubles fonctions de juge et d’intendant.
Quant au Pfleger, curator, procurateur ou procureur, qu’il ne faut pas confondre avec le Landpfleger ou procurator provinciæ, il était également chargé de percevoir les droits d’un seigneur laïc ou d’un seigneur ecclésiastique, et d’exercer en son nom la basse juridiction 50 .
Bien au-dessous du Landgrave ou du Landrichter, et même au-dessous de l’Avoué, était le Juge de commune, Judex 51 , minister 52 , nommé dans les chartes allemandes tantôt Amptman (Tschudi I, 336. Kopp p. 69, 135) ou Amtman, au pluriel Amptleute (Libert. Einsidl. noXXI, p. 109) et Amtleute (Kopp, p. 68), tantôt Anman (Kopp, p. 4), et Amman (ib. p. 36. 135), orthographe qui a prévalu, bien que celle d’Amptman ou d’Amtman soit la /19/ véritable. L’Amtman, ou, si l’on veut, l’Amman, subordonné à l’avoué, Vogt 53 , était simple fonctionnaire, Amt-man 54 , employé civil, ou juge de commune, exerçant la basse juridiction dans une ville, un bourg ou un village, Il y avait donc dans une vallée autant de juges ou ammans, amtleute, qu’il y avait de communes. On rencontre dans un document du 7 mars 1304 (Kopp, p. 65) un Thomas amman de Kegenswile (Kægiswil), dans d’autres un Niclaus amman de Wisserlon, un Rudolf amman de Sachselen (ibid. p. 68. 109), un Johannes amman de Wolfenschiess, un Niclaus amman de Niderwile (ibid. p. 68 cf. p. 2). Dans un acte /20/ publié à Schwyz le premier jour de 1282 (Tschudi I, 189), par lequel les hommes de Schwyz accordent à Conrad Hunnen l’acquisition d’un bien, il y a parmi les signataires ou témoins quatre ammans, probablement d’autant de communes ou de villages.
Lorsque, dans la suite, plusieurs communes se furent unies au lieu principal et qu’elles formèrent une confédération de ligues, une universalité (universitas) ou communauté (communitas), elles conservèrent chacune son amman ou juge communal et subalterne, mais la totalité de ces communes eut pour juge supérieur un Amman ou Juge de la Vallée, ou du pays, minister vallis, appelé Thalamman dans la vallée d’Urseren, et les habitants Tallute 55 (Thalleute, de Thalmann), ou Landamman 56 dans les vallées d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden, et les habitants Landlute (Landleute, de Landmann). Ce minister vallis était ministre, officier, sous-juge du seigneur suzerain.
Cet ordre de choses existait aussi dans d’autres parties de l’Helvétie. On rencontre, par exemple, les dix juges, Amtleute, de la partie des Grisons soumise au comte de Toggenbourg, qui, après le décès de ce maître, formèrent la ligue des dix juridictions avec un magistrat suprême ou Landamman.
Dans plusieurs chartes le Landamman est simplement /21/ nommé Amman, à une époque et dans des circonstances où l’on ne peut le confondre avec l’amman d’une commune ou d’un village 57 .
Une des prérogatives du Landgrave ou de son vicaire, qui exerçait la haute juridiction, était nécessairement de nommer les magistrats en sous-ordre 58 . C’était le seigneur suzerain et non le peuple qui conférait le pouvoir judiciaire. Les hommes des Vallées ne pouvaient élire le Landamman ou Minister Vallis, c’est-à-dire le Juge. Le Comte ou Seigneur ne conférait la charge d’Amman ou de Juge qu’à un homme de condition libre 59 , et s’il nommait un indigène, /22/ c’est-à-dire un habitant de la Vallée, à cet emploi, il pouvait y nommer également un étranger 60 . Ces points importants pour l’appréciation de l’ancien état politique des Waldstetten sont clairement prouvés par des documents authentiques.
Avant la fin du XIIIe siècle les Waldstetten ne formaient pas d’états relevant nûment de l’Empire; elles n’exerçaient pas les principaux droits de pays indépendants, elles ne géraient pas souverainement leurs affaires communales, elles n’avaient ni Landamman ni autre chef de leur choix. Les habitants de ces vallées n’avaient pas la puissance d’eux-mêmes. Il n’existait pas alors ce que nous appelons maintenant Cantons d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden. Voyons ce qu’étaient ces vallées.
URI.
Dans les recherches que nous entreprenons sur l’origine et la constitution politique des Vallées alpestres ou des Waldstetten, Uri mérite incontestablement le premier rang par son ancienneté 61 . En 853 Louis-le-Germanique, fondateur /23/ de l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich, dont ses deux filles Hildegarde et Berthe furent successivement abbesses, donna à cette abbaye le petit pays d’Uri avec les églises ou chapelles, les édifices publics et autres maisons isolées bâties sur les hauteurs 62 . Altorf, connu depuis 744 comme faisant partie de l’Allemanie 63 , fut sans doute compris dans cette donation 64 . Dans une charte de 857, en faveur du prêtre Berthold, sont nommées deux églises ou chapelles dans la vallée d’Uri, celles de Burglen et de Silenen, avec leurs serfs, les dîmes, les terres cultivées et les terres en friche 65 /24/
Le pays d’Uri ne s’agrandit qu’insensiblement de quelques autres communes, de la vallée de la Reuss, de celle d’Urseren, et ce n’est qu’au quinzième siècle qu’il acquit des droits sur la Léventine. Et bien qu’il soit le mieux entouré de montagnes, ses limites lui furent longtemps contestées (Kopp. p. 66). Ce n’est que bien tard que les districts qui en font actuellement partie purent se constituer en canton. Chaque commune, chaque métairie (curtis, hof) du pays d’Uri était mouvante d’un monastère ou d’un seigneur. L’abbaye de Zurich et le couvent de Wettingen y avaient des biens, des rentes et des sujets; les comtes de Raprechtswile ou Rapertswile (Raperti villa) y avaient des droits et des possessions. Le comte Henri de Raprechtswile, dit le Voyageur, qui, en 1227, fonda le monastère de Wettingen (Tschudi I, 120. 136), donna, en 1231, à ce couvent les droits, les propriétés, les rentes et les sujets (eigene Leute) qu’il avait dans le pays d’Uri: ceux qu’y possédaient ses frères Ulric et Rodolphe furent achetés par le couvent en 1290 (Tsch. I, 127. 199) qui ne les revendit à Uri qu’en 1362 (Tsch. I, 457).
Dans le pays d’Uri, où longtemps il n’y eut d’autre baron de l’Empire (Reichsfreie) que celui d’Attinghausen, on comptait, outre les nobles ou chevaliers, trois classes d’hommes, celles des serfs, des gens de Wettingen et des gens de l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich.
Au degré inférieur de cette échelle sociale étaient les serfs (mancipia, eigene Leute, Leibeigene), sujets d’un seigneur, avec les terres auxquelles ils étaient attachés, et dont le seigneur pouvait transférer la propriété par échange, par vente ou par donation.
Au second degré se trouvaient les gens appartenant au couvent de Wettingen. Ils jouissaient de certaines franchises dont les premiers étaient privés. D’après une charte /25/ de l’abbé Conrad, de l’an 1242 (Tsch. I, 136), ils payaient au couvent une rente annuelle selon leur propre estimation: ils pouvaient, selon l’ancien usage, hériter jusqu’au quatrième degré (ad quartam generationem), si le degré de parenté était plus éloigné, les biens devaient écheoir au couvent. Il leur était défendu de contracter un formariage, c’est-à-dire d’épouser une femme de moindre condition, de condition serve, ou une femme qui n’appartînt pas au couvent, à moins qu’elle ne fût libre: dans le cas contraire, l’enfant issu de ce mariage n’avait aucune part aux biens meubles ou immeubles du père; une moitié devenait propriété du couvent, l’autre tombait en partage aux héritiers du père. La promesse de l’abbé, de ne jamais les aliéner du couvent (pour les faire rentrer dans leur première condition), s’ils demeurent fidèles à leurs engagements, et la menace d’en expulser ceux qui par méchanceté se conduiront d’une manière reprochable, prouvent que ces gens du pays d’Uri, en passant de la domination d’un seigneur laïc à celle du couvent de Wettingen, éprouvaient un changement notable dans leur condition. Aussi est-il dit dans la charte qui nous fournit ces précieux détails, que les gens de ce fonds de terre considéraient comme un grand bien d’échapper à la domination séculière.
Le 29 avril 1290 le couvent de Wettingen fit l’acquisition d’autres gens, droits et propriétés d’Uri que lui céda, à prix d’argent, Elizabeth, veuve du comte de Homberg, et Dame de Raprechtswile (Tsch. I, 199), et déjà l’année suivante il les fit consorts et participants (consortes et participes) de tous les droits et priviléges que le fondateur de ce couvent avait accordés aux gens à lui appartenant; c’est-à-dire qu’il leur accorda la faculté d’acquérir des biens, etc. —
Les consorts et participants, consortes et participes, /26/ Genossen 66 , étaient ceux qui partageaient le sort, la condition et les droits d’une classe d’hommes qui jusqu’alors avaient été à leur égard d’une condition supérieure. En devenant participants ils obtenaient entre autres la faculté d’acquérir des biens en roture.
Ce qui réunissait les Genossen et constituait la base de leur droit, c’étaient les Allmende ou Gemeinmerch, Gemeinmerkli 67 , pâturages généraux, communaux ou communs, où chaque Genosse avait droit de pacage. Mais le mot Allmende a un sens plus étendu; car il comprend les alpes, c’est-à-dire, non-seulement les pâturages proprement dits, mais encore les eaux, les forêts, le gibier, les pêcheries 68 , en un mot, tout ce qui dans l’origine étant considéré comme bien sans propriétaire (vastitas cuilibet inviæ heremi — wuestlich, ap. Kopp, p. 58 et suiv.) devenait par celà même domaine impérial. Il résulte de ceci, que telle ou telle contrée de l’Helvétie étant devenue fief héréditaire, le /27/ seigneur, ou le domaine direct, dominium directum, ou celui qui exerçait de sa part les fonctions d’avoué, c’est-à-dire de Vogt ou de justicier, avait également sa part des Allmende, ce qu’on appelle le dominium utile (Voy. Docum. du 15 mai 1302. Kopp, p. 58). Mais le seigneur direct possédait outre cela du bien exclusif, particulier, séparé de celui des Genossen, dont il avait seul la jouissance, qu’il administrait lui-même, ou qu’il abandonnait aux Genossen, ou à d’autres, à titre de bail héréditaire (Erblehen). Tels étaient, par exemple, à Uri, et ailleurs, les Schweigen (prædia pascuaria) ou pâquis, pour l’entretien des vaches et les fromageries (Alpwirthschaft ou Sennerei); sur les fermes ou censes (Höfe, selhöfe, curtes) de Lucerne le sellant 69 , mense, ou revenu du seigneur, et le féage, l’héritage féodal ou hommagé (Dienstmanngut), principalement affecté à la solde des employés.
Naturellement le seigneur direct pouvait, comme le faisaient les Genossen, acquérir encore d’autres propriétés. C’est ainsi que le 6 février 1290, Arnold, chevalier, maire (miles, villicus) de Silenen, vendit à l’abbesse de Zurich deux fonds de terre (duo prædia) que son père lui avait donnés. Ces biens seigneuriaux étaient exempts de services (servitia) et de cens, c’est-à-dire que l’Avoué ou le Vogt ne pouvait imposer aux gens de ces terres ni taxe, ni corvée.
Il n’en était pas de même des autres biens que possédaient les Genossen. Ceux-ci, outre le cens obligatoire au seigneur direct, donnaient annuellement au Vogt 60 muids de grains, et chaque maison une poule. De plus, les gens de /28/ St-Règle 70 , du nombre desquels étaient ceux d’Uri, devaient le servir chacun avec une lance, ou comme il pouvait, satisfaire au droit de rese 71 , ou de chevauchée, dans le pays de la juridiction du Landgrave, dont l’avouerie était un attribut. Par là ils s’acquittaient du tribut personnel et du cens auquel ils étaient soumis, ou des redevances annuelles qui relevaient du fief 72 .
Le Couvent de Wettingen exerçait sur les gens à lui appartenant, titulo servitutis pertinentes, le jus servitutis et le jus patronatus, droit de servage et de patronage. Ces sujets passaient à une condition meilleure quand le couvent de Wettingen, les affranchissant de la servitude de ce monastère, les cédait avec le jus servitutis et le jus patronatus à l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich. Les hommes de la vallée d’Uri, sujets ou dépendants de l’abbaye de Zurich, jouissaient de privilèges plus considérables que ceux du couvent de Wettingen. Ils avaient l’administration générale de leurs affaires, ils étaient habiles à acquérir, à vendre (des immeubles), à donner, à passer des contrats, à assister aux plaids 73 , à tester. C’étaient là ces hommes libres, homines liberi, dont il est question dans plusieurs documents, qui /29/ composaient l’Vniversitas hominum vallis Uranie, ou l’vniversitas vallis vranie (docum. du 20 mai 1258. ap. Kopp, p. 11. 12) ou les homines vallis Vranie (pacte du 1er août 1291. ibid. p. 32).
Ces hommes dits de condition libre, Gemeindefreyen (Kopp, p. 29), homines libere conditionis dans un sens opposé à celui de servilis conditionis 74 , de servitude ou de servage, n’étaient cependant pas exempts de cens annuel, ni de tribut personnel, et ils n’avaient pas la puissance d’eux-mêmes. C’est pourquoi ils étaient aussi appelés liberi censarii freye Zinsleute 75 , « pflichtig mit Leib und Gut », c’est-à-dire, soumis au cens annuel et au tribut personnel.
La condition de ces hommes était supportable, vu qu’ils avaient bien des avantages sur ceux de Wettingen et plus encore sur ceux qui étaient sujets d’un seigneur laïc. Cependant, il y a loin de cette condition à l’état d’indépendance et de souveraineté. L’histoire authentique de ces temps-là ne connaît dans les Waldstetten point d’hommes dits libres qui n’eussent un seigneur, soit ecclésiastique, soit séculier; et bien qu’Uri fût fief immédiat de l’Empire 76 , ses habitants libres, dans le sens que nous venons d’expliquer, étaient, comme ceux d’autres parties de l’Helvétie, sous la juridiction du Landgrave 77 . Les Vallées alpestres ou Waldstetten n’avaient ni la haute juridiction 78 dans leurs limites, /30/ ni la faculté ou le droit de choisir leurs magistrats; partant, elles étaient privées des éléments qui constituent la souveraineté. Ce ne fut qu’en 1389 que le droit de haute justice ou droit de glaive 79 fut accordé à Uri.
Les hommes d’Uri de condition libre, mais soumis à des devoirs féodaux, et formant seuls l’vniversitas vranie, étaient aussi les seuls du pays qui eussent un sceau. Il pend à un document d’Uri du 18 nov. 1249: l’Urus ou le taureau de profil, et cette inscription SIGILLVM. VALLIS. VRANIE. 80 . Mais déjà au document du 20 mai 1258 (Kopp, p. 10-12), qui fait mention de l’vniversitas vallis vranie, et duquel il appert que la partie de cette vallée mouvant de l’abbaye de Zurich avait le droit de communauté, Gemeinderecht, ainsi que dans celui de 1291 et dans d’autres d’une date plus récente, le sceau présente l’Urus de face, et cette inscription: † S’. HOMINVM. VALLIS. VRANIE. Le sceau des actes d’alliance du 6 et du 7 mars 1353 (Tschudi I, 422. 425) a cette inscription nouvelle: S’. COMMVNITATIS. VALLIS. VRANIE, et après que tous les gens de la Vallée se furent rachetés des seigneurs dont ils dépendaient 81 , on fit graver, vers l’an 1480, un autre sceau avec cette inscription: SIGILLVM. TOTIVS. COMMVNITATIS. VRANIE. 82 . Ce changement de sceaux indique un /31/ changement progressif dans la condition sociale et politique des gens de la vallée ou des vallées d’Uri: il prouve que le nombre des hommes de condition libre s’augmenta peu-à-peu, que successivement les communes dépendantes de quelque seigneur s’affranchirent et se joignirent ou s’unirent aux communes déjà libérées, et qu’ensemble elles formèrent enfin une Communauté.
SCHWYZ.
De même que la vallée de Stans s’appelait d’abord Stannes (au pluriel), ainsi celle de Schwyz eut primitivement le nom de Suites, dont se formèrent par contraction Suits, Suitz, Switz, Swiz, Schwitz (par corruption Subriz), en latin Suitia et Suicia 83 . Maintenant on écrit Schwytz ou Schwyz. Nous nous conformons à l’usage.
Pendant longtemps Schwyz ne comprit qu’une faible partie de son territoire actuel. Il n’acquit Art, Steinen, Sattel que dans la seconde moitié du 13e siècle, et cette acquisition, ou plutôt cette réunion à l’ancien territoire de Schwyz, ne fut reconnue de l’Empereur que par lettre patente de 1310: la vallée de Wäggi et la Marche inférieure lui furent conquises par les Appenzellois, en 1405: cette nouvelle acquisition fut reconnue propriété de Schwyz par les ducs d’Autriche, dans la lettre de réconciliation ou de paix (Friedbrief) de 1412 84 . Küssenach, ou Küssnacht, lui échut en 1402 85 , Merlischachen, Pfeffikon, Wollrau, /32/ un peu plus tard; et Gersau, après s’être racheté, en 1390, des seigneurs de Moos à Lucerne, parvint bientôt de cet état d’indépendance à la souveraineté, que cette petite république conserva jusqu’en 1803 qu’elle fut réunie au canton de Schwyz.
Ces divers territoires, en accédant à la Confédération des communes schwyzoises, conservèrent chacun leur coutumier et leur amman. De là vient que le canton de Schwyz a formé jusqu’à nos jours un état d’éléments hétérogènes, composé d’autant de petites républiques qu’il compte de districts, dont chacun a son Landamman. Ces divers endroits étaient originairement des Höfe, curtes, fermes ou censes; et l’on qualifie même encore aujourd’hui de ce nom la partie du canton de Schwyz qui comprend les districts de Pfeffikon et de Wollrau.
Ce qu’on appela d’abord le village (villa Suites), et depuis le bourg de Schwyz, formait une commune dans une petite étendue de terrain; encore les limites que les pâtres de Schwyz s’étaient tracées, ou les pâturages qu’ils prétendaient avoir hérités de leurs ancêtres, leur furent-ils longtemps contestés par les religieux d’Einsiedeln, à qui l’Empereur avait cédé les Alpes environnantes comme un désert ou un bien sans propriétaire, dont il pouvait disposer à son gré. Cette disposition impériale et la longue querelle qui eut lieu au sujet de la délimitation, prouvent suffisamment que dans l’origine Schwyz ne formait pas un état constitué, indépendant, ou, pour mieux dire, relevant nûment de l’Empire, comme le prétend la tradition du pays, que Jean de Muller et d’autres, avant lui et après lui, ont adoptée sans examen, quoiqu’elle ne soit appuyée sur aucun fait positif 86 . Il se peut que les ancêtres du peuple de Schwyz, /33/ fraction des peuples venus du Nord en Italie, et expulsés de ce pays au 6e siècle, se soient réfugiés dans les montagnes et aient été les premiers habitants de la vallée de Schwyz; que, longtemps ignorés dans les gorges des Alpes, ils y aient vécu dans l’indépendance. Toutefois ce droit de premier occupant ne constituait nullement un état d’indépendance perpétuelle, à moins que les pâtres de Schwyz ne pussent exercer à l’égard du souverain qui se disait leur maître, le droit du plus fort et maintenir ainsi leur liberté primitive. Le chef de l’Empire, souverain de l’Helvétie, ne put voir en eux que des sujets: il ne put considérer le sol qu’ils habitaient que comme un territoire faisant partie du grand tout qui était sous la domination impériale, et soumis au régime féodal. Ce petit pays, devenu fief des comtes de Lenzbourg, demeura sous la domination et la protection (Schirmvogtei) de ces comtes, et, après l’extinction de cette maison, sur la fin du 12e siècle, passa, si non d’abord, du moins un peu plus tard, sous l’autorité des comtes de Habsbourg.
Dans le pays de Schwyz, ainsi que dans les autres vallées, il y avait outre les serfs (mancipia) les hommes de Schwyz, qui, dans les documents relatifs à la querelle de Schwyz et d’Einsiedeln, sont appelés cives de villa Suites 87 , cives /34/ de Suites 88 , et habitatores villæ Suites 89 , ou die Landlüte von Schwitz 90 . Ils avaient les mêmes devoirs à remplir, et jouissaient des mêmes avantages ou privilèges que les homines liberæ conditionis de la vallée d’Uri.
UNTERWALDEN.
Tschudi rapporte que le pays d’Unterwalden s’appelait autrefois pays de Stans 91 , qu’en 1150 ce pays, jusqu’alors uni, se divisa en deux parties, celles de la Vallée supérieure, Obwalden, et de la Vallée inférieure, Nidwalden, que chacune de ces vallées eut dès lors son gouvernement particulier, son tribunal, son conseil, tandis qu’auparavant le gouvernement siégeait à Stans, où était le Landrath, et où devaient se rendre les habitants du pays, excepté pour l’assemblée générale, Landsgemeinde, qui se tenait à Wisserlon; que dès cette séparation la vallée inférieure adopta un sceau particulier, Sigillum Universitatis hominum de Stans et in Buchs, et que la vallée supérieure, comme la plus peuplée, conserva le sceau général du pays, /35/ Sigillum Universitatis hominum de Stannes superioris et inferioris Vallis. - C’est ce sceau, que Tschudi a mal lu 92 , qui l’a induit en erreur.
Au temps dont parle notre annaliste, il n’y avait dans cette partie de l’Helvétie ni pays uni connu sous le nom de Stans ou d’Unterwalden, ni tribunal indépendant (Gerichte), ni Conseil (Rath ou Landrath), non plus que dans les vallées de Schwyz et d’Uri.
Ainsi que dans d’autres parties de l’Helvétie, il n’y eut d’abord dans chacune des deux vallées qui composent le pays d’Unterwalden, que des demeures éparses, puis des hameaux, des villages, ou des communes politiquement isolées, dont chacune avait un bas-justicier subordonné à l’avoué (Vogt), qui lui-même tenait sa charge du Landgrave. Quelques-unes dépendaient de seigneurs laïcs, d’autres de seigneurs ecclésiastiques, ou relevaient d’abbayes, mais toutes étaient soumises à la juridiction du Landgrave. Il faut se garder de prendre l’ensemble des districts et des communes qui compose ce que nous appelons aujourd’hui Canton d’Unterwalden, comme ayant formé jadis, avant le 14e siècle, une communauté, un pays uni, indépendant. Engelberg, par exemple, faisait partie de la juridiction du Zurichgau 93 , compris lui-même dans la province de Bourgogne; Stans relevait de Murbach-Lucerne; Sarnen, de Habsbourg; Buchs, d’Engelberg. En 1327 Lungeren n’appartenait encore positivement ni à l’une, ni à l’autre vallée d’Unterwalden 94 ; Alpenach et Hergiswyl ne s’unirent au /36/ pays d’Unterwalden que vers la fin du 14e siècle, le premier de ces villages en 1368, après s’être racheté de la seigneurie de Wolhusen, le second en 1378.
Le nom d’Unterwalden paraît pour la première fois dans une charte du mois de décembre de l’an 1240 95 , et le sceau général du pays ne se trouve à aucun document antérieur au pacte d’alliance du 1er août 1291 96 . La véritable inscription du sceau est celle-ci: S’. VNIVERSITATIS. HOMIN. VAL. DE. STANNES. ET. VALLIS. SVPERIORIS. , qui détruit l’assertion de Tschudi, en prouvant que ce qu’il a pris pour un seul pays appelé Stans, comprenait deux vallées, dont l’une nommée Stannes. Le nom de Stans, d’une date plus récente, s’est offert pour la première fois à l’infatigable savant, auquel nous devons la découverte et l’interprétation de tant de chartes précieuses, dans un document des archives de Schwyz, du 14 Mars 1366. L’inscription du sceau de cette charte est telle que l’a indiquée /37/ Tschudi: « Sigillum Universitatis hominum de Stans et in Buchs » 97 . Le sceau de l’acte de 1291 démontre d’une manière évidente qu’à la fin du 13e siècle, dans une circonstance critique, deux vallées s’unirent en une communauté, que nous appelons Unterwalden, et le sceau particulier de Stans prouve qu’elles se séparèrent de nouveau.
Une autre question importante, qui se rattache immédiatement à l’existence politique du pays que nous nommons Unterwalden, est celle de savoir si dans ce pays il n’y eut d’abord qu’un Landamman, ou s’il y en eut deux? Afin de faciliter la solution de ce problème historique, H. Kopp produit, p. 68 — 69, les extraits suivants de documents allemands qu’il a découverts et consultés:
1. « Le 7 mars 1304 Rodolphe d’Oedisried, chevalier, Landamman d’Unterwalden, appose le sceau à Sarnen. »
2. « Le 7 juillet 1315 les Amman Henri de Zuben, Nicolas de Wisserlon, et les hommes et la communauté d’Unterwalden, apposent à Stans leur sceau. »
3. « Le 13 août 1328 Pierre de Hunwile, chevalier, Landamman d’Unterwalden, scelle à Sarnen. »
4. « Le 22 août 1332 Rodolphe d’Oedisried, Landamman, et la généralité des hommes d’Unterwalden, et en particulier de Lungeren, scellent à Sarnen. »
5. « Le 30 septembre 1333 les Landamman (Wir die Landammanne) et la généralité des hommes d’Unterwalden appliquent le sceau commun de leur pays. »
6. « Le 30 novembre 1336 Hartman, maire de Stans, chevalier, Landamman d’Unterwalden, scelle à Stans. »
7. « Le 22 juin 1340 le Land-Amptman et la généralité des hommes d’Unterwalden en-deçà du Kernwald. »
8. « Le 24 février 1341 l’empereur Louis écrit aux /38/ hommes discrets … à l’Amman … et … à la généralité des hommes, à Unterwalden. »
9. « Le 15 février 1356 Ulrich de Wolfenschiess, Amman d’Unterwalden, scelle à Lucerne. »
10. « Le 14 mars 1366 les Landamman et la généralité des hommes du Haut- et du Bas-Unterwalden - apposent le sceau de leurs pays d’Obwald et de Nidwald. »
Ce dernier document est positif: il tranche nettement la question en ce qui concerne la condition politique des vallées d’Unterwalden dans la seconde moitié du 14e siècle; mais nous ne pouvons en tirer la conséquence que cette condition fut la même avant ou immédiatement après l’an 1291. Comme le Landamman remplaça l’avoué (Vogt), il faudrait savoir avant tout, combien il y avait primitivement d’avoués dans le pays d’Unterwalden. C’est ce que nous ignorons.
Le nº 2 des documents que nous venons de citer semble autoriser à croire qu’en 1315 le pays d’Unterwalden était divisé en deux parties ayant chacune leur Landamman particulier; toutefois il n’offre pas un argument concluant. Henri et Nicolas y sont appelés simplement Amman, et bien que ce nom soit employé fréquemment pour celui de Landamman, il est d’autant moins certain que ce soit le cas ici, que dans un document du 1er mai 1315 Nicolas est appelé Amman de Wisserlon 98 . A moins de prétendre, ce que l’on ne saurait prouver, que d’Amman au mois de mai, Nicolas était devenu Landamman un peu plus tard 99 , nous /39/ pouvons admettre, comme probable, que lui et Henri étaient tous deux simples Amman, l’un de Wisserlon, l’autre de Zuben. Mais encore, dans cette supposition, on demandera si c’est en qualité de simples amman que ces deux hommes scellent un acte concernant la communauté d’Unterwalden? Nous ne pouvons donner d’autre réponse que celle-ci, c’est qu’il paraît résulter d’un acte de 1350, qu’en l’absence ou à défaut du Landamman, c’était l’amman du lieu principal, ou un autre qui, conjointement avec le conseil, avait la direction des affaires 100 .
Le nº 5 offre des difficultés qu’il est difficile de résoudre. S’il semble confirmer l’opinion qui admettrait que vers l’an 1333 le pays d’Unterwalden eut deux Landamman, les nos suivants la repoussent. En considérant comme véritable ce fragment de document du 30 sept. 1333, que M. Kopp a tiré de la feuille hebdomadaire (Wochenblatt) de Luthy, mais dont l’exactitude lui paraît douteuse (p. 69), on demandera pourquoi ceux de 1336, 1341, 1356 font mention d’un seul Landamman? Si la séparation politique des deux vallées avait déjà lieu vers cette époque, comme le document du 22 juin de 1340 (nº 7) permet de le croire, il faut admettre de deux choses l’une, ou que dans les documents de 1336, 1341, 1356 il n’est question que de l’une des deux vallées d’Unterwalden, par conséquent, que chacune avait à cette époque son Landamman particulier, ou que, dans ces documents, il s’agit d’intérêts communs, généraux, concernant les deux vallées, au nom desquelles scellait un /40/ Landamman, parce que les deux vallées n’étaient considérées par le chef de l’Empire que comme un seul pays.
Mais, ne perdons pas de vue qu’il y avait des temps ou l’une ou l’autre vallée se trouvait sans Landamman, et qu’un ou plusieurs ammans géraient les affaires avec la Landsgemeinde 101 ; ce qui peut avoir été le cas dans le pays d’Unterwalden, en 1333. D’après celà les mots du document de cette année: Wir die Landammanne, qui ont porté M. Kopp à douter de l’authenticité de ce document, signifieraient: « Nous les Ammans du pays », et n’offriraient plus aucune difficulté. Cette interprétation nous paraît la seule admissible.
Diverses autres considérations militent en faveur de l’opinion qui n’admet qu’un Landamman d’Unterwalden avant le milieu du 14e siècle: 1o l’absence de documents indiquant pour la même année deux Landamman, l’un de la vallée supérieure, l’autre de la vallée inférieure; 2oque le Landamman désigné dans ces chartes est appelé Landamman zu et von, c’est-à-dire du pays d’Unterwalden; 3o que, à l’exception des chartes du 30 nov. 1336 et du 15 fév. 1356 -, dont la première fut scellée à Stans par le maire de cet endroit, officier de Lucerne, qui y avait des droits, et la seconde à Lucerne même, sans doute parce que, de même qu’en 1244 - 1252 (v. Kopp, p. 3), Stans, qui relevait de Murbach-Lucerne, n’ayant pas de sceau particulier, faisait apposer à ses actes celui de l’abbaye dont il était mouvant -, à l’exception, dis-je, de ces deux documents, tous les autres cités ci-dessus, scellés à Stans, ont, à partir du pacte du 1er août 1291, le millésime impair, et ceux qui furent scellés à Sarnen, le millésime pair; d’où il résulte, ce nous semble, /41/ qu’il faut admettre jusque vers le milieu du 14e siècle la réunion de ces deux vallées, et par conséquent un seul Landamman, qui résidait alternativement à Stans et à Sarnen, ou, ce qui revient au même, que le Landamman de certaine année était élu parmi les hommes de la vallée inférieure et résidait à Stans, et que celui de l’année suivante, choisi parmi les habitants de la vallée supérieure, siégeait à Sarnen.
La convention qui eut lieu le 8 février 1350 aux fins de terminer le différend qui existait entre Schwyz et Notre-Dame-des-Ermites au sujet des limites, et qui fut scellée par Schwyz, n’admet qu’un Landamman pour chacune des Waldstetten ou chaque canton signataire de l’acte 102 . Le pacte de confédération avec Berne, du 7 mars 1353, ne permet d’admettre pour chacune des Waldstetten qu’un Landamman, et, comme nous l’avons déjà dit, prévoit, ainsi que la convention de 1350, le cas où il n’y aurait pas de (Land) Amman 103 : ce qui porterait à croire que même /42/ à cette époque chaque Vallée n’avait qu’un seul Landamman, si l’on ne savait d’ailleurs que dans des circonstances où il s’agissait d’intérêts communs ou généraux les différentes portions d’une des Waldstetten, et par conséquent les deux vallées d’Unterwalden, étaient considérées comme un seul pays 104 .
Nous pensons que comme longtemps Stans et Sarnen n’eurent pas de sceau particulier, les actes privés de Stans furent munis du sceau de Murbach-Lucerne 105 , ceux de Sarnen, du sceau du cellérier de Habsbourg. En admettant pour certain que vers la fin de la première moitié du 14e siècle les deux vallées d’Unterwalden se séparèrent politiquement, que dès lors elles eurent chacune un Landamman et un sceau particulier, on est obligé d’admettre que le sceau que porte le pacte du 1er août 1291, S’. VNIVERSITATIS. HOMIN. DE. STANNES. ET. VALLIS. SVPERIORIS. , le premier qu’eut le pays, demeura sceau général ou commun pour toutes les affaires qui concernèrent les deux vallées, ou auxquelles l’une et l’autre furent intéressées. Tels sont les actes du 1er août 1291, du 9 déc. 1315 (traité de Brunnen, Tschudi I, 277), du 7 nov. 1332 (acte d’association avec Lucerne, Tschudi I, p. 325, suiv.), du 30 sept. 1333 (Kopp, p. 68. 69), du 8 févr. 1350 (intervention des Waldstetten dans les démêlés de Schwyz avec Einsiedeln), du 7 mars 1353 (acte de confédération avec /43/ Berne, Tschudi I, 422—425). Dans tous ces actes les deux vallées d’Unterwalden durent être considérées comme ne formant qu’un seul pays, représenté par un seul Landamman.
M. Kopp (p. 67—69) après avoir fait l’observation très-juste, que le sceau commun d’Unterwalden appliqué au pacte du 1er août 1291 prouve que vers la fin du 13e siècle deux vallées s’unirent en une communauté que nous appelons Unterwalden, et après avoir soulevé cette importante question, si le pays d’Unterwalden eut d’abord un, ou deux Landamman, accompagne les fragments de chartes que nous avons rapportés des réflexions suivantes: « On serait tenté de croire qu’après que les trois Vallées ou Waldstetten eurent obtenu dans leurs limites la juridiction, qui leur échut en vertu de la charte de l’Empereur Louis, du 5 mai 1324, et qu’elles se réservèrent expressément dans l’acte de confédération avec Lucerne, du 7 nov. 1332, ceux qui d’abord avaient travaillé à la réunion des deux parties d’Unterwalden, en favorisèrent aussi la séparation. Un document du 4 juillet 1327 dit de Lungeren qu’il est dans les Vallées d’Unterwalden (in Vallibus Underwalden 106 ), mais bientôt nous rencontrons çà et là des expressions qui indiquent une séparation, telles que: « Unterwald disent dem Kernwald » — en-deçà du Kernwald —, « ob dem Kernwald » — au-delà du Kernwald —, et « ietwedernthalb dem Kernwald » — des deux côtés du Kernwald: chartes du 22 juin 1340, du 12 oct. 1351, et du 4 juin 1352: Tschudi I, 366, 400 et 407. » M. Kopp conclut que le pays se séparant en deux, ainsi que son gouvernement, marcha, vers le milieu du 14e siècle, à l’état politique que nous voyons nettement tracé dans la charte du 14 mars 1366. /44/
Plusieurs seigneurs laïcs et ecclésiastiques avaient des droits, des biens et des sujets dans les Waldstetten. Nous avons vu que la vallée d’Uri était, pour ainsi dire, partagée entre l’abbesse de Notre-Dame-de-Zurich, l’abbé de Wettingen et les comtes de Raprechtswile.
De temps immémorial les comtes de Lenzbourg avaient dans les autres vallées de Schwyz et d’Unterwalden des droits et des possessions considérables. L’abbaye de Beromunster, en Argau, fondée en 850, dont les comtes de Lenzbourg étaient avoués héréditaires, avait des droits et des sujets, mancipia, à Sarnen, Alpenach, Kerns, Art, Kussenach 107 , etc.; celle de Muri, aussi en Argau, fondée en 1018, dont l’avouerie (Kastvogtei) était héréditaire dans la maison de Habsbourg 108 , en avait également dans les vallées de Schwyz et d’Unterwalden 109 . L’abbaye d’Engelberg, fondée en 1083, avait des droits à Buchs, à Stans, à Schwyz 110 . Le monastère de Lucerne, fondé en 615, avait aussi des droits et des possessions à Stans 111 , ainsi qu’à Kussenach, /45/ Alpenach, Sarnen, Gyswyl, en vertu de la donation de certain Réchon, qui fut dans la suite abbé de Lucerne 112 .
Il n’y a là rien d’étonnant, si l’on considère qu’en Helvétie, ainsi que dans d’autres pays, où s’élevèrent successivement des châteaux et des monastères, dont dépendirent les terres environnantes, les fermes, les hameaux, les villages et les gens y appartenant, il se forma deux sortes de seigneuries, les seigneuries laïques et les seigneuries ecclésiastiques; que les évêchés, les abbayes, ainsi que les comtés et les baronnies, se composaient de terres, de métairies ou fermes et censes (curtes, Höfe) et de hameaux ou de villes (villæ. Voy. p. 34. n. 90), qui étaient soumis aux lois de la féodalité. De même que les comtes étaient non-seulement officiers militaires, mais encore fonctionnaires civils, ainsi les évêques, les abbés étaient magistrats civils autant que docteurs religieux. Les uns et les autres avaient des fiefs et exerçaient une juridiction très-considérable.
Après le décès d’Ulrich IX, dernier comte de la branche aînée de Lenzbourg, qui mourut sans lignée, en 1172, après avoir fait au chef de l’Empire, dont il était l’ami et le frère d’armes, une donation générale de ses fiefs et de ses domaines patrimoniaux, l’empereur Frédéric Ier transmit à son fils Otton, outre le titre de comte palatin de la Haute-Bourgogne (Franche-comté), le fief du comté de Rore, que les comtes de Lenzbourg, à qui le comté de Baden avait également appartenu en toute suzeraineté 113 , et prit sous sa protection spéciale l’abbaye de Munster en Argau avec ses dépendances dans les Waldstetten. /46/
La branche cadette de la maison de Lenzbourg, celle des comtes de Baden (qui portent aussi souvent le nom de Lenzbourg) exerçait depuis 1138 l’avouerie (Kastvogtei, præfectura) de la ville de Zurich et de ses deux monastères de N. D. de Zurich et de St. Felix et de Regula, ou du comitat, comté ou territoire de Zurich (comitatus Turicensis, Zurichgau) dont dépendait une partie des Waldstetten, notamment Engelberg 114 . Ce comté de Zurich était compris dans la Bourgogne Transjurane, dont le duc de Zæringen était Duc, Primat ou Recteur en même temps qu’Avoué impérial (Reichsvogt) de Zurich, c’est-à-dire Vicaire ou Lieutenant de l’Empereur 115 . Le comte Werner de Baden, le premier de cette maison qui fut fait avoué (Kastvogt) de Zurich, paraît en cette qualité dans un document de 1145 116 . Il transmit son nouvel office à son frère Arnulf ou Arnold 117 (VIII), dernier comte de Baden, qui mourut la même année qu’Ulrich de Lenzbourg, laissant pour unique héritière de ses biens sa sœur Richenza, femme d’Hartmann de Kibourg, landgrave du Thurgau 118 . Mais la charge d’avoué ou de kastvogt de Zurich et de ses deux monastères, qu’il avait exercée, échut à Adalbert ou Albert Ier de Habsbourg, landgrave d’Alsace, depuis surnommé le Riche, qui obtint /47/ aussi l’avouerie de Seckingen 119 , qu’avait eue Otton 120 , comte palatin de Bourgogne, et dont le pays de Glarus était mouvant. Rodolphe Ier de Habsbourg, dit l’Ancien et le /48/ Paisible, fils d’Albert Ier, et son successeur au comté de Habsbourg comme au landgraviat d’Alsace, reçut l’avouerie de Seckingen, dont avait été investi son père (doc. de 1207 ap. Herrg. et J. de Muller I, 397, suiv, et n. 229), et l’Argau, avec le comté de Rore (J. de Muller I, 400—401), outre qu’il avait l’avouerie de Murbach 121 . Il eut ainsi le droit de haute juridiction sur les Waldstetten et sur Lucerne, mouvant de Murbach. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’en 1209 ce comte Rodolphe de Habsbourg, aïeul de celui qui parvint à la dignité impériale, fut nommé par le roi Otton IV Reichsvogt des Waldstetten, c’est-à-dire, seulement des vallées de Schwyz et d’Unterwalden; car, comme à cette époque le duc de Zæringen était Avoué impérial (Judex ou Landrichter) héréditaire du comté de Zurich, de la ville et de ses deux monastères 122 , dont relevait le pays d’Uri, il doit avoir exercé dans cette partie des Waldstetten la juridiction qu’y exerça depuis l’extinction de cette maison le comte de Habsbourg landgrave d’Alsace et de l’Argau. L’Abbaye y avait de son côté ses avoués ou ses maires pour y administrer ses droits et ses propriétés. Tschudi, qui, T. I, p. 87, dit sans fondement qu’après la mort du dernier comte de Lenzbourg les trois Waldstetten ne prirent ou ne se donnèrent pas de Schirmvogt 123 , et quelles se gouvernèrent longtemps elles-mêmes, a également tort de dire, T. I. p. 107, que l’empereur Otton IV leur imposa comme Landvogt Rodolphe de Habsbourg qui sollicitait cette charge; que les habitants de ces vallées, après l’avoir refusé opiniâtrément parce qu’ils étaient libres, finirent par l’accepter; que déjà auparavant ceux d’Unterwalden, où il /49/ avait des droits et des possessions, l’avaient élu Schirmvogt ou Protecteur 124 . Il appert d’une charte du comte Rodolphe, du 12 juin 1217, qu’il était de droit héréditaire préexistant Avoué légitime et Protecteur des gens de Schwyz 125 . S’il en eût été autrement, ceux d’Einsiedeln, d’une part, et ceux de Schwyz, de l’autre, qui vivaient en guerre au sujet des Alpes depuis si longtemps contestées, et qui portèrent leur affaire devant lui, après l’avoir choisi pour arbitre de leur querelle, lui auraient contesté un titre usurpé, dont l’emploi, dans un acte de cette importance, eut suffi pour annuller le jugement qu’il porta. — L’éditeur de la Libertas Einsidlensis, doc. p. 67. not. b. , tranche la difficulté en disant qu’alors ceux de Schwyz étaient libres et qu’ils n’étaient en aucune manière sujets de Habsbourg; opinion dictée par le préjugé, et que Muller a adoptée.
Partageant, à l’égard de l’ancienne condition politique des Waldstetten, l’erreur de ses devanciers, cet écrivain dit, T. I, p. 434. n. 56. , que Rodolphe, qui se dit de droit héréditaire légitime avoué de Schwyz, prétendait à ce droit en vertu de la succession de la maison de Lenzbourg 126 . /50/
Ainsi il reconnaît que la maison de Habsbourg hérita de celle de Lenzbourg, mais, niant que l’avouerie pût passer par la ligne féminine à la maison de Habsbourg, il oublie que l’hérédité des droits féodaux s’était établie au profit des femmes 127 . Supposé que cette hérédité ne fût pas encore établie, les fiefs qu’avait possédés ou dont avait été investie la maison de Lenzbourg, échéant à l’Empire à l’extinction de cette maison, l’Empereur pouvait en disposer en faveur de qui il voulait. Ce n’était pas une vaine formalité que l’ordonnance qui exigeait que tout successeur d’un grand feudataire demandât au suzerain l’inféodation des offices qu’avait eus son prédécesseur, qu’il lui rendît foi et hommage, et qu’à l’avénement d’un nouvel empereur chaque grand vassal en fît de même. C’était reconnaître au chef de l’Empire le droit d’investiture. Aussi voyons-nous Frédéric Ier investir son fils du landgraviat de l’Argau, et Otton IV le confier à l’héritier d’une partie des biens féodaux de la maison de Lenzbourg, au comte de Habsbourg, qui dès lors était de droit et de fait landgrave d’Argau et avoué de Schwyz. Ce ne fut pas la seule fois qu’un Empereur ôta cette dignité à un comte de Habsbourg. Nous en dirons les raisons plus tard. Jean de Muller, voulant montrer l’injustice des prétentions du comte Rodolphe de Habsbourg, emploie un autre argument, qui paraît plus puissant que le premier: « Ce qui est bien plus fort », dit-il, « c’est que, même à l’apogée du pouvoir, le roi Rodolphe, petit-fils du comte que nous venons de nommer, n’a point prétendu à une telle avouerie héréditaire, et que, lorsque l’acharnement de l’Autriche contre la Suisse fut au comble, les ducs /51/ de cette maison n’ont jamais revendiqué ce droit d’hérédité. » Mais ici, comme en plusieurs endroits, Muller s’est trompé.
D’abord, le roi Rodolphe écrit à ceux de Schwyz, en date du 19 févr. 1291. « Nous ne jugeons pas convenable que l’on vous donne pour Juge (ou Amman) un homme de condition serve » 128 . Or, si la nomination, l’élection d’un simple amman n’était pas de leur compétence, de quel droit auraient-ils nommé l’Avoué (Schirmvogt), ou le Comte provincial (Landgraf)? Ensuite, ce même souverain dit dans une lettre 129 : « Nous faisons connaître à nos féaux tous ceux de la vallée de Schwyz, que notre bon plaisir est, qu’au sujet de toute contestation qui s’élèvera entre eux, de quelque nature qu’elle soit, ils aient à s’adresser à nous, ou à nos fils 130 , ou au Juge de la Vallée /52/ (Landamman), vu qu’ils ne peuvent ni ne doivent paraître devant aucun autre hors de la Vallée. »
Puis — sans nous arrêter à Albert —, le 27 juillet 1324 le prince qu’on présumait devoir être élu roi des Romains ou que l’on destinait pour successeur à Fréderic d’Autriche et à Louis de Bavière, dont le pape Innocent XXII avait, par sa bulle du 9 oct. 1323, cassé les élections, donna à Léopold duc d’Autriche l’assurance qu’il le mettrait en possession des deux vallées de Schwyz et d’Unterwalden, ainsi que des propriétés et des droits que le dit duc déclarait appartenir de droit héréditaire à lui et à ses frères les ducs d’Autriche, et qu’il soutiendrait Léopold dans cette possession 131 . Ce qui, selon la remarque judicieuse de M. Kopp, semble prouver que les ducs n’élevaient pas d’injustes prétentions sur les vallées de Schwyz et d’Unterwalden, c’est le silence qu’ils observent à l’égard d’Uri, qui, mouvant de l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich, et, dès l’origine, fief immédiat de l’Empire, était encore à cette époque (1324) considéré comme tel.
Et lorsque, le 10 févr. 1326, le roi Frédéric III le Bel, donna en fiefs à ses frères entre autres la vallée d’Uri, « Item vallem in Vre », il ne dit mot de Schwyz et d’Unterwalden, sans doute parce qu’il considérait ces deux vallées comme appartenant depuis longtemps à sa maison et jugeait qu’il était inutile de le répéter.
Le 11 oct. 1395 un autre duc Léopold parle de « ses ennemis ceux de Schwyz et leurs confédérés, qui lui doivent /53/ hommage et soumission, et qui se sont révoltés contre lui, leur seigneur légitime » 132 .
Jean de Winterthur 133 , contemporain de Léopold I qui fat défait à Morgarten, parle de « certaine gent rustique, habitant les vallées de Swyz, environnée de hautes montagnes qui lui servent de remparts, qui s’est soustraite à l’obéissance et aux services dus au duc Léopold, et s’est préparée à lui résister. »
Et Justinger 134 , écrivain suisse de la première moitié du 15e siècle, parlant de la bataille de Morgarten, avoue que « la cause des guerres avec l’Autriche fut l’insurrection de ceux de Switz et d’Unterwalden, qui, dit-on 135 , appartenaient à un seigneur de Habspurg, comme Ure dépendait de l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich. »
Melchior Russ 136 , secrétaire de Lucerne, chroniqueur de la fin du 15e siècle, dit la même chose. Si ce qu’a dit Justinger des causes de la guerre des Waldstetten avec l’Autriche n’était qu’une invention, Russ se serait gardé de le répéter à Lucerne, qui en tout point s’était conduit comme les trois autres Waldstetten. Rappeler des prétentions non fondées de la maison de Habsbourg-Autriche sur /54/ les Vallées, c’eût été donner des armes aux ducs de cette maison et commettre un crime de haute trahison. Quel est celui de nos annalistes qui eût osé commettre un tel délit et s’exposer ainsi à une mort certaine?
Il paraît donc bien établi que la maison de Habsbourg, dite plus tard maison de Habsbourg-Autriche, ou simplement maison d’Autriche, avait des droits domaniaux dans les vallées de Schwyz et d’Unterwalden, et que Rodolphe Ier l’Ancien et le Paisible, comte de Habsbourg et landgrave d’Alsace, fut, non imposé comme avoué aux Waldstetten, mais rétabli dans les droits de sa maison, à laquelle ils étaient dévolus de celle de Lenzbourg par alliance, ou qu’il en avait du moins reçu l’investiture. Ce Rodolphe ne fut pas simple Schirmvogt des Vallées, mais landgrave, gouverneur impérial; dignité à laquelle il fut élevé par Otton IV; de manière que sa juridiction s’étendait aussi sur le pays d’Uri, bien qu’il n’y eût pas de propriétés. Les documents que nous aurons l’occasion de citer prouvent que telle fut en effet la charge que lui confia l’Empereur, et qu’elle fut réellement héréditaire dans sa famille.
Indépendamment des preuves que fournissent ces documents, nous trouvons dans Guilliman (écrivain de la seconde moitié du 16e siècle, qui parfois donne sur l’histoire primitive de la Confédération des renseignements curieux qu’il ne peut avoir puisés qu’à de bonnes sources) sur les attributions de la charge de Rodolphe Ier, élu par Otton IV, un passage intéressant, auquel les documents cités ci-dessus peuvent servir de commentaires: « Otton (IV), voulant se rendre en Italie » (sur la fin de 1209, pour se faire couronner par Innocent III) « donna aux communautés d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden, et même à toute la Haute-Allemagne, Rodolphe, en qualité de Vicaire impérial ou d’Avoué provincial, et lui commit les régales, et /55/ le droit du fisc, tels que impôts, tributs, péages, amendes, et il enjoignit en même temps à la noblesse voisine d’obéir, en son absence, au comte de Habsbourg son lieutenant, et de lui donner aide et secours contre ceux qui causeraient du trouble et méconnaîtraient son autorité » 137 .
Ce Rodolphe, comte de Habsbourg, depuis 1199, landgrave d’Alsace, Kastvogt (castaldus) de l’Abbaye de Murbach, ainsi que de Lucerne mouvant de cette abbaye, Schirmvogt des vallées de Schwyz et d’Unterwalden, et landgrave de l’Argau 138 , depuis 1209, augmenta ses possessions de la ville de Lauffenbourg. Après sa mort, arrivée en 1232, ses deux fils Albert et Rodolphe se partagèrent sa succession. Il résulte du pacte de famille, de 1239 (Herrg. II, 255), et d’un autre diplome, du 10 fév. 1256 (Herrg. II, 324), mais surtout de deux documents du 6 août 1256 et du 22. fév. 1257 (Kopp, p. 7. 9.) que la branche aînée (das ältere Haus) de Habsbourg, administrait le Landgraviat, c’est-à-dire exerçait les droits de landgrave de l’Argau. Il se pouvait que les comtes de la branche cadette (die jüngern Habsburger) fussent propriétaires, celà n’empêchait pas qu’ils ne fussent soumis à la juridiction du landgrave, que celui-ci exerçait non-seulement sur les gens et /56/ les biens du Burgenberg 139 , dans le pays d’Unterwalden, mais encore, comme le prouvent les documents du 23 déc. 1257 (Tschudi I, 155) et du 20 mai 1258 (Kopp, p. 10, suiv.) sur la vallée d’Uri, sub tilia in Altorf, à plus forte raison sur celle de Schwyz, dont il était le Schirmvogt légitime et de droit héréditaire 140 .
Après le décès d’Otton IV, Frédéric II, de la maison de Hohenstauffen, parut solidement établi sur le trône impérial. Dès que ce prince eut des démêlés avec le S. Siège, la maison de Habsbourg, amie du pape, dut tomber en disgrâce. Le document du 12 juin 1217 (v. p. 49) prouve qu’à cette époque le comte Rodolphe Ier de Habsbourg, dit l’Ancien, était encore avoué de Schwyz. Déjà en 1219, c’est-à-dire la première année après la mort d’Otton IV et l’extinction de la maison de Zæringen, Henri, fils aîné de Frédéric II, était Recteur de la Bourgogne 141 . Ce prince ayant été promu par l’Empereur son père à la dignité de Roi des Romains, le Rectorat de Bourgogne passa en d’autres mains que celles du comte de Habsbourg, qui fut même dépouillé par Henri de l’avouerie des Vallées, comme nous le verrons bientôt. A la fin, la maison de Habsbourg, qui s’agrandit de la succession de Kibourg, fut non-seulement rétablie dans le landgraviat de l’Argau, mais encore investie de celui du Zurichgau. Un document du mois de juin de 1273. Indict. I. nous apprend que Hermann de Bonstetten, vice-landgrave, exerçait, au nom de son seigneur Rodolphe comte de Habsbourg et de Kibourg, landgrave d’Alsace et d’Argovie, le droit d’advocatie, ou d’avouerie, et la haute juridiction /57/ sur les hommes libres de la vallée de la Reuss, dans le pays d’Uri 142 ; et un autre, du lendemain de S. Laurent (11 août) 1275. Indict. 3. parle de Marquart de Wolhusen, Richter de l’Aergoew et du Zurichgoew, au nom de Rodolphe roi des Romains, jugeant à Altdorff 143 .
Nous n’avons pas résolu toutes les difficultés que présente la question qui nous occupe. On peut objecter que Frédéric Ier donna le landgraviat d’Argau, par conséquent la juridiction des Waldstetten, à son fils Otton; que le comte Rodolphe de Habsbourg, établi dans la dignité de landgrave d’Argau par Otton IV, en fut dépouillé par le roi Henri, qui prit en 1231 les Waldstetten sous sa protection et sous celle de l’Empire 144 , et enfin, opposant aux documents que nous avons cités la charte de 1240 145 , que Frédéric II accorda aux habitants des Waldstetten, et qu’Adolphe leur remit à son tour 146 , en 1297, on serait tenté de soutenir que les Waldstetten relevaient nûment de l’Empire, et que le pouvoir qu’y exerça, ou que prétendit y exercer la maison de Habsbourg, était illégitime, une véritable usurpation.
En effet, les défenseurs de l’une et de l’autre opinion peuvent les soutenir en produisant des documents authentiques qui présentent une contradiction manifeste, que nous espérons pouvoir expliquer d’une manière assez claire et assez positive pour que ce problème historique puisse être considéré comme résolu.
D’abord, nous ferons observer que Frédéric Ier, Henri et Frédéric II firent dans des circonstances extraordinaires des /58/ coups d’autorité; qu’Adolphe de Nassau ne suivit l’exemple du dernier de ces trois princes que lorsqu’il se vit dans un état désespéré, et que même alors il délivra simplement aux Vallées, après leur avoir refusé pendant plusieurs années ce qu’elles sollicitaient, la copie litérale de la charte que leur avait accordée Frédéric II; que lorsque Henri VII de Luxembourg leur eut accordé un diplôme contenant des privilèges et une certaine liberté, elles invoquèrent dans la suite ce diplôme à l’appui de nouvelles demandes, ou pour établir des précédents; enfin, que ce ne fut qu’en 1324 qu’elles furent mises, par Louis de Bavière, en possession du droit de juridiction qu’elles désiraient depuis si longtemps. Tout celà prouve clairement, à notre avis, que dans l’origine les Waldstetten ne jouissaient pas de cet état d’indépendance dont parle une tradition à laquelle on n’a accordé que trop de confiance. A ces observations ajoutons les considérations suivantes, qui sont d’une haute importance.
La fin du 11e siècle vit naître entre Grégoire VII et Henri IV cette lutte mémorable, dans laquelle furent bientôt engagés tous les peuples de la chrétienté: c’était la lutte entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, lutte sanglante qui dura deux siècles avec une fureur opiniâtre, et qui même aujourd’hui n’est pas entièrement terminée. Les défenseurs ou représentants de ces deux pouvoirs, tendant chacun à une suprématie sans condition, il ne pouvait y avoir de parti neutre. C’était, comme on l’a dit, la guerre de tous contre tous, les excès d’une guerre civile avec les horreurs d’une guerre de religion. L’Empereur, décidé de soumettre le Sacerdoce à sa volonté souveraine, arma tous ses vassaux, tous ses peuples contre Grégoire VII, et fit prononcer sa déposition. Le Pontife, résolu de secouer le joug du pouvoir impérial, et d’établir par un coup décisif /59/ la suprématie de l’Eglise, s’entoura de toute la puissance cléricale, lança l’anathème contre Henri IV, le déclara déchu de la dignité royale, et, chose inouïe jusqu’alors, délia ses sujets du serment de fidélité. En entendant gronder les foudres du Vatican les peuples tremblèrent. Ils n’osèrent plus obéir à un prince excommunié par le S. Père. Cet acte d’excommunication et de déchéance, la défection d’un grand nombre de seigneurs, qui en fut le résultat immédiat, les désastres de Henri IV, les humiliations auxquelles il dut se soumettre, les revers qu’essuya le pape à son tour, le trouble, la confusion générale, suite inévitable d’un tel état de choses, l’acharnement de la lutte qui s’était engagée entre le Sacerdoce et l’Empire, vaste et terrible conflit, dont aucune combinaison humaine ne pouvait calculer la durée ni prévoir la fin, l’amour du pouvoir, qui fit déclarer élective la couronne impériale jusqu’alors héréditaire, l’anarchie qui depuis devait nécessairement succéder à chaque règne, les effroyables guerres civiles suscitées par les pontifes qui opposaient un césar au prince dont ils redoutaient la haine ou l’énergie, ou par des ambitieux qui disputaient la couronne aux princes faibles, les secousses nombreuses et violentes qu’éprouva l’Empire, l’empressement avec lequel les grands vassaux profitèrent de l’abaissement de l’Empereur et du désordre général pour établir l’hérédité de leurs fiefs, pour consolider leurs prétentions politiques et se rendre indépendants et forts, la facilité avec laquelle les empereurs qui avaient entrepris la soumission du S. Siège à leur volonté accordaient des bénéfices à des seigneurs ou des privilèges à des peuples pour s’entourer d’un grand nombre de partisans; toutes ces circonstances favorisèrent les projets d’indépendance des feudataires, et préparèrent l’émancipation des cités, des communautés de l’Allemagne, de la Lombardie, de l’Helvétie. Ce pays, /60/ situé entre la Germanie proprement dite et la Lombardie, où les esprits étaient vivement agités, devait ressentir le choc qui ébranlait l’Empire, et subir l’influence des événements qui se pressaient autour de lui. Maîtres du passage qui conduisait les troupes impériales en Italie, les habitants des Alpes, qui ne pouvaient demeurer neutres, devaient être les plus dangereux adversaires ou les plus forts alliés de l’Empereur qui se déciderait à lutter avec le Pontife. Il n’avait aucun moyen de les gagner qu’en accordant des privilèges à ces courageux montagnards, amis de la liberté, qui embrassèrent chaudement le parti des Gibelins, faction attachée aux empereurs, contre les Guelfes ou partisans du pape. — Appliquez ces observations à la conduite des empereurs et à certains faits de notre histoire, vous verrez qu’elles sont d’une justesse frappante, qu’elles donnent la clef de l’énigme qui a dû embarrasser tant d’écrivains.
Les empereurs ou les rois de la maison de Hohenstauffen et ceux qui, comme eux, soutinrent le combat contre Rome, se montrèrent d’assez facile composition pour les priviléges réclamés par les Waldstetten et par des cités limitrophes, telles que Zurich et Lucerne; ils cherchèrent à diminuer le pouvoir et l’influence des puissants comtes de Habsbourg, amis du sacerdoce romain; tandis que ceux qui, vivant en bonne intelligence avec le Pontife, avaient besoin du concours des comtes de Habsbourg pour établir la paix intérieure, contenir dans le devoir certains vassaux avides d’indépendance, certaines contrées disposées à s’émanciper, entre autres l’Helvétie, et maintenir l’intégrité de l’Empire, conservèrent à ces comtes les dignités et les droits qu’ils avaient acquis. Il va sans dire que les rois de cette maison évitèrent tout ce qui pouvait les compromettre. Les Waldstetten, de leur côté, ayant une fois obtenu une charte qui leur garantissait des droits et des libertés, ne /61/ voulurent pas en faire le sacrifice, tandis que tel roi de Germanie, vivant bien avec Rome, et craignant le démembrement de l’Empire que devaient amener des concessions larges, refusa de la reconnaître et de la confirmer. Dès lors commença cette lutte longue, à jamais mémorable, qui eut pour résultat heureux la conquête de la liberté, l’indépendance de l’Helvétie.
Tout ce qui précède démontre clairement que dans cette partie de l’Helvétie où, à une époque fort reculée, les chroniqueurs et les historiens croient trouver des états indépendants, il n’y avait que des fiefs sous la juridiction du comte, vicaire de l’Empereur ou du Roi des Romains. Ainsi que nous l’avons dit, il n’y eut d’abord dans chacune des trois Vallées ou Waldstetten que des maisons éparses, des fermes ou censes, puis des hameaux, des villages, dépendances de seigneurs laïcs ou de seigneurs ecclésiastiques. Altorf, Schwyz, Sarnen et Stans formèrent, sans contredit, chacun le noyau de ce qu’on appela plus tard cantons d’Uri, de Schwyz, de Haut- et Bas-Unterwalden. Au premier de ces endroits s’unirent d’abord Burglen, Silennen; au second Steinen, Art, Sattel; au troisième Buchs, Wolfenschiess, Giswil, Lungeren, etc. Mais en s’associant ces bourgs et ces villages formèrent simplement une réunion, ou, si l’on veut, une confédération de communes et de ligues, unies par un intérêt général, mais conservant chacune leur amman 147 , et demeurant à certains égards indépendantes les unes des autres, comme le font supposer les documents où l’on trouve Stans et Buchs, Sarnen et Lungeren, Switz et Steina 148 . L’état séparé de ces communes s’explique par l’histoire de Weggis et de Gersau, qui /62/ demeurèrent politiquement isolés pendant plusieurs siècles 149 . Cette réunion de communes d’une vallée, qui ne comprenait toutefois que les hommes dits de condition libre, forma la communauté, communitas, universitas, comme pays, reconnue par le comte ou landgrave, ainsi que le prouvent, pour Uri, le document du 20 mai 1258 (ap. Kopp, p. 10—12); pour Unterwalden, celui du 7 mars 1304 (id. p. 65. cf. p. 70). La vallée, dont chaque commune avait son Amman, était sous la juridiction du Vogt ou de l’Avoué, minister Vallis, Vallis Judex (ap. Kopp, p. 30), officier du comte. Mais en formant une association, ces communes allèrent plus loin: voulant se soustraire à l’autorité suprême, à la haute juridiction du comte, chaque endroit, chaque commune, dont les hommes libres avaient toujours été obligés d’assister aux plaids généraux, aux assises provinciales de l’Argau, imita ces assises, et donna à son assemblée le nom de Landtag (dies placiti provincialis, placitum, judicium provinciale), ou de Landgericht, plaid, audience, diète. En même temps que les communes isolées s’unissaient en communauté, les assemblées communales se formaient en assemblée générale ou Landsgemeinde (voy. Kopp, p. 27—28), présidée par un Amman du pays, ou Landamman. C’était là un progrès, un acheminement à l’indépendance des Waldstetten.
Il n’y eut probablement pas de Landamman dans les Vallées avant 1291 150 . Les premiers que l’on rencontre sont: /63/ « Her Arnolt der Meier von Silennun, Lantamman von Vre 151 » (documents du 28 mars et du 16 oct. 1291. ap. Kopp, p. 35. 37). « Her Chvonrat ab Iberg Lantamman von Swiz » (doc. du 16 oct. 1291. ibid. p. 37). « stvofacher Land amman ze swiz» (doc. de 1303 ou 1305 152 ). « Rvodolf von Oedisriet Lantamman ze Vnderwalden » (doc. du 7 mars 1304. ibid. p. 65).
Ce serait une erreur que de croire que l’existence d’une communauté ou la réunion de plusieurs communes emportât ou comprît en soi l’indépendance de tout seigneur. Cette confédération ne constitua point un pays libre dans le vrai sens de ce mot, car elle ne fit pas cesser les droits domaniaux (Hofrechte), puisqu’à une époque plus récente on rencontre par exemple le maire (Meier) de Lucerne à Stans, le cellérier (Keller) de Habsbourg à Sarnen, le procureur (Pfleger) d’Engelberg à Buchs, y exerçant la basse juridiction, chacun au nom de son seigneur; le villicus ou maire de Silennen (1258. Kopp, p. 11. et 1291. id. 35. 37); le maire et le cellérier de Kussenach (1302. id. p. 58). Ce qui ne laisse subsister aucun doute à cet égard, c’est un document du 11 nov. 1308, dans lequel Werner d’Attinghausen, Landamman, et les hommes d’Uri font publiquement l’aveu d’un délit commis par eux envers l’abbesse de Notre-Dame-de-Zurich en soumettant à des droits seigneuriaux les biens de l’abbaye situés dans leur pays, et lui promettent, en la /64/ remerciant de l’indulgence dont elle a usé envers eux, de ne lui faire à l’avenir aucun tort 153 .
Quant à Schwyz, les empiétements de ses habitants sur le territoire et sur les droits du couvent d’Einsiedeln ont formé, avec les documents y relatifs, la matière d’un volume 154 .
Nous ne savons comment on a pu soutenir raisonnablement que les vallées d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden étaient de temps immémorial indépendantes, en ce sens, que leurs habitants avaient possession d’eux-mêmes, qu’ils étaient exempts de cens, de rentes, de services, de redevances à un seigneur, qu’ils choisissaient leurs magistrats parmi leurs citoyens, et relevaient nûment de l’Empire, ne reconnaissant d’autre chef que l’Empereur. — Ce qui constitue l’indépendance d’un pays, c’est la faculté qu’il a d’exercer la souveraineté. Or, à l’égard des vallées alpestres, pour ne point parler des autres contrées de l’Helvétie, la souveraineté résidait dans la personne du Landgrave, grand feudataire de l’Empire, Vicaire impérial: les avoueries, les bailliages étaient autant d’attributs de sa puissance; et c’est dans cette puissance souveraine, dont émanaient les moindres pouvoirs, qu’il faut chercher l’unité, non dans des circonstances locales 155 . On ne peut même parler d’indépendance des Waldstetten dans un temps où elles eurent un Landamman choisi parmi leurs citoyens, vu que ce magistrat, qui remplaça le Vogt ou l’Avoué, tenait son pouvoir particulier du Comte, c’est-à-dire du Landgrave, ou de son Lieutenant le Landrichter 156 . /65/ Lorsque le droit de communauté (Gemeinderecht) fut accordé aux hommes de condition libre, ils songèrent à la conquête du droit de haute juridiction (Landrecht), et enfin à celle du droit de propriété foncière (Grundeigenthum) 157 , à l’acquisition des fiefs et des biens que les seigneurs ecclésiastiques ou laïcs possédaient dans leurs vallées. Mais avant de pouvoir composer des divers droits domaniaux (Hofrechte) la juridiction supérieure ou la souveraineté (Landrecht), il fallait briser la puissance de Habsbourg-Autriche.
il n’est pas probable que les Waldstetten aient conçu d’abord le projet d’une entière émancipation, d’une indépendance absolue; cette idée, étrangère aux mœurs de ce temps-là, nâquit plus tard et ne se développa qu’avec l’aversion pour l’Autriche; mais lorsque la haine de la domination fut profondément imprimée dans les esprits, elle leur inspira une constance inébranlable, un courage invincible, et les nombreux bataillons de l’Autriche durent céder à la force irrésistible de l’amour de la liberté qui enflammait les pâtres des Alpes.
Reportons-nous aux premiers temps de leur histoire et voyons comment s’engagea la lutte dont ils sortirent vainqueurs.
L’usage des pâturages où les habitants de Schwyz conduisaient leurs troupeaux, fit naître la première querelle avec leurs voisins, et c’est par la résistance opiniâtre qu’ils opposèrent à ceux qui prétendaient les en chasser que commence l’histoire de leur petit pays.
Le célèbre monastère d’Einsiedeln ou de Notre-Dame-des-Ermites, fondé au 10e siècle, eut à se louer dès son /66/ origine de la protection et de la munificence d’Otton Ier et de son fils et successeur Otton II 158 . En 1018 l’empereur Henri II, que sa piété et son zèle à doter les églises et les couvents firent mettre au rang des saints, accueillant favorablement la demande de l’abbé Wirand, donna à perpétuité à l’abbaye d’Einsiedeln les alpes environnantes, c’est-à-dire les lieux qui n’étaient point labourés, qui ne servaient qu’au pâturage, et que, pour cette raison, l’Empereur considérait comme sa propriété 159 . Il paraît que longtemps les pâtres de Schwyz continuèrent à y mener leurs troupeaux sans être inquiétés. Mais au commencement du 12e siècle (1114) il s’éleva entre eux et les moines d’Einsiedeln une vive contestation. L’abbé Gérard de Froburg et son avoué Ulric de Raprechtswile se plaignirent à l’empereur Henri IV (V), qui était alors à Bâle, de ce que les comtes Rodolphe et Arnulf ou Arnold de Lenzbourg et les gens de Schwyz avaient envahi une partie du territoire de l’abbaye que ceux de Schwyz prétendaient avoir hérité de leurs pères. L’Empereur, après avoir entendu ses conseillers, qui jugèrent que ces alpes étaient un bien sans propriétaire dont le roi de Germanie pouvait disposer à son gré, ratifia la donation /67/ faite à l’abbé par ses prédécesseurs et condamna le comte Rodolphe de Lenzbourg à 100 livres d’amende 160 .
Les habitants de Schwyz, loin de se soumettre à la décision impériale, persistèrent dans leur refus d’abandonner la partie des Alpes qu’ils disaient leur appartenir, et malgré la charte de Lothaire III 161 et celles de Conrad II (III) 162 , dont le but était de terminer le différend par un jugement définitif entre l’abbé Rodolphe, le comte Ulric de Lenzbourg et ses héritiers, et les habitants de Schwyz, ceux-ci soutinrent avec une constance inébranlable leur prétentions pendant un siècle. Nous ne nous arrêterons pas à tous les détails de cette querelle, qui sont consignés dans les nombreux documents de la Libertas Einsidlensis et en partie dans les ouvrages de Tschudi et de J. de Muller. Nous nous contenterons de dire que ce ne fut qu’en 1217 que cette /68/ vive querelle entre Schwyz et Notre-Dame-des-Ermites fut terminée. L’abbé Conrad, Rodolphe et Henri de Raprechtswile, avoués de l’abbaye, d’une part, et les gens de Schwyz, de l’autre, ayant nommé pour arbitre de leur différend le comte Rodolphe de Habsbourg, avoué et défenseur (Schirmer ou Schirmvogt) de Schwyz, celui-ci, après avoir entendu les deux parties, les mit d’accord, en décidant que les Alpes en litige appartiendraient les unes en toute propriété au Couvent, d’autres à Schwyz, et que d’autres enfin demeureraient en commun 163 .
La paix ne fut pas de longue durée; car, quelque temps après cette décision il s’éleva de nouvelles difficultés entre Schwyz et le couvent d’Einsiedeln: on vit naître de nouvelles disputes, qui se répétèrent plusieurs fois dans la suite; car les Alpes furent très-longtemps un sujet de discorde.
Ce n’est pas seulement avec le couvent d’Einsiedeln que les hommes de Schwyz eurent des contestations. Ils cherchèrent à troubler l’abbesse du couvent de Steinen dans la jouissance de ses biens et de ses droits, et agirent avec si peu de ménagements que le lieutenant ou vicaire du roi Rodolphe dut les menacer d’un sévère châtiment s’ils persistaient dans leurs mauvaises intentions 164 . Ils cédèrent pour le moment, et recommencèrent en 1299.
A l’exemple des habitants de Schwyz, les hommes dits de condition libre de la vallée d’Uri eurent querelle avec l’abbé du couvent de Wettingen. Ils voulaient soumettre à la taille les gens de ce monastère et s’arroger sur eux des droits seigneuriaux, en particulier sur les biens que le comte Henri /69/ de Raprechtswile, le Voyageur, avait possédés dans le pays d’Uri et qu’il venait de céder (1231) au couvent de Wettingen (Tschudi I, 127). Les Uraniens, forts de la lettre du roi Henri (du 26 mai 1231), qui leur ôtait le comte de Habsbourg, firent cette tentative pour s’attribuer la juridiction sur les biens de Wettingen situés dans leur vallée. Henri écrivit à ses officiaux 165 et à ses autres fidèles d’Uri de ne léser en aucune manière les gens et les possessions du monastère de Wettingen qu’il avait pris sous sa protection, de traiter modestement et honnêtement ceux qui étaient dans les endroits appartenant à son avouerie 166 (c’est-à-dire à la juridiction de l’avoué dont l’autorité émanait du chef de l’Empire), et de ne pas rendre leur condition pire quelle n’était du temps du fondateur, c’est-à-dire de ne pas les réduire à la servitude, à l’état de serfs 167 .
Comme les Uraniens ne firent pas attention à cet ordre, Henri leur adressa d’Hagenau une seconde lettre, dans laquelle il réitéra la défense qu’il leur avait faite de molester les gens de Wettingen, sous peine de sa disgrâce 168 .
Plus tard ceux d’Uri firent des tentatives d’un autre côté. Ils disputèrent au couvent d’Engelberg la possession des Alpes environnantes. Cette querelle fut terminée à Altorf, le 11 août 1275, par Marquart de Wolhusen, chevalier, exerçant les fonctions de (vice-) landgrave (Richter) du roi des Romains dans l’Argau et le Zurichgau 169 . Au /70/ commencement du 14e siècle ayant essayé de s’attribuer les droits de l’abbesse de Notre-Dame-de-Zurich, à qui ils firent beaucoup de tort, ils furent enfin obligés de faire l’aveu public de leur faute, et de promettre à l’abbesse de ne plus l’inquiéter dans la possession de ses droits 170 .
On voit par ces exemples que les habitants des Waldstetten n’étant pas maîtres du pays, tâchèrent de le devenir, en employant pour cet effet des moyens propres à susciter des querelles.
Pour atteindre un jour leur but, les trois Vallées ne pouvaient mieux commencer qu’en s’unissant plus étroitement, faibles qu’elles étaient alors, ne comprenant qu’une partie des communes dont elles se composèrent plus tard. Si l’on en croit Tschudi I, 56, les Waldstetten formèrent une alliance pour leur protection mutuelle déjà lors des premiers démêlés (1114) de Schwyz avec l’abbaye d’Einsiedeln; une autre en 1206, au rapport du chevalier Jean de Klingenberg, qui doit avoir vécu en 1240 171 . Ces alliances étaient de 10 ans. — Nos annalistes parlent souvent de pactes qu’Uri, Schwyz et Unterwalden doivent avoir faits pour dix ans. Comme il ne peut être ici question d’alliances telles qu’en contractent des pays indépendants, il nous semble qu’il faut entendre par-là des rapports d’union qui s’établirent entre les diverses communes d’une vallée, rapports qui s’étendirent insensiblement sur les communes d’autres vallées, et qui concoururent à former une association, une union générale des Waldstetten, telle que nous la voyons en 1291.
A l’époque dont parle Klingenberg, selon Tschudi, Philippe de Hohenstauffen ou de Souabe tenait les rênes de l’Empire. Ennemi du pape, il eut pour amis les habitants des Waldstetten. Son rival et son successeur Otton IV, fils /71/ de Henri-le-Lion, duc de Bavière, leur donna pour avoué provincial le comte Rodolphe de Habsbourg l’Ancien ou le Paisible, dont nous avons parlé. Otton, soutenu par le pape Innocent III, fut fait empereur au préjudice de Frédéric II, qui ne fut reconnu qu’après avoir renversé son compétiteur. La guerre appelant Frédéric II en Italie (1220), il fit nommer roi des Romains son fils Henri âgé de sept ans. Les Waldstetten profitèrent du rétablissement de la maison de Hohenstauffen sur le trône impérial pour solliciter le rappel ou la déposition du comte Rodolphe. Pendant les guerres de Bavière, Henri leur ayant envoyé Arnold de Wasseren pour les engager à marcher contre le comte Diethelm de Toggenbourg, qui venait de faire une irruption sur le territoire de l’abbé de S. Gall, ils refusèrent opiniâtrément tout secours jusqu’à ce que le Roi leur eût ôté le comte de Habsbourg. Henri satisfit à leur demande, par un diplôme daté de Hagenau, VII kal. de juin. Indict. IV. (26 mai) 1231 (Tschudi I, 125). « Henri, par la grâce de Dieu, Roi des Romains, toujours Auguste, à ses féaux tous les hommes de la vallée d’Uri 172 , auxquels la présente lettre sera montrée, sa grâce et tout bien! Désirant toujours faire ce qui peut tourner à votre commodité et à votre profit, voici nous vous rachetons et vous relevons de la possession du comte Rodolphe de Habsbourg, vous promettant de ne jamais vous aliéner, mais de vous maintenir et de vous protéger toujours pour notre service et pour celui de l’Empire. C’est pourquoi nous vous engageons à croire et à faire ce que notre fidèle Arnold de Wasseren vous demandera de notre part. »
Les Vallées firent ce que le roi désirait: elles envoyèrent /72/ chacune 200 hommes 173 . Lorsque son père, l’empereur Frédéric II, entreprit le siège de Faenza (Faïence), il les invita aussi à lui donner du secours. Elles lui firent observer, dit Tschudi, I, 134, qu’ayant toujours été libres ne devant des services qu’à l’Empire, dans les pays allemands, et qu’étant mal protégées, elles ne lui donneraient du secours qu’après qu’il leur aurait déclaré par lettre dûment scellée qu’elles étaient libres, que ses habitants s’étaient soumis volontairement à lui et à l’Empire, que l’Empereur les protégerait toujours et ne les aliénerait jamais.
Après avoir obtenu ce qu’ils demandaient, les habitants des Waldstetten prirent les armes et franchirent les Alpes. C’est au siège de Faenza, dit-on, que Struthan de Winkelried 174 du pays d’Unterwalden, fut fait chevalier en récompense de sa bravoure (Tschudi I, 146. J. de Muller I, 497).
Voici le contenu de la charte que Frédéric II délivra aux habitants des Vallées: « Frédéric II, par la grâce de Dieu Empereur des Romains, Roi de Jérusalem et de Sicile, à tous les hommes de la vallée de Schwyz, à ses féaux, sa grâce et tout bien. Ayant reçu de votre part des lettres et des messagers, et agréant votre attachement et votre dévouement à notre personne, qu’ils nous ont fait connaître, nous voulons concourir favorablement et bénignement à la pureté de vos intentions, n’ayant pas pour peu /73/ recommandables votre dévouement et vôtre fidélité, d’autant plus que vous avez prouvé par des actions le zèle que vous avez toujours eu pour nous et pour l’Empire, en vous réfugiant sous nos ailes et sous celles de l’Empire, tels que vous étiez précédemment, comme hommes libres qui ne devez hommage qu’à nous et à l’Empire 175 . Puisque vous avez choisi de bonne et franche volonté notre domination et celle de l’Empire, nous accueillons votre fidélité à bras ouverts, et montrons à votre sincère affection la pureté de notre faveur et bienveillance, en vous prenant sous notre protection spéciale et sous celle de l’Empire, tellement que nous ne permettrons pas qu’en aucun temps on vous aliène ou vous sépare de notre domination et de celle de l’Empire; vous donnant l’assurance et la plénitude de la grâce et faveur que tout seigneur bénin doit répandre sur gens dévoués et fidèles. Jouissez d’une pleine prospérité en toutes choses pourvu que vous nous restiez fidèles et ne nous refusiez pas vos services. Donné au siège de Faenza, l’an du Seigneur 1240, au mois de décembre. Indict. 14. » 176
Tschudi, qui lit in Suitz, dit que les deux lettres pour les deux autres vallées étaient de la même teneur, avec cette différence que l’une portait au lieu du nom de Suitz celui d’Uri, et l’autre le nom d’Unterwalden. — En publiant la lettre du 26 mai 1231, que Henri fit remettre à Uri, Tschudi ajoute qu’elle fut adressée aux trois vallées, et que chaque exemplaire portait le nom de la vallée à laquelle il était destiné. Nous ne partageons pas l’opinion de Tschudi, bien que J. de Muller l’ait adoptée. La vallée d’Uri était /74/ fief immédiat de l’Empire: Otton IV, en vertu de son pouvoir souverain, l’avait placée, comme les deux autres Waldstetten, sous la juridiction du comte Rodolphe de Habsbourg, et Henri la remit sous la protection immédiate de l’Empire, de manière que la lettre de 1231 ne peut concerner que cette vallée. Les lettres de 1233 et de 1234 citées plus haut (p. 69) autorisent à croire qu’à cette époque Uri n’était pas soumis à la juridiction d’un landgrave, ou, ce qui revient au même, que le successeur du comte Rodolphe de Habsbourg, qui mourut en 1232, n’exerça pas le pouvoir judiciaire sur le pays d’Uri.
La condition politique d’Uri, les rapports de cette vallée avec l’Empire n’étant pas les mêmes que ceux de Schwyz et d’Unterwalden, les lettres patentes envoyées à la première de ces vallées ne concernaient pas toujours les deux autres. C’est ainsi que, pour ajouter un exemple au précédent (de 1231), la lettre du roi Rodolphe, adressée à Uri en 1274 (Tschudi I, 180-181), a été sans fondement interprétée par J. de Muller (I, 540) comme regardant aussi Schwyz et Unterwalden (v. Kopp, p. 22).
Nous pensons que lorsqu’Uri, après avoir été, comme Schwyz et Unterwalden, confié par Otton IV au comte Rodolphe de Habsbourg, fut remis par Henri sous la protection immédiate de l’Empire, les deux autres vallées, jalouses de cette prérogative, profitèrent de la mésintelligence qui existait entre l’empereur Frédéric II et le Pontife qui venait de l’excommunier, pour se réfugier sous les ailes de l’Empire et obtenir la déclaration d’indépendance de tout seigneur; ce que l’Empereur, de facile composition pour accorder des priviléges à ses amis, adversaires du sacerdoce de Rome, et surtout aux valeureux pâtres des Waldstetten, maîtres du passage des Alpes, forcé d’ailleurs de demander du secours pour combattre son rival, et /75/ intéressé par-là même à augmenter le nombre de ses partisans, leur accorda, comme nous l’avons vu. S’il en eût été autrement, si ceux de Schwyz eussent pu se vanter à juste titre d’une liberté vierge, comme le veut la tradition adoptée par Tschudi, Muller et d’autres, ils auraient, au besoin, prié l’Empereur de reconnaître et de confirmer leur indépendance avec leurs droits, au lieu de solliciter la déclaration, dans une charte à leur remettre, qu’ils étaient libres et qu’ils s’étaient soumis volontairement à l’Empire; et, ce qui ne laisse subsister aucun doute à cet égard, ils ne se seraient pas prévalus, en 1318, de la charte de Henri de Luxembourg.
Il est évident que la charte de 1240 ne concerne que les habitants de Schwyz et d’Unterwalden, ce que M. Kopp (p. 30) admet sans hésiter. Aussi dans la bulle d’excommunication de 1248 (voy. p. 76) n’est-il pas question de la défection d’Uri, fief immédiat de l’Empire, mais de celle de Schwyz et d’Unterwalden qui, fiefs héréditaires de la maison de Habsbourg, ont embrassé le parti du prince détrôné, qui en vertu de son autorité impériale les avait affranchis de la domination d’un seigneur pour les faire relever nûment de l’Empire. Ce privilège cessait d’exister dès la déchéance du prince qui l’avait accordé, tandis qu’Uri conservait celui dont il avait joui anciennement.
Cette même année (1240) Albert II (IV), dit le Sage, comte de Habsbourg et landgrave d’Alsace, fils aîné et successeur de Rodolphe Ier, mourut dans un pèlerinage qu’il avait entrepris dans la Terre-Sainte.
Innocent IV, successeur de Grégoire IX, voulut soumettre Frédéric II au siège de Rome; mais, rencontrant trop de résistance, il prononça, en 1245, contre lui une sentence d’anathème et de déposition, en présence du concile général de Lyon; par ses intrigues il parvint en 1246 à lui faire /76/ donner pour successeur d’abord Henri Rasp, landgrave de Thuringe, qui mourut l’année suivante, puis Guillaume, comte de Hollande. Il faut que l’un de ces anticésars ait rétabli l’autorité des comtes de Habsbourg sinon à Uri, du moins dans les autres vallées, et que celles-ci, constantes dans leur projet d’émancipation, et persévérant dans leur attachement à la maison de Hohenstauffen, aient refusé obéissance au comte de Habsbourg et soutenu avec ardeur la cause de Frédéric II qui défendait sa couronne en Lombardie, puisqu’à cette époque (1248) le pape excommunia ceux de Schwyz, de Sarnen (ou d’Unterwalden) et de Lucerne pour s’être soustraits à l’autorité de leur seigneur Rodolphe de Habsbourg auquel ils appartenaient de droit héréditaire, et déclarés partisans de Frédéric II 177 , après avoir formé entre eux une alliance contre la maison de Habsbourg. Or ce Rodolphe, aussi dit l’Aîné (senior) 178 , était fils de Rodolphe qui fut nommé Avoué provincial par Otton IV et mourut en 1232, frère d’Albert-le-Sage, qui /77/ mourut en Syrie, en 1240, et cohéritier de son neuveu Rodolphe qui fut élevé au trône impérial. Il fut la tige de la maison de Habsbourg-Lauffenbourg, et mourut en 1249 179 .
Il est évident par la lettre du pape ainsi que par un document sans date (ap. Kopp, nº 2), mais qui doit être postérieur à 1245 et antérieur au 28 août 1248, et par un autre du 4 mai 1252 (Kopp, nº 3) que les habitants de Lucerne, et ceux des vallées de Schwyz, de Sarnen 180 et de Stans 181 , ou les montagnards (intramontani, docum. nº 3), avaient fait une alliance dans le but secret ou avoué de se soustraire à la juridiction ou à la domination du Landgrave. Innocent IV, qui parle des trois premiers, leur reproche, dans la lettre que nous venons de citer, leur défection, et les tance de ce qu’ils font cause commune entre eux (communicare). Ajoutons les paroles du nº 2 des docum. publiés par H. Kopp, « in stannis … ejusdem uallis — coniuratorum nostrorum in lucerna », et celles du nº 3. « si vero a lacu Lucernensi apud intramontanos aliquot prelium exortum fuerit, omnes illuc ire volentes, idem prelium lalorent destruere », etc. C’est à cette alliance que font allusion les mots « antiquam confederationis formam iuramento vallatam » du pacte du 1er août 1291 182 .
Depuis l’extinction de la maison de Hohenstauffen (1254) les querelles entre le Sacerdoce et l’Empire s’apaisèrent, et les Waldstetten, ne trouvant plus dans la personne de l’Empereur un ennemi du S. Père et un appui contre leurs seigneurs, ne purent susciter de nouveaux embarras à la maison de Habsbourg, ni la contrarier dans l’exercice de ses droits. /78/
Pendant que Guillaume de Hollande disputait successivement à Frédéric II et à son fils Conrad IV le diadème impérial, qu’il mettait tous ses soins à rétablir l’ordre, à consolider l’Empire ébranlé, que, après sa mort, l’Allemagne était livrée à une espèce d’anarchie, que deux compétiteurs, Richard de Cornwallis et Alphonse de Castille, prétendaient à la couronne, et qu’à la faveur de ce désordre et des troubles excités par la cour de Rome, les princes et les états de la Germanie secouaient le joug de la dépendance et s’érigeaient en souverains, Rodolphe, comte de Habsbourg, neveu de celui dont nous venons de parler, donnait un libre essor à son ambition, dépouillait ses cousins, inquiétait le vieux comte Hartmann de Kibourg, son oncle maternel, augmentait ses domaines, fortifiait sa puissance, acquérait de la gloire, et se préparait à jouer un rôle important sur la scène politique.
Ce comte Rodolphe de Habsbourg, qui depuis fut roi, et son oncle Rodolphe de Habsbourg-Lauffenbourg, jouirent par indivis, jusqu’à la mort de ce dernier, du landgraviat d’Alsace. La lettre du pape Innocent IV, de 1248, ne permet pas de douter que Rodolphe l’Aîné n’ait été investi de la dignité de landgrave de l’Argau et qu’il n’en ait exercé les fonctions en même temps que celles de haut-justicier des Waldstetten. A sa mort, arrivée en 1249, ce fut son cohéritier Rodolphe (IV) qui lui succéda dans le landgraviat d’Alsace et d’Argau. Bien que nous ne puissions maintenant constater cette date en ce qui regarde les Waldstetten, nous n’hésitons cependant pas à l’admettre comme probable. Quoiqu’il en soit, un document du 6 août 1256 183 , relatif /79/ à un bien situé au Burgenberg dans le pays d’Unterwalden 184 , que le propriétaire, chevalier (miles) de Wluelingen, prouva, en présence du comte Rodolphe de Habsbourg, lui appartenir de droit héréditaire, et un autre du 22 févr. 1257 185 , relatif à une contestation survenue au sujet de ce bien, dont le propriétaire voulait faire don au couvent de Hohenrain (canton de Lucerne) et que termina Ulric de Rusegg, lieutenant du landgrave de l’Argau, qui menaça de proscription quiconque troublerait le couvent dans la possession du bien qui lui avait été légué; ces deux documents, dis-je, prouvent que le comte Rodolphe exerçait la juridiction dans le pays d’Unterwalden. Il l’exerçait aussi dans le pays d’Uri, comme nous le verrons tout-à-l’heure, à plus forte raison sur le pays de Schwyz, qui était une avouerie héréditaire (Erbschirmvogtei) de sa maison, comme nous l’avons prouvé 186 .
C’est donc à tort qu’on prétend qu’après la mort de Conrad IV les trois Vallées choisirent pour Préfet impérial (Reichsvogt) et Protecteur (Schirmer) le jeune comte de Habsbourg. C’est encore une erreur que de dire avec J. de Muller que Rodolphe, appelé au secours d’Uri, rétablit dans ce pays la paix que troublaient les partisans d’Eccelino ou d’Ezzelino da Romano. L’histoire du tyran de Vérone n’a rien de commun avec ce qui se passait alors dans le pays d’Uri, et le personnage, le rôle que l’on fait jouer à Rodolphe est bien différent de celui qu’il y joua. Voici le fait.
Il s’était élevé dans le pays d’Uri une violente querelle entre deux familles non nobles, mais appartenant à la classe des hommes dits de condition libre, celles d’Izeli et de Gruba. Rodolphe, appelé pour rétablir l’ordre et le calme, termina le différend, et parvint avec le concours des hommes /80/ (libres) d’Uri à réconcilier les deux partis. « Si, en vertu du jugement qui fut prononcé, quelque membre de l’une des deux familles venait à rompre la paix, il devait payer au comte Rodolphe 60 marcs, autant à la partie lésée, être mis au ban de l’Empire, déclaré infâme, et perdre tous ses droits », c’est-à-dire, rentrer dans la condition d’hommes serfs. L’acte de réconciliation fut muni du sceau du comte Rodolphe de Habsbourg et de celui des hommes (libres) de la vallée d’Uri. Cette sentence fut prononcée à Altorf, à la place dite Gebreiten 187 .
Mais les gens de la famille Izeli causèrent de nouveaux troubles et commirent des horreurs. Le comte Rodolphe revint à Altorf, et, siégeant dans son tribunal, à la place dite Gebreiten, sous le tilleul, il condamna, avec l’approbation et de l’aveu 188 de la communauté d’Uri, par jugement définitif, la famille Izeli à la perte de tous les biens meubles et immeubles qui lui avaient été cédés par l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich à titre de fiefs héréditaires, et qui furent adjugés en toute propriété à l’abbesse de ce monastère 189 . De plus, le comte menaça de jugement divin et de son indignation 190 quiconque aurait l’audace de molester ou d’inquiéter la dite dame abbesse dans la possession de ces biens. Le comte Rodolphe et la communauté de la vallée d’Uri munirent cet acte de leurs sceaux 191 . Cet acte et les /81/ circonstances qui s’y rattachent donnent lieu à quelques observations importantes. Tout montre que Rodolphe n’est ici ni capitaine-général, Hauptmann, comme l’appelle Tschudi, ni simple Schirmvogt des habitants d’Uri, mais qu’il parle et agit en Landgrave. L’amende qu’il prononce est l’amende du ban royal, il menace de mettre au ban de l’Empire, il peut déclarer infâme, il confisque les biens de ceux qui ont forfait et les adjuge à l’abbaye de Zurich, dont la vallée d’Uri était mouvante; il menace de justice divine et de la perte de sa grâce, ou de sa colère quiconque troublera l’abbesse dans la jouissance des biens qu’il lui a rendus — et, dans le document du 22 fév. 1257 192 son Lieutenant menace de proscription ceux qui troubleront le couvent de Hohenrain dans sa propriété nouvellement acquise. — Quel autre que le Landgrave, le Lieutenant ou Vicaire impérial pouvait tenir un pareil langage, user d’un tel pouvoir? — Ceux qui sont témoins dans les deux actes du 23 déc. 1257 et du 20 mai 1258, qui les approuvent, sont des hommes de condition libre formant la communauté des hommes libres de la vallée d’Uri. Ils y apposèrent leur sceau, parce qu’ils n’étaient pas sujets du Landgrave: ils pouvaient « sub iudicio stare », « ze rehte (rechte) stan (stehen) », c’est-à-dire assister aux plaids ou audiences, comme nous l’avons déjà dit (p. 28), mais ils n’en étaient pas moins soumis à la juridiction du Landgrave; car celui-ci, ou son Lieutenant, exerçait le droit d’avouerie ou de haute juridiction, de haute police, sur les hommes de condition libre, comme il a été dit 193 . /82/
Dans le document du 20 mai 1258, l’Abbesse représente la propriété foncière (Grundeigenthum); la vallée d’Uri, le droit de commune ou de communauté (Gemeinderecht); et le comte Rodolphe, le droit de haute juridiction (Landrecht); les gens de la famille Izeli prévariquèrent ou forfirent en lésant tous les trois. Dans les temps qui suivirent, ce délit se répéta dans plusieurs lieux 194 , jusqu’à ce que le peuple après avoir acquis le droit de commune, travaillant sans relâche à se rendre indépendant et maître des droits domaniaux, se fût attribué d’abord le droit de haute juridiction et enfin le droit de propriété 195 .
Rodolphe, comte de Habsbourg et de Kibourg, landgrave d’Alsace, de l’Argau et du Zurichgau 196 , fut élu roi des Romains le 29 sept. 197 1273 et couronné le 24 oct. suivant. Peu de temps après son avénement à l’Empire, il écrivit « aux hommes prudents, à l’amman (minister, juge) et à la communauté de la vallée d’Uri, ses amés et féaux » 198 , une lettre gracieuse et pleine de bienveillance, dans laquelle, après avoir loué leur fidélité, leur constance, leur sincérité envers lui et envers l’Empire romain, et les avoir assurés de ses bonnes intentions à leur égard, ainsi que de sa disposition à augmenter plutôt qu’à diminuer leurs franchises, il les engageait à se montrer toujours prompts à se /83/ conformer au bon plaisir de l’Empire et de son chef, ajoutant que, loin de les aliéner, il les prenait comme enfants chéris sous sa protection spéciale et sous celle de l’Empire, et qu’il aurait recours à eux quand il s’agirait de rendre à l’Empire des services importants 199 .
Ceux d’Uri craignaient, sans doute, qu’il n’arrivât à leur vallée ce qui lui était arrivé du temps d’Otton IV. Rodolphe les rassura sur ce point. Du reste, comme le pense M. Kopp, cette lettre, ainsi que celle que Rodolphe adressa le lendemain à ceux de Lucerne 200 , peut bien n’être qu’une réponse gracieuse et bienveillante du nouveau chef de l’Empire aux félicitations que venaient de lui adresser les hommes qu’il avait appris à connaître particulièrement lorsqu’il était leur landgrave. Cette lettre ne concernait pas les habitants de Schwyz et d’Unterwalden, dont les rapports avec l’Empire étaient différents de ceux d’Uri.
L’élévation du comte Rodolphe à la dignité impériale ne faisait pas cesser les droits de landgrave appartenant à sa maison, qu’il avait exercés jusqu’alors en Helvétie. Déjà avant ce changement de fortune il s’y faisait représenter dans la dignité de landgrave, comme le prouve le document de juin 1273 (Kopp, p. 10). Un autre, dat. 8 Id. d’août (6 août), ind. 2. 1274 (ibid.), nous apprend que Marquart de Wolhusen était lieutenant du landgrave de Habsbourg en Argau, au nom et en l’autorité de son illustrissime seigneur Rodolphe roi des Romains; et un troisième, du lendemain de la S. Laurent, Ind. 3. 11 août 1275 (ibid.) nous dit que ce même Marquart de Wolhusen était Juge, Richter, c’est-à-dire Landrichter 201 , du roi Rodolphe, dans l’Argau et le /84/ Zurichgau, et qu’il tint un plaid a Altorf, où il termina le différend qui s’était élevé au sujet des Alpes entre Uri et l’abbaye d’Engelberg. (Voy. p. 69.)
Le 26 août 1278 Rodolphe gagna une grande bataille sur Ottocare, roi de Bohême, qui lui refusait l’hommage, et qui périt dans l’action. Le fruit de cette victoire fut la conquête de l’Autriche avec ses dépendances, dont Rodolphe investit en 1282 son fils Albert, par lettres patentes du 27 décembre, dans la diète d’Augsbourg. Delà les comtes de Habsbourg ont pris le nom de ce duché et fondé la deuxième maison d’Autriche.
Albert, père d’une très-nombreuse famille, et guidé par le désir de rendre sa maison riche et puissante, engagea le Roi, son père, à faire de nouvelles acquisitions, et proposa, dit-on, aux évêques, aux comtes, aux abbés, aux seigneurs de l’Helvétie et de l’Alsace de lui vendre leurs droits ou leurs domaines, ou de le prendre pour Avoué. Outre plusieurs domaines qui lui furent cédés à titre de propriété ou de protection, l’abbesse de Seckingen lui remit le pays de Glarus pour qu’il le tînt d’elle en fief héréditaire. Berthold de Falkenstein, abbé de Murbach, lui vendit Lucerne. Déjà dans la première moitié du 13e siècle les Lucernois avaient montré des dispositions à l’insurrection. Ils se réconcilièrent avec leurs maîtres, en 1244 (voy. Kopp, p. 6. 7); mais bientôt, pour parvenir plus sûrement à leur but, qui était de se soustraire à la domination de leurs seigneurs, ils se liguèrent avec les hommes de Schwyz et d’Unterwalden 202 , et s’attirèrent la colère du pape qui les excommunia en 1248. Dirigés par l’esprit d’indépendance qui travaillait les peuples, et enhardis par la distance qui les séparait de l’abbé du monastère de Murbach, dont celui de S. Léger à Lucerne, avec ses dépendances, était mouvant, les Lucernois se /85/ révoltaient contre son autorité et lui refusaient les services auxquels ils étaient obligés. L’abbé Théobald, de concert avec le prévôt et l’assemblée conventuelle, crut que ce qu’il y avait de mieux à faire, c’était de mettre et de laisser sous la protection de l’évêque Eberhard de Constance, tant que celui-ci vivrait, le monastère de S. Léger et ses dépendances, qui étaient compris dans le diocèse de Constance 203 . Un document du 3 janvier 1262 204 fait mention d’une querelle entre Berthold de Falkenstein, abbé de Murbach, et les Lucernois, suscitée par l’insubordination de ces derniers, qui, toujours disposés à la révolte, dépouillaient l’abbaye de Murbach de ses droits et de ses biens. La réconciliation ne fut pas de longue durée, parce qu’elle ne pouvait être sincère. Enfin, fatigué de leurs révoltes toujours renaissantes, et désespérant de les maintenir sous son autorité et de retirer les rentes qu’ils lui devaient, l’abbé résolut de vendre au roi Rodolphe, en toute propriété, Lucerne et les droits que Murbach avait dans plusieurs villages et hameaux, tels que Malters, Kriens, Emmen, Littau, Kussenach, Stans, Alpenach, Sarnen. Il reçut en échange 2000 marcs 205 et cinq villages situés en Alsace. Le contrat, du 16 avril 1291 206 , se fit au nom du duc Albert.
La conclusion de ce marché dut effrayer les habitants des autres Waldstetten, qui à plusieurs reprises avaient essayé de secouer le joug du landgrave et de s’attribuer le pouvoir qu’il exerçait. Récemment encore les hommes de Schwyz et d’Uri avaient fait de nouveaux efforts pour s’arroger des droits seigneuriaux, ceux d’Uri en /86/ disputant au couvent d’Engelberg quelques propriétés, ceux de Schwyz en voulant soumettre à des taxes et à des services les biens et les gens du couvent de Steinen, et ils s’étaient attiré de sévères réprimandes accompagnées de menaces du lieutenant de l’empereur ou du landgrave. Voyez les documents du 11 août 1275 (Kopp, p. 10), du 7 janvier 1275 et du 24 avril 1289 (Tschudi I, 182. 198). Ces deux derniers documents sont conçus en termes qui donnent à entendre clairement sous quel rapport le roi Rodolphe et les princes de sa maison considéraient la vallée de Schwyz.
Les habitants de cette vallée ne pouvaient plus se faire illusion. Nous ignorons quelle démarche ils firent auprès du Roi. La lettre qu’il leur adressa le 19 fév. 1291 207 , dans laquelle il leur dit qu’il ne voulait pas qu’on leur donnât pour juge, c’est-à-dire pour amman, un homme de condition serve, ce qui signifie un homme non de la classe dite des hommes libres mais appartenant à quelqu’autre seigneur ou couvent, prouve: 1o que Rodolphe ne confirma pas la charte que Frédéric II avait accordée en 1240 aux vallées de Schwyz et d’Unterwalden; 2o que les Vallées ne choisissaient pas elles-mêmes leur juge ou amman, mais qu’il était nommé par le landgrave; 3o que par conséquent à cette époque les habitants des Waldstetten, notamment ceux de Schwyz et d’Unterwalden que concernait cette lettre, étaient encore sous la juridiction du landgrave. Aussi l’acquisition que la maison de Habsbourg-Autriche fit de Lucerne et de ses dépendances dut-elle inspirer une vive inquiétude aux Vallées.
Rodolphe Ier, dont la principale étude était de consolider l’Empire, de maintenir ce grand tout composé de tant de /87/ parties diverses, de poursuivre si non d’accomplir l’œuvre commencée par la Trêve-Dieu, nous voulons dire l’abolition des fréquentes querelles ou guerres privées des feudataires, la cessation de tous les excès, de tous les désordres, de tous les abus qu’engendrait le droit du plus fort, ordonna le 13 déc. 1281, à Mayence, le Landfriede ou la paix générale (pax generalis) du Rhin, qui devait comprendre tous le pays de Constance à Mayence et durer jusqu’à Noël 1286, qui, à la diète de Wurzbourg, 24 mars 1287, fut prolongée pour trois ans, et puis à Spire, en 1291, pour six ans, mais que l’on n’observa plus dès qu’il eut fermé les yeux. Ménageant la cour de Rome, il vécut avec elle en bonne intelligence sans cependant compromettre la dignité impériale. Il sut faire respecter son autorité dans toute l’étendue de l’Empire germanique, et mériter en même temps le beau nom de Clément. « Ce prince unissait aux vertus sociales qui font l’honnête homme, les qualités qui font l’homme d’état et le héros. En montant sur le trône, il avait trouvé l’Allemagne plongée dans la plus affreuse anarchie. La licence y avait pris la place des lois; tout était permis à la force, parce que nulle autorité n’était capable de la réprimer. Rodolphe, par sa prudence et sa valeur, vint à bout de rétablir le bon ordre et la tranquillité. Habile à manier les esprits, il sut contenir les grands par leur propre intérêt dans le devoir, et resserrer l’union près de s’anéantir entre le chef et les membres » 208 . Il fonda la grandeur de sa maison par des héritages, par le brillant succès de ses armes, et par une politique adroite, qui, au commencement de sa carrière, blessa quelquefois la justice: devenu roi, il fut un modèle d’équité. Non content d’observer scrupuleusement les formes, il donnait encore à ses subordonnés /88/ l’exemple de la modération. Un document du 16 sept. 1275 209 en est une preuve. Nommé — comme roi Rodolphe, ou, pour mieux dire, comme comte de Habsbourg, non comme roi des Romains — avoué de l’abbesse d’Essen, il prononça d’avance sa déchéance ou la perte légale du droit qu’il venait d’acquérir, si jamais il passait les bornes prescrites ou s’il abusait de son autorité. En se contenant dans les limites de la légalité, il se donnait le droit, la force de réprimer la hardiesse, la licence des avoués, et en faisant respecter les propriétés il favorisait le développement des libertés des communes.
Ce prince, qu’on appelle à juste titre le Restaurateur de l’Empire, termina sa longue et glorieuse carrière le 15 juillet 1291. Sa mort ébranla le trône et menaça d’une dissolution complète l’Empire, dont il avait maintenu l’intégrité par son génie et par sa fermeté.
Rodolphe n’avait pas réussi à faire élire son fils Albert roi des Romains. L’ayant proposé, l’an 1290, à la diète de Francfort, il ne put obtenir le consentement de cette assemblée. La puissance déjà considérable d’Albert et ses qualités personnelles contribuèrent à le faire rejeter. Elevé à l’école de son illustre père, décidé, comme lui, à maintenir l’autorité de l’Empire, maître de vastes possessions, fécond en ressources, doué de talents politiques et militaires, dominé par l’ambition, il paraissait trop redoutable aux grands, qui épiaient l’occasion de relâcher le lien qui les contenait, de rompre le rapport qui les unissait à l’Empire, et préféraient l’anarchie à l’ordre, parce qu’elle favorisait leurs projets ambitieux. Aussi la mort de Rodolphe fut comme le signal d’un désordre général, dont les princes, les seigneurs, les villes et les communes s’empressèrent de profiter pour s’attribuer autant de droits qu’ils pouvaient espérer de faire /89/ confirmer de gré ou de force par le souverain qui succéderait au roi défunt 210 . Les grands feudataires, aveuglés par l’égoïsme, ne prévoyaient pas les conséquences de leur conduite, ils ne comprenaient pas qu’en se détachant de l’Empire pour se rendre forts ils s’affaiblissaient et donnaient aux populations, sur lesquelles ils comptaient faire peser leur joug, un exemple dont elles profiteraient à leurs dépens. Sans s’en douter ils étaient des instruments de l’émancipation lente, il est vrai, mais progressive, des peuples. Ces dispositions à l’indépendance se manifestèrent dans plusieurs contrées de l’Empire, où se formèrent des fédérations. Mais c’est à l’Helvétie qu’appartient la gloire, je ne dirai pas d’avoir préparé le démembrement de l’Empire, car ce n’en serait pas une, et ce n’était pas son but, mais d’avoir la première arboré l’étendard de la liberté, et proclamé l’indépendance qui depuis si longtemps était l’unique objet de ses désirs, et qu’elle sut si bien défendre lorsqu’elle l’eut acquise! Déjà le 24 juillet, peu de jours après le décès de Rodolphe Ier, Zurich fit entendre le premier cri d’indépendance 211 ,que l’écho répéta dans les Waldstetten, dont les habitants suivirent aussitôt l’exemple que venaient de leur donner leurs voisins. Ifs dépassèrent même ceux-ci, car le 1er août 1291 ils publièrent la déclaration suivante, qui est leur premier pacte d’alliance perpétuelle, lequel, après avoir été ignoré pendant plusieurs siècles, fut découvert dans les archives de Stans 212 . Nous donnons ici la /90/ traduction de ce document, parce qu’il répand une vive lumière sur la confédération helvétique.
Premier traité d’alliance perpétuelle entre les trois Waldstetten Uri, Schwyz, Unterwalden.
« Au nom du Seigneur, Amen! C’est protéger son honneur et veiller à l’utilité publique que de consolider, comme il convient, les traités de paix et de tranquillité. Qu’il soit donc notoire à chacun que les hommes de la vallée d’Uri et de l’assemblée générale de Schwyz, ainsi que la communauté des montagnards de la Vallée inférieure, considérant la crise du temps présent, ont promis de bonne foi, pour être d’autant mieux en état de défendre leurs personnes et leurs biens, et pour mieux conserver les unes et les autres dans un état convenable, de s’assister réciproquement de secours, de conseils, de tout bon office, de bras et de biens, au-dedans et au-dehors des Vallées, en un mot, de tout leur pouvoir et de toutes leurs forces, contre tous ceux qui à eux ou à l’un d’eux fera quelque violence, quelque tort ou injure, en machinant quelque mal que ce puisse être contre /91/ leurs personnes ou leurs biens. Or, à tout événement, chacune des susdites communautés a promis à l’autre d’accourir à son aide lorsqu’il sera nécessaire, pour la secourir, à ses propres frais, selon qu’il faudra résister aux attaques des malveillants ou venger une injure, prêtant, aux fins de rester fidèles à ces promesses, un serment sans dol et sans fraude, et renouvelant par le présent acte l’ancienne forme de notre confédération déjà confirmée par serment 213 . En telle sorte, toutefois, que chacun des dits hommes qui a un seigneur sera tenu de lui montrer de l’obéissance et de le servir conformément à sa condition et à son devoir 214 .
Nous sommes convenus, avons décrété et résolu d’un commun accord, à l’unanimité, de ne recevoir et de n’admettre dans les Vallées ci-dessus nommées, aucun juge (amman) qui aurait acheté sa charge 215 à prix d’argent, ou de quelqu’autre manière, ou qui n’habitera pas parmi nous et ne sera pas notre compatriote. S’il s’élève quelque dissention parmi les confédérés 216 , les plus prudents parmi /92/ eux devront intervenir pour assoupir la discorde entre les parties, et celà par les moyens qui leur paraîtront les plus expédients; dans le cas où l’une des parties rejettera leur décision, les autres confédérés l’obligeront de s’y soumettre. Avant tout, il est statué par les confédérés que si l’un d’entre eux en tue un autre par surprise et sans coulpe ou faute de celui-ci, et qu’on le saisisse, il sera puni de mort, à moins qu’il ne puisse prouver son innocence 217 d’un pareil crime, laquelle pourra seule le soustraire à la peine qu’encourt un si odieux délit, et s’il s’est évadé il ne pourra jamais rentrer dans le pays. Ceux qui récéleront ou protégeront un tel malfaiteur, seront bannis des Vallées jusqu’à ce que les confédérés les rappellent sous condition. Si quelqu’un a causé dommage à l’un des confédérés par incendie, soit de jour, soit de nuit, en secret et à dessein, il perdra à jamais ses droits de concitoyen, et celui qui cachera et défendra un tel malfaiteur sera tenu de donner satisfaction à celui qui aura reçu le dommage.
De plus, si un des confédérés en dépouille un autre de ses biens, ou lui porte dommage de quelque manière que ce soit, si le coupable a des possessions dans les Vallées, on les retiendra pour procurer selon la justice un dédommagement à la partie lésée. En outre, personne n’a droit /93/ de pignoration sur un autre, si celui-ci n’est reconnu débiteur, ou caution, et il ne l’aura jamais sans l’autorisation spéciale de son juge (amman).
Enfin, chacun doit obéir à son juge et, s’il est nécessaire, désigner le juge dans les Vallées auprès duquel il doit se pourvoir en droit. Et si quelqu’un refuse de se soumettre à son jugement, et que par son obstination quelqu’un des confédérés éprouve du dommage, tous les autres confédérés seront tenus de forcer le susdit contumace à l’indemnité. En cas de guerre ou de discorde entre des confédérés, si l’une des parties litigantes ne veut pas se prêter à une décision de droit, ou à une satisfaction entière, les autres confédérés se joindront à sa partie adverse.
Les ordonnances et réglements ci-dessus, sagement établis pour notre utilité commune, dureront, avec l’aide du Seigneur, à perpétuité. En témoignage manifeste de la chose, et à la demande des susdits confédérés, le présent instrument a été muni des sceaux des trois communautés et Vallées ci-dessus mentionnées. Fait l’an du Seigneur mil deux cent nonante et un, à l’entrée du mois d’août. »
En ne considérant dans cet acte que la question de droit par rapport à la constitution de l’Empire germanique, on conçoit qu’il a pu être quelquefois empreint du nom de rébellion. Sans entrer à cet égard dans une discussion profonde, qui nous ménerait trop loin, nous nous contenterons de proposer, à l’exemple de M. Kopp (p. 35), deux questions que nous accompagnerons de quelques réflexions:
1o « Les trois Vallées n’ayant pas le droit de haute juridiction dans leurs marches ou limites, qui leur donnait le droit de limiter, par quelque condition que ce fût, le seigneur haut-justicier dans le choix de ses juges ou de ses officiers? »
2o « Comme le droit de glaive était incontestablement /94/ exercé par le landgrave, et que les Vallées n’avaient aucune part à la haute juridiction ou à la haute police, qui pouvait les autoriser à s’arroger les droits du landgrave? »
Pour résoudre ces questions, il ne suffit pas de considérer la féodalité sous un seul point de vue, de répéter « qu’elle ne fut qu’une usurpation du pouvoir monarchique par ses délégués. » La féodalité ne fut pas seulement un temps d’usurpation d’un côté, d’esclavage d’un autre, un temps de barbarie, de grossière ignorance et de désordre. Suite nécessaire du bouleversement des empires et de la ruine de l’ancienne civilisation, elle devait servir, dans les desseins de la Providence, à préparer une civilisation nouvelle et meilleure. Elle avait un temps à parcourir, une grande mission à remplir. D’elle devaient naître, avec les progrès du christianisme et l’éducation des peuples, des institutions nouvelles, qui forment la base de l’ordre social, le fondement des libertés publiques. Si, considéré sous le rapport du droit établi par le conquérant, des lois imposées par le plus fort au plus faible, le pacte du 1er août 1291, comme d’autres qu’il fit naître, est à la vérité un acte de résistance ouverte aux ordres, à la volonté du suzerain, à d’autres égards la démarche significative des premiers confédérés, leur conduite hardie est pleinement justifiée tant par l’abus que les avoués, les subordonnés ou les officiers du landgrave faisaient de leur pouvoir, par la vénalité de leurs charges, autre source de maux, que par l’esprit d’indépendance qui depuis la mémorable querelle du Sacerdoce avec l’Empire s’était développé en Europe, notamment en Italie et en Germanie, ainsi que par les encouragements que divers princes donnaient aux peuples sur lesquels ils devaient s’appuyer pour empêcher les empiétements des grands vassaux qui, donnant en toute occasion l’exemple d’une dangereuse insubordination envers leur suzerain, avaient mauvaise grâce /95/ à qualifier, dans leurs rapports avec les peuples, de droit et de légitimité ce que, dans leurs rapports avec le chef de l’Empire, ils appelaient usurpation.
Remarquez que les habitants des Waldstetten, en formant une association dans le but d’obtenir certains droits et d’améliorer leur condition sociale et politique, ne cherchèrent point à se détacher de l’Empire, dont la protection leur était nécessaire; qu’ils n’attaquèrent point directement les droits du chef de l’Empire, mais qu’ils se proposèrent de diminuer, de réduire à rien s’il était possible, le pouvoir despotique des avoués, dont plus d’un empereur même avait hautement désapprouvé les exactions de tout genre. Quand on entend parler du droit, du pouvoir légitime des subordonnés du landgrave, on demande naturellement sur quoi était fondé ce droit, ce pouvoir, et jusqu’à quel point les peuples avaient concouru à son établissement. Si l’acte d’insurrection de 1291 ne pouvait pas se justifier par les circonstances qui l’amenèrent, si la révolution des peuplades alpestres ne pouvait être approuvée, ou même excusée, quelle révolution, soit antérieure, soit postérieure à celle-là, mériterait le nom de légitime? Enfin, n’oublions pas qu’on était alors à la fin des croisades qui, par leurs causes et leurs résultats, contribuèrent singulièrement à l’émancipation des peuples, à l’adoucissement de leur sort, en leur facilitant l’obtention des droits qu’ils réclamaient à juste titre comme membres de l’humanité, et préparèrent un monde meilleur en changeant la face de l’Europe. Une force irrésistible poussait les hommes à l’indépendance, à la conquête de la liberté.
Tandis que l’Allemagne était livrée à une nouvelle anarchie, qui dura neuf mois, les hommes des Vallées poursuivaient courageusement l’œuvre qu’ils avaient commencée. Ceux de Schwyz et d’Uri firent, le 16 oct. 1291, avec la /96/ ville de Zurich un traité d’alliance défensive pour trois ans, qui devenait obligatoire dès Noël, et dont voici les articles principaux: « Rien de ce qui s’est fait jusqu’à présent de part et d’autre ne nous lie 218 . Tout homme 219 qui a un seigneur auquel il appartient, doit le servir selon la coutume et le droit comme avant la mort du Roi (Rodolphe); mais si le seigneur exige de lui plus qu’il ne peut exiger de droit, les parties contractantes protégeront l’opprimé 220 . Si l’une des parties contractantes veut occuper un château contre l’avis des deux autres, celles-ci ne seront engagées à rien par cette entreprise; si dans le (du?) château 221 se commet /97/ quelque dommage par incendie, ou par dégâts, les confédérés doivent s’aider de conseils et de secours contre ceux qui auront usé de violence. Ceux de Zurich s’engagent à repousser toute agression faite dans le pays de Schwyz ou dans celui d’Uri; les habitants de ces vallées, à leur tour, promettent d’attaquer vigoureusement ceux qui endommageront la ville de Zurich, ses vignes ou ses arbres, et, s’ils ne peuvent les chasser, de leur nuire par le fer et par le feu. Si quelqu’un de ceux pour qui cet acte est obligatoire refuse de s’y conformer, personne ne le soutiendra; si l’une des parties contractantes jure de nouveau fidélité à un seigneur, les autres ne seront pas tenues de faire la même chose 222 , etc. — « Le conseil et les bourgeois de Lucerne; Arnolt maire de Silennun, Lantamman, et les hommes d’Uri; Chvonrat ab Iberg Lantamman et les hommes de Schwyz firent ce pacte. Six hommes de Zurich: Mulner, Manesse, Beggenhofen, chevaliers, Gault. de S. Pierre, Bibirlin et Conrad Chrieg (Krieg), bourgeois; trois d’Uri, Werner d’Attinghausen, Burkart, ancien amman, et Conrad /98/ maire d’Oertschon 223 ; trois de Schwyz, Conrad ab Iberg, Landamman, Rodolphe Stauffacher et Conrad Hunnen furent garants de ce traité, dont chacune des parties contractantes reçut une copie.
Les clauses en furent arrêtées et signées à Zurich, le jour de S. Gal, Ind. V (indiction césaréenne), c’est-à-dire le 16 oct. 1291. Jos. Simler, dans son ouvrage de Rep. Helvet. éd. Elzev. p. 38-39; son traducteur H. J. Leu, von dem Reg. der Lob. Eydgen. 2e édit. p. 37-39; Tschudi I, 148-149; et Muller I, 512, ont rapporté mal à propos cet acte à l’an 1251. Muller ajoute, qu’il paraît avoir été renouvelé en 1254. Cette grave erreur s’est propagée jusqu’à nos jours, quoique ni l’indiction, ni les circonstances ne coïncident avec la date de 1251. Nous devons à l’esprit d’observation, à la sagacité de M. Kopp la découverte de cette erreur, le rétablissement de la date, et à l’exactitude diplomatique de ce savant la véritable leçon de ce document qui est conservé aux archives de Zurich 224 .
Schwyz qui, comme Sarnen (dont l’absence à cette occasion a lieu de nous étonner 225 ), s’était déjà fortifié vers le milieu du 13e siècle 226 par une alliance avec Lucerne, alliance qui, annulée par l’acquisition que l’Autriche fit de cette ville et de ses dépendances, n’obligeait plus à rien, n’offrait plus d’appui, voulut, avec Uri, chercher un nouveau soutien dans la ville de Zurich, qui à son tour en trouvait un puissant dans les Vallées. /99/
Cette démarche hardie ne pouvait manquer d’exercer quelque influence. Des alliances nombreuses devaient prêter une grande force aux fédérés et leur offrir la chance d’obtenir du nouvel empereur la confirmation des droits qu’ils venaient de s’attribuer. Il n’était pas difficile de prévoir que d’autres villes, d’autres vallées suivraient l’exemple de Zurich, de Schwyz et d’Uri. En effet, le 29 nov. de la même année la comtesse Elisabeth de Raprechtswile accéda aussi pour trois ans à la ligue formée contre la maison de Habsbourg-Autriche 227 , et Rodolphe, évêque de Constance, en fit de même 228 . Il n’y a pas de doute qu’une pareille tentative de la part de Lucerne, ville depuis longtemps inquiète et inquiétante, n’ait provoqué le diplôme du 20 déc. 1291, par lequel Ulrich vom Thore, nommé récemment Vogt ou Avoué de Habsbourg-Autriche, lui garantit les priviléges et les coutumes dont elle jouissait sous les avoués de Rothenbourg auxquels il était appelé à succéder 229 . Les efforts que venaient de faire, ou que firent un peu plus tard, les Lucernois pour se détacher de la maison de Habsbourg-Autriche ne furent pas couronnés d’un heureux succès. Le 31 mai 1292 le conseil et les bourgeois de Lucerne jurèrent fidélité à leurs seigneurs Albert duc d’Autriche, comte de Habsbourg, de Kibourg, et landgrave d’Alsace, et Jean, son neveu, leur promettant solennellement de respecter leurs droits et leurs propriétés, ainsi qu’ils avaient coutume de le faire envers l’abbé et le monastère de Murbach, avant qu’ils passassent sous la domination des ducs d’Autriche. En revanche, le duc Albert leur promit le même jour, en son nom et au nom de son neveu et pupille, de maintenir /100/ tous les droits et priviléges dont ils jouissaient du temps de la domination des abbés de Murbach 230 .
Depuis peu de jours l’Empire avait un chef. Après un interrègne d’environ dix mois, qui avait laissé un libre cours aux passions, Gérard d’Eppenstein, archevêque de Mayence, était parvenu à faire élire son parent Adolphe de Nassau, à qui le duc Albert disputa le sceptre.
Il importe, ne fût-ce que pour pouvoir s’expliquer la cause des guerres qui dans la suite eurent lieu entre ces deux rivaux, de savoir si Albert, duc d’Autriche, prétendant à la couronne impériale, prêta serment d’allégeance ou de fidélité à Adolphe son suzerain. Le défaut de documents propres à rétablir l’ordre des faits et des dates dans les récits confus des chroniqueurs, semble rendre impossible la solution de ce problème. M. Kopp, qui s’en est occupé, pense (p. 52) qu’il n’y a que les archives d’Autriche qui puissent nous fournir les moyens de lever les difficultés que présente cette question.
Tschudi prétend (I, 207, b.) qu’Adolphe fut élu le 16 janvier 1292, que le duc Albert lui rendit foi et hommage avant d’entreprendre la guerre contre Zurich et Constance qui s’étaient ligués contre sa maison, que cette guerre se termina par la bataille que les Zuricois perdirent, selon lui (I, 209, b.), le 13 avril 1292. Or, à cette époque Adolphe de Nassau n’était pas élu roi des Romains. Il y a du vrai et du faux dans le rapport de Tschudi. Ailleurs (I, 208) il dit positivement qu’Albert obtint du roi Adolphe non-seulement l’investiture, mais encore — ce qui en était une conséquence — la permission, l’autorisation d’agir comme il jugerait convenable envers ses ennemis et ceux qui s’étaient soulevés contre son autorité, c’est-à-dire de prendre les /101/ armes, d’employer la force pour les ramener au devoir. — Il s’agit des Zuricois, des hommes des trois Vallées, de l’évêque de Constance, du comte de Nellenbourg et d’autres qui voulaient se soustraire à l’autorité du Duc-landgrave ou du Comte-duc. — Cette autorisation de la part du chef de l’Empire suppose nécessairement l’investiture qui, à son tour, ne pouvait être que la suite de l’accomplissement des devoirs du vassal envers son suzerain. Ce qui vient à l’appui de cette observation, c’est une clause du traité de paix qu’Albert fit (le 26 août) avec les Zuricois après leur défaite: « chacune des parties contractantes se réserve le roi des Romains 231 , et déclare que si l’une devient l’ennemie du Roi, l’autre au contraire lui donnera du secours. » Albert n’était donc pas alors ouvertement ennemi d’Adolphe: il fallait nécessairement qu’il lui eût rendu foi et hommage, soit en personne, soit d’une autre manière, qu’il eût reconnu ce nouveau chef de l’Empire légitimement élu et couronné, et qu’il en eût obtenu l’investiture de l’Autriche et de ses fiefs en Helvétie. Adolphe fut-il facile envers Albert pour l’apaiser, le gagner? Albert eut-il recours à la feinte ou se soumit-il à la nécessité? observa-t-il envers le nouveau roi de Germanie les formalités d’usage pour ne pas être accusé d’avoir forfait, et pour être d’autant mieux en état de renverser son rival en s’affermissant dans la possession des nombreux fiefs dont sa maison avait été investie? Quoiqu’il en soit, il est hors de doute qu’Albert rendit foi et hommage /102/ au Roi, probablement dans le mois de mai 232 , avant de faire la guerre à Zurich et à l’évêque de Constance. Pouvait-il et, dans les circonstances où il se trouvait, devait-il l’entreprendre sans le consentement du roi des Romains? — Tschudi a sans doute raison quand il dit qu’Albert s’acquitta de ses devoirs envers son suzerain et qu’il obtint l’investiture qu’il désirait.
Mais, selon notre annaliste, à cette époque, c’est-à-dire au mois de mai, la guerre entre le duc et les Zuricois était terminée par la défaite que ceux-ci avaient essuyée le 13 avril 1292.
Cette date, considérée comme celle de la défaite des Zuricois, est aussi peu exacte que celle du 16 janvier que Tschudi croit être le jour de l’élection d’Adolphe. L’élévation du comte de Nassau à l’Empire eut lieu au commencement du mois de mai 1292 (le 1er de ce mois selon l’Art de vérifier les dates, IIe série, T. VII, p. 354; le 5 selon M. Kopp, p. 52). Si Albert n’entreprit la guerre contre Nellenbourg, Constance, Zurich qu’après le 31 mai 1292, lorsqu’il eut réglé à Lucerne ce qui concernait les droits de sa maison et ceux de cette ville 233 , et pris des mesures afin de n’avoir rien à craindre pour le moment du côté des Waldstetten, il faut que Tschudi ait commis une erreur que J. de Muller (I, 610. n. 67) n’a pas remarquée. Selon Tschudi (I, 209), Stumpff (an 1292), Simler (de Rep. Helv. p. 100-101, ou p. 94 de la trad. allem.), les Zuricois, ligués avec l’abbé de S. Gall et l’évêque de Constance, parurent devant Winterthur (le 11 avril selon Tschudi), battirent (le 12 avril selon Stumpff) la garnison commandée par Hugues de Werdenberg, lieutenant d’Albert, qui voulait les repousser, /103/ commencèrent le siège de la ville, mais furent entièrement défaits le lendemain, dit Simler sans préciser la date, ou le 13 avril selon Stumpff et Tschudi 234 . Mais les circonstances qui précédèrent cette défaite et que Tschudi n’a pas omises, sont de nature à nous faire supposer que les Zuricois restèrent assez longtemps établis devant Winterthur; car, selon C. Justinger (p. 48), « ils commencèrent le siège de cette ville le 13 avril 1292 235 , mais ils attendaient pour l’attaquer que l’évêque de Constance leur eût envoyé le secours qu’ils lui avaient demandé: Hugues de Werdenberg — qui sans doute avait intercepté la lettre adressée à l’évêque — leur fit parvenir une réponse supposée qui leur annonçait l’arrivée d’un renfort: pour donner le change à l’ennemi il fit avancer un corps de troupes portant la bannière de l’évêque; lorsqu’il les vit s’approcher des Zuricois, il sortit à l’improviste avec la garnison et des habitants de la ville: les deux corps se précipitèrent sur les assiégeants, les défirent et en tuèrent un grand nombre» 236 . /104/
Qui croira que tout celà ait pu se faire dans le court espace de vingt-quatre heures? Il faut que la bataille de Winterthur, qui força les Zuricois à se réconcilier avec Albert, se soit livrée tout au plus quelques semaines avant la conclusion de la paix. On pouvait se demander: « D’où vient que le duc Albert qui, menacé de divers côtés, devait agir avec vigueur et promptitude, sans manquer de prudence, attendit plus de quatre mois avant de faire rentrer dans le devoir les Zuricois que son lieutenant avait complètement défaits? » Une telle lenteur était incompatible avec le caractère de ce prince. Peu de temps après cette victoire, le 26 août, la paix entre le duc et Zurich fut résolue dans cette ville, et le 29 suivant l’acte en fut dressé et signé à Winterthur. Cette paix se fit au nom du duc Albert et de son neveu le duc Jean, dont il était le tuteur 237 .
Ainsi ceux de Lucerne, de Zurich, de Constance avaient fait de vains efforts pour se rendre indépendants du landgrave, duc d’Autriche. Albert venait de rompre l’association des parties de l’Helvétie qui s’étaient unies par des traités ou qui étaient entrées dans la ligue du 16 oct. 1291, formée contre sa maison.
Le lundi de pâques (30 mars) 1293 les bourgeois de Lucerne jurèrent, devant l’avoué Otton d’Ochsenstein, la paix générale 238 , qui, ordonnée par Rodolphe Ier le 24 mars 1287, prolongée à Spire en 1291, mais négligée depuis la /105/ mort de ce prince, fut renouvelée à Cologne par son successeur, le 2 oct. 1292 239 . En même temps ils se réservèrent leurs droits et priviléges, ou plutôt le maintien de la constitution intérieure de leur ville, que Rodolphe Ier avait reconnue et confirmée par lettres patentes du 9 mai 1282 et du 1er novembre 1281 240 .
Otton d’Ochsenstein essaya d’obtenir des habitants des Vallées ce qu’il venait d’obtenir de ceux de Lucerne: son entreprise échoua contre la résolution qu’ils avaient prise de se rendre indépendants du landgrave.
Jurer la paix générale, c’était s’engager à n’entreprendre aucune hostilité, à faire cesser toute guerre ou querelle, à ne troubler en aucune façon la paix du Pays, à respecter la constitution de l’Empire, à se rendre aux assises provinciales ou aux plaids généraux du landgrave. La prestation du serment de fidélité, qui devait avoir lieu à l’avénement d’un nouvel empereur, ou d’un nouveau seigneur, était un engagement que les vassaux prenaient envers leur seigneur de respecter ses droits, de le servir en toute occasion, de combattre pour lui en certains cas dans le pays soumis à sa juridiction, de le défendre de leur propre corps. Le refus de remplir cette obligation était considéré comme un acte de rébellion. /106/
« En 1293 », dit Tschudi I, 212, « Adolphe envoya son maréchal Hildebrand de Pappenheim en Helvétie pour y recevoir, au nom du roi des Romains, les témoignages de fidélité. S. Gall, Constance, Zurich, Berne et d’autres villes répondirent à l’appel qui leur fut fait, mais les trois Waldstetten Uri, Schwyz et Unterwalden déclarèrent qu’elles ne rendraient foi et hommage au Roi que quand il aurait confirmé leurs priviléges » 241 .
Refuser au chef de l’Empire hommage et fidélité, c’était le refuser au landgrave, son vicaire, au seigneur, son vassal. Les Waldstetten, en ne jurant pas la paix générale, se mirent par leur refus en état de résistance ouverte aux ordres de leur souverain et de guerre avec la maison de Habsbourg-Autriche. C’est maintenant que l’on saisit toute la portée des pactes du 1er août et du 16 oct. 1291.
Mais le duc Albert avait déjà rompu la ligue de ses adversaires: les deux vallées de Schwyz et d’Uri restaient seules debout contre un prince qui avait fait preuve d’habileté, et dont les forces étaient redoutables.
Deux documents, l’un du 30 mars, l’autre du 10 avril 1293 242 font mention des hostilités commencées par les montagnards (Waltlüten) ou hommes des Waldstetten, en particulier par ceux d’Uri. Le dernier nous apprend, entre autres, que Werner, avoué 243 de Baden, procureur ou procurateur 244 d’Albert dans l’Argau, fit arrêter à Lucerne des /107/ marchandises qui, destinées pour l’Italie, devaient traverser la vallée d’Uri; qu’il employa cette mesure de rigueur parce que les hommes de cette vallée avaient excité la discorde et la guerre; mais que, mu par les prières des Italiens intéressés à la chose, il permit le transport des marchandises. Uri n’était pas, il est vrai, propriété de l’Autriche, mais il était sous la juridiction de l’Argau, et le landgrave pouvait avoir recours à cette mesure, qui était une espèce de blocus, pour empêcher tout commerce avec les insurgés, les isoler et les forcer ainsi de rentrer dans le devoir. La conduite de cet officier, qui accorda facilement le passage qu’on lui demandait, et la mesure employée contre Uri, prouvent ou que le duc Albert, qui ne pouvait trop compter sur la fidélité de Lucerne, de Zurich, de Constance, craignait de s’engager dans les Alpes s’il usait de rigueur envers les montagnards dont les dispositions lui étaient hostiles, ou que, laissant aux insurgés le temps de la réflexion, il voulait obtenir par la douceur ce que peut-être il lui aurait été facile d’obtenir par la force, alors que ce petit peuple, quoiqu’intrépide, n’était pas encore prêt à soutenir une lutte sérieuse. Quelques années plus tard les choses étaient changées; l’Autriche n’avait plus les mêmes chances de succès!
Pendant qu’Albert soutenait et défendait les droits de sa maison, Adolphe travaillait à rétablir l’autorité impériale qui avait reçu de rudes atteintes par les désordres de l’interrègne. Mais, bien qu’issu d’une maison illustre, ce prince, sans autre fortune que ses talents et son épée, ne pouvait consolider l’Empire, ni se maintenir sur un trône chancelant que les grands feudataires, mus par l’ambition, /108/ s’efforçaient d’ébranler toujours davantage, au lieu de le soutenir. Adolphe avait l’intention, le désir de conserver l’Empire dans son intégrité. Il entreprit même, à l’exemple de son prédécesseur, le rétablissement du royaume d’Arles, pour affermir la puissance de l’Allemagne en affaiblissant celle de la France. Après avoir échoué dans cette entreprise, il s’engagea imprudemment dans une longue guerre avec la Thuringe. Déconsidéré par une lutte dont il ne sortait pas victorieux, joué des grands, qui conspirèrent contre lui, surtout de son parent l’archevêque de Mayence, qui, trompé dans l’espoir qu’il avait conçu de ne laisser au nouveau chef de l’Empire qu’un pouvoir nominal, travaillait à sa déposition avec le même zèle qu’il avait mis à procurer son élection, inquiété par son rival Albert d’Autriche, qui jouissait d’un crédit proportionné à sa puissance, Adolphe, dont la position devenait de jour en jour plus critique 245 , eut enfin recours aux moyens qu’avait employés l’empereur Frédéric II dans sa disgrâce; il voulut se faire des amis 246 , et dans son embarras, il finit (30 nov. 1297) par prêter l’oreille aux sollicitations des habitants des Waldstetten, qui demandaient la confirmation de leurs libertés. Ce qui est digne de remarque, c’est qu’Adolphe leur donna exactement la même charte que leur avait donnée Frédéric II, en 1240: il n’y a de changé que le nom du souverain, la date et le nom du lieu où elle fut signée 247 . /109/
Si cet acte était un crime aux yeux d’Albert, dont il compromettait l’autorité, un crime bien plus grand aux yeux de l’archevêque de Mayence, à qui le comte de Nassau avait fait des promesses que l’Empereur ne pouvait tenir, fut qu’Adolphe refusa d’aliéner de l’Empire des domaines dont il ne pouvait disposer. Cité au collège électoral de Mayence 248 , où il ne parut pas, il fut déclaré contumace et déposé. Gérard d’Eppenstein opéra sa déchéance et fit élire à sa place Albert duc d’Autriche 249 . Adolphe résolut de défendre sa couronne, ou de périr les armes à la main. Le 2 juillet 1298 les deux rivaux se livrèrent entre Gellheim et Rosenthal un combat meurtrier, qui coûta au malheureux Adolphe le sceptre et la vie. Dès-lors Albert fut seul maître de l’Empire.
Il se peut que les habitants des Waldstetten, qui avaient complimenté Rodolphe à son avénement au trône impérial, et qui probablement avaient observé la même formalité envers son successeur Adolphe, aient envoyé leurs félicitations à Albert, qu’ils l’aient même prié de confirmer le diplôme qu’ils avaient reçu de Frédéric II et dont Adolphe venait de leur délivrer une copie; il se peut, disons-nous, qu’ils n’aient pas craint de faire cette démarche hardie auprès du nouveau chef de l’Empire, leur landgrave, quoiqu’ils se fussent ligués contre lui et que depuis plusieurs années ils bravassent ouvertement son autorité. En admettant même cette hypothèse, croira-t-on, avec Tschudi I, 220, qu’immédiatement après son élévation à la dignité suprême ils l’aient prié « de confirmer leurs privilèges comme à gens /110/ qui avaient reçu des chartes des empereurs précédents, même de son père, et qui n’appartenaient qu’à l’ Empire? » peut-on, à cet égard, ajouter foi à cet annaliste, quand on connaît les rapports des Waldstetten avec l’Empire, et que l’on sait que Rodolphe Ier ne reconnut point la charte de Frédéric II, et qu’Adolphe, sans la reconnaître, leur en délivra, dans sa détresse, une copie comme un acte émané de lui dans un moment où il cédait à une impérieuse nécessité? — La réponse que Tschudi met dans la bouche d’Albert, « que des affaires trop pressantes l’empêchaient pour le moment de s’occuper du sujet de leur demande, » n’a pas plus de sens que celle qu’il lui prête à l’occasion de nouvelles réclamations de la part des Waldstetten: « qu’il leur ferait des propositions qu’il pensait leur être utiles et devoir être agréées, » ou que les représentations d’Albert sur les avantages que pouvaient retirer des pays réunis sous son sceptre. Albert n’avait aucune proposition à leur faire. La conduite qu’il devait observer envers les Waldstetten était tracée par la constitution de l’Empire et les attributions du landgrave. Quand Tschudi allègue comme un des principaux motifs de leur crainte, de leur inquiétude, le défaut d’un préfet impérial pour administrer le droit du glaive, il se trompe; car, comme les droits et l’office du landgrave ne cessaient pas d’exister à la mort d’un empereur, le droit de haute juridiction, de haute police était exercé pendant l’interrègne 250 ; d’ailleurs, comme on le verra bientôt, il n’y avait pas eu d’interruption dans la succession des Landgraves ou des Landrichter, c’est-à-dire des haut-justiciers, à qui /111/ appartenait l’exercice du droit de glaive, qu’ils pouvaient au besoin déléguer à l’avoué (Vogt). Nous avons vu, p. 12. que l’avoué pouvait prononcer la peine capitale au nom du comte ou de son lieutenant. — Du reste, on sait que le landgrave devait rendre foi et hommage au nouveau roi de Germanie et lui demander l’inféodation des offices qu’il avait eus jusqu’alors, ou l’investiture, que le souverain pouvait lui refuser.
Le prétendu message dont Tschudi (I, 225 et suiv.) et Muller (I, 633) disent qu’Albert chargea, en 1300, les barons de Lichtenberg et d’Ochsenstein se réduit à une simple commission, à un ordre que devait communiquer, en 1293, aux habitants des Vallées Otton d’Ochsenstein (neveu du feu roi Rodolphe), landvogt ou avoué provincial d’Alsace, chargé par Albert duc d’Autriche, landgrave d’Alsace, de l’Argau et du Zurichgau, de faire jurer aux Lucernois, ainsi qu’aux habitants des autres Waldstetten, la paix générale; ce à quoi ces derniers se refusèrent, parce que par cet acte solennel ils auraient prêté foi et hommage et pris l’engagement d’assister aux plaids du comte, de reconnaître sa juridiction, d’éviter soigneusement tout ce qui pouvait troubler l’ordre et la tranquillité, eux qui avaient déjà commencé les hostilités 251 . Tschudi emploie une abondance de paroles inutiles et dépourvues de sens: voulant expliquer des faits dont il n’a pas la clef, il les altère, ou pour mieux dire, loin de faciliter l’intelligence des choses qu’il a cru comprendre, mais qu’il n’a pas comprises, il les rend encore plus obscures. Pourquoi le duc-landgrave, pourquoi le roi des Romains aurait-il entamé des négociations avec les Waldstetten? S’il eût eu le dessein de leur imposer des devoirs qu’il n’avait /112/ pas le droit d’exiger d’eux, ou de les forcer à se soumettre, c’eût été probablement chose assez facile à ce prince qui avait triomphé d’ennemis plus nombreux. Dans un temps où les hommes libres, ou proprement demi-libres, aspiraient seuls à de plus grandes prérogatives qu’à celle du droit de commune, dont ils étaient déjà en possession, le puissant duc d’Autriche aurait obtenu peut-être sans peine ce que ses successeurs tentèrent en vain lorsque tous les habitants des Waldstetten, unis pour leur défense commune et encouragés par quelques succès, eurent le sentiment de leur force et que, prêts à soutenir une lutte opiniâtre, ils marchèrent au combat résolus de vaincre ou de mourir.
Sans nous arrêter plus longtemps à l’allée et au retour de ces messages inutiles, qui se réduisent, d’un côté, à l’envoi d’un commissaire ou avoué du duc-landgrave pour faire reconnaître son autorité, et d’un délégué du Roi pour demander la prestation d’hommage et de fidélité, de l’autre, à une simple mission des Vallées pour complimenter le nouveau chef de l’Empire et lui demander la confirmation de certains priviléges, demande qui ne put être suivie que d’un refus formel et de l’ordre de remplir les obligations qui les liaient envers leur seigneur, reprenons le fil des événements.
Nous devons cependant prévenir le lecteur que la disette de documents relatifs à cette époque et le silence des chroniqueurs ne nous permettent pas de suivre avec une exactitude scrupuleuse le développement des idées d’indépendance ou d’émancipation qui, surtout depuis 1291, s’étaient manifestées dans les vallées alpestres de la manière la plus énergique, ni d’énumérer toutes les collisions qui probablement eurent lieu entre les habitants de ces vallées et les officiers du landgrave. Ce silence et le caractère d’Albert qui, marchant sur les traces de son père, résolut de maintenir dans son intégrité la constitution de l’Empire germanique, nous /113/ autorisent à croire que ce prince qui, comme son père, ne reconnaissait pas la charte de 1240 donnée par Frédéric II, voulait faire respecter son autorité dans les Vallées, mais sans avoir recours pour le moment à des mesures de rigueur; car, dans cette époque si agitée, des incidents d’une nature plus grave que ne paraissait l’être l’opiniâtreté des pâtres des Alpes, tels que les démêlés d’Albert avec Boniface VIII, la croisade qu’il devait entreprendre après sa réconciliation avec ce souverain pontife contre Philippe-le-Bel roi de France, — vain projet auquel se rattachait le plan du rétablissement du royaume d’Arles, — des troubles dans les provinces de Hollande, de Zélande et de Frise, la guerre avec les électeurs du Rhin, absorbaient ce prince qui voulait tout à la fois affermir l’autorité impériale, maintenir la paix générale et consolider la puissance de sa maison.
Pendant que ces graves événements l’occupaient tout entier, les hommes des Waldstetten ne demeuraient pas inactifs. Ceux de Schwyz firent de nouvelles tentatives pour acquérir des droits seigneuriaux sur le couvent de Steinen. La reine Elisabeth, épouse d’Albert, fit parvenir aux ammans et à la communauté de Schwyz une lettre datée de Nuremberg, dans l’octave de l’Epiphanie 1299, pour les informer qu’elle prenait ce couvent sous sa protection, leur défendant de porter dommage à ses propriétés et à ses libertés. Le même jour elle leur en adressa une autre, dans laquelle, après leur avoir dit que du consentement du roi son époux elle avait pris ce couvent sous sa protection, elle exprima au Landamman de Schwyz son étonnement de ce que, de l’aveu des ammans, il avait frappé ce couvent d’un impôt de L. 7. 1 s. , et lui ordonna de rendre cet argent injustement exigé, de laisser à l’avenir ce couvent jouir en paix de ses franchises et de n’inquiéter en aucune façon les /114/ religieuses 251 bis . — Il est indubitable qu’en 1302 l’autorité d’Albert était encore reconnue dans le pays de Schwyz; car, en cette année une avalanche y ayant causé des dégâts et rendu impraticable la route entre Morschach et Schwyz, l’évêque de Constance, dont le diocèse comprenait le pays de Schwyz, usant de son pouvoir ordinaire, accorda, sauf l’autorité de son seigneur le roi Albert, aux habitants de la Vallée, que la chûte des neiges et l’éboulement des terres empêchaient de se rendre à l’église paroissiale de Schwyz, la permission de se servir de la chapelle de Morschach en guise de temple, et d’y avoir un prêtre qui pût y distribuer la communion, y célébrer le service funèbre, etc. Albert, en sanctionnant, comme chef de sa maison et au nom de ses fils, l’autorisation accordée par l’évêque, déclara positivement que son approbation ne devait en aucun temps porter préjudice au patronage des églises exercé par ses fils, c’est-à-dire au droit qu’ils avaient de nommer aux bénéfices, aux églises des pays qui étaient sous la domination des princes de Habsbourg-Autriche 252 .
Cette déclaration expresse montre avec quelle attention scrupuleuse Albert cherchait à maintenir dans les Waldstetten les droits de sa maison, qui depuis longtemps y étaient méconnus, ou du moins compromis. Il ne fut pas moins attentif à faire respecter dans le pays d’Uri les droits et l’autorité de l’Empire, en ordonnant à l’amman de la vallée d’Uri (ministro vallis Uraniæ) ou au landamman d’Uri, de laisser l’abbé et le couvent de Wettingen, ainsi que les gens de ce monastère habitants de la dite vallée, dans la libre possession des droits et des immunités ou des priviléges dont ils avaient joui autrefois 253 . /115/
« Albert qui lorsqu’il n’était encore que duc d’Autriche et comte de Habsbourg n’avait rien changé à cet ordre de choses (Voy. doc. du 30 mars 1293. Kopp, p. 42), n’y changea rien lorsqu’il fut devenu roi. Il maintint la constitution de l’Empire germanique, par conséquent l’office et les droits du Landgrave et du Landrichter. Au chevalier Ulric de Rusegg qui, le 2 mai 1293 (Kopp, p. 46-47) et le 12 mars 1298, était Landrichter ou lieutenant du Comte dans l’Argau et le Zurichgau 254 , succéda Herman de Bonstetten, l’aîné (doc. du 1er déc. 1300 et du 20 sept. 1302), et lorsque celui-ci mourut, le comte Rodolphe de Habsburg 255 fut fait landgrave du Zurichgau, auquel appartenait ou dont relevait le couvent d’Engelberg dans le pays d’Unterwalden, comme nous l’avons dit. C’était le même comte qui le 23 janvier 1300 possédait un fonds de terre dans le pays d’Unterwalden et qui avait pour homme lige (Dienstmann) 256 le chevalier Henri de Winkelried, dit Schrutan », 257 .
Nous avons déjà dit que les avoueries et autres offices étaient autant de fractions ou de portions du pouvoir du Landgrave, que la réunion de plusieurs communes de l’une ou de l’autre vallée en une communauté, avec un magistrat, qui fut d’abord l’avoué de la Vallée, puis le Landamman, /116/ n’y fit pas cesser les droits seigneuriaux, et nous avons cité des exemples d’officiers exerçant dans divers endroits des Vallées la basse juridiction au nom de leur seigneur et en vertu de l’autorité que leur avait commise le comte ou landgrave, qui exerçait la haute justice ou la haute police au nom du Roi ou de l’Empereur romain. Albert, ou celui qui agissait comme chef de la maison de Habsbourg-Autriche 258 , c’est-à-dire le Comte, seigneur haut-justicier (Landgraf), le seigneur-suzerain (Landesherr), ou son lieutenant (le Landrichter), dont émanaient le pouvoir de l’amman d’une vallée (minister vallis) ou du landamman et tous les pouvoirs subalternes, pouvait, sans passer les bornes prescrites de son autorité, conférer la charge de Vogt ou d’avoué de tel ou tel endroit à qui il voulait. Le chef de l’Empire n’avait fait aucun changement à cet égard, pas même en reconnaissant comme pays ou communauté les communes d’une vallée et en lui donnant un avoué ou landamman. Les diverses avoueries qui, réunies, composaient la puissance du Landgrave, n’étaient point abolies à l’époque où nous sommes arrivés. De même qu’avant et après le 18 nov. 1279 les seigneurs de Wolhusen, Arnold et son fils, administraient l’avouerie d’Alpenach et celle de Stans, ainsi les chevaliers de Kussenach, investis de l’avouerie de ce nom déjà avant l’élévation de Rodolphe Ier à la dignité suprême, en exerçaient encore les droits après la mort d’Albert. — Nous avons cru ne pas devoir passer sous silence ces particularités importantes, tirées de l’ouvrage de M. Kopp, p. 70, parce /117/ que l’instruction qui en découle facilite l’intelligence des événements qui se passèrent dans les Waldstetten au commencement du quatorzième siècle. Est-il besoin de dire qu’en parlant de ces avoués nous faisons allusion aux officiers que l’on appelle communément et improprement les baillis autrichiens?
Quoiqu’Albert, en soumettant Lucerne, Zurich, Constance, eût rompu la ligue de 1291, il n’avait cependant pu étouffer en Helvétie le feu de l’insurrection. Malgré ses soins à maintenir les droits et l’autorité de sa maison, l’esprit d’indépendance qui s’était manifesté dans les Waldstetten puisait une nouvelle force dans la contrainte qu’il éprouvait, et loin de s’éteindre il animait de plus en plus les habitants des Vallées et se communiquait à leurs voisins.
« Les villageois 259 de Kussenach, d’Haltikon et d’Immensee prétendaient jouir des gemeinmerch comme d’un terrain commun ou sans propriétaire 260 , c’est-à-dire avoir leur part aux alpes ou aux lieux non labourés comprenant les pâturages, les eaux et forêts, etc. , payer au Vogt ou à l’avoué de Kussenach une redevance annuelle en argent et en nature — grains, volaille, etc. — moindre que celle que retiraient ses prédécesseurs, lui faire moins de services et de corvées, et ils voulaient même se soustraire à son autorité en se liguant avec les habitants d’autres communes. Les arbitres choisis par les deux parties pour terminer ce différend, savoir Berthold, prévôt du couvent de Lucerne, les chevaliers Jacob von Litow (Littau) et Johans von Iberg, jugeant selon le droit coutumier, décidèrent que sans le consentement de l’avoué ou du maire de Kussenach aucun habitant de cet endroit ne pouvait obtenir la jouissance des /118/ gemeinmerch s’il n’avait à Kussenach un fonds de terre, soit en propriété, soit en fief, excepté toutefois les deux officiers susdits, à qui leur charge donnait cette jouissance quand même ils n’avaient pas de terres en propre 261 ; qu’à l’exception des gens appartenant à Habsbourg, qui ne devaient au Vogt qu’une corvée, à faire quand il l’exigerait, les autres devaient lui en faire une dans chaque saison de l’année, à l’époque qui lui conviendrait le mieux; que ceux qui avaient des bêtes de somme ou de charge devaient les y employer, mais que ceux qui n’en avaient pas devaient faire ce service gratuit et forcé avec leur corps, les femmes aussi bien que les hommes. De plus, les arbitres ou juges défendirent expressément aux habitants de Kussenach, d’Haltikon et d’Immensee de se liguer avec des seigneurs, ou avec des villes, ou avec des pays. Enfin, ils prononcèrent une amende de cent marcs d’argent contre celle des deux parties qui ne se conformerait pas à cette sentence; si c’était l’avoué, une moitié de l’amende devait écheoir au couvent de Lucerne, l’autre au maire de Kussenach; si, au contraire, les gens susdits étaient les coupables, un tiers de l’amende revenait au couvent de Lucerne, un tiers à l’avoué de Kussenach, et un tiers au maire de ce lieu. Si un ou plusieurs habitants des trois endroits nommés ci-dessus, en minorité, méprisaient l’arrêt des juges, leur désobéissance entraînait la perte de la moitié de leurs biens meubles ou immeubles, au profit du monastère de Lucerne, de l’avoué et du maire de Kussenach. Celui d’entr’eux qui ne possédait rien devait être expulsé de l’avouerie de Kussenach, et il ne pouvait y rentrer qu’avec la permission du prévôt de Lucerne, de l’avoué et du maire de Kussenach, en payant deux marcs d’argent » 262 . /119/
Ces détails sont précieux à divers égards, surtout en ce qu’ils nous offrent un exemple de collisions, de frottements d’intérêts entre les communes et les avoués, ainsi que l’occasion d’apprendre à connaître plus particulièrement la condition de ces hommes demi-libres, taillables et corvéables, qui, à l’exemple de ceux qui jouissaient de certains priviléges, tâchaient de rompre la chaîne féodale dont la maison de Habsbourg-Autriche s’efforçait de resserrer les anneaux.
Dans le même temps que cette vive querelle avec l’avoué de Kussenach avait lieu, Werner comte de Homberg (ou Hohenberg), seigneur du vieux Raprechtswile dont dépendaient la Marche et la vallée de Wægi, soit qu’il eût à se plaindre des importunités des ducs d’Autriche, comme le dit Tschudi I, 229, soit, ce qui est plus probable, nous pouvons même dire plus certain, qu’étant leur vassal il méconnût leur suzeraineté 263 , fit avec ses voisins de Schwyz un traité d’alliance pour dix ans contre la maison d’Autriche, et l’année suivante, 1303, des gens du pays de Gaster, sujets /120/ des ducs d’Autriche, ayant fait une irruption sur les terres du comte de Homberg, celui-ci appela ses nouveaux alliés à son secours et usa de représailles envers ceux qui l’avaient attaqué. Les hommes de Schwyz qui, dans cette petite guerre, avaient fait un dégât assez considérable sur les terres de l’abbesse de Schænis, se réconcilièrent avec elle 264 .
Tandis que d’un côté le roi des Romains, en même temps chef de la maison de Habsbourg-Autriche, faisait observer scrupuleusement les droits de l’Empire et ceux de sa famille, de l’autre, les habitants des Waldstetten et leurs voisins, loin d’abandonner leur projet d’émancipation, le poursuivaient avec une constance inébranlable.
On regarde communément comme une des causes principales des événements qui se passèrent en Helvétie au commencement du 14e siècle les projets d’agrandissement dont Albert, dit-on, était sans cesse occupé. Plusieurs écrivains lui reprochent une ambition démesurée et une avarice sans bornes, d’autres, au contraire, louent sa modération, sa générosité. Les récits des historiens trahissent l’adulation d’un parti, la haine de l’autre. Comment choisir entre ces deux extrêmes? Ce que nous pouvons faire de mieux, c’est de nous en rapporter au témoignage des documents authentiques. Or ceux que nous connaissons nous portent à croire qu’Albert usa non-seulement de modération, mais encore de ménagement, de prudence envers les Waldstetten et autres lieux soumis à la juridiction de sa maison, et qu’il n’exigea d’eux que ce qu’il pouvait exiger selon la constitution de l’Empire germanique. On ne saurait nier qu’Albert, suivant l’exemple de son père, qui fonda la grandeur de sa maison, n’ait profité en homme habile de diverses /121/ circonstances pour la consolider, en agrandir les domaines, en accroître la puissance, toutefois en observant les formes sans éluder les lois, si ce n’est en ce qui concerne le patrimoine de son neveu et pupille Jean de Habsbourg, envers qui il fut injuste, peut-être moins par avidité que par crainte ou par prudence; ce qui, à nos yeux, ne suffit pas pour le justifier.
Il ne faut qu’un peu de pénétration pour s’expliquer la facilité avec laquelle Rodolphe Ier et son fils Albert réussirent à faire des acquisitions importantes. Terminant promptement toute contestation, évitant soigneusement toute rupture avec le sacerdoce de Rome, ils réhaussèrent l’éclat de leur maison, augmentèrent leurs propriétés pendant et immédiatement après les croisades, alors que, dans différentes contrées de l’Europe, la puissance des seigneurs qui, en grand nombre, avaient pris part à ces expéditions, était considérablement diminuée, que les liens de la servitude s’étaient relâchés, que le nombre des hommes libres, c’est-à-dire demi-libres, était fort augmenté, que l’esprit d’émancipation faisait des progrès prodigieux pour cette époque, que la base sur laquelle reposait l’édifice de la féodalité éprouvait de violentes secousses, et que plusieurs seigneurs dont la fortune était compromise, voulant en sauver quelques restes, vendaient leurs droits non au plus offrant, mais au plus puissant.
Albert, qui était fait pour tenir en des temps difficiles le gouvernail de l’Etat, profita de l’occasion propice de maintenir l’autorité impériale en contenant les grands dans le devoir, et d’affermir la puissance de sa maison par l’acquisition qu’il fit en Allemagne et en Helvétie de domaines et de fiefs auxquels étaient attachés des droits considérables. Par-là il s’attira tout à la fois la haine des grands de l’Empire, qui voyaient d’un œil jaloux son pouvoir s’accroître au détriment du leur, et l’inimitié des habitants des Waldstetten /122/ qui, déjà mécontents de ce que la maison de Habsbourg avait des propriétés dans leurs vallées et tout-autour, et plus encore du refus qu’ils avaient essuyé en demandant des franchises que le chef de l’Empire, que le Landgrave ne pouvait ni ne voulait leur accorder parce qu’il aurait par-là travaillé à la ruine de sa maison, persistaient dans le dessein de s’emparer de force de ce qu’ils ne pouvaient obtenir autrement. Nous ne pouvons citer aucun document, aucun témoignage authentique à l’appui de l’opinion généralement répandue qu’Albert voulut former entre autres principautés un duché des pays helvétiques. Quand cette assertion ne serait pas dénuée de toute preuve suffisante, qu’elle aurait même un haut degré de vraisemblance ou de probabilité, il ne serait cependant pas permis d’en inférer que ce fut là la véritable cause de l’insurrection des Waldstetten, vu que ces vallées, qui n’étaient pas indépendantes, travaillaient depuis longtemps à le devenir, en cherchant à obtenir le droit de communauté, qui devait nécessairement conduire d’abord à la conquête du droit de haute justice ou de haute police, puis à celle du droit de propriété foncière, et que, à mesure que l’idée de l’émancipation, de l’affranchissement du joug féodal se développa dans l’esprit de leurs habitants, ceux-ci marchèrent à ce noble but avec un courage, avec une persévérance admirable, qui leur eût procuré sans doute avec le temps, comme à d’autres peuples, ce qu’ils désiraient si ardemment, et dont des circonstances particulières hâtèrent ou favorisèrent l’acquisition.
Il s’agit maintenant de faire connaître et d’apprécier ces circonstances; car nous voilà parvenus à l’époque où, selon la tradition, qui à plus d’un égard est l’unique source de nos chroniqueurs, se développa le drame politique dont le dénouement fut l’indépendance de l’Helvétie.
Accoutumé dès l’enfance à considérer cette époque comme /123/ la plus belle, la plus héroïque, la plus mémorable de notre histoire, accoutumé à entendre raconter des faits sur lesquels se fonde l’orgueil national, des faits dont le souvenir se perpétue de génération en génération, on a de la peine à se persuader que l’authenticité puisse en être contestée. Cependant il en est ainsi. Le défaut de documents propres à les constater, la défiance qu’inspirent inévitablement des écrivains qui ont ignoré le caractère de notre ancienne histoire et la condition politique de leurs ancêtres — condition dont le souvenir s’effaça peu-à-peu, — la connaissance très-imparfaite et les idées fausses que nos chroniqueurs avaient du régime féodal, la confusion, le désordre, les anachronismes, les contradictions que l’on remarque dans leurs ouvrages, la manière diverse dont ils racontent une des scènes les plus intéressantes de notre histoire; toutes ces circonstances ont porté non-seulement des hommes disposés à douter de tout ce qu’on ne saurait prouver avec une exactitude mathématique, mais encore des esprits calmes et réfléchis, des savants distingués, à rejeter dans le domaine de la Fable des faits que d’autres disent appartenir à l’Histoire.
Si la discussion dans laquelle nous allons nous engager ne peut dissiper tous les doutes, elle répandra da moins quelque clarté sur cette époque si obscure de notre histoire.
On dit généralement qu’Albert, voulant se soumettre les trois pays d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden, y envoya des gouverneurs, tels qu’Hermann Gessler, Beringer de Landenberg, munis d’instructions sévères et accompagnés de soldats grossiers.
La manière dont Albert se conduisit envers les turbulents Lucernois en leur garantissant leurs priviléges et en leur pardonnant d’avoir favorisé les intentions des autres Waldstetten est, sans doute, une preuve de modération; mais n’oublions pas que Lucerne lui appartenait, que les habitants /124/ de cette ville et des censes adjacentes avaient juré la paix générale, que dès-lors Albert n’avait aucune raison de traiter avec la même sévérité les Lucernois et les hommes d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden. En sa qualité de chef de l’Empire il investit, le 1er avril 1299, l’abbé d’Einsiedeln des droits régaliens dans le pays de Schwyz 265 ; par sa lettre du 1er avril 1302 266 il protégea le couvent de Wettingen contre les envahissements des hommes d’Uri, et à la mort d’Elizabeth de Spiegelberg 267 , princesse-abbesse de Notre-Dame-de-Zurich, il établit aussitôt dans les droits de cette grande-église la nouvelle abbesse Dame Elizabeth de Matzingen 268 . Ces faits ne justifient point les reproches d’usurpation dont Albert est l’objet. — Mais peut-être ne respecta-t-il les droits de ces couvents que pour ne pas indisposer contre lui le souverain pontife? Il se peut aussi qu’il n’ait témoigné de la bienveillance à ces abbayes et maintenu leurs droits dans leur intégrité qu’afin de pouvoir un jour d’autant mieux s’emparer de tout, car il est certain qu’il ne négligeait aucune occasion favorable d’augmenter les domaines de sa maison. Toutefois, il y aurait peu de générosité de notre part à insister sur la supposition d’une chose possible.
Uri, fief immédiat de l’Empire, était sous la juridiction du landgrave de la maison de Habsbourg, mais il n’était ni propriété ni fief de cette maison. Bien que nous ayons clairement prouvé celà, nous ne pouvons nous dispenser de citer encore une fois le document du 10 fév. 1326, charte par laquelle le roi Frédéric-le-Bel, fils d’Albert, donne en fief à ses frères « Item vallem in Vre. » Ainsi, jusqu’alors cette vallée n’avait pas été fief du landgrave, elle n’avait pas /125/ appartenu à la maison de Habsbourg-Autriche. Albert, ou le membre de cette famille qui agissait comme chef de cette maison, pouvait y déléguer un Juge pour exercer la haute juridiction ou la haute police, comme faisaient ceux que nous avons vus siéger sur le tribunal à Altorf et dans la vallée de la Reuss, mais il ne pouvait y envoyer des avoués ou d’autres officiers subalternes pour percevoir des rentes et administrer des droits seigneuriaux qu’il n’y possédait pas. Nos chroniqueurs ont raison quand ils disent qu’il y avait des officiers de la part de l’Autriche, c’est-à-dire du landgrave, dans divers endroits tels que Kussenach, Stans, Sarnen; mais ils ont tort de considérer leur venue dans ces lieux comme la preuve d’un acte d’oppression et de tyrannie commis au mépris des libertés des Waldstetten, vu que ces avoués venaient y exercer les offices féodaux. C’est de l’abus de leur pouvoir qu’il faut s’indigner. Le chef de la maison de Habsbourg-Autriche, c’est-à-dire Albert qui en exerçait les droits au nom de son pupille Jean, le landgrave ou, à sa place, le Landrichter pouvait commettre telle ou telle avouerie, mairie, ou cellérerie à qui il voulait, ou maintenir dans cette fonction une famille dont les membres se succédaient de droit héréditaire, sauf à être confirmés par le landgrave. Ainsi, comme nous l’avons dit plus haut, les chevaliers de Wolhusen, père et fils, administraient l’avouerie d’Alpenach, de Stans et d’autres censes de Murbach-Lucerne, et les chevaliers de Kussenach, dont il est fait mention déjà au 13e siècle 269 , investis de l’avouerie de même nom avant l’élévation de Rodolphe à la dignité royale, continuèrent à la posséder pendant le règne de son fils Albert 270 /126/ et même longtemps après la fin tragique de ce prince 271 . A l’extinction de cette famille l’avouerie de Kussenach, qui comprenait plusieurs fermes et censes, passa à Walther de Tottikon, et par sa fille Jeanne à son époux Henri de Hunwile; enfin, le 24 août 1402 elle échut au pays de Schwyz, sans avoir jamais appartenu à un Gessler 272 .
Si Gessler est un personnage imaginaire, si ce qu’on dit de lui n’est qu’une fiction, que sera-ce de l’histoire de Guillaume Tell? — Occupons-nous d’abord du prétendu gouverneur autrichien, pour revenir ensuite à la question de savoir si Albert envoya des officiers dans le pays d’Uri, et s’il voulut s’en emparer de force.
Il faut admettre comme certain que Herman Gessler n’a pas été Vogt ou avoué de Kussenach, et qu’il n’a pu faire, au moins en cette qualité, sa résidence au château de ce nom. Mais, est-il bien sûr qu’il n’en ait point occupé une partie, qu’il n’ait point habité Kussenach, qu’il n’ait eu aucune part à la juridiction de ce lieu et de ses dépendances? Je suis disposé à croire que « Her Herman der Meier von Kvssenah » qui, avec « Her Walther von Hvnwile » et d’autres, paraît comme témoin dans la déclaration que fit le 20 déc. 1291 Ulrich vom Thore en entrant en exercice de l’emploi d’avoué de Lucerne 273 , était notre Herman Gessler, de famille noble 274 , que de maire il /127/ fut élevé par le duc-landgrave à l’office de Vogt ou d’Amtmann, c’est-à-dire d’Avoué ou de Juge 275 , appelé à /128/ l’exercer dans la vallée voisine, et que cette circonstance ignorée de nos annalistes a donné lieu à plus d’une erreur.
Si nos chroniques prouvent que leurs auteurs n’avaient qu’une bien faible connaissance de la féodalité, qu’ils n’avaient aucun esprit d’examen et de critique, ces défauts ne nous autorisent pas à rejeter sans mûre réflexion les récits traditionnels qu’elles renferment. J’attache un grand prix aux documents authentiques, sans refuser pour celà toute confiance aux rapports qui se sont transmis de bouche en bouche, parce que la plupart des traditions, si elles ne sont pas de pures fictions poétiques, ou le fruit d’une imagination égarée et de l’ignorance, ont un fond de vérité historique. Je crois qu’il y a du vrai dans la tradition relative à Gessler, recueillie par nos annalistes. Si j’emploie ici le mot tradition, c’est dans la supposition, peut-être gratuite, qu’ils n’ont puisé leurs renseignements ni dans des actes ou des documents, ni dans des chroniques ou des relations du temps; ce qu’on ne saurait prouver. Je crois aussi que l’observation que j’ai faite au sujet de Hermann, maire de Kussenach, mérite une sérieuse attention. Quoiqu’il en soit, plusieurs personnes, ayant appris par l’ouvrage de M. Kopp que l’avouerie de Kussenach n’a jamais été commise à un Gessler, se sont trop empressées de faire de cet officier, que certains auteurs nomment aussi Grisel, ou Grissler, 276 , un personnage fabuleux, et de n’accorder à la réalité de celui de Tell qu’une croyance hypothétique. Il a existé une famille noble du nom de Gessler, connue dans l’histoire politique et militaire, ainsi que dans la république des lettres, et nous nous félicitons de pouvoir en donner la généalogie.
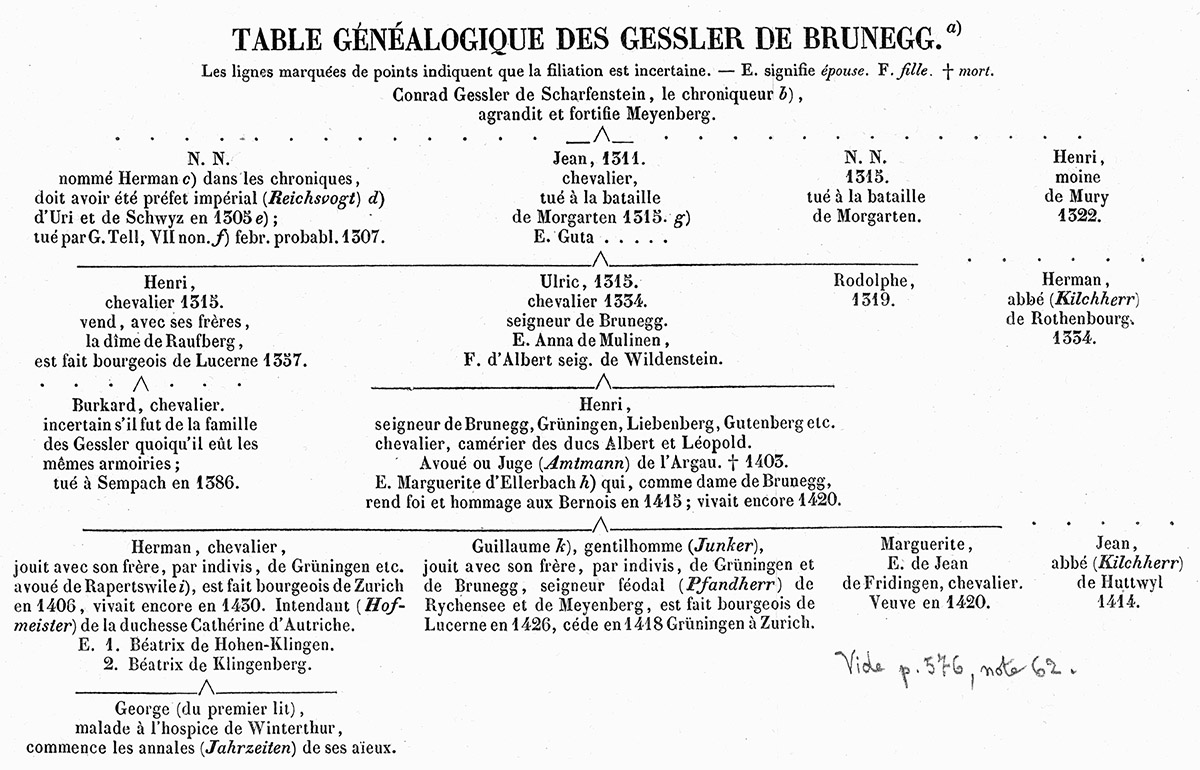
a) Cette table généalogique inspire d’autant plus de confiance, qu’elle a été faite par un des hommes les plus versés dans l’histoire de la Suisse, feu l’avoyer F.-N. de Mulinen, dont les ancêtres étaient alliés aux Gessler. Je la dois à la bienveillance dont m’honore son fils, M. G. de Mulinen, qui fait, dans l’intérêt de la science, un noble usage de la riche collection de documents et de livres rares que son père lui a léguée. — Je n’ai pu me dispenser d’accompagner cette Table de quelques notes.
b) Voy. G. E. v. Haller, Bibl. der Schweiz. Gesch. T. IV, p. 161. 225. 366. ou nos 371. 435. 713. Ce qu’on a dit de ce chroniqueur et de son ouvrage est fondé sur des conjectures plutôt que sur des données positives. Cf. p. 127. n. 274.
c) C’est celui que je pense être Her Herman der Meier von Kvssenah. Voy. p. 126.
d) Il n’y avait pas de Reichsvogt ou de préfet impérial à cette époque. Ce fut Henri de Luxembourg qui établit un officier de ce nom, en introduisant un changement dont je parlerai plus tard. Lisez Vogt ou Avoué.
e) Pour ce qui concerne les dates 1305 et 1307 voyez plus bas.
f) Il faut lire VII Idus febr. On appréciera dans la seconde partie cette indication d’un nécrologe (voy. p. 127) et le fait qui s’y rattache.
g) « Dns Joannes Gessler miles, de meyenberg, occubuit in proelio apud Morgarten 1315. Necrol. (voy. p. 127) Eccl. in Rueggeringen, hodie Rotenburg. » Schneller, note sur la chron. de M. Russ, p. 68. n. 98.
h) Voy. le docum. du 1er juillet 1420 dans Tschudi II, 134.
i) Voy. Tschudi I, 633. b.
k) Voy. le docum. du 1er juillet 1420 dans Tschudi II) 134.
Passons à l’autre question que nous avons proposée. Albert voulut-il s’emparer du pays d’Uri et y délégua-t-il pour cet effet des officiers?
En ne prenant en considération que sa conduite envers les monastères de Wettingen et de Notre-Dame-de-Zurich, en 1302 et en 1308, on dirait qu’il ne peut avoir eu l’intention d’en usurper les droits dans la vallée d’Uri. Il y a plus, nos chroniqueurs ne lui reprochent rien de positif; P. Etterlin (p. 35 et 36) l’appelle même le bon roi, « der guot künig. » Mais l’injustice dont il se rendit coupable envers son pupille Jean suggère de pénibles réflexions. D’ailleurs sommes-nous instruits de ce que fit Albert à l’égard d’Uri et des deux autres vallées entre 1303 et 1308? Non, nous ne connaissons aucun acte qui en parle en termes formels. Nous voyons seulement par un document du 7 mars 1304 (Kopp, p. 65) que ceux de Lucerne avaient eu naguère une querelle ou une guerre privée avec les hommes du Hasli, et que le landamman d’Unterwalden scella pour ceux du Hasli, qui n’avaient pas de sceau, l’acte de réconciliation —, et par un autre (cité ci-dessus, p. 63), de l’année 1305 (?), que Kraft comte de Toggenbourg réclama de Stauffacher, landamman de Schwyz, un homme à lui appartenant que ceux de Schwyz avaient fait prisonnier, circonstance que Stumpff rapporte à l’an 1306, comme nous l’avons dit. Il résulte de ces deux faits que les hommes des Vallées vivaient alors en guerre avec la noblesse vassale du Landgrave, ou avec des gens appartenant à la maison de Habsbourg-Autriche, qu’il y avait tout à la fois agitation et résistance dans ces vallées, ou attaque de leur côté. Il ne pouvait en être autrement, vu que les hommes de ces vallées renouvelaient constamment leurs tentatives pour se rendre maîtres des droits domaniaux sur les terres de leur pays mouvantes de couvents, de seigneurs, ou dépendant du landgrave, qu’ils /130/ refusaient de jurer la paix générale, méconnaissaient l’autorité du Comte haut-justicier, et que celui-ci voulait maintenir son pouvoir et les droits féodaux. Il y avait depuis longtemps rupture et guerre ouverte 278 . Otton d’Ochsenstein avait fait jurer la paix générale aux Lucernois sans pouvoir obtenir des Waldstetten le même acte de soumission, ce qui avait engagé Werner, avoué de Baden, procureur d’Albert dans l’Argau, à prendre envers ceux d’Uri les mesures de rigueur que nous avons fait connaître. Depuis, Albert dut encore opposer son autorité royale à leur volonté. Croit-on qu’entre 1302 et 1308 Albert ait laissé persister impunément dans leur désobéissance les habitants des Waldstetten, lui qui était observateur si minutieux, défenseur si scrupuleux des droits de sa maison? M. Kopp, qui dit (p. 71) qu’aucun document à lui connu ne prouve qu’Albert ait fait le moindre tort aux trois Vallées, reste-t-il dans les bornes d’une sage critique quand il reproche à Muller de dire (I, p. 637) « qu’Albert interdit tout commerce, toute relation avec les Waldstetten »? tandis que l’on sait positivement que son procureur Werner avait fait arrêter à Lucerne des marchandises destinées pour la Lombardie, qui devaient traverser la vallée d’Uri, et qu’il avait intercepté toute communication avec les gens de cette vallée parce qu’ils résistaient aux ordres du suzerain. Si l’officier d’Albert landgrave dut agir avec une telle rigueur, que pense-t-on que firent quelques années plus tard, après la scène de Kussenach qui sans doute se répéta ailleurs, les avoués irrités de l’opiniâtreté des montagnards? M. Kopp ne va-t-il pas trop loin quand il repousse (p. 127) toute accusation dont on charge les avoués de l’Autriche, parce que les actes insolents et tyranniques qu’on leur reproche ne sont consignés /131/ dans aucun document à lui connu? tandis qu’il est démontré par des actes authentiques que dès les premiers temps de la féodalité les avoués furent avides de pouvoir et de biens, qu’ils opprimèrent le peuple au point de s’attirer la censure de leurs souverains. Quand on voit par le document du 15 mai 1302 quelles étaient encore à cette époque la condition du bas peuple et les exigences des avoués, croira-t-on que du temps d’Albert, à qui les habitants des Waldstetten refusaient hommage et fidélité, les avoués furent doux, désintéressés, humains, indulgents envers ces pâtres rebelles? et ne pouvons-nous, sans franchir les bornes de la raison, admettre qu’ils furent envers eux insolents, grossiers, arbitraires, qu’ils leur imposèrent des taxes onéreuses, des services pénibles, et se conduisirent en petits despotes pour les soumettre à la domination du landgrave, eux qui étaient si intéressés à la défendre et à maintenir les lois de la féodalité?
Nous sommes pleinement autorisés à croire que, de même qu’Ochsenstein et Werner avoué de Baden avaient travaillé à faire rentrer les hommes des Waldstetten dans le devoir, d’autres officiers, des avoués (Vögte) s’employèrent au même but; que ces délégués, d’autant plus disposés à dépasser les ordres de leur maître qu’ils appartenaient à une classe de feudataires depuis longtemps connue par son avidité, son ambition, sa dureté qui soulevait le peuple contre elle 279 , irrités de la résistance opiniâtre des montagnards qui compromettait leur fortune, eurent recours à des mesures de rigueur, à des moyens violents pour les soumettre, pour les /132/ courber sous un joug qui leur était devenu insupportable, et qu’ils commirent les actes d’insolence dont on les accuse; que S. v. Birken 280 a raison de dire, en général, « que la maison d’Autriche doit la perte de ses états héréditaires à la tyrannie de ses officiers, et que plus d’un prince est injustement accusé du mal qu’ont fait des serviteurs iniques »; qu’Etterlin (p. 35) fait une réflexion juste quand il reproche à l’Autriche « d’avoir accordé trop de confiance à ses délégués et donné trop peu d’attention aux plaintes du peuple », ajoutons « et à l’esprit du temps »; que ces avoués, oubliant qu’Uri était fief immédiat de l’Empire, où ils n’avaient rien à administrer, rien à ordonner qu’en matière de haute police, défendirent avec une rigueur excessive les droits de Wettingen et de Notre-Dame-de-Zurich, exercèrent une justice trop sévère, abusèrent de toute façon de leur pouvoir; que ce fut pour contraindre ces paysans turbulents que Gessler entreprit la construction du Twing-Uri, mot qui trahit des intentions mauvaises outre qu’il indique le siège du Twing und Bann ou de la haute juridiction; enfin, que ce concours de circonstances, dont la principale est peut-être la violence employée envers Uri, inspira aux peuples des Waldstetten le plan d’une conjuration en leur offrant les motifs d’insurrection prévus dans les deux pactes de 1291.
Ces considérations, comme on le voit, ne sont point la conséquence d’une hypothèse hasardée; elles découlent de faits positifs, elles conservent au temps féodal la physionomie qui lui est propre, elles n’en faussent pas le caractère: les actes que nos chroniqueurs imputent aux avoués autrichiens acquièrent par elles un haut degré de vraisemblance. Loin d’avoir quelques motifs pour nier la possibilité de ces /133/ actes, on ne peut même soutenir raisonnablement qu’ils ne sont pas probables.
Mais une grande difficulté nous arrête. Comment déterminer l’époque où ces faits ont eu lieu?
M. Kopp estime (p. 127) que si les actes de rigueur et de tyrannie dont on accuse les avoués de l’Autriche étaient avérés, aucune époque ne leur conviendrait mieux que l’an 1315. Il présume que les récits du 15e siècle qui, conçus d’abord en termes généraux, sans application particulière, s’enrichissent peu-à-peu d’une foule de détails, ont été facilement recueillis par la haine irréconciliable dont l’Autriche était l’objet, groupés autour de noms historiques des deux partis, et rattachés confusément à une époque incertaine des premiers temps de l’histoire des Confédérés.
C. Justinger et M. Russ qui, si nous en exceptons l’histoire de G. Tell rapportée par ce dernier, ne parlent que d’une manière générale des vexations commises par les avoués, n’en indiquent pas l’époque précise. P. Etterlin a rassemblé plusieurs détails sans les classer selon l’ordre des temps. F. Hämmerlin, qui écrivit du temps de la fameuse guerre de Zurich, raconte aussi quelques particularités sans en indiquer la date. La confusion des temps est telle dans certaines parties de nos anciennes chroniques que, par ex. , M. Russ raconte la mort d’Albert après la bataille de Morgarten, et que P. Etterlin, après avoir marqué avec exactitude l’année 1291 comme celle de la mort de Rodolphe Ier, fait mourir son successeur Adolphe en 1288, quoiqu’il sache qu’il y eut un interrègne d’environ un an depuis Rodolphe, et qu’Adolphe régna six ans. Plus d’une partie de notre histoire nationale est embrouillée par les anachronismes des annalistes.
N’embrassons pas tous les détails dans cet examen chronologique. Arrêtons-nous au fait qui, selon l’opinion /134/ commune, est le fait principal, autour duquel les autres viennent pour ainsi dire se grouper: nous voulons dire l’acte de résistance de G. Tell aux ordres de l’Avoué, acte qui précédé des vexations dont parlent nos chroniqueurs fut suivi de l’insurrection.
Tschudi et Bullinger rapportent cet événement à l’an 1307, date que Muller a admise sans la constater; Stumpff et Cysat 281 à l’an 1314; l’auteur d’un drame historique dont nous parlerons tout-à-l’heure, à l’an 1296, et Diebold Schilling de Lucerne à l’an 1334. Il est vrai que ce dernier parle proprement du coup d’adresse que l’on attribue à G. Tell; mais comme il fut ordonné, à ce qu’on dit, pour punir G. Tell de son audace, on n’insistera pas sur cette différence.
Examinons ces diverses dates et tâchons d’établir celle où s’est passé l’événement dont on vient de parler.
Un drame historique intitulé: Ein hüpsch Spil, gehalten zu Ury in der Eydgnoschafft, von Wilhelm Thellen jhrem Landtmann, vnnd ersten Eydgnossen, ouvrage très-curieux à divers égards, dont la tradition conservée chez les habitants des Waldstetten fait le fond, contient certains détails qui, paraissant erronés, empêchent M. Kopp d’accorder quelque croyance à son auteur. Mais ce travail étant un drame et non un ouvrage purement historique, il n’est pas étonnant qu’il renferme des particularités dont il est facile de contester l’authenticité. Il contient cependant moins d’inexactitudes que M. Kopp n’a supposé. Le quatrième héraut, après avoir énuméré les faits militaires des Confédérés depuis la bataille de Morgarten, termine cette revue par la guerre de Souabe, la soumission de Locarno et l’expédition entreprise en novembre 1511 par ceux de Schwyz et leurs confédérés, et qui est connue sous le nom de kalte Winterzug ou d’expédition d’hiver. /135/
Ainsi cet ouvrage n’est pas d’une date antérieure au commencement du 16e siècle. Il est de ce siècle; car, il en existe une édition très-rare, de 48 pages in 8o, imprimée à Bâle chez Samuel Apiarius en 1579 282 , inconnue à G. E. de Haller qui, dans sa Bibliot. de l’Hist. Suisse, T. V. p. 23 nº 71, cite celles de 1648 et de 1740, dont la dernière a été consultée par M. Kopp (p. 44). Ayant eu l’heureuse idée de confronter l’édition de 1740 à celle de 1579, j’ai remarqué entre elles une différence notable. L’édition postérieure offre plusieurs leçons qui s’écartent plus ou moins du texte de l’édition du 16e siècle, et qui sont des fautes d’impression, mais assez graves pour altérer des faits. Je pourrais en donner plusieurs preuves: le lecteur se contentera volontiers de celles qui ont rapport à des circonstances dont je dois m’occuper. Ainsi, par ex. , selon l’édition du 18e siècle, dont M. Kopp a fait usage, le comte Rodolphe de Habsbourg obtint en 1243 des trois Vallées
« Dass sie sich unter sein Herrschafft han
Gütlich ergeben mit ihrem Land,
Als aber nachdem er Kaiser ward
Wurden sie bevogtet streng und hart. »
C’est-à-dire que « en 1243 les habitants des trois Vallées se mirent volontiers, avec leur pays, sous la domination du comte Rodolphe de Habsbourg, mais que, lors qu’après celà il (Rodolphe) devint empereur, les montagnards furent maltraités par des avoués. »
Il y a dans ces lignes des erreurs manifestes, que l’on ne doit cependant pas imputer à l’auteur. Celui-ci, en disant /136/ que les habitants des Waldstetten se mirent volontiers ou volontairement sous la domination du comte Rodolphe de Habsbourg, n’a fait que se conformer à la tradition: il était, comme tant d’autres, sous l’empire du préjugé que nous avons combattu. Quant à l’indication de 1243, si peut-être elle n’est pas parfaitement exacte, elle s’écarte peu de la vérité. On a pu voir plus haut (p. 76-78) que c’est vers cette époque que le comte Rodolphe de Habsbourg, qui devint roi, fut investi du landgraviat de l’Argau, dont la juridiction s’étendait sur les Waldstetten. — Mais le second point est d’une plus grande importance. Ce n’est pas du temps de Rodolphe Ier, qui donna à ses officiers civils l’exemple de l’équité et les contint dans le devoir, que les habitants des Waldstetten furent molestés, maltraités par les avoués. Ce n’est pas non plus ce qu’a dit l’auteur du drame: dans l’édition de 1579 on lit clairement:
« Als uber nach dem ein Keiser ward », c’est-à-dire « lorsqu’après celui-là, après Rodolphe, vint un empereur. » Il est question d’Albert d’Autriche, qui est souvent qualifié du titre d’empereur, et nommé dans ce drame, par anticipation, avant Adolphe, parce qu’avant l’élection d’Adolphe il était déjà seigneur-suzerain des Waldstetten. On voit qu’en ceci, comme à d’autres égards, l’auteur est fidèle à la tradition constante des Waldstetten. M. Kopp, induit en erreur par un texte altéré, en a tiré des conséquences qui se réduisent à rien.
Vient l’année 1296 à laquelle, selon M. Kopp, l’auteur du drame rapporte le coup d’adresse de Tell, que dans cette discussion chronologique nous devons admettre comme un fait qui fut la conséquence de l’insubordination de Tell. L’auteur en question n’indique aucune date pour l’histoire de la pomme. A la fin de la pièce, le quatrième héraut dit, p. 32-33: /137/
« Dann wie sie (unsere altvorderen) zum ersten här sind kommen
Zur freyheit hand jr wol vernommen
Das ist ungefarlich bschehen
Nach Christi Geburt mag ich jehen
Tausendt zweyhundert vnd darzu
Sechs vnd neuntzig ich sagen thu
So hand sich erstlich die drey land
Erlediget von der Tyrannen hand
Vnd zusammen sich vorbunden
…
Ein jar darnach ganz gütligklich
Ergaben sie sich dem Römischen Reich
Vnter König Adolph dem frommen
So sind sie wider ans Reich kommen
Vnd desselben allein bekennt
Vnd vom Reich Freye Leut genennt. »
Ce qui signifie: « Vous venez d’apprendre comment nos pères sont d’abord parvenus à l’état de liberté, ce fut environ l’an 1296 ap. J. C. , je puis l’affirmer: alors les trois pays secouèrent le joug de leurs tyrans et firent une alliance; mais l’année suivante ils se donnèrent à l’Empire Romain, sous le pieux Adolphe, et ils furent reconnus pour gens dépendant nûment de l’Empire, qui leur donna le nom d’hommes libres. » Il faut distinguer ici trois choses: l’histoire de G. Tell, l’alliance des Waldstetten, et leur réunion à l’Empire.
Si l’histoire de G. Tell est placée à cette époque, c’est que l’auteur du drame, partant de l’idée que le coup hardi de Tell hâta l’émancipation des Waldstetten, ou du moins leur affranchissement de la maison d’Autriche, crut ne pouvoir marquer une époque plus convenable que celle ou leurs habitants furent considérés par Adolphe comme appartenant à l’Empire. C’est en effet environ l’an 1296, ou, comme il le /138/ dit, l’année suivante, savoir le 30 nov. 1297, qu’Adolphe leur donna la charte de l’empereur Frédéric II, dont le contenu est conforme à ce que dit le quatrième héraut: c’est depuis lors que les hommes des Waldstetten, qui avaient refusé de jurer la paix générale et par conséquent de reconnaître l’autorité de l’Autriche, purent se croire et se dire indépendants de cette maison et mouvants de l’Empire. Je ne conçois pas comment M. Kopp n’a pas fait attention à celà. — Quant à l’alliance, nous en parlerons plus tard. La date de 1296 est appréciée: on sait maintenant ce qu’elle signifie.
Passons à celle de 1334. M. Kopp (l. c.) nous apprend « qu’on lit au f. 12. b. de la chronique du Lucernois Diebold Schilling, CCC XIIIj et XIIj juillet, que Cysat a raturé deux XX, et mis à la marge « Wilhelm Tell 1314. », que les traits de ces deux XX se laissent entrevoir; de manière que D. Schilling aurait rapporté le coup de Tell à l’an 1334, date qui contredit celle qu’il avait adoptée au f. 5. a. » Circonstance surprenante, dont toutefois nous ne révoquons pas en doute la réalité, parce que nous savons que M. Kopp a la vue perçante et l’esprit consciencieux. Du reste, si cette date mérite quelque attention, c’est uniquement parce que l’Autriche dut reconnaître cette année l’alliance ou la confédération de Lucerne avec les autres Waldstetten, après avoir fait de vains efforts pour la dissoudre. — L’écrivain qui peut avoir rapporté à l’an 1334 ce qui précède l’insurrection des Waldstetten, n’a pas cru pouvoir indiquer une époque plus convenable que celle où l’Autriche entreprit et fit la guerre pour reconquérir dans les vallées des Alpes ce qu’elle avait perdu et y rétablir l’autorité de ses officiers. Mais il pouvait admettre également, et même avec plus d’apparence de vérité, l’année 1324, je veux dire l’époque où, le pape ayant cassé les deux élections des deux césars Frédéric d’Autriche et Louis de Bavière, et prononcé /139/ formellement la déchéance de ce dernier, le futur roi des Romains promit aux ducs d’Autriche de les réintégrer dans la possession des deux vallées de Schwyz et d’Unterwalden qu’ils avaient décidément perdues au Morgarten, et où la maison d’Autriche, pour y rétablir ses droits, voulait envoyer des officiers; projet que, sans doute, elle ne put exécuter, parce que Louis, resté sur le trône, venait de reconnaître comme un fait accompli l’indépendance des Waldstetten de toute domination autrichienne.
L’année 1314 est celle où il convient de rapporter la démolition des bourgs ou châteaux-forts, comme le font Stumpff et Cysat. Les circonstances qui se rattachent à cette destruction ont été réunies avec d’autres, toutes ensemble groupées autour du fait dont Tell est le héros, et considérées comme faisant partie du plan d’insurrection, ou comme suite immédiate de cet événement. Stumpff, ne pouvant soulever le voile épais qui couvre l’époque de l’histoire de Tell, crut devoir lier intimement celle-ci à la démolition des châteaux, dont il paraît avoir pu préciser la date.
Quelle que soit la confusion des temps que l’on remarque dans certaines relations de nos chroniqueurs, on est obligé, après les avoir bien examinées, de conclure que l’histoire de G. Tell, précédée de l’administration vexatoire des avoués, est antérieure à la bataille mémorable de 1315. M. Kopp en convient lui-même (p. 44. n.). La lecture de C. Justinger ne laisse subsister aucun doute à cet égard. Je dis Justinger, parce que l’endroit de sa chronique auquel je renvoie (p. 61) a été copié mot à mot par M. Russ (p. 58 et suiv.) et en partie par P. Etterlin (p. 33 et suiv.), avec cette différence, que Russ parle de Guillaume Tell, et qu’il a (p. 62) un passage dont on retrouve le sens dans l’auteur qu’il a copié, après le récit de la bataille du Morgarten (p. 64 fin). Après avoir passé en revue les affaires de Berne /140/ jusque vers l’époque de cette bataille, voulant faire connaître les causes de cet immortel combat, Justinger rappelle en termes généraux l’histoire des Waldstetten, leurs hostilités envers les maisons de Habsbourg et d’Autriche, les circonstances qui amenèrent la rupture et la guerre, entre autres les actes insolents des avoués. Il termine par ces mots: « Celà dura jusqu’en 1315 que se livra la bataille du Morgarten. »
J’ai quelques motifs pour ne pas admettre avec Stumpff l’an 1314 comme celle où eurent lieu les actes arbitraires des avoués qui provoquèrent la résistance de Tell et l’insurrection de ses compatriotes. Les voici:
1o. La bataille de Morgarten, qui fut réglée et bien combinée de la part des montagnards que l’Autriche venait attaquer avec des troupes qui avaient l’expérience de la guerre, même sur le sol inégal de l’Helvétie, et pour laquelle ils organisèrent une armée nombreuse eu égard à leur population, suppose des chefs habiles, de la discipline, des préparatifs qu’il n’était guère possible de faire dans un temps où tous leurs mouvements étaient épiés par les gens armés ou par les serviteurs des avoués qui occupaient les châteaux forts, dans un temps où, bien qu’aguerris, et décidés de ne pas tolérer le joug de l’Autriche, ils ne pensaient qu’à expulser leurs petits despotes, non à se mettre sur le pied de guerre ouverte contre un ennemi puissant, contre un prince dont l’habileté, le talent militaire et la supériorité des forces leur étaient suffisamment connus. Il faut croire, ce qui nous paraît seul admissible, que depuis l’expulsion des avoués et la mort d’Albert, les habitants des Waldstetten, profitant du repos que leur procurait le nouveau chef de l’Empire, et prenant des mesures dictées par la prudence, vu que leur existence politique, loin d’être assurée ou garantie, dépendait du bon plaisir du nouveau souverain /141/ (usque ad voluntatis nostre beneplacitum), se préparèrent pour des temps fâcheux. Ils étaient prêts à combattre lorsque Léopold, après avoir inutilement essayé de rétablir dans leurs vallées son autorité et ses délégués, marcha contre eux pour les soumettre par la force.
2o. Albert mourut le 1er mai 1308. Léopold, son fils, revêtu du pouvoir de landgrave à la place de Jean de Habsbourg, meurtrier du roi, confirma le 31 du même mois les priviléges des habitants de Lucerne (docum. ap. Kopp, p. 86). Nous ne connaissons pas de lettre qu’il ait adressée aux autres Waldstetten. Les habitants de ces vallées marchaient dans la voie de l’émancipation et attaquaient des droits domaniaux (Voy. doc. du 11 nov. 1308. ibid. p. 91). Henri VII de Luxembourg donna aux vallées qui n’étaient pas fiefs immédiats de l’Empire deux chartes du 3 juin 1309 (Tschudi I, 245-246. Kopp, p. 102-103) contenant la confirmation des priviléges que leur avaient accordés les empereurs ou rois ses prédécesseurs (Frédéric II et Adolphe), auxquels il ajouta, pour les trois vallées, l’indépendance de tout tribunal autre que celui de S. M. , au moins jusqu’à nouvel ordre. Par-là ce nouveau chef de l’Empire, l’ennemi politique le plus dangereux des ducs d’Autriche (avec lesquels il pouvait cependant venir à se réconcilier), éloigna des Vallées le landgrave de la maison de Habsbourg-Autriche et tous ses avoués. Il régna jusqu’en août 1313, sans retirer aux Waldstetten les diplômes qu’il leur avait délivrés. Pendant quatre ou cinq ans leurs habitants ne furent pas molestés. Il faut nécessairement que les vexations, les actes de licence des avoués autrichiens aient en lieu à une époque antérieure à 1309.
C’est aussi à une époque assez rapprochée de cette année qu’il faut rapporter l’alliance des Waldstetten dont parlent M. Russ (p. 62), P. Etterlin (p. 33) et l’auteur du drame que nous avons cité plus haut. C’était un pacte d’union pour se /142/ fortifier contre les avoués et se préparer à la résistance. Le chevalier Jean de Klingenberg, qui, selon Tschudi (I, p. 104. a.), vécut en 1240, et dont l’arrière-petit-fils, de même nom, mort à Næfels, avait continué la chronique dont on a perdu la trace, dit qu’Uri, Schwyz, et Unterwalden firent en 1206 une alliance de commune défense pour 10 ans. Sans trop insister sur le peu de probabilité d’une pareille longévité dans une famille dont le membre qui mourut en 1388 aurait été arrière-petit-fils, ou même petit-fils 283 d’un homme qui 150 ans auparavant devait avoir atteint un certain âge, nous doutons ici de l’exactitude de Tschudi, d’autant plus que nous avons déjà signalé de graves fautes de chronologie dans son ouvrage, et qu’on remarque à l’endroit même que nous venons de citer (I, p. 104. b.) une grande erreur; car Tschudi raconte gravement que le baron Werner d’Attinghausen, alors landamman d’Uri, fut l’auteur de cette alliance. Or en 1206 il n’y avait pas de landamman dans la vallée d’Uri, qui alors ne formait pas une communauté. C’est au commencement du 14e siècle qu’un Werner d’Attinghausen était landamman. Tschudi le dit lui-même (T. I, p. 227 et suiv.), mais il se trompe encore quant à l’année. Voy. plus haut, p. 62. n. 150. et les documents du 11 nov. 1308 et du 25 juin 1309, ap. Kopp, p. 91. 111.
Nous croyons que cette alliance, si ce fut un pacte d’union entre les trois Vallées et non une simple réunion de quelques communes, est de l’an 1306. Au commencement du 13e siècle on ne voit encore aucune union générale des Vallées: la première est de 1291. Celle que nous croyons avoir eu lieu en 1306 doit avoir eu pour causes quelques exactions des avoués et un projet de défense de la part des Waldstetten. De pareilles unions se faisaient ou se préparaient alors /143/ ailleurs pour les mêmes raisons. (Voy. le doc. du 15 mai 1302. Kopp, p. 58 et suiv.) Remarquez que la date de 1306 n’est point une simple conjecture. Selon la chronique (MS) de Hüplin et celle de Sprenger (Haller, Bibl. der Schw. Gesch. IV, p. 165) la première alliance des Waldstetten (proprement la seconde, car la première fut ignorée de tous nos chroniqueurs) eut lieu en 1306.
Je pourrais, en terminant cet examen, alléguer en faveur de ma conclusion un document dont je ferai usage dans une autre occasion, qui dit que Guillaume Tell contribua puissamment à la conquête de l’indépendance des Waldstetten en 1307. On pourrait objecter que ce document n’existe plus en original, ou plutôt qu’on ne sait ce que l’original est devenu. Mais cet argument n’est pas péremptoire.
Le document du 15 mai 1302 (ap. Kopp, p. 58), en nous montrant d’une part les exigences des avoués, de l’autre les prétentions des communes, nous fait voir jusqu’à quel point était déjà engagée la lutte entre les deux partis. Les Waldstetten et les communes limitrophes cherchaient de la force dans des ligues. L’alliance de 1306 est un de ces événements dont la réalité ne nous parait pas douteuse. Une des principales causes qui la firent naître, est sans contredit l’insolence des avoués, jaloux de leur pouvoir et de leurs droits. Justinger, dont l’autorité ne peut être suspecte, dit positivement que les avoués autrichiens commirent envers les habitants des Waldstetten des actes révoltants. Essayons de les exposer sans exagération et de les examiner avec impartialité.
Hermann Gessler, personnage dont on ne peut révoquer en doute la réalité, mais à qui l’on donne à tort le nom de Brunegg 284 , occupait en qualité de Vogt ou d’Avoué le /144/ château de l’île de Schwanau, dans le lac de Lowerz ou de Lauerz, et se rendait parfois à Altorf, pour siéger sur le tribunal comme Juge, Richter, Amtmann, ou Vogt, établi par le landgrave ou comte haut-justicier de l’Argau, et par conséquent du pays d’Uri. Pour se mettre à l’abri d’une attaque à laquelle il pouvait être exposé, comme l’avaient été naguère l’avoué de Kussenach 285 et sans doute plusieurs autres avoués, il ordonna la construction d’un château qui devait porter le nom de Twing-Uri, ce qui signifie château seigneurial d’Uri, résidence de l’Avoué, qui au nom du seigneur haut-justicier exerçait la juridiction (Twing und Bann) dans la vallée d’Uri.
Beringer de Landenberg, d’une famille noble de l’Argau, dont plusieurs membres ont joué un grand rôle dans les guerres de l’Helvétie, occupa le château de Sarnen, dans le Haut-Unterwalden. On prétend que celui de Rotsberg qui, situé sur une colline entre Alpenach et Stans, dominait le chef-lieu du Bas-Unterwalden, fut occupé par Wolfenschiess, lieutenant ou sous-avoué de Landenberg. Je doute que Wolfenschiess, issu d’une famille d’Unterwalden dont plusieurs membres occupèrent, déjà dans la première moitié du 14e siècle, la charge de landamman de ce pays, ait été /145/ sous-avoué de Landenberg. Il est plus probable qu’il était amman d’une commune, et qu’on l’a confondu avec un autre personnage.
Quoiqu’il en soit, ces deux châteaux, avec les fermes ou censes, dépendant du collège ou du monastère de St. Léger à Lucerne qu’Albert avait légitimement acquis, ce prince, ou celui qui agissait comme chef de la maison de Habsbourg-Autriche, pouvait en confier l’avouerie ou la mairie à qui lui semblait bon. Peu importe que Gessler et Landenberg fussent déjà dans ces vallées avant l’époque dont nous parlons, ou qu’ils ne s’y soient établis qu’alors, il est certain que depuis longtemps il y avait des officiers du landgrave dans les Waldstetten, soit pour exercer les droits de haute juridiction dans la vallée d’Uri, où les officiers de l’abbesse de Notre-Dame-de-Zurich et de l’abbé de Wettingen administraient les biens, percevaient les rentes de ces abbayes, et exerçaient la basse-juridiction au nom de leurs seigneurs respectifs, soit pour rendre la justice et administrer les domaines du landgrave dans les deux autres vallées, où il avait des droits et des propriétés.
Unterwalden comptait parmi ses habitants un homme respectable par son âge et des services rendus à son pays, Henri, dit du Melchthal, c’est-à-dire, de la vallée que traverse un torrent nommé Melch. Cet homme, repoussant toute idée de sujétion à l’Autriche, et encourageant ses compatriotes à défendre les priviléges qui leur avaient été accordés par des empereurs, dut irriter Landenberg, qui probablement le condamna à quelque amende, ou eut recours à la confiscation pour vaincre sa répugnance et le punir de son audace. Quelques-unes de nos chroniques disent que Landenberg ayant ordonné à un de ses serviteurs d’emmener des bœufs qui appartenaient à ce vieillard, son fils Erni s’y opposa et que, blessé de la brutalité de ce /146/ serviteur qui lui dit: « si les paysans veulent labourer la terre ils n’ont qu’à traîner eux-mêmes la charrue », il le frappa de son bâton, lui cassa un doigt, et s’enfuit chez son ami (Stettler dit chez son cousin ou parent, Vetter) Walter Fürst, dans le pays d’Uri; que Landenberg, informé de ce qui venait de se passer, fit arrêter Henri, lui demanda où était son fils, et que, ne pouvant l’apprendre, ce tyran fit crever les yeux au vieillard.
Il faut, en général, se défier des chroniqueurs quand ils rapportent des excès de barbarie et de cruauté. L’horrible et le merveilleux, qui annoncent une imagination égarée et superstitieuse, jouent un grand rôle dans leurs récits. Que d’absurdités ils racontent gravement comme des faits réels!
Il me semble que la haine a exagéré la faute de Landenberg. Le reste du récit qui concerne cet avoué et le vassal rebelle s’explique. Les paroles dures adressées par le satellite au fils du vieillard n’étonneront pas le lecteur qui se rappellera la déclaration faite en 1302 aux paysans de l’avouerie de Kussenach, « que ceux qui n’avaient pas de bêtes de somme pour faire les corvées devaient y employer leur corps, les femmes aussi bien que les hommes. » Si l’homme qu’elles indignèrent et qui frappa celui qui les prononça s’enfuit au pays d’Uri, c’est non-seulement parce qu’il y avait un parent, un ami-zélé pour la bonne cause, mais encore parce qu’il pouvait y trouver plus de sûreté que dans sa vallée. Il devait se soustraire au châtiment sévère que Landenberg lui aurait infligé.
J’ai une observation à faire sur le prétendu nom de famille de celui que l’on dit avoir été traité d’une manière si cruelle par l’avoué d’Unterwalden. J. de Muller (I, p. 640) parle d’un « homme du Melchthal », dont il nomme (p. 641) le fils « Erni», diminutif d’Arnold. H.-J. Leu, dans sa traduction de Simler (p. 50. n. 7) dit que, selon Wagner, Merc. /147/ Helv. , le nom de famille de cet homme était von der Halden, et que de son temps (1735) il y avait encore une famille de ce nom dans le pays d’Unterwalden. Ceci peut être vrai: on rencontre des An der Halden et des In der Halden. Ces prépositions font voir qu’il y a là un nom de localité. Les gens de la classe à laquelle appartenait Henri du Melchthal n’avaient pas de nom de famille. Le fils portait, selon un usage constant peut-être chez tous les peuples, le nom de son grand-père, et ajoutait à ce nom soit le mot fils de … , ou un équivalent, soit le mot dictus 286 (dit), ou un de même valeur, quand une localité, une profession, quelque circonstance remarquable le distinguait d’autres individus de la même contrée qui avaient le même nom (prénom) que lui. Ces noms distinctifs restèrent à ceux qui les portaient et devinrent, depuis leur émancipation, des noms de familles. Cette particularité, dont nous trouverons des exemples propres à dissiper les doutes qui planent sur la réalité de certains personnages, n’a pas été observée avec l’attention qu’elle mérite. De là vient que nos historiens ont souvent vu des nobles où il n’y avait que des laboureurs et des artisans, par ex. à Lucerne 287 et dans les autres Waldstetten.
Dans plusieurs parties de la Suisse, notamment au lac des Quatre-Cantons, on appelle Halde un côteau, une colline avec un groupe de maisons formant un hameau 288 .
Près d’Engelberg est le village d’Alzellen, qu’habitait un honnête paysan, nommé Conrad, dit Baumgartner, dont la belle et chaste épouse, en danger d’être violée par un lieutenant de l’avoué, ou par l’avoué même, qui la força /148/ de lui préparer un bain, parvint à se dérober à ses instances. Rencontrant son mari, qui revenait de la forêt, elle l’informa de ce qui venait de se passer. Conrad, enflammé d’une juste colère, gagna sa demeure, assomma de sa hache l’infâme persécuteur qui voulait le déshonorer sous son toit même, et se réfugia dans la vallée d’Uri.
Ce fait, dont on a contesté l’authenticité, parce que ce n’est pas le seul de ce genre que l’on rencontre dans l’histoire de la Suisse, a été raconté diversement. Selon Felix Hæmmerlin et Felix Faber, tous deux écrivains du 15e siècle 289 , « le comte de Habsbourg, seigneur naturel des habitants de la vallée d’Art, établit au château (du lac) de Lowerz (dans l’île de Schwanau), un châtelain (castellanum) en qualité de gouverneur (gubernatorem), c’est-à-dire d’avoué, de toute la vallée. Deux Schwyzois le tuèrent pour avoir fait violence à leur sœur. Le comte irrité voulut les punir; mais d’abord deux de leurs parents, puis dix autres habitants du pays, puis vingt s’unirent aux deux frères, et résolurent de mourir plutôt que de permettre que ceux qui avaient vengé l’honneur de leur sœur fussent punis. Cette résistance occasionna bientôt une émeute générale: les habitants se liguèrent contre leur seigneur et démolirent le château dont on vient de parler. » — Ces deux écrivains ajoutent que « les hommes d’Unterwalden s’insurgèrent aussi, /149/ prirent le château de Sarnen, chassèrent Landenberg, et se confédérèrent avec ceux de Schwyz contre leur seigneur. » Je pense, comme J. de Muller (I, p. 641), que dans ces relations diverses à quelques égards, mais semblables quant au fond, il s’agit d’un seul et même fait, accompagné de circonstances qui lui sont étrangères. Il résulte de ces deux récits, notamment du dernier sorti de la plume de gens ennemis des Waldstetten, qu’en effet un avoué du landgrave de la maison de Habsbourg-Autriche avait fait ou voulu faire violence à une personne, et que cette action brutale fut punie de mort. La tradition avait conservé le souvenir de cet événement qui, se transmettant de bouche en bouche, s’enrichit de détails, dont nous passons sous silence celui qui n’a pas fait le moins d’impression sur l’esprit d’un peuple superstitieux. Faber et Hæmmerlin, ignorant les véritables causes de la mésintelligence entre le landgrave et les habitants des Waldstetten, et les motifs qui portèrent ceux-ci à résister ouvertement à leur suzerain et à ses délégués, les ont cherchés dans un ensemble de circonstances qu’ils ont recueillies et racontées pêle-mêle, au lieu de les examiner, de les distinguer, et de les rapporter à leur véritable époque. De là cette confusion de personnes, de choses et de temps que l’on remarque dans leur récit. Ils ont confondu, à ce qu’il parait, le château de Schwanau, qu’habitait Gessler 290 , avec un autre, on pourrait croire avec celui de Rotsberg que Simler 291 et Tschudi 292 prétendent avoir été occupé par Wolfenschiess. Simler ajoute 293 que d’après le rapport /150/ des Unterwaldiens ce fut Wolfenschiess qui tomba sous les coups du mari de la femme outragée. Hæmmerlin et Faber ne nomment pas l’auteur de l’injure faite à la pudeur de cette femme. Etterlin (p. 25. 32.) et Stumpff (an. 1314) l’appellent Landenberg, ce qui selon Simler 294 et Stettler 295 est une erreur.
J. de Muller (I, p 639 et n. 207) admet sans hésiter que ce fut Wolfenschiess, frère de deux hommes de ce nom qui remplirent plus tard les fonctions de landamman d’Unterwalden. Ce nom paraît déjà dans un document du 25 juin 1309 (ap. Kopp, p. 111): nous avons cité un landamman de la même famille dans un document de 1356; mais nous ne trouvons aucune indication positive qui puisse justifier l’opinion de ceux qui croient qu’un membre de cette famille, qui fut honorée à diverses époques de la confiance des habitants d’Unterwalden dont elle faisait partie, a été sous-avoué de Landenberg, traître à la patrie et capable de commettre un acte de licence comme celui que vengea la hache de Conrad. Quoiqu’il en soit de l’audacieux auteur de cette infamie, il résulte du désaccord des écrivains en ce qui regarde son nom et sa qualité, qu’ils ne se sont pas copiés l’un l’autre, et de leur accord à reconnaître pour vrai le fait principal, qu’il a réellement eu lieu. La différence que l’on remarque dans l’exposition de ce fait et des circonstances accessoires n’est pas d’un assez grand poids pour le faire rejeter. D’ailleurs Faber n’est pas toujours bien instruit, comme, par ex. , quand il dit que le duc Jean n’avait que douze ans lorsqu’il demanda son patrimoine.
La manière dont nos plus anciens chroniqueurs parlent de la conduite des avoués de cette époque peut avoir donné lieu à bien des erreurs de détails. Justinger, qui doit avoir /151/ été assez bien informé, puisqu’il sait que Schwyz et Unterwalden appartenaient à un seigneur de Habsbourg, qu’Uri était mouvant de l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich, que les efforts des Waldstetten pour se soustraire à la domination de leurs seigneurs furent la principale cause, la source de la guerre avec l’Autriche, rapporte ainsi les circonstances qui la firent éclater: « Ceux d’Uri s’étaient depuis longtemps ligués avec les deux autres Waldstetten. Or, la guerre commença parce que le seigneur-suzerain, ses avoués et officiers, qui étaient dans les Vallées, exigèrent plus de services qu’on ne leur en devait, et usèrent d’artifices 296 pour augmenter leurs droits. Ils se conduisirent aussi avec une grande licence envers d’honnêtes habitants, des femmes et des filles, et voulurent leur faire violence. Ces braves gens ne pouvant tolérer de tels excès, résistèrent aux avoués. Ainsi s’éleva une vive querelle entre le seigneur-suzerain et les Waldstetten » 297 .
Supposé qu’à une époque où les excès qu’on reproche aux avoués étaient rapportés confusément, ceux qui en recueillirent les détails les aient attribués par erreur à l’un ou à l’autre avoué, celà n’infirme point le témoignage des chroniqueurs quant aux actes mêmes. D’ailleurs les oppressions, les violations étaient trop ordinaires au temps de la féodalité, pour que nous ayons quelque raison de révoquer en doute la réalité du fait que l’on dit s’être passé à Alzellen. Croira-t-on que les femmes et les filles de pauvres vassaux n’étaient pas en butte à la passion brutale des officiers de seigneurs peu scrupuleux dans l’établissement de certains droits? /152/ Supposera-t-on une moralité austère, de la pudeur chez des sous-juges dont la cupidité authentiquement prouvée a été censurée par plus d’un chef de l’Empire?
Je ne vois pas dans les désirs coupables de ces avoués la cause première de l’insurrection des habitants des Waldstetten: je l’ai indiquée ailleurs; mais je crois qu’ils ont puissamment contribué à la faire éclater. Le célèbre Niebuhr a fait une observation très-juste à l’occasion de la mort de Lucrèce: « La soif du sang, l’avarice des tyrans de l’antiquité n’était pas ce qu’il y avait de plus affreux pour leurs sujets; c’était la violence faite à une femme, à une fille, tache que rien ne pouvait laver que le sang » Pour nier l’action d’un Sexte-Tarquin, d’un Appius Claudius et, dans notre histoire, d’un Landenberg ou d’un Wolfenschiess, d’un châtelain de Guardoval, il faudrait pouvoir nier un fait incontestable dans l’histoire: c’est que le plus souvent les symptômes de tyrannie se sont manifestés par des actes d’impudicité. Aucun autre vice n’a causé plus de commotions terribles, plus de révoltes générales, plus de morts violentes. En Suisse, il coûta la vie aux deux baillis dont nous venons de parler: la mort de l’un fut l’avant-coureur de la chûte des tyranneaux des Vallées, celle de l’autre fut le signal de la liberté des habitants de Camogask et de la formation des Ligues-Grises.
Malgré le témoignage de nos annalistes et les considérations dont nous l’avons accompagné, l’action odieuse que nous avons rapportée pourrait être révoquée en doute par ceux qui se reposeraient sur une assertion de M. Kopp, qui dit, à la page 45 de son recueil de documents, que « dans le drame Ein hüpsch Spil (dont on a parlé plus haut) l’homme qui pour sauver l’honneur de sa femme tua l’avoué dans un bain, est constamment appelé Cuno Appenzeller. » Ce qui est vrai de l’édition de 1740, qu’a lue M. Kopp, ne l’est /153/ pas de celle de 1579. Dans celle-ci, l’homme dont il s’agit est constamment appelé Cueno Apatzeller. Le prénom Cueno est le nom vulgaire de Conrad, comme Erni est le nom vulgaire d’Arnold. Le nom d’Apatzeller est composé de deux mots, savoir de la préposition ap, pour ab, qui signifie de (comme dans ab Yberg, ab dem Lande, ab dem Ross, ab dem See kommen) et du lieu de Conrad, qui est Atzellen ou plutôt Alzellen (pour Altzelle? ancienne cellule, ou chapelle), dans le Bas-Unterwalden. Le vengeur de l’injure faite à sa femme était, comme nous l’avons dit (p. 147), d’Alzellen. N’ayant pas de nom de famille, il était désigné sous celui de l’endroit où il avait sa demeure, comme Arnold du Melchthal, qui avait pour nom distinctif celui de sa vallée. Celà est d’autant moins douteux que P. Etterlin (p. 25) dit de Conrad « ein byderman vff (auf) Alzellen », et (p. 32) « ein armer man vff Alzelen » 298 , et que, dans une pièce inédite 299 il est nommé Küöni ab Allzellen. De même qu’Arnold est appelé indifféremment vom Melchthal ou an der Halden, du nom de la vallée ou du lieu qu’il habitait, ainsi Conrad porte deux noms de localité, ceux d’Alzellen et de Baumgarten 300 . La préposition de qui précède les noms de lieu en français pour désigner une origine, ou nommer les habitants d’un endroit, est exprimée en allemand par la terminaison er: Apatzeller, Baumgartner 301 . /154/ Gessler avait entrepris ou ordonné la construction d’un château fort, Twing-Uri 302 , qui, selon von Birken 303 , devait aussi porter le nom significatif d’Urner Joch ou de joug d’Uri. On rapporte de cet avoué des traits qui pour n’être pas constatés par des documents n’en ont pas moins un caractère de vraisemblance. Passant un jour à cheval près de Steinen, il voit une maison dont l’extérieur annonce l’aisance 304 . Il la considère d’un œil jaloux. Le propriétaire, Werner de Stauffach, ou (der) Stauffacher, fils de Rodolphe (Stauffacher) qui avait été récemment Landamman de Schwyz 305 , n’en était pas éloigné. Gessler lui demande à /155/ qui appartient cette maison? Werner, qui ne devait pas ignorer qu’en encourageant ses compatriotes à se soustraire à l’autorité seigneuriale il avait mécontenté le gouverneur, lui répondit: « Seigneur, elle est au Roi et je la tiens de sa bonté » 306 . « C’est moi, répond l’arrogant avoué, qui suis le maître de toute la contrée 307 . Je ne souffrirai pas que les paysans bâtissent ainsi des maisons et fassent ce que bon leur semble comme s’ils étaient libres » 308 .
Ces paroles firent sur Stauffacher une impression profonde. Il rentre consterné, et communique à son épouse Marguerite 309 ce qu’il vient d’entendre. Elle tâche de relever son courage abattu, en lui faisant observer que Dieu, qui a en /156/ horreur l’injustice et la tyrannie, n’abandonne pas ceux qui implorent son secours: elle l’engage à chercher des compatriotes courageux qui gémissent sous la même oppression que lui, et de délibérer avec eux sur les moyens d’affranchir le pays. Stauffacher est ranimé par ce prudent conseil: un rayon d’espérance renaît dans son cœur. Il part pour Uri, où il apprend de Werner d’Attinghausen que Gessler est généralement détesté. Il va trouver son ancien et fidèle ami Walther Fürst: il rencontre chez lui un jeune homme brave, courageux, entreprenant; c’était Arnold du Melchthal. Ces trois hommes 310 , passionnés jusqu’au délire pour la liberté, se prêtent le serment mutuel de sacrifier leurs biens et leur vie pour affranchir leurs compatriotes de l’autorité seigneuriale et conquérir les droits qui depuis longtemps font l’objet de leurs vœux et de leurs efforts; ils se promettent de s’employer, chacun de son côté, à faire entrer dans leur association le plus d’hommes possible, disposés comme eux à exposer leurs jours pour le salut commun.
Le secret devait être inviolable jusqu’au moment d’exécuter leur entreprise hardie. Les conjurés choisirent pour /157/ lieu de réunion un pré dans un endroit solitaire, hérissé de buissons, et très-favorable à l’entreprise. Ce lieu, appelé Grütli ou Rütli 311 , par Etterlin (p. 28) Betlin 312 , est situé au bord du lac des Quatre-Cantons, à peu de distance des limites d’Uri et d’Unterwalden, au pied du Selisberg, vis-à-vis d’un rocher nommé Mittenstein. Les trois confédérés, auquel se joignit, selon Etterlin (p. 28), l’homme qui avait tué un avoué ou son lieutenant dans le bain, engagèrent des parents, des amis et d’autres compatriotes à s’associer à eux, et lorsque le nombre parut suffisant, ils fixèrent un jour pour se rassembler et délibérer sur les moyens les plus propres à faire réussir leur projet.
L’entrevue nocturne des conjurés eut lieu, selon quelques écrivains, le 17 oct. , selon d’autres le 7 nov. 1307. Je pense que cette confédération des hommes des trois Waldstetten, confirmée par serment, est l’alliance dont il a été question (p. 141 et suiv.) et qu’elle eut lieu sur la fin de 1306. Je soumettrai ailleurs à un examen les difficultés chronologiques qui résultent des rapports des divers écrivains qui ont fait le récit des événements de cette époque. Les chefs de la conjuration ou de la confédération se rendirent, chacun avec dix hommes, au Grütli. Cette réunion fut sans doute une des plus solennelles dont l’histoire fasse mention. Les intérêts les plus graves d’un peuple qui languissait de secouer le joug d’une domination odieuse y furent discutés. Mais comment savons-nous, comment pouvons-nous savoir quelles décisions prirent ces courageux amis de la patrie, qui sous la voûte des cieux délibérèrent sur les moyens de la rendre libre? Le secret de cette conférence devait être inviolable: il ne fut pas trahi. La résolution que prirent les /158/ confédérés au Grütli dut être en harmonie avec leur conduite passée. D’après leurs dispositions, que diverses circonstances nous ont fait connaître, il est très-probable que les trente-trois confédérés jurèrent de braver tous les périls pour soustraire leur pays à l’autorité du comte-suzerain, au despotisme de ses avoués; qu’ils concertèrent les mesures de défense, les préparatifs qui devaient assurer la réussite de leur entreprise, qu’ils formèrent le projet de s’emparer au besoin des châteaux, qu’ils se promirent un mutuel secours, enfin, qu’ils convinrent d’agir avec prudence et d’attendre les événements jusqu’à ce que l’heure où il faudrait agir eût sonné.
Cependant un des confédérés exposa ses compagnons au plus grand danger et compromit les plus graves intérêts de la patrie. Guillaume Tell refusa de se soumettre à un ordre de Gessler qui le révolta. Arrêté, il parvint à se sauver et tua le préfet autrichien.
Cet événement inopiné et les circonstances qui s’y rattachent, ainsi que l’examen des écrits qui contestent l’authenticité de l’histoire de Guillaume Tell, formeront le sujet de la seconde partie de cet ouvrage.
Il est probable qu’après la mort violente de Gessler les autres avoués s’enfuirent ou furent chassés, et que les habitants des Waldstetten, se considérant dès-lors comme ne dépendant plus que de l’Empire, travaillèrent aussitôt à la conquête des droits domaniaux et de haute juridiction pour parvenir enfin à celle de la propriété foncière, et qu’ils prirent des mesures pour résister à celui qui s’avancerait pour les soumettre. Ce n’est point là une vaine conjecture; car, il résulte d’un document que nous citerons plus tard, qu’à cette époque les hommes d’Uri firent de nouveaux efforts pour s’emparer des droits et des possessions que l’abbesse /159/ de Notre-Dame-de-Zurich avait dans leur vallée et se rendre indépendants de ce monastère; ce qui, vu les dispositions de ceux de Schwyz et d’Unterwalden, nous permet d’admettre que ceux-ci avancèrent aussi dans la voie qui conduisait à l’émancipation et à la conquête. L’attitude des hommes des Waldstetten devint bientôt menaçante. Nous aurons l’occasion de nous convaincre qu’elle inspira à la maison d’Autriche une crainte qui n’était que trop fondée.
D’ailleurs le moment était favorable à l’entreprise des Confédérés. L’Argau était fort agité: un violent orage se formait sur l’horizon politique de cette contrée, dont presque toute la noblesse, fatiguée de voir Albert toujours exercer les droits de landgrave ou de suzerain, dont elle désirait que le duc Jean fût investi, en ressentait une indignation d’autant plus redoutable qu’elle était contrainte. Les dispositions des feudataires de l’Argau enhardissaient les hommes des Waldstetten qui, ressortissant à la juridiction de ce comté, ne pouvaient les ignorer et en profitaient habilement pour hâter l’exécution de leurs projets.
Ces observations répandent du jour sur la conduite des intrépides montagnards et donnent à cette partie de leur histoire, telle que je la comprends, un caractère de vraisemblance qu’elle perd quand on l’isole et qu’on ne la considère pas dans ses rapports avec d’autres circonstances de cette époque qui était grosse d’événements sérieux.
Albert, toujours jaloux de maintenir l’intégrité de l’Empire, d’augmenter et de consolider à la fois la puissance de sa maison, faisait des préparatifs pour le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité dans l’Argau. Il n’est pas besoin de dire que son arrivée en Helvétie devait faire rentrer dans le devoir les habitants des Waldstetten, qui s’étaient rendus coupables de résistance ouverte aux ordres de leur suzerain et de ses officiers, et avaient entrepris un changement dans /160/ leur état politique, changement qu’Albert ne pouvait ni ne voulait tolérer. Les Waldstetten avaient refusé de jurer la paix générale, méconnu l’autorité du landgrave et de ses délégués, contracté des alliances avec des villes et avec des feudataires prêts à se détacher de l’Empire ou du moins désireux de pouvoir et de richesses, et qui pour la plupart attendaient avec impatience l’installation du duc Jean. Albert résolut d’employer la force pour contraindre ses sujets à la soumission.
Mais une mort aussi violente qu’inattendue détruisit en un instant les projets de ce monarque. Jean de Habsbourg, son neveu, l’assassina. Ce jeune prince réclamait les propriétés et les droits qui lui revenaient de son père mort à Prague le 11 mai 1290, et dont le roi Albert avait l’administration en qualité d’oncle et de tuteur.
A l’époque où nous sommes arrivés, le duc Jean 313 devait être mis en possession de la succession de son père. Dans l’acte du 24 nov. 1307, passé sous les yeux du Roi, le duc Jean, exerçant les droits de comte de Habsbourg et par conséquent de seigneur-suzerain (Landesherr), ratifie, en cette qualité, une faveur que son oncle et tuteur, le roi Albert, chef de la maison de Habsbourg-Autriche, accorde à un vassal. Le titre que porte le duc Jean en tête de la charte, /161/ le sceau dont elle est munie, la sanction qu’il donne à un acte d’Albert, prouvent que Jean est majeur (âgé de 18 ans), reconnu capable de porter les armes ou habile à ceindre l’épée, et qu’il exerce un droit de seigneur-suzerain ou de comte-souverain, quoiqu’il ne soit pas encore prince, nous voulons dire en possession de son héritage 314 .
Son oncle le lui refusait, moins peut-être dans l’intention de s’en emparer, que dans la crainte que ce jeune homme sans expérience ne subit l’influence des feudataires de l’Argau et ne se laissât diriger par les conseils de ces grands-vassaux, qui, mécontents de l’administration sévère du chef de l’Empire qui contrariait leurs projets ambitieux, désiraient, plutôt dans leur intérêt que dans celui du jeune duc, de le voir établi dans ses droits et mis en possession de ses domaines. Son ame ne fut que trop sensible à leurs insinuations.
Selon les observations de H. Kopp (p. 74 et suiv.), fondées sur des documents authentiques, il est très-probable que les trois barons de l’Empire, Rodolphe de la Balm 315 , Walther d’Eschenbach et Rodolphe de Wart 316 , répondirent à l’appel que fit, en automne 1306, le chef de l’Empire à la noblesse, et qu’ils le suivirent dans l’expédition qu’il entreprit contre la Bohême; que ce fut à cette occasion, peut-être à Vienne, qu’ils firent la connaissance du duc Jean et formèrent des relations avec des feudataires, des seigneurs depuis longtemps disposés sinon à se défaire du Roi 317 , du moins à briser son pouvoir, et qu’en décembre 1307 ils revinrent en Helvétie, après l’issue malheureuse de cette expédition. /162/ S’il n’est pas exact de dire avec nos historiens que Jean de Habsbourg fut excité par la vue de son cousin Léopold, jeune homme de son âge, comblé d’honneurs et de biens, assertion que rien ne confirme 318 , il est cependant hors de doute qu’il le fut par l’injustice d’Albert qui lui refusait son patrimoine, et par l’instigation de plusieurs seigneurs qui haïssaient le Roi, parce qu’il les contenait dans le devoir et maintenait les droits de l’Empire. Parvenu à l’âge de majorité, Jean de Habsbourg peu satisfait d’un simulacre de pouvoir que son oncle lui permettait d’exercer, et qui n’était proprement qu’une formalité, ne cessait de réclamer son patrimoine. N’obtenant qu’un refus amer, le désespoir où le jeta ce refus opiniâtre en fit un parricide 319 .
Ce qui s’était passé en Helvétie avait irrité Albert. Il n’avait attendu pour châtier les rebelles que la fin de ses démêlés avec l’évêque de Bâle, Otton de Grandson. L’armée était à Rheinfelden. Le Roi traversa la Thurgovie et se rendit en Argovie.
Le premier mai (1308) Albert voulut quitter Baden, où des préparatifs l’avaient arrêté, pour rejoindre la reine son épouse, qui l’attendait avec le gros de l’armée à Rheinfelden. Il était accompagné de plusieurs gentilshommes. Les historiens disent qu’Albert était fort gai pendant le repas, et que /163/ son neveu ayant renouvelé ses instances au sujet de son héritage, Albert avec ironie lui mit une guirlande de fleurs sur la tête, en disant: « Voilà qui vous convient mieux que les soins pénibles du gouvernement. » Cette cruelle raillerie fit sur le jeune duc une impression si vive qu’il fondit en larmes, déchira la guirlande, la jeta loin de lui et quitta brusquement la salle.
Ce fut alors que le désir d’une vengeance sanglante se glissa dans son cœur. Il n’est pas probable qu’elle ait été résolue longtemps auparavant, ni que la noblesse qui épousait la cause du jeune duc ait eu le dessein d’attenter à la vie du chef de l’Empire. Le jour où Jean fit en vain un dernier effort pour obtenir son patrimoine, il jura dans sa colère la perte de l’usurpateur. L’occasion ne pouvait être plus favorable: Albert avait une suite peu nombreuse, dont une partie était dévouée à son neveu. Celui-ci communiqua son funeste projet à ses amis: le sieur de Finstingen, Conrad de Tægerfelden, à qui l’éducation du jeune prince avait été confiée, et les barons Rodolphe de la Balm, Walther d’Eschenbach et Rodolphe de Wart jurèrent avec lui d’ôter ce jour-là même la vie à leur souverain.
Après le dîné Albert se mit en route accompagné de son fils Léopold, des conjurés et des autres seigneurs de sa suite. On arriva près de Windisch, où il fallait traverser la Reuss. Les conjurés, sous prétexte que le bâteau pourrait être trop chargé, séparèrent le Roi de ses fidèles et passèrent les premiers. Au sortir du bâteau, Albert allait au pas de son cheval et s’entretenait, en attendant sa suite, avec Walther de Kastel 320 , qui se trouvait là, lorsque tout-à-coup le duc /164/ Jean, s’écriant: « Voici le salaire de l’injustice! » traversa de sa lance la gorge du monarque; de Balm lui perça le flanc et d’Eschenbach lui fendit la tête: de Wart, que jusqu’ici l’on croyait innocent, souilla aussi ses mains du sang de son souverain. Kastel s’enfuit. Le chef de l’Empire germanique expira, dit-on, dans les bras d’une pauvre femme accourue pour le soutenir.
Ce régicide fut commis en plein jour, à la vue du duc Léopold et de quelques seigneurs qui de l’autre rive en furent témoins sans pouvoir porter le moindre secours à l’infortuné monarque. Le champ qui fut le théâtre de cette scène sanglante est dans la plaine de l’ancienne Vindonissa que domine le château de Habsbourg, manoir domanial des ancêtres d’Albert. La reine Elisabeth, sa veuve, y fit ériger un monastère dont le maître-autel fut élevé sur la place même où il rendit le dernier soupir. Agnès, fille d’Albert et veuve d’André III, roi de Hongrie, contribua beaucoup à la construction, à l’embellissement et à l’entretien de cet édifice sacré, dont elle est regardée comme la seconde fondatrice. Ce couvent, sécularisé depuis, prit le nom de Kœnigsfelden ou champ du Roi, nom qu’il a conservé jusqu’à nos jours. Le corps d’Albert, déposé d’abord à l’abbaye de Wettingen, fut transféré l’année suivante dans la sépulture royale de la cathédrale de Spire et inhumé auprès des restes de Rodolphe son père et d’Adolphe son compétiteur 321
Jean, surnommé le Parricide, ayant perdu tous ses droits /165/ par le meurtre du roi de Germanie, ils passèrent au duc Léopold, qui dès-lors agit en qualité de comte de Habsbourg et de seigneur-suzerain 322 de l’Argau, etc. , tandis que son frère aîné, le duc Frédéric, devint chef de la maison d’Autriche 323 .
Après avoir consommé leur crime, les régicides s’étaient dispersés et tournés chacun du côté où il croyait pouvoir se dérober à la poursuite d’une justice vengeresse ou défendre sa vie et ses biens. Ils ne pouvaient étouffer la voix de la conscience; ils ne pouvaient espérer du repos. Prévoyant qu’il n’y aurait pas de quartier pour eux, qu’en vain ils crieraient merci, les uns errèrent en fugitifs ou se cachèrent comme des proscrits, les autres, comptant sur le secours ou la coopération des nobles de l’Argau et du Thurgau, et sur les troubles que pouvait occasionner la vacance de l’Empire, se décidèrent à soutenir la lutte dont les menaçait la colère d’Elisabeth et de ses fils, et firent dans leurs châteaux-forts des préparatifs de défense. Tandis que Rodolphe de Wart se tenait au château de Falkenstein, près de Balstall, Walther d’Eschenbach s’était avancé dans la proximité de ses forts et de ses riches domaines, d’où ses gens se répandaient dans les environs pour butiner. Un document du 2 oct. 1308 nous apprend que le monastère de Wettingen, qui avait donné la sépulture à la victime royale, dut payer à ce régicide une forte contribution, lui livrer des denrées pour éviter le pillage et ne pas être inquiété pendant quelque temps par ses gens, qui faisaient des incursions, sans doute pour approvisionner les châteaux-forts 324 .
Rodolphe de la Balm s’était enfermé dans son château d’Alt-Buron, entre l’Aar et la Wigger, où un document /166/ du 9 janvier 1309 325 nous le montre faisant des dispositions en faveur de l’abbaye de St. Urbain en compensation du mal que lui et sa famille avaient fait à ce monastère. La position des régicides devenait de jour en jour plus critique. Sans appui dans le pays, soutenus seulement par un petit nombre de nobles, ils paraissaient devoir succomber. Déjà sur la fin d’avril 1309 le château de Wart, dans le district de Winterthur, était devenu la proie de l’ennemi, mais le baron Rodolphe se tenait dans celui de Falkenstein; celui d’Alt-Buron était cerné et sérieusement menacé; Eschenbach, sur la Reuss, avait succombé ou était près de sa chûte, et Walther d’Eschenbach n’avait plus d’autre lieu de défense que le château de Schnabelbourg, au pied de l’Albis. Les ducs Frédéric et Léopold s’avancèrent avec des troupes contre ce château fort et, après avoir fait avec Zurich, qui devait observer la neutralité, une convention par laquelle ils s’engageaient à réparer le dommage que pourrait éprouver son territoire, tandis que la ville, de son côté, promettait de ne donner aucun secours aux assiégés, ni au comte Wernher de Homberg, ni aux Waldstetten, s’ils s’armaient contre eux, à moins que le Roi n’en décidât autrement 326 , ils entreprirent le siège de ce château, qui bientôt dut se rendre faute de vivres et de secours 327 . La garnison, dit Tschudi, fut décapitée.
Pour comble de malheur, le nouveau roi de Germanie, Henri VII, qui, comme on le voit par le document que nous venons de citer, ne s’était pas jusqu’alors prononcé ouvertement à l’égard des ducs d’Autriche, se rendit enfin à leurs /167/ sollicitations, et lança, le 18 sept. 1309, peu de jours après la prise du château de Schnabelbourg, lorsque la cause des régicides fut décidément perdue, un acte de proscription 328 contre le duc Jean, les barons Rodolphe de Wart, Rodolphe de la Balm, Walther d’Eschenbach et le chevalier Conrad de Tægerfelden, qu’il dégrada, déclarant leurs fiefs vacants, leurs biens échus à l’Empire, leurs femmes et leurs enfants déchus de tous leurs droits.
Il est probable que ce fut alors que le duc Jean, perdant tout espoir de salut, franchit les Alpes et se rendit en Italie. On dit qu’après avoir erré quelque temps dans les bois après la scène sanglante de Windisch, il s’arrêta à Notre-Dame-des-Ermites, y prit un froc et se rendit ainsi déguisé à Pise, où Henri VII le vit en 1313. Un auteur contemporain, le Frère François de Bologne, que nous avons cité plus haut (p. 162), rapporte que ce malheureux jeune homme mena la triste vie d’un proscrit, qu’après être allé çà et là, à l’aventure, il vint à Pise, où ayant été reconnu il fut livré à Henri VII, qui se trouvait alors dans cette ville, jeté par ordre de ce prince dans un noir cachot 329 , où il mourut bientôt de tristesse et de douleur. Mais ce chroniqueur, qui ajoute que les complices de Jean d’Autriche, pourchassés par les fils du monarque assassiné, furent enfin saisis dans une ville et décapités, prouve qu’il n’était pas en tout point exactement informé. Quoiqu’il en soit, Jean d’Autriche et de Habsbourg, ou le Parricide, mourut le 13 décembre 330 1313 à Pise, où il fut enterré dans l’église des Augustins. /168/. Ce qu’Hæmmerlin et d’autres racontent de la vieillesse et de la misère de cet infortuné, d’un fils aveugle qu’il engendra dans son malheur et qui mendiait à Vienne 331, est inventé.
On ignore ce que devinrent C. de Tægerfelden et Finstingen: peut-être échappèrent-ils à la faveur d’un déguisement et d’un nom supposé. S’il n’est pas avéré que Finstingen fut coupable, quoique Stumpff (ad an. 1308) le compte parmi les meurtriers d’Albert, on ne peut douter de la culpabilité de Tægerfelden, que Henri VII comprit dans l’acte de proscription. Rodolphe de la Balm succomba peut-être bientôt au chagrin et à la misère. Selon Vrstisen, il mourut à son château d’Alt-Buron. Un acte de 1312, qui fait mention de « feu Rodolphe de la Balm (von der Palm) » 332 , prouve qu’à cette époque il avait cessé de vivre. Walther d’Eschenbach passe encore un acte le 1er juillet 1310 333 : depuis on n’a de lui aucune trace. Selon Ebendorffer de Haselbach 334 et d’autres, il se réfugia dans le Wurtemberg, où il passa trente-cinq ans comme simple berger, et ne fut reconnu que lorsqu’à l’article de la mort il révéla son nom et son rang. /169/
Rodolphe de Wart, après avoir perdu le château de ce nom et vendu, le 13 août 1309 335 , sa part de celui de Falkenstein avec tous les droits qui en dépendaient et qu’il ne pouvait plus maintenir, voulut aussi chercher son salut dans la fuite. Ce seigneur, que Tschudi (I, p. 250) et Muller (II, p. 20) prétendent n’avoir été que spectateur de l’assassinat d’Albert, n’était malheureusement que trop coupable, d’après le témoignage de plusieurs écrivains, entre autres de son contemporain Jean de Winterthur, dont les yeux virent une partie des effets terribles de la vengeance autrichienne 336 , et qui raconte ainsi la fin tragique de Rodolphe de Wart: « Trahi à son retour après avoir pris la fuite, et livré au duc Léopold, le seigneur de Wart fut enfermé dans une étroite prison. Lorsque le duc lui reprocha son crime de lèse-majesté, de Wart lui répondit qu’il n’avait pas tué son seigneur, mais un malfaiteur qui avait souillé ses mains du sang d’Adolphe son souverain légitime. Cependant, bientôt après avoir prononcé ces paroles téméraires, il rentra en lui-même et se repentit amèrement de son crime. Cet infortuné, qui avait ôté la vie à son maître, à son bienfaiteur, fut condamné sans aucune forme de procès ou de jugement à subir le supplice le plus affreux: il expia sa faute sur la roue. Les membres brisés, il vécut encore trois jours sur le bois infâme, pendant lesquels son épouse se tint au pied de l’instrument du supplice, sans se trahir, de peur de le détourner de son Dieu vers qui devaient se diriger toutes ses pensées pour le salut de son /170/ ame. Sans doute le glaive de la douleur perça le cœur de cette tendre épouse » 337 .
Que ce récit d’un chroniqueur est simple, touchant et vrai! L’auteur, ému des souffrances de Wart, et indigné de la barbarie de Léopold, s’écrie, en faisant allusion à l’épithète de Glorieux dont le duc était honoré: Ecce quam gloriose vindicavit mortem patris sui Lupoldus! « C’est ainsi que Léopold vengea glorieusement la mort de son père! » 338 /171/
La mort violente d’Albert, l’affreuse misère de Jean d’Autriche et de ses compagnons, l’horrible supplice de R. de Wart, offrent des tableaux assez sombres pour qu’il ne soit pas nécessaire de les charger de scènes encore plus lugubres. L’historien consciencieux, l’ami de l’humanité, qui porte à ceux qui ne sont plus un intérêt d’autant plus vif que leur voix ne peut se faire entendre, éprouve une joie bien douce à pouvoir réhabiliter la mémoire d’une princesse de vingt-huit ans, que l’on a fait passer pour un monstre de cruauté, comme si l’imagination, toujours capricieuse, s’était plu à faire servir Agnès de contraste à la figure angélique de Gertrude. La découverte de documents authentiques nous permet de rectifier le jugement des auteurs qui ont flétri la mémoire de cette jeune femme, victime d’une déplorable erreur et d’une haine que rien ne saurait excuser.
On raconte d’Agnès, fille d’Albert et veuve d’André roi de Hongrie, qu’à la prise de Fahrwangen, principal château-fort du baron de la Balm, elle fit décapiter soixante-trois chevaliers innocents, et que voyant couler à ses pieds le sang de ces soixante-trois victimes de sa fureur, elle s’écria: « Je me baigne dans la rosée de Mai! »
Si véritablement quelque membre de la famille d’Albert fut l’auteur de ce carnage, si cet affreux spectacle n’est pas identique avec le massacre des soixante - trois 339 défenseurs du château de Greifensee, ordonné (le 27 mai 1444) par le féroce Ital Reding; si les horribles paroles que l’on met dans la bouche d’Agnès ne sont pas celles que prononça (le 26 août 1444) l’insolent Burkard Mönch, sur le champ de bataille de S. Jacques, en foulant les cadavres des Suisses, cet acte de vengeance d’odieuse mémoire ne doit être /172/ attribué qu’à la reine-veuve Elisabeth 340 , ou à son fils Léopold, que Jean de Winterthur (l. c.) appelle un autre Jéhu.
On a dit qu’Agnès se dédommagea cruellement de la fuite des complices de Jean d’Autriche sur leurs familles innocentes, qu’à la prise de Marschwanden, château de la maison d’Eschenbach, les soldats farouches montrèrent plus d’humanité qu’Agnès, que sans eux elle eût étouffé de ses propres mains un petit enfant couché dans un berceau, dernier rejeton de la maison d’Eschenbach, qu’elle ne lui conserva la vie que pour lui faire quitter un nom si odieux et prendre celui de Schwarzenberg; et, sans doute pour donner plus de poids à ces accusations, on a prétendu que, retirée au couvent de Kœnigsfelden, résolue de finir ses jours dans la dévotion, comme elle invitait les passants à se rendre dans son église, Frère Berthold Strobel d’Oftringen lui dit avec l’accent de l’horreur que lui inspiraient ses actes atroces: « Madame, c’est une mauvaise dévotion que de répandre le sang innocent et de fonder des couvents avec des richesses injustement ravies. Dieu aime la clémence et la miséricorde. »
Quant à la prétendue scène de Marschwanden, les chartes qui existent de Walther d’Eschenbach ne permettent pas d’admettre qu’il ait eu des enfants. S’il en avait eu, il ne les aurait pas omis dans les actes où il dispose de ses biens. R. de Wart et R. de la Balm parlent des leurs 341 . Le silence /173/ des documents à cet égard suffit pour rendre suspect ce qu’on vient de lire relativement à l’enfant dont Agnès doit avoir changé le nom. — Pour ce qui concerne le nom de Schwarzenberg, M. Kopp montre (p. 84 et suiv.), pièces en mains, que les familles d’Eschenbach, de Schnabelbourg et de Schwarzenberg étaient étroitement unies par le lien de parenté, que par droit d’hérédité et de succession les domaines de ces familles changèrent de maîtres et que ce changement amena celui du nom de famille, de manière que les seigneurs d’Eschenbach prirent successivement les noms de Schnabelbourg et de Schwarzenberg.
D’ailleurs, outre que rien n’atteste qu’Agnès soit entrée au couvent de Kœnigsfelden avant 1316 342 , il est facile de prouver qu’en construisant la chapelle avant d’édifier le monastère de Kœnigsfelden, on construisit aussi une demeure pour deux hommes pieux, dont l’un s’appelait Frère Nicolas de Bischoffzell, l’autre Frère Strobel, natif d’Oftringen, qu’il y vint ensuite quatre autres frères, et que tous les six moururent à Kœnigsfelden 343 .
C’est ainsi que des parchemins poudreux mettent au jour la vérité et font rentrer dans le néant des fables trop facilement accréditées.
Au surplus, la chronique de Kœnigsfelden rend à Agnès ce témoignage, que dès sa jeunesse elle fut pieuse, bienfaisante, charitable 344 . /174/
Toutes les fois que l’Empire était sans chef, les grands vassaux d’un côté, les communes de l’autre, se montraient fort empressés à prendre possession de certains droits. Depuis la chute ou l’expulsion des préfets de l’Autriche, surtout pendant la vacance qui suivit la mort d’Albert, les communes des Waldstetten se sentirent assez fortes pour relâcher davantage le lien qui les unissait à leur suzerain et diminuer le pouvoir de la maison de Habsbourg-Autriche et des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, en poursuivant avec ardeur l’œuvre d’émancipation depuis longtemps entreprise, et en s’attribuant les droits qu’exerçaient les avoués. /175/
C’est à cette époque d’anarchie que la communauté d’Uri renouvela ses prétentions sur les biens que possédait dans cette vallée l’abbaye de Notre-Dame-de-Zurich, qu’elle soumit à des taxes.
Mais entre temps, notamment depuis le 2 oct. 1308, la face des choses était changée. Les régicides avaient perdu leurs principaux forts, et les autres ne pouvaient tenir longtemps. Leur parti devenait de jour en jour plus faible; l’Autriche triomphait de ses ennemis et semblait n’attendre qu’un moment favorable pour fondre sur les Waldstetten, dont les habitants, surpris par les événements, n’étaient pas en mesure de résister à la fois à la puissante maison qu’ils avaient gravement offensée et à la noblesse qui lui restait fidèle. Leur position devenait critique. On ne saurait douter que le succès des ducs et l’appui que leur promettait Henri de Luxembourg, pour qu’ils favorisassent son élection, n’aient fait sur les hommes des Waldstetten une impression profonde; car, le 11 nov. 1308, Wernher d’Attinghausen, landamman, les hommes d’Uri et les consorts ou participants de Silennen firent amende honorable, et remercièrent l’abbesse de Notre-Dame-de-Zurich de ce qu’à leur prière elle renonçait au dédommagement qu’ils lui devaient pour avoir exigé des impôts des propriétés situées dans leur pays mais appartenant à l’abbaye, lui promettant de ne plus la dépouiller de ses revenus 345 . Plus tard ils s’emparèrent de nouveau des rentes de l’abbaye 346 .
Après un interrègne d’environ sept mois, pendant lequel les ducs d’Autriche, exécutant leurs projets de vengeance, ruinaient les châteaux des meurtriers de leur père, l’Empire germanique reçut un chef. Henri de Luxembourg fut élu roi des Romains à Rens le 15 nov. 1308, puis d’une manière /176/ plus solennelle à Francfort, le 27 du même mois, et couronné à Aix-la-Chapelle le 6 janvier 1309. Il prit le nom de Henri VII.
Le troisième jour après son élection solennelle, c’est-à-dire le 30 oct. , le nouveau chef de l’Empire promit à Francfort d’investir les ducs d’Autriche de tous les fiefs et de tous les droits qu’ils avaient possédés sous les trois derniers rois ses prédécesseurs, et de les soutenir contre tous ceux qui les leur contesteraient, ou qui s’armeraient contre eux. Après son couronnement Henri fit la même promesse, à Cologne, le 13 janvier 1309. Puis, remontant le Rhin, il se rendit en Helvétie, en visita plusieurs villes, et traversa les pays sujets de la maison d’Autriche pour rentrer par Constance en Allemagne. Quoiqu’il se trouvât si près des ducs et qu’il fût témoin de leur guerre avec les assassins de son prédécesseur, il différa sous divers prétextes l’investiture qu’il leur avait promise, et, ne mettant pas au ban de l’Empire les régicides, il ne leur ôta point le pouvoir de résister aux ducs d’Autriche, qui durent même bientôt s’apercevoir que le roi Henri était moins disposé en leur faveur qu’en faveur de leurs adversaires 347 . Henri VII ne pouvait se dissimuler que la maison d’Autriche ne renonçait pas à la succession au trône de Germanie. S’il n’agit pas sincèrement envers les ducs, c’est qu’il crut ne pouvoir compter sur leur loyauté. La crainte de rencontrer dans Frédéric un dangereux rival, quand il aurait affermi la puissance de la maison d’Autriche avant d’avoir consolidé la sienne et d’être bien établi sur le trône, le dirigea sans doute dans sa conduite. Il lui importait de s’assurer pour un de ses fils le trône de Bohême, auquel l’Autriche pouvait prétendre 348 . De plus, l’Empire pouvait faire valoir les prétentions qu’avait eues le /177/ duc Jean sur les biens héréditaires communs de Habsbourg-Autriche et sur les fiefs de cette maison ducale; circonstance que Henri VII, en homme prudent, ne devait pas négliger, et qui était propre à inspirer de la crainte aux ducs Frédéric et Léopold. Ceux-ci, en appuyant l’élection de Henri de Luxembourg au trône impérial, qu’ils ne pouvaient espérer d’occuper dans les conjonctures présentes, vu que la domination autrichienne s’était fait peu d’amis, avaient quelque vue secrète, et le candidat à l’Empire, en leur promettant l’investiture qu’ils désiraient, était bien décidé de ne pas tenir comme empereur ce qu’il promettait comme duc de Luxembourg. L’intérêt bien entendu déterminait les actions des deux partis. On se trompe, à mon avis, quand on ne croit voir que déloyauté chez l’un, que désintéressement chez l’autre 349 . Les intentions de Henri VII se manifestèrent bientôt par ses actes. D’abord il donna les biens de la maison de Balm à titre de fief impérial à Strassberg. Puis, voulant d’un côté diminuer la puissance de l’Autriche, de l’autre s’assurer l’appui des Waldstetten, il suivit l’exemple de ceux de ses prédécesseurs qui avaient eu besoin de leur secours, et leur accorda des avantages considérables. Il lui importait de trouver sur la dangereuse route d’Italie non des ennemis qui pouvaient lui défendre l’entrée de la Lombardie, /178/ ou lui couper la retraite en cas d’échec, mais des amis qui lui ouvrissent les portes de leurs montagnes et lui offrissent du secours et un moyen de salut en cas de revers. Avant son départ de Constance il confirma, le 3 juin 1309, à Schwyz et à Unterwalden les priviléges que leur avait accordés Frédéric II en 1240, que Rodolphe n’avait pas ratifiés et qu’Adolphe n’avait reconnus, comme nous l’avons dit, que dans son extrême embarras. Henri VII, en donnant aux hommes des deux vallées susdites cette marque de faveur, se réserva leur fidélité à l’Empire et à son chef, et l’accomplissement des devoirs auxquels étaient soumis tous les vassaux de l’Empire 350 . Non content d’avoir assimilé la condition politique des vallées de Schwyz et d’Unterwalden à celle d’Uri, en les élevant au rang de fiefs immédiats de l’Empire, Henri VII accorda, le même jour, aux trois Waldstetten un nouveau privilége, dont aucun souverain ne les avait gratifiées; car, à la charte que nous venons de citer, il en ajouta une autre, contenant la déclaration formelle que les hommes des trois Vallées ne pourraient être appelés à comparaître, pour quelque sujet que ce fût, devant un tribunal quelconque hors de leurs limites, excepté devant celui de l’Empire 351 . /179/
Il est vrai qu’en homme prudent Henri VII avait glissé dans ce diplôme une clause, par laquelle il se réservait au besoin la révocation du privilége important qu’il accordait aux hommes des Vallées 352 , clause qui pouvait devenir la source d’une guerre cruelle, et qui devait nécessairement engager ces hommes, à qui la liberté devenait aussi chère que le joug de la domination leur était odieux, à prendre les mesures que réclamait la défense du droit précieux qu’ils venaient d’obtenir. Par l’acquisition de ce privilége les Waldstetten firent un grand pas vers leur indépendance. Henri VII venait de les affranchir de tout tribunal étranger, et pour que l’on ne pût douter que le lien qui unissait le landgrave, de la maison d’Autriche, aux Waldstetten ne fût rompu, il leur donna, ainsi qu’à d’autres contrées de l’Helvétie 353 , un Avoué provincial (advocatus provincialis) ou Landvogt 354 . Les ducs d’Autriche, comme pour protester contre les actes du Roi, et prouver qu’ils ne renonçaient pas à leurs droits sur les Waldstetten, donnèrent aussitôt à leur lieutenant dans l’Argau le titre de Landvogt 355 , qu’ils substituèrent ainsi, par opposition à ce que faisait le Roi, /180/ à celui de Landrichter. Ils lui reconnaissaient le pouvoir de changer un titre sans lui reconnaître celui de les dépouiller de leurs droits héréditaires, que toutefois ils ne pouvaient exercer avant d’en avoir été investis par le nouveau chef de l’Empire.
Jusqu’alors les trois Vallées n’avaient pas connu de tels priviléges. Ce que le Roi venait de leur accorder devait surpasser leur attente.
Dès lors elles firent de leur autorité privée ce qu’auparavant elles n’ordonnaient que par la médiation du Landrichter. Ainsi, lors d’un différend survenu entre le monastère d’Engelberg et les gens d’Uri, au sujet de quelques alpes, les deux partis nommèrent leurs défenseurs et pour arbitre le landamman de Schwyz 356 , tandis qu’autrefois les affaires en litige se décidaient devant le tribunal du Landgrave ou du Landrichter. La puissance de ce seigneur haut-justicier venait de recevoir une rude atteinte par un acte d’autorité impériale qui permettait aux hommes des Vallées de prendre une attitude imposante. Les collisions étaient inévitables. Ceux d’Uri, loin de penser à faire quelque concession à la maison de Habsbourg-Autriche, songeaient bien plus à profiter des avantages qu’ils avaient obtenus, et, franchissant en idée leurs limites, ils entraient en relation avec les habitants de la vallée d’Urseren 357 , sur lesquels il leur importait d’exercer de l’influence pour être maîtres du passage du S. Gothard et n’avoir pas d’ennemis en-deçà de cette montagne qui devait les protéger.
La convention que firent les ducs d’Autriche avec Zurich, /181/ le 1er août 1309, lorsqu’ils voulurent entreprendre le siège du château de Schnabelbourg, prouve jusqu’à quel point ils redoutaient une attaque de la part des hommes des Vallées et du comte Wernher de Homberg, depuis peu procurateur de l’Empire ou lieutenant impérial dans les Waldstetten 358 , et combien ils craignaient que le Roi n’y donnât la main 359 .
Ce ne fut que le 18 sept. 1309, alors que la cause des régicides était décidément perdue, que le Roi de Germanie lança contre eux l’acte de proscription dont nous avons parlé (p. 167) et qu’il se rapprocha, du moins en apparence, des ducs d’Autriche, toutefois sans reprendre aux Waldstetten ce qu’il leur avait accordé.
Dans ce temps les communes de Schwyz, qui ne négligeaient aucune occasion d’augmenter leurs propriétés et leurs droits, contestaient à l’abbaye d’Einsiedeln la possession des alpes qui depuis longtemps étaient le sujet de petites guerres sans cesse renaissantes. Epiant toujours le moment favorable de faire valoir leurs anciennes prétentions et de s’emparer de ce qui par sentence impériale ou arbitrale avait été adjugé à l’abbaye, elles avaient profité de la confusion générale pendant la vacance du trône pour recommencer les hostilités avec Einsiedeln. Une lettre du pape Clément V, datée d’Avignon, 12 sept. 1309 (ap. Kopp, p. 117), nous apprend que plusieurs hommes de Schwyz, parmi lesquels figurent Conrad Ab Yberg et Rodolphe Stauffacher avec ses deux fils, s’étaient adressés au S. Siége, se plaignant de ce que l’Abbé et l’assemblée conventuelle les avaient cités devant l’official de Constance au sujet de certains pâturages, prés, bois, etc. , sans autorisation /182/ apostolique, et de ce que ce juge de cour ecclésiastique, procédant mal dans cette affaire, les avait condamnés injustement et de plus excommuniés, sans avoir égard à leur recours au siége apostolique. Le pape ordonna de procéder à un nouvel examen de l’affaire et de juger définitivement selon le droit. Il paraît que de part et d’autre on persista dans ce qu’on avait fait ou résolu. En 1311 ceux de Zurich, invités par les deux partis à terminer ce différend, s’employèrent à rétablir la paix 360, et le 19 juin de cette année les arbitres prononcèrent un jugement qui condamnait les hommes de Schwyz à la réparation des dommages qu’ils avaient causés à l’abbaye. La teneur de l’acte qui contient cette sentence ne permet pas d’admettre l’épisode des prétendus coups de couteaux que Tschudi et Muller disent avoir été portés par des religieux d’Einsiedeln à deux pélerins de Schwyz 361 . La guerre entre Schwyz et Einsiedeln continua, malgré tous les efforts de Zurich, ancienne et bonne amie de Schwyz, pour rétablir et consolider la paix. L’avoué provincial, trop faible ou trop indifférent pour faire respecter l’autorité impériale pendant que Henri VII était occupé en Italie, laissait aux deux partis ennemis le temps de se faire beaucoup de mal. Le 24 avril 1313, Everard de Burglen, seigneur thurgovien, nommé récemment Landvogt impérial à la place de Rodolphe de Habsbourg-Lauffenbourg, prononça un jugement en vertu duquel les hommes de Schwyz devaient payer en trois termes, dans l’espace d’un an, une somme de 900 L. , sous un autre nom que celui d’amende pécuniaire 362 . On exigeait réparation de dommages, mais en /183/ observant envers eux des formes propres à les réconcilier avec leur partie adverse.
Avant que cette amende fût payée et la querelle terminée, un événement imprévu devint la cause de nouveaux troubles et fournit aux hommes de Schwyz l’occasion de faire de nouvelles invasions sur le territoire d’Einsiedeln. Nous voulons parler du décès de Henri VII qui, tombé malade au château de Buonconvento, en Toscane, y mourut, soit de poison, soit d’une fièvre pestilentielle, le 24 août 1313, dans la cinquième année de son règne et la deuxième de son empire 363 .
Après la mort de Henri VII, la division qui se mit parmi les électeurs pour le choix d’un nouveau chef de l’Empire, occasionna un interrègne de quatorze mois et produisit ensuite une double élection.
Durant ce schisme politique et les guerres civiles qui en furent la conséquence, chacun ne songeant qu’à son propre /184/ intérêt, l’Etat éprouva des secousses violentes qui l’ébranlèrent. La maison d’Autriche, dont le dernier empereur avait compromis la fortune, ne voulait pas laisser échapper l’occasion qui s’offrait de la rétablir et de la consolider si son chef parvenait à la dignité royale. Le duc Frédéric disputait la couronne à Louis de Bavière, et partageait avec son frère Léopold le soin de défendre en Helvétie les droits de sa maison. Les Confédérés, de leur côté, profitaient habilement du conflit des deux rivaux qui s’arrachaient le diadème et de la lutte des partis qui mettaient partout le désordre; ils s’affermissaient mutuellement dans la résolution de maintenir les priviléges qu’ils avaient obtenus sous le dernier règne, se préparaient à les défendre courageusement, ne négligeaient aucun moyen d’affranchir leur territoire de toute domination, de conquérir les droits qu’y exerçaient des étrangers, et, bravant les périls, ils attaquèrent hardiment les plus proches sujets ou partisans de l’Autriche. Les petites populations des Vallées puisaient un nouveau courage dans leur isolement. Entourées de voisins qui, frappés de terreur par les triomphes que les ducs avaient remportés sur la noblesse de l’Argau, osaient d’autant moins se déclarer contre la maison d’Autriche que la candidature de Frédéric était appuyée par un parti puissant, elles n’avaient pas même, comme en 1291, l’avantage de voir entrer dans leur association quelque ville ou quelque seigneur. Six semaines après la mort de Henri VII, les ducs Frédéric et Léopold, redoublant d’efforts pour maintenir en Helvétie la paix générale et empêcher des ligues particulières avec les Waldstetten, firent à Diessenhofen, avec la ville de Zurich, un traité, en vertu duquel cette ville prit les deux ducs et leurs frères pour Seigneurs et Protecteurs jusqu’à ce que l’on eût élu et couronné à Aix-la-Chapelle un Roi des Romains; les ducs prirent dans ce contrat l’engagement de /185/ protéger dans tous leurs domaines et de tout leur pouvoir la vie et la fortune des Zuricois, de laisser intacts les droits et les franchises de la ville et de l’abbaye, de ne prétendre ni à l’avouerie de la ville de Zurich, ni aux droits et aux propriétés qui en dépendaient; on convint de part et d’autre que les Zuricois ne seraient pas tenus de prendre part aux guerres ouvertes dans lesquelles les ducs se trouvaient engagés, à moins qu’ils ne voulussent s’y prêter librement » 364 .
Les hommes de Schwyz, ennemis irréconciliables d’Einsiedeln, fondirent à l’improviste, dans la nuit du 5 au 6 janvier 365 1314, sur l’abbaye et enlevèrent plusieurs religieux qui ne durent leur élargissement qu’à l’intervention et à la sollicitation de quelques seigneurs puissants, qui écrivirent à Werner Stauffacher, landamman de Schwyz, et à la communauté de ce pays 366 . Les captifs ne furent relâchés qu’à condition que l’abbé et ses religieux payeraient une somme considérable 367 et ne vengeraient jamais l’injure qu’on venait de leur faire. /186/
Durant les hostilités de Schwyz envers Notre-Dame-des-Ermites les hommes des Vallées faisaient la guerre à Lucerne. Nous ne savons pas qui des trois Vallées ou de Lucerne fut l’agresseur. Il est probable que les hommes d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden prirent l’offensive, pour affaiblir la puissance de l’Autriche et réduire les Lucernois à l’inaction ou les obliger à faire, comme jadis, cause commune avec eux. Quoiqu’il en soit, l’autorité des ducs paraissait si bien établie à Lucerne, que cette ville, d’ancienne alliée des autres Waldstetten, devint leur ennemie, et que, loin de permettre, comme au milieu du 13e siècle, de les assister dans les guerres contre leurs seigneurs, elle ordonna à ses habitants, ainsi qu’à ceux d’Immensee, de Kussenach, de Greppen, d’Hergiswil, d’armer contre elles 368 . Cette guerre commença déjà avant la mort de Henri VII. Il paraît que Schwyz, tout occupé de sa querelle avec Einsiedeln, ne tarda pas à se réconcilier avec Lucerne; car, d’après un document du 22 juin 1309 (ap Kopp, p. 107), le comte Werner de Homberg, dont on vient de parler, Conrad ab Yberg, (Land)-amman, et la communauté de Schwyz annoncèrent aux autorités de Lucerne que les bateaux et les hommes de cette ville qui voudraient se rendre à Fluelen ne seraient plus inquiétés par les hommes de Schwyz.
Les habitants d’Uri, d’Unterwalden et de Lucerne continuèrent avec acharnement cette guerre de représailles, qui dura jusqu’après la bataille du Morgarten 369 , coûta du sang et causa beaucoup de ravages. Les deux partis /187/ s’attaquaient sur le lac ou tâchaient d’effectuer à l’improviste des descentes pour dévaster le pays ennemi par le fer et par le feu. Les événements que nos écrivains rapportent, les uns à 1310, les autres à 1314, se rattachent à cette guerre, dont ils paraissent n’avoir connu ni la durée, ni la cause. Ce qu’on raconte d’un bateau de Lucerne, que, voulant aborder à Stansstad pour surprendre le pays d’Unterwalden, il fut écrasé par une pierre de moule et l’équipage noyé, fait partie de ces événements. Muller (II, 30) dit que ce bateau, nommé l’Oie (Gans), appartenait à Lucerne et que l’équipage venait attaquer Unterwalden, Russ, au contraire, dit (p. 29) qu’il appartenait à Uri et que les hommes de cette vallée venaient avec un grand nombre de leurs voisins attaquer Lucerne. Ce chroniqueur donne plusieurs détails de cette violente querelle 370 . Nous les passons sous silence parce que, n’ayant pas de documents propres à les vérifier, nous ne pouvons les exposer avec ordre et clarté. Ce que nous avons dit de cette guerre suffit pour l’apprécier.
Cependant, après un déplorable interrègne de quatorze mois, l’Empire eut deux chefs au lieu d’un. Frédéric-le-Bel, duc d’Autriche et comte de Habsbourg, fils du roi Albert Ier, fut élu à Saxenhausen, près de Francfort, le 19 oct. 1314, par l’archevêque de Cologne et le comte palatin, frère de Louis de Bavière, et couronné le 25 nov. suivant à Bonn, par l’archevêque de Cologne. Son cousin germain et son compétiteur, Louis de Bavière, fils de Louis-le-Sévère, comte palatin et duc de Bavière, et de Mathilde, fille du roi Rodolphe Ier, fut élu un jour après son rival, le 20 oct. , à Francfort, par cinq électeurs, et couronné le 26 nov. suivant à Aix-la-Chapelle, par l’archevêque de Mayence 371 /188/
Cette double élection, augmentant le schisme politique qui compromettait l’existence de l’Empire, jeta le trouble et la confusion dans toutes les contrées de la Germanie.
Toute l’Helvétie s’était déclarée pour Frédéric d’Autriche, excepté Berne et Soleure qui ne reconnurent point en lui un souverain légitime 372 , et les trois Waldstetten Uri, Schwyz, Unterwalden, qui, ennemies naturelles de la maison d’Autriche, embrassèrent chaudement la cause de Louis de Bavière.
La puissance de la maison d’Autriche était imposante: le chef de cette maison, soutenu par un parti considérable, avait quelque chance de siéger seul sur le trône impérial; les ducs avaient triomphé de leurs ennemis en Argau et raffermi leur autorité dans d’autres parties de l’Helvétie. Les hommes des trois petits pays au cœur des Alpes, entourés de partisans de l’Autriche, leur offraient une résistance opiniâtre, espérant tout d’un courage qui jusqu’alors ne s’était pas démenti.
Il est assez probable que si l’élection d’un successeur de Henri VII n’eût pas occasionné de schisme dans l’Empire, et que les suffrages des électeurs se fussent portés sur Frédéric d’Autriche, la guerre avec les Waldstetten aurait été bientôt terminée. Frédéric, fidèle à la politique de son aïeul et de son père, se serait hâté de travailler au maintien de l’intégrité de l’Empire, de remettre en vigueur la constitution germanique, de rétablir par conséquent les droits et la domination de Habsbourg-Autriche, et d’y soumettre les Waldstetten, que l’empereur Henri VII en avait affranchies. La position de ces vallées était très-critique. Frédéric ne voulait ni ne pouvait, sans rompre le lien qui unissait tant /189/ de contrées à l’Empire et compromettre les intérêts de sa maison, ratifier la charte du 3 juin 1309 qu’Henri VII leur avait accordée. D’ailleurs cette charte ne garantissait pas à toujours aux Waldstetten les priviléges qu’elle contenait, puisque son auteur s’était réservé la faculté de la révoquer 373 . Il est vrai que Henri VII, par un effet des circonstances où il se trouva, ne retira point aux Vallées ce qu’il leur avait accordé. Cependant, à la mort de ce souverain cette charte n’avait plus de valeur. Dès-lors Schwyz et Unterwalden retombaient sous la domination ou sous l’avouerie de Habsbourg, et ces deux vallées avec Uri faisaient de nouveau partie du landgraviat de l’Argau et de la juridiction de ce comté: les trois Waldstetten rentraient dans leur première condition politique; en d’autres termes, on allait voir se reconstituer l’ancien ordre de choses tel qu’il avait existé sous les rois Rodolphe et Albert. Il n’est point étonnant que les trois Waldstetten aient préféré leur nouvelle condition à l’ancienne. Mais, si d’un côté l’on conçoit que les Waldstetten, dont l’indépendance était remise en question, refusèrent de reconnaître Frédéric, parce qu’il n’avait pas réuni tous les suffrages et qu’en le reconnaissant elles auraient renoncé à leurs précieux priviléges, dont elles attendaient de Louis la confirmation, de l’autre on comprend que Frédéric et Léopold, loin de renoncer à leurs droits, aient pris des mesures pour les maintenir et se soient préparés à les défendre les armes à la main.
Avant tout ils nommèrent le comte Werner de Homberg au landgraviat du Thurgau, donnèrent au comte Frédéric de Toggenbourg l’office de Pfleger ou de Procurateur de Glarus, au comte Otton de Strassberg celui de Vogt ou d’Avoué du Pays-d’enhaut (Oberland) et chargèrent sire Henri de /190/ Griessenberg des fonctions de Landrichter de l’Argau 374 , ou de lieutenant de Léopold, qui par suite de l’élection de Frédéric devenait duc d’Autriche et de Styrie, landgrave d’Alsace, comte de Habsbourg et de Kibourg, et par conséquent landgrave de l’Argau.
En rétablissant, avec l’ancien ordre de choses, le nom de Landrichter auquel Henri VII avait substitué celui de Landvogt, Frédéric et Léopold rétablirent aussi leurs officiers subalternes ou avoués, auxquels les habitants des Waldstetten refusèrent de se soumettre.
C’est à cette époque, c’est-à-dire à la fin de 1314 ou au commencement de 1315, qu’il faut rapporter la prise et la destruction des châteaux-forts par les hommes d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden. Nous n’en racontons pas les détails, parce qu’ils sont connus et que nous n’avons d’ailleurs pas de documents pour en garantir l’exactitude.
Dans le même temps les hommes d’Uri, qui, comme ceux des deux autres vallées, ne respectaient plus aucun droit seigneurial dans leurs limites, aucun vassal de la maison de Habsbourg-Autriche, avaient une querelle avec le comte Werner de Homberg, proche parent des comtes de Habsbourg 375 . Ce seigneur, qui en 1309 était procurateur (Pfleger) de l’Empire romain dans les Waldstetten 376 , obtint, le 21 janvier 1313, de Henri VII, le péage de Fluelen à titre /191/ de fief impérial. Ce fief, dont Frédéric-le-Bel lui confirma l’investiture, fut un sujet de discorde et de contestation entre le comte de Homberg et les hommes d’Uri, qui eussent préféré être en possession de ce péage, et qui refusaient de reconnaître les diplômes de Frédéric, sous prétexte qu’il n’était pas seul roi 377 . Ce péage fut sans doute un des motifs de la guerre qui devenait de jour en jour plus imminente. Le comte, dont la cause fut confondue avec celle des ducs d’Autriche, la perdit par la journée de Morgarten, et déclara, huit jours après cette action mémorable, qu’il en appelait à la décision impériale, c’est-à-dire au jugement du prince qui serait reconnu seul chef de l’Empire 378 .
Les trois Waldstetten trouvèrent un ennemi de plus dans Jean de Schwanden, abbé d’Einsiedeln. Cet abbé et Gérard de Benar, évêque de Constance, excommunièrent les habitants des Waldstetten, qui outre celà furent mis au ban par la chambre impériale de Rothweil. Ceux-ci, qui s’étaient hâtés de se déclarer pour Louis de Bavière, s’empressèrent aussi de solliciter sa protection et son secours. Louis accueillit favorablement leur demande. D’abord il dissipa les inquiétudes que leur avaient données des discours peu propres à les rassurer sur ses intentions à leur égard, et les exhorta à résister courageusement aux ducs d’Autriche, comme à gens orgueilleux qui ne cherchaient qu’à satisfaire leur ambition en détruisant le bonheur des peuples; il les engagea à persévérer dans leur fidélité et leur constance jusqu’à ce qu’à la diète déjà convoquée à Nuremberg il pût leur donner des marques non équivoques de sa bienveillance 379 . Enhardis par ces paroles, les Confédérés /192/ résistèrent opiniâtrément aux ducs et à leurs partisans. De Nuremberg Louis leur envoya une charte, dans laquelle, après leur avoir promis de prompts remèdes à leurs maux, et les avoir de nouveau encouragés à se conduire avec fermeté, à ne point se laisser abattre par les menaces de leurs ennemis, il annula la sentence qui les mettait au ban de l’Empire, et leur dit que Pierre (Aichspalter), archevêque de Mayence (dont dépendait l’évêché de Constance qui comprenait dans son diocèse les Waldstetten), lui avait promis de faire lever l’excommunication prononcée contre eux à l’instigation de l’abbé d’Einsiedeln 380 . Enfin, par une troisième lettre il cassa, en vertu de son autorité royale, tout acte de proscription qui les avait frappés 381 .
Cependant les ducs d’Autriche, loin de céder, redoublaient d’activité pour maintenir leurs droits. Tandis que Frédéric défendait sa couronne, Léopold faisait une levée de boucliers contre les Waldstetten. Chacun allait confier sa fortune au sort des batailles.
Le duc Léopold étant venu de Strasbourg à Bâle, où, à Pentecôte (11 mai) 1315, il célébra ses noces avec Cathérine de Savoie, se rendit de là par Soleure à Baden, où il était le jeudi après la S. Urbain (29 mai) 382 . C’est là, sans doute, qu’il fit les premiers préparatifs de la campagne qu’il avait méditée, mais dont l’exécution fut retardée entre autres par la difficulté de réunir des troupes de divers points, et par les mesures à prendre pour empêcher tout soulèvement. Décidé d’employer la force pour soumettre à son autorité les montagnards rebelles 383 , Léopold assembla vers la fête de S. Martin ses chevaliers, ses vassaux, fit venir des troupes /193/ des villes qui lui étaient fidèles et en composa une armée de 20,000 hommes, selon Jean de Winterthur, écrivain contemporain, nombre qui me paraît d’autant plus exagéré que d’autres historiens, quoiqu’ennemis de l’Autriche, ne parlent que de 9000 hommes 384 . Cette armée, excitée par son chef Léopold, surnommé le Glorieux, était disposée à tirer une vengeance éclatante de « ces hommes rustiques » qui, se confiant en leurs montagnes, osaient braver la puissance de l’Autriche. Selon le chroniqueur qu’on vient de nommer, on avait même fait provision de cordes pour emmener leurs bestiaux.
Les habitants des Waldstetten, — particulièrement ceux de Schwyz dont le territoire devait être le premier foulé par l’ennemi —, n’eurent pas plutôt appris que des forces considérables allaient s’avancer contre eux, qu’ils redoublèrent d’activité pour fortifier convenablement les lieux que la nature avait laissés découverts et qui offraient un passage à l’armée autrichienne. J. de Winterthur prétend qu’ils tentèrent la voie des négociations et prièrent Frédéric comte de Toggenbourg d’être leur médiateur auprès de Léopold, qui, irrité de leur obstination, ne voulut point accepter leurs conditions humiliantes. Léopold ne pouvait faire la paix avec les hommes des Waldstetten, que sous la condition expresse qu’abandonnant aussitôt le parti de Louis de Bavière ils reconnaîtraient Frédéric d’Autriche et rentreraient sous la domination du landgrave de la maison de Habsbourg, comme les Lucernois et d’autres. Ceux d’Uri, /194/ de Schwyz et d’Unterwalden n’ignoraient pas qu’il n’y avait pour eux d’autre moyen de réconciliation qu’une soumission entière, circonstance qui me fait douter de la véracité ou de l’exactitude du chroniqueur en cet endroit, à moins que l’on ne voie dans les propositions faites au duc un moyen de gagner du temps pour se préparer d’autant mieux à une lutte inévitable, dont l’issue devait être décisive. Il s’agissait pour ces intrépides montagnards de sauver une indépendance mal assurée, ou de la perdre; de vaincre, ou de mourir.
Lorsque les troupes mandées par Léopold furent arrivées à Zug, lieu du rassemblement, le duc tint un conseil de guerre, dans lequel il fut résolu, dit-on, d’attaquer les rebelles sur trois points différents, afin de terminer promptement, et comme d’un seul coup, une campagne que la mauvaise saison, le froid, les neiges pouvaient interrompre en même temps que faire échouer le duc dans son entreprise. C. Justinger raconte à cette occasion une anecdote, que M. Russ et P. Etterlin ont répétée. « Les troupes étant en marche sur Egeri, on délibéra sur la route qui conduirait le plus sûrement dans le pays de Schwyz. On décida d’y entrer le long du Morgarten et du Sattel. Le duc, qui avait auprès de lui un bouffon, nommé Conrad von Stocken, lui demanda ce qu’il pensait de cet avis? — Il ne me plait pas, répondit-il. — Pourquoi? — Vous avez tous dit comment on peut entrer dans le pays, mais aucun de vous n’a songé aux moyens d’en ressortir » 385 .
Voici le plan d’attaque des Autrichiens. Le 15 novembre, à la pointe du jour, Léopold, avec la plus grande partie de l’armée, devait quitter Zug 386 , traverser les deux villages d’Egeri, côtoyer le bord oriental du lac de ce nom, longer /195/ les pentes du Morgarten 387 , et entrer dans le pays de Schwyz par le chemin qui est au pied du mont Sattel 388 . Le même jour, le comte Otton de Strassberg 389 , avoué (Vogt) de Léopold dans l’Oberland ou le Pays d’en-haut, devait avec 3000 à 4000 hommes franchir le Brunig et fondre sur le Haut-Unterwalden, tandis que, pour faire une autre diversion, 1200 à 1500 hommes de Lucerne, de l’Entlibuch et des environs débarqueraient dans le Bas-Unterwalden pour tout ravager, opérer leur jonction avec le comte, et s’emparer de tout le pays.
En quittant le lac Egeri 390 pour pénétrer dans le pays de Schwyz, on trouve sur la frontière le hameau an der Schornen ou Schorno, où, entre la Figlerfluh et le Wergberg est une gorge qui forme l’entrée dans le pays de Schwyz. Ce passage était gardé par une vieille tour, faisant partie, à ce que l’on croit, d’un mur de défense (die letzy, comme /196/ l’appellent M. Ross et P. Etterlin) qui s’étendait le long de rochers et de précipices, dans l’étendue de plus de deux lieues, jusqu’à Art. Cette opinion s’est propagée jusqu’à nos jours, quoiqu’elle fût déjà rejetée par Zay, qui, loin d’admettre que ce rempart se soit prolongé de Rothenthurm à Schornen, et de là le long du Kaiserstock et du Gryppen jusqu’à Art, pense qu’il y avait de ce côté des ouvrages de défense à de certains intervalles, mais non un mur continu, qui eût été inutile aux endroits rendus inaccessibles par les montagnes et les épaisses forêts. On ne fermait que les plaines, surtout là où la cavalerie aurait pu pénétrer. Il est cependant certain qu’il y avait quelques tours de défense et d’observation, dont il existe encore deux en assez bon état, l’une au village de Rothenthurm, qui en tire son nom, l’autre à Schornen, qui servit de point de ralliement aux confédérés à la bataille du Morgarten.
Ce que M. Russ et P. Etterlin appellent letzy, c’est-à-dire Letze-mauer (ou Landwehr) était, comme l’indique ce mot, un mur de défense, à Art, d’environ 12 pieds de haut sur 3 d’épaisseur à sa base et de 1200 de longueur, qui, commençant au Sonnen- ou Rufiberg, s’étendait dans la longueur d’un bon quart de lieue le long du dos escarpé de la montagne jusqu’au lac, puis s’élevait le long du lac d’Art, ou de la partie supérieure du lac de Zug, jusqu’au Rigi ou Schattenberg. Il fermait si bien la vallée d’Art, que personne n’y pouvait pénétrer du côté du lac avant d’avoir fait une brêche à ce mur ou de l’avoir escaladé. Dans le lac, aussi loin que se prolongeait le mur, étaient de hautes et fortes palissades qui rendaient l’abordage sinon impossible, du moins très difficile. De plus ce mur était flanqué de deux tours carrées de 60 pieds de haut sur 4 à 6 d’épaisseur, d’où l’on pouvait observer l’ennemi et le repousser, l’une au pied du Rufiberg, l’autre au pied du Rigi; une troisième était au /197/ milieu de la vallée, à 40 toises du mur. La première de ces tours était rasée il y a plus de deux siècles, la seconde fut démolie en 1805, la troisième, dans la vallée, en 1775. Elles étaient si solidement construites qu’il fallut des efforts presque incroyables pour les abattre. On n’en trouve, pour ainsi dire, plus de vestiges, mais on voit encore des restes du mur. Les pieux ou palis furent détruits par le temps et l’eau, ou par la main des hommes.
On ne saurait préciser l’époque de la construction de ce mur et de ces tours. Hämmerlin, en disant que celle de la vallée d’Art fut élevée du temps de Charlemagne, lui suppose une trop haute antiquité. Zay, M. Lutz et d’autres pensent qu’on commença ces ouvrages en 1260, alors que, disent-ils, la noblesse usurpatrice et importune, ayant été chassée des pays de Schwyz et d’Unterwalden, faisait tous ses efforts pour les envahir. L’histoire authentique ne sait rien de cette prétendue expulsion. Les événements de 1257 et 1258 arrivés à Uri (voy. p. 79 et suiv.), dont la tradition ne transmit que des souvenirs vagues et confus, ont donné lieu à cette méprise. Il est probable que ce mur et ces tours furent construits par les Schwyzois depuis 1308, lorsque, d’un côté, l’indépendance temporaire ou douteuse que leur accorda Henri VII, de l’autre, l’invasion dont ils étaient sans cesse menacés de la part de leurs voisins et des ducs d’Autriche, leur firent un impérieux devoir de protéger leurs limites et de se mettre en état de défendre leurs priviléges mal assurés. — Si l’époque de la construction de ces ouvrages est incertaine, on n’ignore pas à quoi ils étaient destinés. On avait aussi construit une tour à Stansstad contre les invasions des Lucernois, et à cet endroit le lac des Quatre-Cantons était hérissé de palissades pour empêcher l’abordage 391 . /198/
A la nouvelle de l’approche de l’ennemi, les habitants de Schwyz, ne doutant pas qu’il ne voulût envahir leur pays, s’étaient rassemblés dans le retranchement d’Art, qui leur offrait la position la plus avantageuse. On croit que le duc, afin de mieux voiler son projet, avait fait avancer quelques troupes vers ce retranchement pour faire une fausse attaque 392 . Il ne peut avoir pensé sérieusement à pénétrer de ce côté dans le pays de Schwyz; car, en attaquant Art, il avait derrière lui le lac de Zug, et devant lui le Rigi, haut de plus de 5000 pieds, dont la base, qui a environ 10 lieues de circonférence, est baignée du côté de l’est par le lac de Lauerz, au nord par celui de Zug, à l’ouest et au sud par le lac des Quatre-Cantons. Le bourg d’Art, situé, comme l’indique son nom latin arta (arcta) vallis, à l’entrée d’une gorge qui sépare le pied escarpé du Rigi d’un autre mont moins élevé, nommé Rossberg ou Rufiberg (rufus mons), offrait dans son retranchement une position si forte aux Schwyzois, qu’ils auraient écrasé l’armée ennemie dans le défilé.
Cependant il faut que, malgré l’extrême difficulté de pénétrer dans le pays de Schwyz par Art, Léopold ait fait de ce côté une démonstration qui engagea les montagnards à se poster derrière le mur de défense, si ce que disent nos plus anciens chroniqueurs est vrai, que le chevalier (Henri) de Hünenberg, qui se trouvait dans le corps d’armée dirigé sur Art, instruisit ceux de Schwyz du véritable plan d’attaque, en décochant dans leurs lignes une flèche à laquelle tenait un morceau de parchemin avec ces mots: « Soyez sur vos gardes au Morgarten » 393 . /199/
Le Landamman de Schwyz, Rodolphe Reding de Biberegg, qui, trop faible pour conduire ses compatriotes au combat, portait dans un corps usé par les ans une ame forte et grande, capable d’enflammer leur patriotisme, leur conseilla de laisser quelques soldats à Rothenthurm et dans le retranchement d’Art, pour observer les mouvements de l’ennemi de ces côtés, et de se poster avec les confédérés, qu’ils venaient d’appeler à leur secours, sur les hauteurs, d’où ils auraient tout l’avantage sur l’ennemi.
La diligence des confédérés fut si grande que le lendemain de leur appel arrivèrent sur le soir à Brunnen 400 hommes d’Uri, et peu de temps après 300 d’Unterwalden. Ces 700 hommes se joignirent à 600 combattants de Schwyz qui devaient compléter l’armée des trois Waldstetten. Tous brûlant du même amour pour la patrie jurèrent de s’ensevelir plutôt sous ses ruines que de reculer devant l’ennemi, et aussitôt ils s’emparèrent du mont Sattel et des hauteurs /200/ voisines, tandis que cinquante exilés ou fugitifs 394 des trois Vallées, résolus de sacrifier leur vie pour la cause de leurs concitoyens, gagnèrent le sommet du Morgarten et firent un amas de pierres, de cailloux et de troncs d’arbres pour en foudroyer l’ennemi à son passage.
Treize cent cinquante hommes, voilà à qui tient en ce moment la destinée des Waldstetten, et, on peut le dire, de toute l’Helvétie. Si à la vue d’une armée dix fois plus nombreuse que la leur ils reculent, tout est perdu. Mais ils /201/ ont des chefs comme Guillaume Tell et Walther Fürst 395 , Henri d’Ospenthal 396 et les fils de Reding pour les conduire à la victoire. Tous ont à sauver une patrie, leur indépendance, à reconquérir les droits de l’humanité: tous savent qu’il faut vaincre ou mourir.
Le matin du 15 novembre 397 on vit de dessus les hauteurs briller au soleil les casques, les cuirasses, les boucliers et les lances de l’armée autrichienne. Léopold, trop sûr de la victoire, avançait fiérement à la tête de sa cavalerie pesamment armée; l’infanterie formait l’arrière-garde, faute d’autant plus grave que le chemin étroit entre la colline et le lac aboutissait à un terrain marécageux, trop gelé pour que l’infanterie pût s’y tenir sans glisser, et trop peu pour qu’une lourde cavalerie couverte de fer n’enfonçât pas 398 . Bientôt tout ce passage fut obstrué. Alors les cinquante bannis commencèrent, en poussant de grands cris, à rouler d’énormes quartiers de rocs et des troncs d’arbres, et à lancer une grêle de cailloux et de pierres qui, renversant et écrasant hommes et chevaux, portèrent la mort, le désordre et /202/l’épouvante dans toute cette avant-garde qui, serrée par la colline, le lac et la masse de son infanterie, ne pouvait ni se contenir, ni reculer. Les confédérés, postés près du plateau de la Haselmatt, remarquent à peine ce bouleversement, qu’ils fondent avec la rapidité de l’éclair sur les ennemis, les assomment de leurs lourdes massues (Morgensterne) armées de pointes de fer, ou les percent de leurs larges épées à deux mains et de leurs longues hallebardes 399 , et en font un horrible carnage. Accoutumés à se tenir fermes dans un terrain raboteux, munis même de crampions 400 à leurs souliers pour ne pas glisser, ils soutiennent vigoureusement le premier choc, et dès lors la victoire se décide pour eux. Dans ce moment terrible l’infanterie veut s’ouvrir pour donner passage à la cavalerie; celle-ci, pressée de front et en flanc par les montagnards, terrassée par les débris qu’on lance sur elle, se renverse sur l’infanterie, la culbute et en écrase une partie dans les efforts redoublés qu’elle fait pour sortir de ce pas mortel: les chevaux effrayés se précipitent dans le lac, d’autres s’embarrassent dans le marais, et leurs /203/ cavaliers sont tués immobiles sur eux. Les seules troupes de Zug et des environs ne plièrent pas. Les 50 (ou 52) hommes que la ville de Zurich avait fournis périrent tous à leur place. Ceux de ces braves dont on nous a conservé les noms sont les chevaliers Wysso, Ulric d’Hettlingen, Ulric am Wasen d’Uster, Pantaleon de Landenberg, Jean Bruchunt, et Henri de Rümlang 401 , procurateur (Pfleger) des ducs à Rothenbourg 402 .
La perte de l’armée autrichienne fut de 1500 hommes sans les noyés, la plupart appartenant à la cavalerie. La fleur de la noblesse périt dans cette affaire 403 . De ce nombre furent un comte (Rodolphe ou Ulric) de Habsbourg, seigneur de Raprechtswile, trois barons de Bonstetten, deux de Hallwyl, un de Baldeck, trois d’Urikon, quatre de Toggenbourg 404 , le baron de Russegg, un ou deux Gessler 405 , et, dit-on, Beringer de Landenberg, qui s’était réjoui de tirer une vengeance éclatante des montagnards rebelles.
Le comte de Montfort, l’abbé d’Einsiedeln et plusieurs autres seigneurs s’étaient éloignés dès le commencement de l’action. Léopold, cherchant aussi son salut dans la fuite, parvint à s’échapper par un sentier détourné que lui montra un paysan. 406 . Jean de Winterthur dit qu’il le vit arriver le soir pâle et demi-mort de frayeur. Il parle de cette fatale journée comme d’une boucherie qui porta le deuil dans toutes les familles, il pouvait en avoir les meilleurs renseignements par son père qui en fut témoin oculaire 407 . /204/
Les Confédérés ne perdirent, dit-on, que 15 hommes et un des cinquante braves qui commencèrent le succès de cette journée à jamais mémorable. De ce nombre il ne doit y en avoir que sept dont les noms ont été arrachés à l’oubli: Pierre Wipfli et Henri im Dorf, d’Unterwalden; Henri d’Ospenthal, Conrad de Beroldingen, Rodolphe Fürst, Conrad Lory et Walther Seemann, d’Uri. Ceux de Schwyz ne sont pas connus.
Les vainqueurs fléchirent le genou sur le champ de bataille, pour rendre grâces au Tout-Puissant de l’insigne faveur qu’il leur avait accordée en exauçant leurs prières et leurs vœux généreux. Après quoi ils se disposèrent à aller ranimer leurs femmes et leurs enfants par leur présence, ne soupçonnant pas que leur patrie était encore menacée de deux côtés.
Le comte Otton de Strassberg, dont on ignorait l’entreprise et les forces, venait de passer le Brunig avec ses 5000 ou 4000 hommes. Il traversa, sans rencontrer de résistance, Lungeren, Saxelen, Sarnen, et s’avança jusqu’à Alpenach, tandis que ceux qui venaient de Lucerne allaient aborder à Bürgenstad. Le messager de la Vallée supérieure qui allait demander du secours à Stans, rencontra celui de la Vallée inférieure qui venait en demander pour repousser les Lucernois. Aussitôt on dépêcha un homme pour rappeler de Schwyz les 300 Unterwaldiens. Ceux-ci étaient déjà arrivés à Brunnen. Cent hommes de Schwyz se joignirent à eux. Ces 400 braves atteignirent bientôt Buchs, puis Burgenstad, où ils /205/ fondirent sur les Lucernois, qui ravageaient cette partie du pays, et en tuèrent un grand nombre, outre ceux qui trouvèrent la mort en voulant se rembarquer 408 .
Renforcés par leurs confrères qui s’étaient déjà préparés à chasser l’ennemi, ces 400 vainqueurs avancent, en poussant des cris de triomphe, vers Alpenach pour attaquer Strassberg. A la vue des bannières d’Unterwalden, qu’il croyait prises par les Autrichiens, le comte ne douta plus du revers de Léopold, et comprenant qu’il ne pouvait tenir contre les intrépides montagnards dont le nombre grossissait à tout moment, il ordonna la retraite, et ne parvint à s’échapper qu’après avoir perdu 300 hommes. On prétend que les Confédérés n’eurent à regretter que Henri Steinibach409 .
C’est ainsi que les pâtres des Alpes foudroyèrent la brillante armée de Léopold, dit le Glorieux, qui, sûr d’un succès qui devait les soumettre à jamais à la domination de Habsbourg-Autriche, ne recueillit que honte et douleur au lieu des lauriers et de la joie que lui promettait son orgueil. La divine Providence eut compassion des habitants des Vallées alpestres. — Ils instituèrent une fête solennelle pour /206/ célébrer tous les ans la mémoire de cette action 410 , qui ne cède en rien à la glorieuse journée de Marathon, ou un petit peuple ami de la liberté défit les nombreux bataillons du Grand-Roi et sauva la patrie.
Frédéric-le-Bel faisait d’inutiles efforts pour rétablir l’ancienne constitution de l’Empire; son frère Léopold avait fais de vaines tentatives pour reconquérir à la tête d’une armée formidable les droits de sa famille: la bataille du Morgarten décida contre lui, et l’Autriche ne put regagner dans la suite ce qu’elle avait perdu par cette défaite 411 .
Le lendemain de la bataille du Morgarten, dit Tschudi (I, 274. a.), ceux de Schwyz envoyèrent des députés au roi Louis, qui, informé de leur succès, leur adressa une lettre de félicitation. — Soit que Louis de Bavière fût instruit aussitôt de cette victoire, qui devait lui être agréable, mais dont il ne parle pas dans sa lettre, soit qu’il voulût soutenir le courage des habitants des Waldstetten que menaçait la vengeance de l’Autriche, il leur envoya une lettre, dans laquelle il loua leur constance, leur fidélité, et leur promit une abondante mesure de consolation, une récompense telle qu’ils la méritaient, et pour le printemps l’appui d’une solide assistance contre leurs ennemis qui étaient les siens 412 .
Jusqu’alors la liaison des trois Waldstetten n’avait été, pour ainsi dire, que momentanée. Le besoin de se rendre forts par une étroite union s’était assez fait sentir chez ces peuples pour qu’ils songeassent à la resserrer. Persuadés que les ducs d’Autriche continueraient les hostilités, ils se /207/ hâtèrent de renouveler et de consolider leur ancien traité d’alliance, et d’y faire les changements et les additions que les circonstances avaient rendus indispensables. Ils s’assemblèrent pour cet effet à Brunnen, au commencement du mois de décembre 1315. C’est de ce traité qu’ils prirent le nom d’Eidgenossen, c’est-à-dire, liés par le même serment, Confédérés 413 . Il nous a paru convenable de donner la traduction de cet acte important. Le lecteur trouvera en note une autre traduction de ce traité, qui est ancienne et probablement peu connue 414 .
TRAITÉ DE BRUNNEN.
« Au nom de Dieu, Amen! Comme la nature humaine est faible et fragile, il arrive que ce qui devrait être durable et perpétuel est bientôt facilement livré à l’oubli; c’est pourquoi il est utile et nécessaire que les choses qui sont établies pour la paix, la tranquillité, l’avantage et l’honneur des hommes, soient mises par écrit et rendues publiques par des actes authentiques.
Ainsi donc, Nous d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden /208/ faisons savoir à tous ceux qui liront ou entendront ces présentes lettres, que prévoyant et appréhendant des temps fâcheux et difficiles, et afin de pouvoir mieux jouir de la paix et du repos, défendre et conserver nos corps et nos biens, nous nous sommes mutuellement promis de bonne foi et par serment, de nous assister réciproquement de conseils, de secours, de corps et de biens, et à nos frais, contre tous ceux qui feront ou voudront faire injure ou violence à nous et aux nôtres, à nos personnes ou à nos fortunes, de manière que si quelque dommage est porté à la personne ou aux biens de l’un d’entre nous, nous le soutiendrons pour qu’à l’amiable ou par justice restitution ou réparation lui soit faite.
Deplus, nous promettons par le même serment qu’aucun des trois Pays et nul d’entre nous ne reconnaîtra qui que ce soit pour son seigneur, sans le consentement et la volonté des autres. Du reste chacun de nous, homme ou femme, doit obéir à son seigneur légitime et à la puissance légitime en tout ce qui est juste et équitable, sauf aux seigneurs qui /209/ useront de violence envers l’un des Pays, ou qui voudront dominer injustement sur nous, car à tels aucune obéissance n’est due jusqu’à ce qu’ils se soient accordés avec les Pays. Nous convenons aussi entre nous, que nul des Pays, ni des Confédérés ne prêtera serment et ne rendra hommage à aucun étranger sans le consentement des autres Pays et Confédérés; qu’aucun Confédéré n’entrera en négociation avec quelque étranger que ce soit sans la permission des autres confédérés, aussi longtemps que les Pays seront sans seigneur. Que si quelqu’un de nos Pays trahit leurs intérêts, viole ou transgresse aucun des articles arrêtés et contenus dans le présent acte, il sera déclaré perfide et parjure, et son corps et ses biens seront confisqués au profit des Pays.
Outre celà nous sommes aussi convenus de ne recevoir et de n’admettre pour juge aucun homme qui aurait acheté sa charge à prix d’argent ou de quelque autre manière, ou /210/ qui ne serait pas notre compatriote. S’il naît ou s’élève quelque différend ou guerre entre les confédérés, les hommes les plus intègres et les plus prudents se réuniront pour pacifier ce différend ou terminer cette guerre soit à l’amiable, soit par justice; si l’une des parties s’y refuse, les confédérés assisteront l’autre pour qu’à l’amiable ou par justice la dispute soit terminée aux dépens de celle qui aura refusé les moyens de conciliation. Si entre deux Pays survient une querelle ou guerre, et que l’un d’eux ne veuille pas y mettre fin à l’amiable ou par justice, le troisième Pays soutiendra celui qui consentait à un arrangement et lui donnera secours pour que l’affaire se termine de gré ou de force.
Si un des confédérés en tue un autre, il sera puni de mort, à moins qu’il ne puisse prouver et que les juges ne déclarent qu’il l’a fait par nécessité, pour défendre sa vie. Si le meurtrier s’enfuit, quiconque de notre pays le recevra, lui donnera refuge dans sa maison et le défendra, sera exilé /211/ et ne rentrera pas dans sa patrie s’il n’y est rappelé du consentement des confédérés.
Si un des confédérés met ouvertement ou en secret et à dessein le feu à la maison d’un autre, il sera banni à perpétuité de notre territoire, et quiconque le recevra dans sa maison, lui donnera asile et protection, sera tenu de réparer le dommage causé par l’incendiaire.
Nul ne pourra prendre des gages que de son débiteur ou de sa caution, et il ne le fera point sans l’autorité du juge. Chacun obéira à son juge et indiquera le juge dans notre pays devant lequel il veut comparaître.
Si quelqu’un refuse de se soumettre à la sentence et que sa désobéissance porte dommage à l’un des confédérés, ceux-ci le contraindront à l’indemniser. /212/
Et afin que les assurances et les conditions susdites demeurent stables et perpétuelles, Nous, ci-dessus nommés, citoyens et confédérés d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden, avons apposé nos sceaux au présent acte fait à Brunnen, l’an 1315 de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier mardi après le jour de Saint-Nicolas » (9 déc.) 415 .
Le roi Louis, qui avait assuré les Waldstetten de sa bienveillance et leur avait promis son secours, ayant convoqué à Nuremberg les Grands de l’Empire qui lui étaient fidèles, cette assemblée déclara les ducs d’Autriche (ainsi que les autres partisans de Frédéric-le-Bel) coupables de lèse-majesté et déchus des droits qu’ils exerçaient dans les vallées de Schwyz, d’Uri et d’Unterwalden et dans les lieux circonvoisins, ainsi que des propriétés, fermes et censes qu’ils y possédaient, lesquels droits et propriétés, avec les gens y appartenant, devaient désormais relever nûment de l’Empire, qui ne les aliénerait jamais 416 .
Quelques jours plus tard, le 29 mars 1316, Louis ratifia les chartes que quelques chefs de l’Empire avaient accordées aux Waldstetten, savoir celles de Frédéric II, du mois de décembre 1240, de Rodolphe Ier, du 19 février 1291, de Henri VII, du 3 juin 1309, et une autre du 5 mai 1310, du même prince, qui reconnut que les hommes de Schwyz, /213/ qui prétendaient (ut proponunt) s’être rachetés autrefois 417 d’un comte Eberhard de Habsbourg, — assertion que n’appuyait aucune preuve authentique —, ne dépendaient plus que de l’Empire 418 .
Comme Lucerne se trouvait, par l’acte de proscription et de déchéance qui venait de frapper les ducs d’Autriche, dégagé de toute obligation envers eux et exposé à des dangers, les bourgeois et la communauté de cette ville firent des démarches auprès des communautés d’Uri et d’Unterwalden pour opérer une réconciliation. Les habitants des trois Vallées se montrèrent très disposés à une paix commune qui pût mettre fin à la guerre que Lucerne et ses voisins se faisaient depuis plusieurs années 419 . Nous ne saurions dire positivement si ces premières négociations furent suivies d’une réconciliation franche et sincère. Ce qui n’est pas douteux, c’est que Lucerne fut compris dans la trêve que les trois Vallées firent plus tard avec les ducs d’Autriche.
Cependant l’indépendance des Waldstetten n’était pas assurée. Les ducs d’Autriche, supportant avec un noble courage le poids de l’adversité, rassemblaient toutes leurs forces et redoublaient d’énergie, l’un pour défendre la couronne que lui disputait son rival et rétablir les droits de sa maison, les autres, surtout Léopold, pour seconder leur frère et faire rentrer sous la domination de Habsbourg-Autriche les peuples de l’Helvétie qui s’étaient insurgés. Outre les trois Vallées deux villes étaient surtout hostiles à la maison d’Autriche, Berne et Soleure: mais avant de les attaquer Léopold jugea convenable de conclure un armistice avec Uri, /214/ Schwyz et Unterwalden qui, recevant de Louis de Bavière plus de promesses que de secours, et flottant entre la crainte et l’espérance, firent, le 19 juillet 1318, avec les ducs une trève qui devait expirer à la fin du mois de mai suivant, mais qui, renouvelée plusieurs fois, fut enfin prolongée jusqu’au 15 août 1323. Les voisins des Waldstetten, tels que les gens de Glarus, de Wesen, accédèrent à cette trève, ainsi que le comte Werner de Homberg, seigneur du vieux Raprechtswile ou de la Marche, qui désira et obtint la cessation des hostilités entre Schwyz et lui, et Jean, abbé d’Einsiedeln, qui, par ordre du duc Léopold, avoué de l’abbaye, leva en 1319 l’excommunication que, du consentement du pape, il avait prononcée en 1318 contre les gens de Schwyz 420 .
Voici les principales conditions de cette paix momentanée, ou de cette trève: « Les hommes des Waldstetten Uri, Schwyz, Unterwalden n’inquiéteront point les vassaux et les gens des ducs: ils laissent dans leurs limites aux ducs d’Autriche les propriétés, fermes et censes et la juridiction, telles que ceux-ci les possédaient du temps de l’empereur Henri VII; en revanche ils se réservent la libre jouissance des biens leur appartenant dans la juridiction (Gewalt) des ducs, au-dehors et au-dedans, comme ils l’avaient avant la guerre (de 1315). Les deux partis conviennent de s’entendre sur la réparation des pertes de rentes, cens, ou redevances annuelles, causées par pillage, capture ou par incendie, mais de n’exiger l’un de l’autre aucun dédommagement des pertes causées avant la guerre, à moins que ce ne soit le désir des deux partis. Les Waldstetten s’engagent à ne se liguer, ni en particulier, ni en commun, avec qui que ce soit contre les ducs, et à ne donner aucun secours à leurs ennemis. Les droits de péage seront perçus comme auparavant. Les vassaux des ducs traverseront sans être inquiétés le /215/ territoire des Waldstetten, qui, à leur tour, auront liberté de communication et de commerce avec Lucerne, Zug et d’autres lieux limitrophes. »
Les pâtres des Alpes, en ne remontant que jusqu’au temps de Henri VII, ou de la charte du 3 juin 1309, ne faisaient aux ducs que des concessions peu importantes. Ils traitaient en vainqueurs.
Dès que cette trève fut conclue Léopold s’avança vers Soleure, dont il entreprit le siège. Dans son armée se trouvait, entre autres seigneurs puissants, Jean de la Tour, sire de Chatillon, qui, au camp de Soleure, promit, le 24 septembre 1318, au duc Léopold et à ses frères un corps de 3000 hommes contre les Waldstetten, et dix casques avec tous les hommes dont il pouvait disposer en-deçà des Alpes, contre Berne 421 , qui avait envoyé aux Soleurois un secours de 400 hommes 422 . Le siège durait depuis dix semaines, lorsque l’Aar, grossi considérablement par les pluies, entraîna le pont qui le traversait avec les soldats dont le duc avait eu l’imprudence de le charger. Les assiégés, ne voyant plus que des frères dans ces malheureux qui luttaient contre la mort, volèrent à leur secours et en sauvèrent un grand nombre qu’ils renvoyèrent à Léopold. Ce prince, vaincu par la magnanimité de ses ennemis, leva le siège 423 . /216/
La promesse faite par le sire de Chatillon aux ducs d’Autriche prouve que ceux-ci n’attendaient que la prise de Soleure et peut-être la soumission de Berne pour fondre avec toutes leurs forces sur les Waldstetten. La levée du siége de Soleure fut sans doute un des principaux motifs qui engagèrent les ducs à prolonger la trève avec les hommes des Waldstetten qui, craignant de se voir assaillis de tous côtés par les ennemis dont ils étaient environnés, consentirent à une prolongation de la trève, attendant avec impatience l’issue de la lutte qui s’était engagée entre Frédéric d’Autriche et Louis de Bavière.
Ces deux princes continuaient à se faire une guerre aussi cruelle qu’opiniâtre. Le 28 septembre 1322 leurs deux armées se rencontrèrent à-peu-près dans le même lieu où se livra 478 ans plus tard la bataille de Hohenlinden, entre Muhldorf et Ampfing. La victoire se déclara pour Louis. Frédéric et son frère Henri ayant été faits prisonniers, l’un fut envoyé au château de Trausnitz, en Bavière, l’autre remis à Jean de Luxembourg, roi de Bohême, qui avait combattu pour Louis. Cette bataille fut funeste à la maison d’Autriche.
Quoique Louis eût vaincu Frédéric, qu’il l’eût en son pouvoir et qu’il fût seul maître de l’Empire, cependant il ne rétablit pas la constitution germanique, soit qu’il voulût récompenser ses partisans, notamment les hommes des Waldstetten, de leur opposition à la maison d’Autriche, et se réserver leur assistance qui était d’un grand prix en Helvétie, soit qu’il fût trop faible pour maintenir l’intégrité de l’Empire. La maison de Habsbourg-Autriche était vaincue, il est vrai; deux de ses princes étaient prisonniers, mais leurs frères étaient entreprenants et comptaient beaucoup d’amis puissants que Louis, assis sur un trône chancelant, devait craindre. Il lui importait de conserver ses amis en /217/ leur faisant de larges concessions. Les habitants des Waldstetten, forts du triomphe qu’ils avaient remporté au Morgarten, n’étaient pas hommes à sacrifier le prix de leur victoire. Leur attitude était noble et imposante. Ces intrépides montagnards, non contents d’avoir humilié l’orgueil des Autrichiens, dictèrent des lois à l’Empereur même, ou du moins en lui exprimant sans détour leur désir d’être à jamais affranchis de la domination des ducs, de voir rompre les liens qui les unissaient à la maison de Habsbourg-Autriche, ils lui prescrivirent les conditions auxquelles ils voulaient faire partie de l’Empire et en être membres. Profitant habilement de la position du roi Louis et des circonstances qui leur étaient favorables, profitant de leur belle victoire, unis après leur triomphe comme ils l’avaient été dans des jours de détresse et pendant la fureur du combat, les confédérés attendirent pour prêter serment de fidélité au roi de Germanie qu’ils fussent sûrs de posséder ce qui depuis si longtemps était l’objet de leurs vœux. Après avoir obtenu des avantages signalés sur les ducs d’Autriche, loin d’en faire le sacrifice au Roi, ils voulurent s’assurer une position telle que dès lors leur dépendance de l’Empire fût plutôt nominale que réelle, et qu’ils pussent retirer de l’Empire plus d’avantages qu’ils ne lui en procureraient. Ce n’est que le 7 octobre 1323 qu’ils rendirent foi et hommage au chef de l’Empire, représenté par le comte Jean d’Arberg, sire de Valangin et Landvogt ou Préfet impérial d’Unterwalden, de Schwyz et d’Uri. Cet acte de fidélité se fit aux conditions suivantes: « Que les trois Waldstetten, c’est-à-dire, non-seulement Uri, ancien fief immédiat de l’Empire, mais encore Schwyz et Unterwalden reléveraient nûment de l’Empire, et que le Roi ne les en aliénerait jamais; que tout changement à cet égard les délierait de leur serment; que les habitants des Waldstetten ne seraient jamais obligés /218/ d’assister aux plaids d’un landgrave, ni de comparaître devant un tribunal quelconque hors de leurs limites » — ainsi, ni devant celui de Habsbourg-Autriche, ni devant celui de l’Empereur même (?), privilége que Henri VII ne leur avait pas accordé 424 . Enfin ils obtinrent encore une autre prérogative importante, un avantage déjà prévu dans l’acte de fédération du 1er août 1291 425 , que Henri VII ne leur avait pas accordé, savoir, « que nul autre qu’un de leurs compatriotes (Lantman), homme libre, habitant de la vallée, ne pût être leur Juge », c’est-à-dire, leur Amman ou Landamman 426 .
« On conçoit, dit M. Kopp, que les pâtres des Alpes » — qui avaient traité en maîtres avec la superbe maison d’Autriche — « aient pu dicter de pareilles conditions à leur souverain; mais on comprend aussi que nul autre qu’un prince mal affermi sur le trône ait put concéder de tels priviléges. Que signifiait le pouvoir d’un Landvogt isolé, abandonné de l’Empire qui aurait dû le soutenir et faire respecter son autorité? Il est évident qu’un tel officier devait bientôt perdre toute considération. Ce ne fut que neuf ans après son élévation à la dignité royale que Louis de Bavière obtint des habitants des Waldstetten qu’ils lui rendraient foi et hommage, et à quelles humiliantes conditions, après avoir battu et fait prisonnier son rival! Dès lors appartenir à l’Empire signifie être indépendant, agir en maître. Si les Waldstetten reconnurent encore un lien, une union avec l’Empire, ce fut moins pour lui rendre de véritables services que pour obtenir insensiblement des droits et des fiefs impériaux » 427 . /219/
Mais le beau triomphe des confédérés avait été avantageux à Louis de Bavière, qui dans des jours critiques cherchait à soutenir leur courage par des promesses dont ils ne perdirent pas le souvenir. Que serait-il arrivé si les montagnards avaient uni leurs forces à celles de Léopold? Louis aurait perdu sa couronne. Cédant à l’empire de la nécessité, il fit de ces braves des alliés fidèles plutôt que des sujets inquiétants. Les confédérés, loin de renoncer lâchement aux avantages qu’ils pouvaient retirer de leur victoire, profitèrent sagement de leurs succès pour assurer leur indépendance pour laquelle ils venaient de verser leur sang. Qui oserait les blâmer d’avoir affermi la base sur laquelle devait reposer l’édifice de la liberté helvétique? La suite justifiera leur conduite en prouvant que leur existence politique était précaire, que leur indépendance, qui ne trouvait dans les promesses du Roi qu’une faible garantie, pouvait être compromise, et qu’ils ne devaient mettre leur confiance qu’en Dieu et en leur courage.
Cependant le duc Léopold, après avoir vainement tenté de délivrer son frère, crut mieux réussir en suscitant de nouveaux adversaires à Louis. En 1323, le pape Jean XXII, qui jusqu’alors avait gardé le silence sur les deux élections, les casse par sa bulle du 9 octobre, avec ordre à Louis de Bavière de se désister, dans trois mois, de l’administration de l’Empire. Louis et les états d’Allemagne qui lui restent fidèles protestent contre cette bulle.
C’est alors que Louis, qui va se voir obligé de tourner ses armes contre le souverain pontife quand l’Allemagne sera pacifiée, sent tout le prix d’une étroite union entre le roi de Germanie et les vaillants confédérés des Waldstetten. Le 4 mai 1324 il leur annonce « qu’il compatit aux maux que leur causent leurs ennemis qui sont les siens; que, voulant qu’ils sachent combien leur fidélité lui est chère, il les avertit /220/ qu’il a révoqué (abrégé) la trève conclue entre lui et Léopold duc d’Autriche, de manière qu’elle expirera à Pentecôte, qu’à cette époque il entrera en campagne avec une nombreuse armée pour poursuivre ses ennemis et ceux de l’Empire; il les engage à révoquer également la trève qu’ils peuvent avoir faite avec ses ennemis et les leurs, afin de lui porter secours en temps opportun et d’attaquer avec vigueur leurs ennemis communs dès qu’ils pourront recommencer les hostilités. Il leur fait deplus savoir que si, cédant aux importunités de certaines personnes, il a accordé à celles-ci des faveurs qui leur soient désagréables, il y apportera des modifications et fera ce qui pourra leur plaire. Enfin il leur promet que le cas échéant où il fera quelque traité avec Léopold, il ne les en excluera pas » 428 .
Déjà le lendemain, 5 mai, Louis déclare les ducs d’Autriche coupables de haute trahison, ajoutant que de l’aveu des grands de l’Empire réunis en diète à Francfort, ils ont encouru la confiscation de leurs domaines pour avoir forfait au Roi leur seigneur, qu’en conséquence ils sont déchus de leurs propriétés, fermes et censes, droits et gens y appartenant dans les vallées d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden et dans les lieux circonvoisins, lesquels ne relèveront plus que de l’Empire qui ne les aliénera jamais; les serfs (mancipia) et gens (homines) des dits domaines sont déliés de toute obligation, de tout devoir et obéissance envers les ducs et ne ressortiront qu’au tribunal de l’Empire: aucun habitant, aucun homme quelconque des dites Vallées ne devra plus comparaître en justice devant le duc Léopold ou ses frères, ni devant leurs avoués, et ne pourra être cité qu’au tribunal du S. Empire romain, ou à celui de son délégué 429 . /221/
Cette lettre patente, dont une partie est la répétition de celle du 23 mars 1316 430 , qu’elle confirme en tout point, annulant en même temps tout ce que Frédéric-le-Bel, en sa qualité de roi, avait pu lui opposer, est la manifestation de la volonté souveraine de Louis, seul chef de l’Empire, le complément des libertés, des priviléges ou des droits que les Waldstetten pouvaient désirer, moins le droit de glaive ou de haute justice, qui ne leur échut que plus tard. Plus de doute, les hommes des Waldstetten, de quelque condition qu’ils soient, ne sont plus de la juridiction du landgrave de la maison de Habsbourg-Autriche; leur indépendance absolue des ducs de cette maison est prononcée. Aucun des adversaires de Louis, ou de l’Empire, ne conserve des droits dans les dites Vallées; ceux des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques qui n’ont pas mérité sa disgrâce sont seuls maintenus: ce sont là les droits dont les habitants des Waldstetten durent se libérer dans la suite. N’étant plus soumis au landgrave, ils sont en pleine possession de la juridiction dans l’enceinte de leurs limites. Le préfet impérial n’a qu’un simulacre de pouvoir, et si cet officier essaye de faire respecter son autorité, s’il cherche à l’augmenter, il ne trouvera pas même un appui dans la personne de l’Empereur.
Par une autre bulle du 11 juillet 1324, Jean XXII déclara Louis contumace, le priva de tout le droit qu’il pouvait prétendre à l’Empire en vertu de son élection, et le cita à comparaître devant lui le 1er octobre suivant. La diète de Ratisbone déclara cette citation nulle, avec défense d’y avoir égard. Jean XXII destinait la couronne impériale à Charles IV roi de France, qui avait épousé en seconde noce Marie, fille de l’empereur Henri VII. Les ducs d’Autriche revendiquèrent aussitôt les droits dont Louis les avait dépouillés, et déjà le 27 du même mois de juillet Léopold /222/ reçut du nouveau candidat à l’Empire l’assurance qu’il le mettrait en possession des deux vallées de Schwyz et d’Unterwalden et de leurs dépendances 431 .
Louis pensa qu’en se réconciliant avec son auguste prisonnier, il détournerait le malheur qui le menaçait. Frédéric-le-Bel fut remis en liberté à des conditions que le pape et Léopold ne voulurent point admettre. Frédéric, ne pouvant s’acquitter de sa parole, se constitua lui-même de nouveau prisonnier de son rival, qui, vaincu par cette générosité, et craignant une guerre dont l’issue pouvait lui être funeste, fit au mois de septembre un accommodement. On a des preuves que Frédéric fit usage de l’autorité royale depuis qu’il eut recouvré la liberté. Nous en citerons une, qui est d’une grande importance dans notre histoire. Le roi Frédéric donna, par diplôme du 10 février 1326, en fief à ses frères entre autres la vallée d’Uri, « Item vallem in Vre », sans faire mention de celles de Schwyz et d’Unterwalden, qu’il considérait comme appartenant encore de droit héréditaire à sa maison 432 . Frédéric enlevait, sans coup férir, aux confédérés le fruit de la victoire qu’ils avaient remportée au Morgarten, et détruisait d’un seul trait l’ouvrage de Louis, qui, soit par nécessité, soit par faiblesse, sacrifiait les Waldstetten qui avaient bien mérité de lui. C’est ainsi que parfois, dans leurs traités, les princes se jouent des peuples et trafiquent de leur bonheur! Je laisse à ceux qui font à Frédéric II, à Henri VII, et même à Louis IV, un crime d’avoir accordé leur protection et des priviléges à des hommes qui versaient leur sang pour la liberté et pour l’Empire, le soin de justifier la conduite de Frédéric-le-Bel, qui, moins scrupuleux qu’Albert même, faisait d’Uri, fief immédiat de l’Empire, un domaine de sa famille. /223/
Bientôt un grand malheur vint frapper Frédéric et toute sa maison. Le 28 février 1326 la mort lui enleva, à Strasbourg, son principal soutien, Léopold, dont une ancienne chronique dit: « Léopold était un homme qui avait le courage d’un lion 433 , il était doué d’une âme élevée, d’une grande prudence, d’un esprit pénétrant, d’un caractère doux et affable » 434
Par diplôme de Chum (Como) du 1er mai 1327 435 , Louis, se rendant à Rome pour se faire couronner empereur, confirma, en sa qualité de roi des Romains, les diplômes et priviléges que lui et ses prédécesseurs avaient accordés aux vallées d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden. Par une autre lettre, du même endroit et du même jour, il fit aux hommes de ces vallées la promesse solennelle que dès qu’il serait couronné empereur, il confirmerait en cette qualité tous les priviléges qu’ils avaient obtenus 436 .
Cette année Mayence, Worms, Spire, Strasbourg, Fribourg en Brisgau, Constance, Lindau, Bâle, Zurich, Berne, Soleure ayant fait une alliance pour protéger leur commerce contre les aventuriers et les brigands qui devaient être encore plus à craindre pendant l’absence du roi, les Conseils et bourgeois de Berne et de Zurich invitèrent les confédérés des trois Vallées à entrer dans cette grande association. Ceux-ci accueillirent avec joie cette proposition, et comme ils avaient conclu avec les ducs d’Autriche une trève qu’ils ne pouvaient rompre qu’un mois après les avoir avertis, ils se réservèrent ce mois, le cas échéant où une des villes, membre de l’association, trouverait que les Waldstetten /224/ dussent prendre les armes (den Frid absagen) 437 . Cette association, à laquelle accédèrent Rodolphe, évêque de Constance, Ulric, comte de Montfort, outre Eberhard, comte de Kibourg , qui en faisait déjà partie, fut prolongée en 1329 438 .
Louis IV, après s’être fait couronner empereur et avoir déclaré son adversaire Jean XXII déchu de la papauté, s’acquitta de la promesse qu’il avait faite aux trois Waldstetten, en confirmant, en sa qualité d’empereur romain, tous leurs priviléges 439 . L’année suivante, les Waldstetten ayant des motifs de se plaindre du préfet impérial, qui, sans doute, essayait de faire respecter son autorité ou d’augmenter son pouvoir, l’Empereur lui ordonna de rester dans les bornes prescrites et déclara qu’à l’avenir aucun Reichsvogt ne devait faire tort aux Waldstetten en quoi que ce pût être 440 .
Les habitants des Waldstetten, enhardis par les avantages qu’ils avaient successivement obtenus, travaillaient incessamment à l’acquisition des fiefs impériaux qui étaient dans leurs limites, sans craindre le mécontentement de Louis et sans s’inquiéter de ses ordres. Malgré les victoires que ce prince avait remportées sur ses ennemis, il était loin d’avoir pacifié l’Empire: ses affaires, aulieu de se consolider, allaient même en décadence. Les confédérés des Alpes, dont les libertés avaient été mainte fois et encore récemment compromises, voulaient profiter des circonstances qui pouvaient leur être favorables pour assurer leur indépendance en diminuant le nombre des feudataires qui avaient des biens dans leurs vallées. Il se pouvait qu’un jour on voulut les faire /225/ rentrer sous une domination pour laquelle ils avaient une aversion insurmontable. Profitant des leçons de l’expérience, ils déployaient la plus grande énergie pour maintenir leur indépendance et établir de fait dans leurs limites la possession des fiefs qui ne leur appartenaient pas de droit. C’était une des conséquences de leur révolution, un des moyens de rendre stable la constitution qu’ils s’étaient donnée. Qui oserait les blâmer d’avoir fait des efforts pour la maintenir?
Nous avons vu (p. 190 et suiv.) que le péage de Fluelen, cédé par Henri VII et laissé par Frédéric-le-Bel au comte Werner de Homberg, devint un sujet de querelle entre ce comte et les hommes d’Uri, qui s’en étaient emparés. Depuis plusieurs années ils en percevaient le droit sans le consentement de Louis IV, lorsque ce prince, depuis peu couronné empereur des Romains, écrivit aux landammans, aux bourgeois et aux communautés de Schwyz, d’Uri et d’Unterwalden, ses amés et féaux, que ce péage étant échu à l’Empire, par la mort du comte Werner de Hohenberch (Homberg), qui n’avait pas laissé d’héritier, et qui d’ailleurs avait mérité la confiscation de ce fief pour avoir été infidèle à son souverain, il en investissait le maréchal Winant den Boch et ses héritiers, pour la somme de mille marcs, leur ordonnant de lui en laisser la possession 441 .
Malgré cet ordre impérial le baron Jean d’Attinghausen perçut le péage pendant plusieurs années, sans le consentement de l’Empereur 442 . Enfin, le chef de l’Empire, pour ne pas tout perdre, fit un accommodement avec son vassal. Le baron n’était pas le payeur le plus exact; car, peu de temps avant la mort de l’Empereur, le 26 avril 1347, l’impératrice Marguerite l’invita à lui rendre un grand service /226/ en payant sans délai les 400 florins de revenus arriérés qu’il n’avait pas encore acquittés 443 .
Depuis les batailles de Morgarten et de Mühldorf, qui furent si funestes à la maison d’Autriche, l’agitation devint toujours plus grande dans les pays de l’Helvétie; les liens qui les unissait à cette maison se relâchaient et devaient finir par se rompre. L’exemple et les succès des Confédérés firent une impression profonde sur l’esprit de leurs voisins et éveillèrent chez eux l’amour si naturel de la liberté.
Glarus, qui avait déjà manifesté quelque velléité d’indépendance, ne pouvait résister à l’influence qu’exerçaient sur ses habitants le voisinage et la conduite des hommes de Schwyz. Toutefois les Glaronais avancèrent lentement dans la voie de l’émancipation: ce ne fut que dans la seconde moitié du 14e siècle qu’ils firent un progrès sensible. Lucerne, dont la conduite au 13e siècle, comme celle des trois autres Waldstetten, annonçait une volonté ferme de secouer le joug de tout seigneur ecclésiastique ou laïc, avait cependant obtenu des princes des maisons de Habsbourg et d’Autriche des priviléges considérables, qui entretinrent assez longtemps l’union et la bonne harmonie entre cette ville et les ducs ses suzerains. Les Lucernois exercèrent même pendant plusieurs années des hostilités envers les montagnards, qui, de leur côté, firent à ces dangereux voisins tout le mal que des ennemis, autrefois alliés, peuvent se faire dans une guerre opiniâtre qui compromet l’existence de l’un et de l’autre parti.
Mais lorsque Lucerne, favorisé sous plus d’un rapport par la maison de Habsbourg-Autriche, porté par là même à jeter un regard de dédain sur les trois Vallées alpestres, vit /227/ ses voisins avancer à pas de géant, marcher de conquête en conquête, l’envie ou le désir d’obtenir les mêmes avantages s’empara de ses habitants. Résolus de ne pas rester en arrière, ils saisirent avec empressement l’occasion favorable que leur offrait la fermentation générale d’une époque si agitée, pendant laquelle chacun, profitant des guerres de Louis de Bavière avec Frédéric d’Autriche et ses frères, de ses démêlés avec le pape, de la position délicate de ces princes envers l’Empire et l’Eglise, cherchait son propre avantage et songeait uniquement à son intérêt particulier. Ajoutons que la position de Lucerne, entre les pays héréditaires des ducs d’Autriche et les trois Vallées, forçait cette ville à prendre un parti. Ces circonstances étaient propres à amener une rupture, ou du moins à en fournir le prétexte 444 .
Mais l’existence politique des trois Vallées était encore précaire, soumise à des chances; un revers de Louis de Bavière pouvait compromettre leur avenir, un succès des ducs d’Autriche leur ravir les avantages que leur avaient procurés leur fermeté, leur bravoure et une victoire achetée au prix de leur sang; une réconciliation entre les deux maisons rivales, dont la base devait être nécessairement une concession large de la part de celle de Bavière, remettait en question la liberté et tous les droits qu’avaient acquis les trois pays fédérés.
Lucerne, isolé, était trop faible pour soutenir par lui-même ses prétentions et lutter avec quelque espoir de succès contre la maison d’Autriche, dont la puissance, bien que diminuée, offrait encore un aspect imposant, même après la mort de Léopold, de Henri, de Frédéric, qui furent dignement remplacés par leurs frères Albert-le-Sage et Otton-le-Hardi. Ces princes sentaient couler dans leurs veines le sang de leur illustre aïeul et de leur valeureux père. /228/
Mais ces ducs étaient entraînés dans des guerres dont la fin paraissait éloignée, et cette circonstance permettait aux Lucernois de préparer l’œuvre qu’ils se proposaient d’exécuter. Ils ne voulaient pas laisser échapper cette occasion favorable de se soustraire à une autorité qui devenait pour eux un lourd fardeau. Le 28 janvier 1328 445 vingt-six chevaliers et bourgeois de Lucerne, considérant l’instabilité des choses, la détresse du peuple, l’absence des ducs qui devaient le protéger, firent une association pour cinq ans dans le but de maintenir leur constitution intérieure, les priviléges, les libertés de leur ville 446 , en réservant à leur seigneur-suzerain (c’est-à-dire à la maison d’Autriche) les droits dont il devait jouir à Lucerne.
Le 1er octobre de cette année le chevalier Walther de Hunwile et son cousin Werner de Hunwile accédèrent à cette première association de leurs concitoyens, et le 13 octobre 1330 le Schultheiss (dont le pouvoir dérivait de l’Advocatie), les nouveaux et les anciens conseillers et le secrétaire de Lucerne entrèrent dans l’association politique, modifiée, des 26 citoyens, pour le temps qu’elle devait encore durer, et la considérèrent comme ayant été formée par eux. Le 21 du même mois la communauté des riches et des pauvres bourgeois se réunit à Lucerne, dans la chapelle, et confirma, en se liant ou se liguant elle-même, ce que le Schultheiss et le conseil avaient juré. L’expression: « en réservant aux ducs d’Autriche les droits dont ils devaient jouir à Lucerne », signifie proprement « les droits qu’on voulait leur laisser. » Il est évident que les bourgeois de /229/ Lucerne se proposaient de réduire insensiblement à rien l’autorité de l’avoué de Rothenbourg et de Lucerne, officier du duc suzerain qui avait le droit incontestable de nommer et de révoquer son juge à Lucerne, c’est-à-dire le Schultheiss. Ils voulaient faire ce qui avait enfin réussi aux Vallées, s’attribuer la juridiction dans leurs limites sauf à reconnaître un fantôme de pouvoir, une autorité nominale de l’Autriche —, puis s’approprier les fiefs et les rentes du seigneur. Par prudence ils feignaient de ménager et de défendre les droits, les intérêts et l’honneur de la maison d’Autriche 447 . Cette association, qui n’avait point l’apparence d’une démarche hostile à la maison d’Autriche, n’en fut pas moins considérée par l’avoué de Rothenbourg comme attentatoire à l’autorité des ducs d’Autriche 448 . Le duc Otton, voulant conjurer l’orage qui le menaçait, fit aux Lucernois une concession importante, en leur délivrant un diplôme 449 , en vertu duquel le Schultheiss serait à l’avenir un bourgeois de Lucerne, obligé de siéger en conseil. Les Lucernois, non contents de cette prérogative, voulaient rendre ce choix dépendant de leur ville, et anéantir ainsi l’autorité de l’avoué. Quoiqu’Otton leur accordât de nouveaux avantages, il ne pouvait réussir à les satisfaire 450 . Ils marchaient à une entière indépendance, en augmentant, en consolidant leurs droits de ville et de commune.
L’empereur Louis, craignant beaucoup du parti guelfe qui reprenait le dessus, et voyant que ses affaires allaient en décadence, fit des démarches pour se réconcilier avec la cour d’Avignon; mais ce fut en pure perte. Elle voulait /230/ absolument ou sa déposition ou son abdication volontaire. Il chercha alors à se rapprocher de la maison d’Autriche. Pour se réconcilier solennellement avec elle, il révoqua tous les actes d’autorité qu’il avait faits contre elle; et pour qu’il n’y eut aucune incertitude à l’égard de ses intentions, il investit, par diplôme daté de Munich, 5 mai 1331, les ducs Albert et Otton des duchés d’Autriche et de Styrie, des seigneuries de Carniole et de la Marche, des autres comtés, seigneuries, fiefs, droits, quels que fussent leurs noms, que les dits ducs et leurs ancêtres avaient tenus jusqu’alors de l’Empire et possédés en Souabe, en Alsace et ailleurs 451 . Mais les ducs pouvaient-ils espérer que les hommes des Waldstetten, qui s’étaient montrés si empressés à profiter de leur victoire et des priviléges à eux accordés par Louis roi, confirmés par Louis empereur, en prenant possession des domaines et des droits que l’Autriche avait dans leurs vallées, mettraient le même empressement à les leur restituer? Etait-il probable que ces intrépides et fiers montagnards, qui pouvaient désormais se passer de la protection de l’Empire, se conformeraient aux désirs de l’Autriche et à la volonté d’un souverain qui, ballotté par la fortune, assis sur un trône chancelant, promettait, sanctionnait, puis, ne reculant pas devant l’idée du parjure, se rétractait et faussait sa parole qui aurait dû être inviolable? Pouvait-on croire que les héros du Morgarten, dont le roi de Germanie avait si souvent imploré le secours contre ses ennemis avec lesquels il voulait maintenant se réconcilier en sacrifiant les Waldstetten, consentiraient à être les instruments de leur /231/ ruine et à se déshonorer? Non! les Confédérés étaient décidés: ils voulaient défendre et maintenir ce qu’ils avaient conquis 452 . Ce qui prouve, au reste, que les ducs d’Autriche ne s’attendaient point à une restitution volontaire de leur part, c’est que le comte Eberhard de Kibourg promit aux ducs, le 24 mars 1331, « de les assister avec ses gens, de tout son pouvoir, dans le Thurgau, dans le Zurichgau, dans l’Argau jusqu’au mont S. Gothard » — c’est-à-dire jusqu’au-delà de la vallée d’Urseren — « en Bourgogne jusqu’au lac de Lausanne, et dans leur comté de la Haute-Alsace. » 453
A cette époque le comte Albert de Werdenberg, beau-frère du comte Eberhard par Cathérine de Kibourg, était Landvogt ou préfet impérial dans les vallées de Schwyz, d’Uri et d’Unterwalden, qui eurent avec lui et avec l’abbé de Dissentis des démêlés sérieux, auxquels il ne fut pas facile de mettre fin de si tôt; car, malgré la convention d’Unterwalden et de Schwyz qui se promirent, en 1334 454 , un mutuel secours le cas échéant où leurs concitoyens refuseraient d’accéder à l’accommodement fait avec ces seigneurs, la réconciliation n’eut lieu qu’en 1339 455 , et la guerre civile faillit éclater dans les Waldstetten. Schwyz et Unterwalden craignaient, sans doute, qu’Uri n’agît d’une manière inconsidérée et ne suscitât de nouveaux ennemis aux confédérés.
Les habitants de la vallée d’Urseren, mouvante de /232/ l’abbaye de Dissentis, étaient en guerre avec ceux de la Léventine, et ils demandèrent du secours à leurs voisins d’Uri, qui l’accordèrent avec d’autant plus d’empressement qu’ils avaient déjà formé des relations avec cette vallée, qu’ils convoitaient, tant il leur importait d’être maîtres du passage du S. Gothard et d’avoir derrière eux une barrière que l’ennemi ne pût franchir. Déjà le 12 août 1331 la paix se fit entre les habitants de la Léventine et ceux d’Urseren, par la médiation du seigneur de Come et de ses frères, ainsi que d’Uri, de Schwyz, d’Unterwalden et de Zurich. Le S. Gothard resta fermé du côté de l’Italie.
Les ducs d’Autriche ne pouvaient conserver l’espoir de recouvrer les anciens fiefs de leur maison. L’empereur Louis, révoquant les concessions qu’il leur avait faites naguère, sanctionna de nouveau, le 24 décembre 1331, dans les formes usitées, les priviléges, les droits et les louables coutumes des hommes de Schwyz, d’Uri et d’Unterwalden 456 .
Les trois Vallées, grâce au courage, à la persévérance, à l’union de leurs habitants et à un concours de circonstances favorables, avaient échappé à de grands dangers, et se trouvaient en possession de ce qu’elles avaient tant désiré.
Lucerne, vivement inquiété, se pressait d’atteindre le but auquel les autres Waldstetten étaient parvenues. Les autorités de cette ville donnèrent des preuves de fermeté dans le péril; elles réitérèrent la défense d’assister aux plaids généraux du landgrave ou de son lieutenant, de comparaître devant un tribunal étranger, et, sous peine de sévère punition, de porter sa plainte à quelque autorité autre que le conseil, ou, selon les circonstances et la nature de la plainte, que le Schultheiss ou l’Amman. Lorsque von Ruoda, avoué /233/ de Rothenbourg, somma les Lucernois de dissoudre l’association du 13 octobre 1330, qu’il considérait comme hostile au suzerain, le conseil et la bourgeoisie (Menge) décrétèrent que quiconque obéirait à l’ordre de l’avoué serait sévèrement puni, ses biens confisqués et employés à la guerre pour la défense commune. Mais en même temps, pour éviter le pillage, le meurtre et l’incendie, en un mot tout ce qui pouvait compromettre leur avenir et gâter leur cause, ils interdirent tout attroupement, toute émeute.
Dans ce temps les armes d’Autriche et de Kibourg triomphaient des forces de Berne et de Soleure, et Lucerne était menacé d’une attaque du côté de l’Argovie autrichienne 457 . Le danger commun fit que Lucerne, Uri, Schwyz et Unterwalden cherchèrent leur salut dans une étroite union: l’expérience leur avait appris que l’union fait la force. Uri, Schwyz, Unterwalden mirent le sceau à leur indépendance /234/ en faisant leur premier acte de souveraineté, qui fut celui de l’admission de Lucerne dans leur confédération, le 7 novembre 1332. Ainsi se forma la Confédération des Quatre-Waldstetten 458 .
Voici les articles principaux de cet acte de fédération:
« Prévoyant des temps de crise, les vallées d’Uri, de Schwyz, d’Unterwalden, et Lucerne s’unissent afin de pouvoir d’autant mieux défendre leurs personnes et leurs biens: en conséquence ces quatre Waldstetten contractent une alliance perpétuelle. Les Lucernois respecteront les droits et la juridiction que les ducs d’Autriche, leurs seigneurs, exercent à Lucerne, mais ils maintiennent les droits, les priviléges et les coutumes de Lucerne et du Conseil de cette ville. Les hommes d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden, secouant toute domination de l’Autriche et du Landgrave, réservent à l’Empereur, leur suzerain, et au S. Empire romain les droits que ceux-ci possèdent dans les Waldstetten. Chacune de ces vallées se réserve dans l’enceinte de ses limites la juridiction à elle appartenant et ses coutumes. Les deux parties contractantes se garantissent réciproquement leurs droits et s’engagent à les protéger. Elles se promettent un mutuel secours, chacune à ses frais, en cas de danger ou d’agression de la part de l’ennemi commun. Les conditions de ce traité reposent sur le pacte de 1315. »
En vertu du jugement que prononcèrent les arbitres choisis par Lucerne et les ducs d’Autriche, le 18 juin 1336, l’alliance de cette ville avec les trois Vallées devait être nulle et non avenue 459 . Mais Lucerne parvint avec le temps à secouer entièrement le joug de l’Autriche. En 1454 les Lucernois demandèrent le renouvellement de l’acte de confédération de 1332, avec la substitution des mots l’Empereur et /235/ le S. Empire romain à ceux de ducs d’Autriche, ne reconnaissant le droit de juridiction qu’à la ville et au Conseil de Lucerne. Afin de donner à cet acte une vertu rétroactive, le second traité fut mis sous la date du premier 460 .
Passons en revue les principaux événements qui succédèrent à ce pacte d’alliance. Les embarras suscités par le roi de Bohême au chef de l’Empire et aux ducs d’Autriche avaient rendu nécessaire un rapprochement. L’empereur Louis et les ducs étaient réconciliés. Le malheur et des intérêts communs rendirent cette réconciliation sincère et cimentèrent l’union de ces princes. Il importait aux ducs de calmer dans les pays d’en-haut des esprits fortement agités. Ils atteignirent ce but par le traité de paix générale (Landfriede), conclu pour cinq ans, à Baden, le 20 juillet 1333 461 , auquel accédèrent non-seulement tous les pays héréditaires des ducs, mais encore Bâle, Zurich, Berne, et plusieurs autres villes et seigneurs, à l’exception des trois Vallées, de Lucerne, et de Glarus qui voulait aussi se soustraire à l’autorité de l’Autriche. En souscrivant ce traité, les Lucernois auraient renoncé à leur projet d’émancipation et annulé leur acte de confédération avec leurs voisins des Waldstetten, et ceux-ci auraient consenti au rétablissement d’une dynastie déchue de ses droits dans leurs vallées, avec laquelle ils ne voulaient entretenir que des relations propres à garantir, à affermir leur indépendance, plutôt qu’à la compromettre, ou même à la détruire.
L’Empereur, plus propre à se laisser mener par les événements qu’à les diriger, interposa sa médiation pour réconcilier Schwyz et Unterwalden avec les ducs, et nomma pour cet effet des commissaires 462 . Dix jours après, Otton fit une /236/ nouvelle concession à Lucerne 463 . Louis, par sa condescendance, trahissait la faiblesse de l’autorité impériale; Otton, en accordant de nouveaux avantages à Lucerne, montrait son impuissance à recouvrer ce qu’il avait perdu. La maison d’Autriche cédait peu-à-peu ce qu’elle ne pouvait conserver, et prenait les mesures que lui dictait la prudence pour sauver une partie de ses droits, décidée à profiter de la première conjoncture favorable pour rétablir son autorité partout où on l’avait méconnue. En passant sous silence le pays d’Uri, qui n’était pas compris dans le projet de conciliation des deux autres vallées avec l’Autriche, l’Empereur annulait la disposition du 10 février 1326, par laquelle Frédéric-le-Bel avait donné la vallée d’Uri à ses frères 464 ; mais il révoquait aussi ses propres diplômes et celui de Henri VII, qui reconnaissaient l’indépendance de Schwyz et d’Unterwalden de toute domination autrichienne. Les confédérés des Waldstetten n’étaient pas dupes d’une politique dont le caractère n’était pas la franchise et la bonne foi. Schwyz et Unterwalden, que dans le projet de paix on séparait ou détachait d’Uri dont ils étaient devenus les égaux par leur élévation au rang de fiefs immédiats de l’Empire, devaient soupçonner dans le traité qui se préparait quelque arrière-pensée, quelque vue secrète, l’intention de les faire rentrer sous la domination de l’Autriche, eux qui, en vertu des déclarations impériales ne devaient plus, ne voulaient plus être aliénés de l’Empire. Cette crainte, qui n’était que trop fondée, suffisait pour les faire renoncer à toute négociation. « Les hommes ne consentent pas à rentrer dans le moins, lorsqu’ils ont joui du plus» 465 . Uri pouvait s’attendre au moins à devoir reconnaître la juridiction du duc d’Autriche: cette vallée était intéressée à soutenir les deux autres. /237/
Lucerne, non content de ce qu’on lui avait accordé, voulait reconnaître la suzeraineté des ducs, à vrai dire une autorité nominale, leur réserver quelques droits dont ils seraient dépouillés plus tard, du reste, se gouverner seul. La paix ne pouvait s’établir: la guerre était inévitable. Les quatre Waldstetten devaient faire cause commune; c’était le moment de remplir les conditions du pacte de 1332. Un pour tous, tous pour un fut la devise de ces valeureux confédérés. Ils n’attendirent pas que l’ennemi vînt les trouver. Les Lucernois sortirent de leur ville avec leurs confrères d’Uri, de Schwyz et d’Unterwalden; ils marchèrent à la rencontre des Autrichiens, qu’ils pensaient surprendre; mais surpris eux-mêmes à Buochenas (ou Buonas, près de Hertenstein, non loin du lac de Zug), ils perdirent beaucoup de monde; cependant ils restèrent maîtres du champ de bataille 466 . L’issue de ce combat, peu favorable aux Lucernois, les rendit plus attentifs aux propositions de paix que leur faisait l’Autriche. Les arbitres des villes de Bâle, de Berne et de Zurich, choisis de part et d’autre pour poser les conditions de la paix entre Lucerne et l’Autriche, prononcèrent le 18 juin 1336 leur sentence, qui réservait aux Lucernois les priviléges qu’ils possédaient avant la guerre, et leur imposait l’obligation de reconnaître et de respecter la suzeraineté de Habsbourg-Autriche, de lui laisser la libre jouissance de ses droits, et de rompre le pacte d’association fait avec les trois Vallées 467 . J’ai déjà dit que ce pacte fut renouvelé.
A cet événement en succédèrent d’autres et diverses circonstances qui favorisèrent la cause des Confédérés, les embarras toujours croissants de Louis de Bavière, le /238/ désordre de l’Empire, la mort du duc Otton (16 ou 17 fév. 1339), et la bataille qui se livra le 21 juin 1339 près de la petite ville de Laupen, que défendait Jean de Bubenberg, où les Bernois et leurs alliés d’Uri, de Schwyz, d’Unterwalden, du Hasli, du Siebenthal (ou Simmenthal) et de Soleure, sous les ordres de Rodolphe d’Erlach, fils d’Ulric d’Erlach, qui 41 ans auparavant avait battu la noblesse sur le Donnerbuhl (ou im Jammerthal), défirent les nombreux bataillons des orgueilleux comtes, barons et chevaliers qui avaient juré la perte de Berne et pris l’engagement de réduire à la servitude les peuples et les villes qui secouaient le joug de leurs maîtres. Cette journée fut fatale à la maison d’Autriche et à la noblesse, qui fut moissonnée sur ce champ de bataille.
Le nombre des confédérés s’accrut rapidement. Le duc Albert, ses successeurs et des empereurs même leur firent une guerre infructueuse. La liberté s’assit triomphante au sein de l’Helvétie et protégea de son égide cette terre sacrée dont elle fit son asile.
Après avoir assisté à la naissance des libertés des Waldstetten, nous en avons suivi le développement jusqu’au jour où l’indépendance de ces vallées fut sanctionnée par leur premier acte de souveraineté, qui couronna l’œuvre des Confédérés. La révolution de ces contrées était accomplie: elle eut un long retentissement en Europe. Qu’elle est grave, qu’elle est imposante, qu’elle est belle et féconde en leçons l’histoire des pâtres des Alpes, qui donnèrent au monde moderne l’exemple de ce que peut une poignée d’hommes au cœur généreux, unis par une sainte concorde, fortifiés par les dangers et les revers qui abattent si facilement des ames ordinaires. Il ne s’attache ni moins de poésie, ni moins de célébrité à l’existence de ces petites sociétés politiques de nos montagnes qu’à celle de grands états. Leur histoire a un caractère imposant qui manque à celle de maint empire. Elle est en quelque sorte l’histoire de la liberté humaine. /239/
Les habitants d’Uri, de Schwyz, d’Unterwalden, en secouant le joug de la servitude que jadis la main du plus fort leur avait imposé, s’élevèrent à la dignité de l’homme. En s’opposant énergiquement à une législation antisociale, ils défendirent les droits de l’humanité. C’est à l’admirable persévérance, au courage héroïque de ces montagnards que nous devons notre existence politique et l’avantage d’occuper parmi les nations européennes un rang honorable. Ces hommes intrépides, rompant les liens de l’esclavage, affranchirent leur pays de la domination étrangère, frayèrent à leurs voisins le chemin de l’indépendance, et léguèrent à leurs descendants le bien le plus précieux pour l’homme qui sait en jouir avec sagesse, la liberté.
Nous aimons à vanter la gloire de nos pères: nous sommes fiers de la liberté qu’ils nous ont acquise. N’oublions pas que la confiance en Dieu, l’amour de la vertu et l’union fraternelle peuvent seuls nous la conserver. Je crois voir un de ces graves républicains de l’antiquité sortir de son tombeau; je crois entendre sa voix sévère qui nous dit: « Fils de l’Helvétie, étudiez le passé, lisez l’histoire pour apprendre a connaître la vie des peuples et puiser dans leur destinée d’utiles leçons. Voyez ce que furent, voyez ce que devinrent les républiques de la Grèce et la république romaine. Cherchez les causes de leur grandeur et de leur décadence: évitez les maux qui leur furent si funestes. La patrie que vous ont laissée vos ancêtres, les confédérés du Grütli, les héros du Morgarten, de Laupen, de Sempach, de Morat, cette patrie, que la divine Providence a bénie d’une manière signalée, sera forte si vous êtes vertueux et unis, faible si vous renoncez à la vertu et que l’égoïsme vous divise. Car la concorde fait la force des petits états, la discorde détruit même les plus puissants! » 468